Monthly Archives: March 2016
Spécial 8 mars : Ces femmes qui font des métiers d’hommes
 L’univers mâle s’ouvre de plus en plus aux Sénégalaises. Mécanicienne, ingénieur, taxiwoman, gardienne, policière… elles sont nombreuses aujourd’hui à boxer dans la même catégorie que les hommes. Reportage.
L’univers mâle s’ouvre de plus en plus aux Sénégalaises. Mécanicienne, ingénieur, taxiwoman, gardienne, policière… elles sont nombreuses aujourd’hui à boxer dans la même catégorie que les hommes. Reportage.
Les Sénégalaises ne militent pas que pour la parité. Aujourd’hui, elles sont nombreuses à travailler pour l’égalité professionnelle. Taxiwomen, mécanicienne, ingénieur, camionneuse, elles sont nombreuses à investir des métiers jusqu’ici exclusivement masculins. Petit tour au garage mécanique «Femme-auto», sis à Liberté VI Extension.
Madame Bangoura, 34 ans, née Anna Guèye, est l’assistante technique dudit garage. Mère de famille, ce petit bout de femme, a blanchi sous le harnais au bataillon des matériels militaires du Sénégal. Diplômée d’un Cat 1 et 2, elle a intégré ce garage de 20 employés dont 8 femmes, en août 2008, à la suite d’une demande d’emploi. Vêtue d’une combinaison dont il est difficile de reconnaitre les couleurs à cause de la noirceur, Anna, comme l’appelle les intimes, a fait de son travail une religion. Casquette bien vissée sur la tête, elle avoue sa passion pour les “trucs d’hommes” depuis le bas âge. Petite, elle apprend à bricoler auprès de son frère ainé alors mécanicien. Très vite, elle est prise par le virus et décide plus tard d’en faire son gagne-pain. Malgré les difficultés rencontrés et les préjugés sur ce “genre de métiers”, Anna ne se décourage pas pour autant. Le plus important pour elle, reste sa passion pour le métier. Et surtout, de ne pas tendre la main. Car, pense-t-elle, il n’y a plus de métier exclusivement réservé aux hommes ou aux femmes. La mécanicienne se dit convaincu que tout ce que l’homme peut faire, la femme en a la capacité aussi.
C’est à l’âge de 12 ans que la jeune femme a arrêté ses études après avoir obtenu son Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee), pour se consacrer à ce métier. Native de Mont Rolland (Thiès) , la jeune dame, qui se dit femme au foyer accompli, a le soutien de son époux.
Tout sauf Imam
Khady Diatta, plus connue sous le nom de Madame Badji, est aussi une mécanicienne au niveau du garage «Femme-auto». Abondant dans le même sens que sa collègue Anna Guèye, Khady n’est pas le genre de femme qui pense que la mécanique est un métier d’homme. Pour elle, les femmes peuvent faire tous les métiers sauf la profession d’imam. Et avec l’évolution du monde, il n’y a plus de métiers réservés à un sexe. De l’avis de la jeune mécanicienne, beaucoup de femmes ont intégré le métier à cause de l’évolution de la société et de la technologie. Comme Anna, Khady est aussi une passionnée de la mécanique. Elle dit avoir appris le métier au Centre de formation professionnelle Sénégal-Japon, où elle a obtenu son Brevet de technicien industriel (BTI) en 2009. Spécialisée en mécanique auto, Khady est fière de son métier et le pratique depuis 7 ans sans aucune gène. Khady, mère de trois (3) enfants, la trentaine bien sonnée, travaille depuis 4 ans dans le garage. Son mari, enseignant en électromécanique au Centre de formation Sénégal-Japon, le soutient.
«Il n’y a pas de sot métier»
A l’opposé de Khady et Anna, Rokhaya Ndiaye, quant à elle, a choisi d’être taxi-sister par manque de possibilité. Rencontrée au centre-ville, la jeune mère, avec un visage serein et respectueux, n’aime point croiser les bras et attendre un emploi. Diplômée d’un Baccalauréat de série L, elle dit avoir mis un terme à ses études par manque de moyens car elle est un soutien de famille. Après avoir tapé à toutes les portes en vain, elle a décidé d’embrasser ce métier. A l’instar de Khady et Anna, Rokhaya ne croit pas à des métiers réservés à un sexe. Sa conviction est qu’il n’y a pas de sot métier. Taille moyenne avec un teint dépigmenté, cette habitante du quartier populaire de Pikine se dit fière d’exercer le métier de taxi-sister, en dépit des nombreuses difficultés qui plombent leur travail. Chaque matin à 8 heures, Rokhaya roule, après avoir fini son travail de ménagère. A 13 heures, elle marque une pause pour servir à manger aux enfants avant de reprendre à 15 heures pour finir à 20 heures.
Trouvée dans une station service de la place, située sur l’Avenue Bourguiba, A.D ( nom d’emprunt), pompiste, pratique cette profession depuis bientôt un an. Le regard méfiant (car elle a peur de parler à la presse sans l’autorisation de son patron), elle croit que l’avenir de ce métier se trouve entre les mains des femmes. Car, estime-t-elle, la gente féminine attire plus la clientèle que les hommes.
Femme ingénieure
Thérèse Mendy est aussi une de ces femmes qui sortent de l’ordinaire. Célibataire, elle est stagiaire en qualité de superviseur de chantier dans une entreprise de Bâtiment et travaux public (Btp) de la place. Thérèse dit être une passionnée de génie civil depuis son jeune âge. Trouvée dans son chantier à l’unité 9 de Keur Massar, la jeune femme, veut encourager les femmes à s’investir dans la profession pour bousculer les préjugés.
Un sociologue de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar explique cette tendance des femmes à embrasser les métiers jusqu’ici dévolus aux femmes s’explique par le fait que «le monde évolue d’une manière rapide”. “Avec le développement de la technologie, les femmes veulent faire tout ce que les hommes faisaient. A cela, s’ajoute le chômage. De nos jours, c’est seulement la fonction d’imam que la femme ne peut pas faire. Je pense qu’il n’existe plus de métiers réservés uniquement à un sexe en dehors de diriger une prière», a-t-il soutenu.
Auteur: Cheikhou AIDARA – Seneweb.com
Les inégalités hommes-femmes perdurent dans le monde du travail
 Les filles réussissent mieux que les garçons à l’école en général. Mais cette bonne performance ne se retrouve pas dans la sphère professionnelle.
Les filles réussissent mieux que les garçons à l’école en général. Mais cette bonne performance ne se retrouve pas dans la sphère professionnelle.
A l’occasion de la journée internationale de la femme, ce mardi, l’Insee s’est penché sur les inégalités entre les deux sexes. Première constatation des experts de l’institut : dans l’Hexagone, « les filles réussissent mieux leur scolarité que les garçons, qu’il s’agisse de son déroulement, des compétences acquises, des résultats aux examens ou du taux de diplômés ».
Ainsi, le taux de réussite au baccalauréat était de 93,2 % pour les filles en 2013 et de seulement 90,8 % pour les garçons. De la même façon, en 2011, 38,1 % des femmes âgées de 25 à 54 ans étaient diplômées du supérieur alors que, chez les hommes, ce chiffre n’était que de 32 %.
La Bretagne se distingue
Deux régions françaises se singularisent toutefois : « En Bretagne, et dans une moindre mesure dans les Pays de la Loire, les écarts de réussite scolaire entre filles et garçons sont plus faibles qu’en moyenne », remarquent les auteurs de l’étude.
Parmi les autres régions, la Corse se distingue mais dans la mauvais sens, cette fois-ci puisque les différences de réussite scolaire entre les filles et les garçons y sont plus importantes. Pourtant, c’est une des régions où le taux de réussite au baccalauréat est le plus élevé pour les garçons et la Corse est même la région de France où le taux de réussite au bac des filles est le meilleur de France.
Fortes différences salariales
Mais, si les femmes réussissent mieux que les hommes à l’école et si la proportion de diplômées dans la population y est plus élevées, cela ne se retrouve pas dans le monde du travail. D’abord, « les hommes occupent plus souvent un poste à la hauteur de leur niveau de diplôme », notent les experts de l’Insee. En 2011, 26,6 % des hommes occupaient un emploi dont les caractéristiques exigées étaient inférieures à leur diplôme tandis que cette situation concernait 32,2 % des femmes. Ensuite, le taux de chômage des femmes est supérieur à celui des hommes. Enfin, le salaire des hommes est en moyenne supérieur de 19,4 % à celui des femmes.
Bref, la réussite scolaire des filles par rapport à celle des garçons, résultante du système éducatif, ne se matérialise pas dans la sphère professionnelle. « Les différences entre femmes et hommes sur le marché du travail sont aussi liées à des écarts de situation familiale, de modes de cohabitation et de transports », selon l’Insee. Ainsi, les jeunes femmes quittent plus tôt le domicile parental que les jeunes hommes. Près de 30 % des garçons âgés de 25 ans vivaient encore chez leurs parents en 2011 alors que seules 16,7 % des femmes y résidaient à cet âge. Les femmes sont aussi parents plus jeunes et surtout vivent plus souvent seules ou en situation de monoparentalité. En 2011, 6,8 % des femmes étaient à la tête d’une famille monoparentale alors que ce rôle n’était dévolu qu’à 1,6 %hommes.
La politique pointée du doigt
Autre domaine dans lequel les inégalités sont fortes, la politique. « Dans le monde du travail, les femmes sont moins souvent cadres dirigeantes, mais également dans la vie politique », pointe l’étude. « Les hommes sont toujours majoritaires parmi les conseillers municipaux (58 % en 2014 contre 63 % en 2008) » et « les maires restent des hommes dans 83 % des communes de France en 2014 ». La loi de 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, municipaux et communautaires, et qui impose la parité dans les listes électorales n’a pas permis d’atteindre les objectifs en matière d’égalité. Et pour cause : elle ne s’applique que pour les communes de plus de 1.000 habitants.
lesechos.fr
8 mars: La présidente d’AFCF déplore la situation des femmes
 La présidente de l’Association des Femmes Chefs de Familles (AFCF)- Mme Aminetou Mint Moctar, a dressé un tableau sombre de la situation des femmes dans le pays, au cours d’une conférence/débat organisée mardi à l’occasion de la célébration de la fête internationale du 08 mars.
La présidente de l’Association des Femmes Chefs de Familles (AFCF)- Mme Aminetou Mint Moctar, a dressé un tableau sombre de la situation des femmes dans le pays, au cours d’une conférence/débat organisée mardi à l’occasion de la célébration de la fête internationale du 08 mars.
Listant les problèmes auxquels sont confrontées les mauritaniennes, Mme Mint Moctar a dénoncé « la recrudescence des actes de violence, un taux élevé et en constante hausse des cas de divorce, passés de 49% à 52% en l’espace de quelques années, selon les estimations fiables de plusieurs institutions, la délinquance juvénile, une crise économique dont les effets se font beaucoup plus sentir chez les femmes ».
La militante des droits humains a également déploré des cas de violences sexuelles tues et dont les auteurs restent impunis.
Elle a toutefois noté « certaines avancées » à travers l’adoption d’un nouveau cadre judiciaire prévoyant des peines sévères à l’encontre des individus reconnus coupables de violence contre les femmes.
le calame
Libre Expression. Le Président de la République est tenu par la Constitution de pacter avec quiconque dans l’intérêt supérieur du pays et la stabilité de ses citoyens
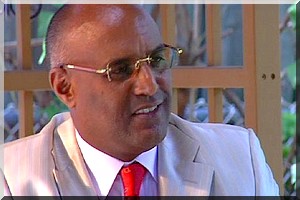 Maître Takioullah Eidda – Depuis quelques jours, certains allèguent que selon des documents, qui seraient saisis lors de la présumée élimination d’Oussama, et rendus publique par l’Office of the Director of National Intelligence (ODNI), la Mauritanie aurait été tentée de ne pas user de son droit de poursuite contre la nébuleuse d’Al-Qaïda si celle-ci, et ses groupes affiliés, évitent la Mauritanie et s’engagent à ne pas commettre d’actes de violence sur son sol.
Maître Takioullah Eidda – Depuis quelques jours, certains allèguent que selon des documents, qui seraient saisis lors de la présumée élimination d’Oussama, et rendus publique par l’Office of the Director of National Intelligence (ODNI), la Mauritanie aurait été tentée de ne pas user de son droit de poursuite contre la nébuleuse d’Al-Qaïda si celle-ci, et ses groupes affiliés, évitent la Mauritanie et s’engagent à ne pas commettre d’actes de violence sur son sol.
Évidemment, nous sommes ici dans le conditionnel, conditionné à la véracité de cette histoire, à dormir debout, notamment à son contenu, mais aussi à son contenant et, bien sûr, à la source de sa divulgation.
Mais à supposer, pour les fins de la discussion, que cette information repose sur un minimum de crédibilité, il n’en demeure pas moins que la Mauritanie a l’obligation constitutionnelle d’agir de la sorte pour défendre la stabilité au pays et la paisibilité de ses citoyens, et ce, compte tenu de la situation chaotique dans laquelle se trouvait son armée et la nature des rapports de forces avec ses ennemis.
I- Forces de défenses et de sécurité quasi-inexistantes avant 2012
La Mauritanie de feu Mokhtar Ould Daddah n’existait que dans l’imagination subjective de ses soutiens nostalgiques et inconditionnés. Tellement elle était faible, pauvre en ressources humaines, cruellement sous développée, sans moyens, sans administration structurée, sans perspective et, bien évidemment, sans armée.
Malheureusement, l’arrivée des militaires au pouvoir n’a fait qu’empirer cette douloureuse réalité. Et pour cause: chaque militaire qui prenait le pouvoir n’avait de souci que d’affaiblir les institutions, particulièrement celle de l’armée, dans le but de faire le vide autour de lui et enfin de compte garder son emprise au sommet du pouvoir.
Fragilisée, clochardisée, délaissée et affamée, l’armée mauritanienne n’avait d’existence réelle que le nom et le mythe. D’ailleurs, les coups d’État de 1978, 1981, 1984, 2003 & 2005 l’avaient largement démontré.
Tout comme l’avaient démontré les actes terroristes qui ont suivi, à savoir celui du 24 décembre 2007, veille de Noël, où quatre touristes français sont froidement assassinés. Deux jours plus tard, trois soldats mauritaniens sont tués dans la base militaire de Al-Ghallaouia.
Actes après lesquels les organisateurs du Paris-Dakar décident, le 5 janvier 2008, d’annuler la course «mythique». Dans la nuit du 1er février 2008, le « V.I.P », la plus grande boîte de nuit de Nouakchott, et l’ambassade d’Israël mitoyenne, sont pris pour cible, une Française et deux Franco-mauritaniens blessés. Puis, l’enlèvement de trois espagnols sur l’axe Nouakchott-Nouadhibou. Ces attaques ont été revendiquées par la nébuleuse d’Al-Qaïda.
Et la cerise sur le gâteau de la barbarie fut servie le 14 septembre 2008 à Tourine, où 11 militaires de la deuxième région, incluant le capitaine Dié ould Abidine, sont tombés dans une embuscade tendue par un groupe se réclamant de la mouvance d’Al-Qaïda. Et pour l’anecdote suite à l’attaque de Tourine, des privés avaient été appelés à fournir la logistique pour les unités militaires parties en renfort auprès des soldats tombés au champ d’honneur, tellement l’armée ne disposait d’aucune ressource!
Alors, comment la Mauritanie dans un été pareil pouvait entrer en guerre frontale contre ces groupes d’Al-Qaïda, lesquels étaient lourdement armés, aveuglés par les discours théologiques wahabistes et excessivement riches, grâce aux financements de certains pays du Golf et aux rançons payées par les pays occidentaux en échange de leurs ressortissants pris en otage? Comme on dit: «toujours braves ceux qui ne sont pas dans la bataille» ou encore «ceux qui sont dans les salons fastueux de Nouakchott».
II- Les rapports de force doivent dicter la nature du comportement
Quoi qu’on dise, le fait de discuter avec son ennemi, qu’il nous est impossible de vaincre ou incapable d’affronter, est un acte de lucidité, de sagesse et de réalisme.
D’ailleurs, tous les pays occidentaux ont négocié, directement ou indirectement, avec Al-Qaïda! Les pays voisins aussi. On a qu’à citer l’Algérie (la loi sur l’amnistie), le Mali, le Niger, le Bourkina, le Tchad … et j’en passe.
Car, confronter un ennemi fantôme, n’est pas une tâche facile: le Nigéria et le Tchad l’ont appris à leurs dépends et, d’ailleurs, continuent aujourd’hui à en payer le lourde prix!
Quant à moi, si l’information attribuée à l’Office of the Director of National Intelligence (ODNI) s’avérait le moindrement crédible, cela me rassure sur le leadership en Mauritanie, car il démontre, par cet acte, un degré passablement avancé, de bon jugement, de lucidité, de réalisme, voire de patriotisme, au cœur desquels se trouve la quiétude des citoyens, la paix et la stabilité du pays.
Après tout, tout au long de l’Histoire, toutes les grandes puissances de ce monde ont pacté avec le diable dans l’intérêt supérieur de leurs pays et le bien-être de leurs nations.
Conclusion
Dans le but de garantir l’intégrité du territoire et la protection des citoyens, le Président mauritanien est tenu par un devoir constitutionnel qui l’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires, eu égard aux circonstances, y compris négocier avec des groupes qualifiés de terroristes ou descendus de la planète Mars!
Évidement, cela ne veut pas dire qu’il est d’accord avec leurs méthodes, leurs idées ou leurs objectifs, mais uniquement pour gérer une situation de crise et d’urgence dans lesquelles des vies humaines sont en danger éminent, et contre lesquelles il ne dispose pas des moyens nécessaires pour les confronter autrement.
Maître Takioullah Eidda, avocat
Québec, Canada
cridem
Plus de visa entre le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad
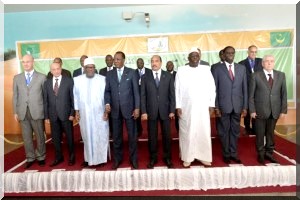 Les ministres de défense et de la sécurité des pays membres du G5 Sahel ont décidé vendredi soir de créer de “groupes d’action rapide avec l’appui technique de la France et de l’Espagne et le financement de l’Union Européenne”.
Les ministres de défense et de la sécurité des pays membres du G5 Sahel ont décidé vendredi soir de créer de “groupes d’action rapide avec l’appui technique de la France et de l’Espagne et le financement de l’Union Européenne”.
“Ces groupes, composés d’une centaine d’hommes, bien entraînés et très mobiles se déploieront dans les zones où opèrent les terroristes. C’est un exemple qui a réussit en Espagne dans le cadre de la lutte contre les séparatistes de l’Etat”, a expliqué le secrétaire permanent du G5 Sahel Najim Elhadj Mohamed.
“Il faut maintenant que les états adressent les requêtes pour que le financement se mettent en place” a ajouté M Mohamed.
Les ministres ont aussi décidé de “l’implantation en Mauritanie du Centre sahélien d’analyse des menaces et d’alerte précoce et la création de l’école de guerre sous l’appellation collège de défense du G5 Sahel”.
Enfin les ministres décident de “la mise en œuvre de la suppression des visas selon les modalités suivantes: pour les passeports diplomatiques et de service, des actes administratifs pris par chaque Etat permettront à leurs détenteurs de circuler librement entre les cinq états et pour les passeports ordinaires, des rencontres bilatérales entre les ministres des affaires étrangères et de la sécurité se tiendront pour la prise des dispositions en vue de la suppression effective des visas sous trois mois”.
“Le problème se pose juste pour le Tchad et la Mauritanie qui ne sont pas membres de la Cedeao. Sinon la libre circulation est déjà effective entre le Burkina, le Mali et le Niger” explique le ministre tchadien de la sécurité Ahmat Mahamat Bâchir.
Source: Lepaystchad
Malijet




