Category Archives: Agora
“Samba Thiam, le diable de l’imaginaire maure : entre peur de la vérité et stratégie de déni”
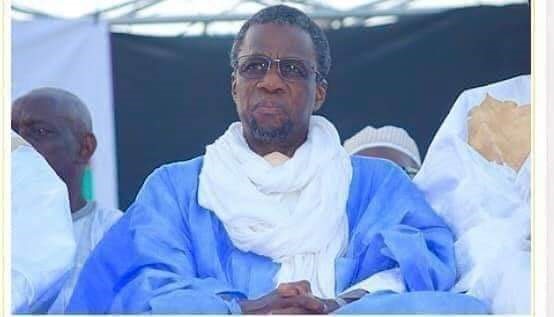
Dans l’imaginaire collectif de certains milieux maures, Samba Thiam est perçu non pas comme un simple opposant, mais comme une figure quasi diabolique. Ce phénomène, loin d’être anodin, est révélateur d’un système profondément enraciné de peur, de déni, de domination et de rejet de toute remise en question. Il ne s’agit pas ici de critiquer un groupe dans sa globalité, mais d’analyser un imaginaire construit, alimenté et utilisé politiquement, au service de l’ordre établi.
Une diabolisation construite dès les premières heures
Dès l’apparition des FLAM et la publication du Manifeste du Négro-Mauritanien opprimé en 1986, le pouvoir mauritanien a mobilisé toute une stratégie de peur dans les milieux arabo-berbères pour faire croire que Samba Thiam et ses compagnons voulaient « détruire la nation », « diviser le pays », « attaquer l’arabité » ou encore « venger les Noirs contre les Maures ». On a sciemment transformé une dénonciation du racisme d’État en discours haineux pour mieux effrayer la majorité arabo-berbère et la souder autour du pouvoir dominant.
Ainsi, Samba Thiam est devenu le symbole vivant de ce que le système ne voulait ni entendre ni reconnaître : la vérité sur l’apartheid mauritanien.
Une peur irrationnelle face à la remise en question
Pourquoi cette peur ? Parce que Samba Thiam ne joue pas selon les codes. Il ne demande pas la charité, il exige la justice. Il ne supplie pas, il accuse avec preuves et intelligence. Il ne s’excuse pas de défendre la dignité des siens. Et dans une société où le pouvoir dominant attend souvent des opprimés qu’ils soient silencieux, reconnaissants, et dociles, un Noir qui parle haut, fort, et clair devient dangereux.
Il incarne une rupture avec le récit officiel de l’unité nationale et de l’harmonie raciale — récit profondément ancré dans l’imaginaire maure, mais totalement déconnecté de la réalité vécue par les communautés noires.
Un refus de la vérité travesti en légitime défense
Samba Thiam ne fait pas peur parce qu’il ment. Il fait peur parce qu’il dit ce que d’autres n’osent pas dire, avec constance, rigueur et courage. Ceux qui le diabolisent ne le réfutent pas sur le fond. Ils ne répondent pas à ses arguments. Ils le caricaturent, l’accusent, l’excluent. C’est plus facile que de se remettre en question, que de reconnaître les crimes du passé, que d’admettre l’existence d’un système de domination.
Ainsi, dans certains cercles, traiter Samba Thiam de « raciste », de « communautariste », ou de « fauteur de trouble » permet d’éviter le débat de fond. On se protège de la vérité en l’accusant d’extrémisme. C’est une stratégie classique d’inversion des rôles, où l’agresseur se dépeint en victime pour éviter de faire face à sa propre histoire.
Une fracture à surmonter pour construire une Mauritanie juste
Cette image de Samba Thiam comme figure du mal dans l’imaginaire maure est un obstacle à la réconciliation nationale. Tant que des pans entiers de la société continueront à rejeter l’autre dès qu’il parle de ses droits, à diaboliser toute voix noire exigeante, il n’y aura ni paix durable ni unité réelle.
Le dépassement de cette fracture passe par :
• L’ouverture d’un dialogue historique sincère ;
• La reconnaissance des souffrances vécues ;
• La fin des amalgames entre lutte pour l’égalité et haine de l’autre.
Il faut cesser d’avoir peur de ceux qui demandent justice. Car ce ne sont pas eux qui menacent la nation, mais bien ceux qui refusent obstinément de reconnaître les injustices sur lesquelles elle a été construite.
le diable n’est pas toujours celui qu’on croit
Samba Thiam n’est pas le diable. Il est le miroir que certains refusent de regarder. Il est l’interlocuteur qu’un pouvoir dominateur préfère caricaturer plutôt que d’écouter. Il est la mémoire vivante d’un peuple qu’on a voulu effacer. Et tant que l’imaginaire maure restera prisonnier de cette peur fabriquée, la Mauritanie ne pourra pas avancer vers une nation apaisée, égalitaire et véritablement unie. Rétablir la vérité sur Samba Thiam, c’est donc un pas nécessaire pour libérer aussi l’imaginaire maure de ses propres chaînes.
Mamadou Sy.
سامبا تيام، شيطان المخيال المور: بين الخوف من الحقيقة واستراتيجية الإنكار
في المخيال الجماعي لبعض الأوساط المور، لا يُنظر إلى سامبا تيام كمجرد معارض، بل كرمز شيطاني تقريبًا. هذه الظاهرة، البعيدة كل البعد عن أن تكون تافهة، تكشف عن نظام متجذر من الخوف، والإنكار، والهيمنة، ورفض أي شكل من أشكال المساءلة. لا يتعلق الأمر هنا بانتقاد جماعة بأكملها، بل بتحليل مخيال تم بناؤه وتغذيته واستغلاله سياسيًا في خدمة النظام القائم.
شيطنة ممنهجة منذ البدايات
منذ ظهور حركة FLAM ونشر بيان الزنجي الموريتاني المضطهد عام 1986، أطلق النظام الموريتاني حملة تخويف منظمة في الأوساط العربية-الأمازيغية، لترويج فكرة أن سامبا تيام ورفاقه يريدون “تدمير الوطن”، “تقسيم البلاد”، “الهجوم على العروبة”، أو حتى “الانتقام للسود من المور”. لقد تم عمداً تحويل إدانة للعنصرية المؤسسية إلى خطاب كراهية، بهدف ترهيب الأغلبية العربية-الأمازيغية وتوحيدها حول السلطة المهيمنة.
وهكذا، أصبح سامبا تيام رمزًا حيًا لما لا يريد النظام سماعه أو الاعتراف به: الحقيقة حول الأبارتايد الموريتاني.
خوف غير عقلاني من المساءلة
لماذا كل هذا الخوف؟ لأن سامبا تيام لا يلعب وفق القواعد التقليدية. لا يطلب الصدقة، بل يطالب بالعدالة. لا يتوسل، بل يتهم، بالحجج والذكاء. لا يعتذر عن الدفاع عن كرامة شعبه. وفي مجتمع تتوقع فيه السلطة المهيمنة من المضطهدين أن يكونوا صامتين، ممتنين، وخاضعين، يصبح صوت زنجي يتكلم بجرأة ووضوح أمرًا خطيرًا.
إنه يمثل قطيعة مع السرد الرسمي للوحدة الوطنية والانسجام العرقي — ذلك السرد المتجذر في المخيال المور، لكنه مفصول تمامًا عن واقع المجتمعات الزنجية.
رفض للحقيقة يُقدّم كدفاع مشروع
سامبا تيام لا يُخيف لأنه يكذب، بل لأنه يقول ما لا يجرؤ الآخرون على قوله، بثبات ودقة وشجاعة. من يشيطنونه لا يردون على مضمون أقواله. لا يناقشون حججه. بل يشوهون صورته، ويتهمونه، ويقصونه. فذلك أسهل من مواجهة الذات، أو الاعتراف بجرائم الماضي، أو الإقرار بوجود نظام للهيمنة.
وهكذا، في بعض الدوائر، يُوصم سامبا تيام بـ”العنصرية”، أو “الطائفية”، أو “إثارة الفتنة” كوسيلة لتجنب النقاش الجاد. يُستخدم اتهامه بالتطرف كدرع ضد مواجهة الحقيقة. إنها استراتيجية كلاسيكية لقلب الأدوار، حيث يقدم المعتدي نفسه كضحية لتجنب مواجهة تاريخه الخاص.
شرخ يجب تجاوزه لبناء موريتانيا عادلة
هذه الصورة التي تُقدّم سامبا تيام كرمز للشر في المخيال المور تشكل عقبة أمام المصالحة الوطنية. ما دامت قطاعات واسعة من المجتمع تواصل رفض الآخر بمجرد أن يتحدث عن حقوقه، وتشيطن كل صوت زنجي يطالب بالإنصاف، فلن تكون هناك لا سلام دائم ولا وحدة حقيقية.
تجاوز هذا الشرخ يمر عبر:
• فتح حوار تاريخي صادق؛
• الاعتراف بالمعاناة التي عاشها الآخرون؛
• إنهاء الخلط بين النضال من أجل المساواة وكراهية الآخر.
يجب أن نتوقف عن الخوف من الذين يطالبون بالعدالة. فهؤلاء ليسوا هم من يهدد الأمة، بل من يرفضون بإصرار الاعتراف بالظلم الذي تأسست عليه.
الشيطان ليس دائمًا من نظنه كذلك
سامبا تيام ليس الشيطان. إنه المرآة التي يرفض البعض النظر فيها. إنه المحاور الذي تفضل السلطة المتسلطة تشويهه بدل الاستماع إليه. إنه الذاكرة الحية لشعب حاول البعض محوه. وطالما ظل المخيال المور أسير هذا الخوف المصطنع، فلن تتمكن موريتانيا من التقدم نحو أمة هادئة، عادلة، وموحدة بحق. تصحيح الصورة عن سامبا تيام هو بالتالي خطوة ضرورية لتحرير المخيال المور من قيوده الذاتية.
LIVRE BLANC : dialogues, leurres et lueurs. Par Pr ELY Mustaphav – DEDICACE
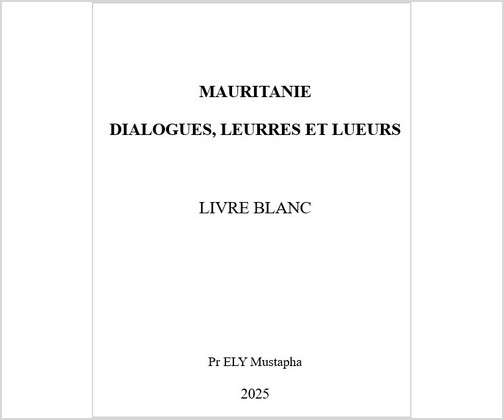
Pr. ELY Mustapha — « Mon fils était brillant, il aimait l’école et voulait devenir ingénieur. Le jour de l’accident, il était si content car il devait recevoir un prix pour ses bons résultats. Puis le toit s’est effondré…”
A Mme Aïcha, mère de Moussa,
l’un des enfants tués lors de l’effondrement de l’école de Dar El Barka
Victime d’une gouvernance qui se perpétue par le Dialogue.
Un Livre, des illusions et de l’espoir
J’introduis, ici, ce livre blanc commencé il y a bien longtemps et muri par des articles et essais successifs qui, publiés sur mon blog et dans les médias nationaux et internationaux en constituent la chaine et la trame.
Aujourd’hui et au crépuscule d’un paradoxe, soit celui d’une nation qui, depuis près d’un demi-siècle, cultive l’art du dialogue comme rituel politique, étouffe méthodiquement la voix de son peuple, je publie ce livre blanc.
Ce livre blanc n’est ni une chronique de plus sur les échecs mauritaniens, ni un pamphlet vengeur.
C’est une radiographie que j’ai voulue sciemment critique, du fait de la gravité de la situation, d’un système où le dialogue, promesse de démocratie, s’est mué en outil de domination.
Imaginez un paysage politique où chaque décennie apporte son lot de tables rondes, de concertation nationale, de feuilles de route – des mots nobles vidés de leur sens.
Derrière ces termes se cache une réalité brutale : depuis le coup d’État de 1978, la Mauritanie a connu 14 processus de dialogue officiels, tous aboutissant au même scénario. Des opposants se transforment en complices, des révoltes s’éteignent dans des compromis truqués, et le peuple, spectateur impuissant, voit ses espoirs s’évaporer au rythme des déclarations solennelles.
Je pars d’un constat cruel : 45 ans de dialogues n’ont produit aucune alternance politique, aucune réforme structurelle, aucune justice pour les maux qui frappent le pays et ses habitants et moins encore pour ceux criants des victimes de l’esclavage ou des purges ethniques. Pire, ils ont permis à des régimes successifs de se recycler en « garants du consensus », tout en maintenant intactes les racines de l’autoritarisme.
Ce travail s’ancre dans les récits des oubliés : ces jeunes diplômés au chômage qui ironisent sur les « accords entre costards », ces femmes haratines exclues des négociations, ces opposants emprisonnés pour avoir refusé de jouer la comédie du dialogue.
Notre approche combine trois grilles de lecture :
1. L’histoire critique : De la junte d’Ould Salek (1978) aux « Assises pour la Réconciliation» de 2023, je retrace chaque dialogue comme un épisode d’une série tragique où le pouvoir réécrit les règles du jeu à son avantage. Pour entretenir la mémoire contre l’oubli, pour les jeunes générations et pour l’Histoire qui est le premier témoin des errements humains.
2. Le miroir africain : En confrontant l’expérience mauritanienne à celles d’autres pays, tels le Tchad, le Congo pays que j’ai visités, je montre des mécanismes communs de confiscation du politique par les élites.
3. La théorie politique : Toute démarche pratique qui ne puisse être éclairée par un processus intellectuel théorique éclairant ses constats aux fin de compréhension et de partage est limitée Aussi de la « démocratie autoritaire » (Levitsky & Way) au concept de «résilience autoritaire » (Heydemann), j’essaie de décrypter comment les régimes mauritaniens ont détourné les outils démocratiques pour survivre.
Mais ce livre blanc va plus loin. Il démontre comment ces pseudo-dialogues ont hypothéqué le développement du pays :
– En détournant l’attention des urgences sociales (31% de pauvreté, 25% de chômage des jeunes).
– En légitimant un système économique de prédation (50% des richesses contrôlées par 0.3% de la population).
– En alimentant les fractures identitaires (discriminations persistantes contre les Haratines et les Négro-Africains, qui apparaissent tant dans la répartition des richesses que dans les droits aux emplois publics).
Ce travail est aussi un acte de foi. Je crois qu’en démontant les rouages de cette machinerie du faux-semblant, je participe humblement à éclairer la nécessité de renforcer une véritable démocratie par le bas.
Les pages qui suivent ne se contentent pas de critiquer positivement – elles esquissent les contours d’une citoyenneté consciente, nourrie par les leçons amères du passé et les aspirations d’une génération connectée, lucide, et déterminée à briser le cycle.
À toi qui tiens ce texte, ce livre blanc, – citoyen désenchanté, militant découragé, diplomate désireux de comprendre -, je te dis ceci : Ceci n’est pas un livre sur la Mauritanie, mais sur la condition humaine aux prises avec le pouvoir. C’est l’histoire d’un peuple qui, malgré les trahisons répétées, refuse d’abdiquer son droit à rêver.
C’est une plongée au cœur des leurres et des lueurs de la Mauritanie politique, à travers un dialogue, miroir aux alouettes, qui est la preuve manifeste et intangible des dégâts qu’il cause au devenir et au développement du pays. Et qui est, au-delà de ces aspects critiques, une offense à la conscience de tout un peuple.
Que ces pages soient à la fois un miroir, un maillet pour briser les illusions, et une boussole pour ceux qui osent imaginer l’impensable : un dialogue qui libère au lieu d’asservir.
La justice n’est pas un cadeau des puissants, disait si justement Me Fatimata M’Baye, mais une conquête des peuples. (Me Fatimata M’Baye, Avocate mauritanienne des droits humains. Discours à Genève, 2019)
Lien de téléchargement libre du livre :
Pr ELY Mustapha
Coup d’État en Mauritanie : les tribus ont pris le pouvoir. Par Pr ELY Mustapha

“Il n’est pas des nôtres celui qui appelle au tribalisme. Il n’est pas des nôtres celui qui combat pour le tribalisme. Il n’est pas des nôtres celui qui meurt pour le tribalisme.”
Hadith du Prophète Mohamed que la paix soit sur lui
(Sunan Abu Dawud 5121, Livre 41, Hadith 133)
“Ô peuple ! Votre Seigneur est Un et votre père [Adam] est un. Un Arabe n’a aucune supériorité sur un non-Arabe, ni un non-Arabe sur un Arabe ; un blanc n’a aucune supériorité sur un noir, ni un noir sur un blanc, si ce n’est par la piété et les bonnes actions.”
Sermon d’Adieu (Khutbatul Wada) du Prophète Muhammad (PSL)
(Musnad de l’Imam Ahmad ibn Hanbal (hadith n° 23489)
Sahih al-Bukhari (partie du long hadith du Sermon d’Adieu)

La mort institutionnelle de l’Etat
La Mauritanie contemporaine offre un cas d’école de la déliquescence institutionnelle : l’État, en tant qu’entité régulatrice, n’existe plus. À sa place s’est imposé un système de gouvernance parallèle, dirigé par des tribus arabo-berbères qui contrôlent les leviers économiques, sécuritaires et politiques du pays.L’État mauritanien fonctionne comme une coquille vide, où les tribus dictent lois, budgets et nominations Ce « coup d’État silencieux » ne s’est pas produit en une nuit, mais résulte d’un processus historique de captation des ressources et de neutralisation méthodique des institutions.
Aujourd’hui, analyser la Mauritanie sans placer les logiques tribales au cœur de l’équation relève de la cécité académique.
I- Les racines historiques de l’hégémonie tribale
La colonisation française : architecte précurseur du tribalisme mauritanien moderne
L’administration coloniale française a codifié les hiérarchies tribales en s’appuyant sur des chefs tribaux comme relais locaux, marginalisant les Haratines (descendants d’esclaves) et les AfroMauritaniens. Ce système néopatrimonial a survécu à l’indépendance (1960), les élites tribales reproduisant les schémas de domination via le parti unique La réforme foncière de 1983, permettant l’expropriation des terres afro-mauritaniennes au profit des tribus, a marqué un tournant. En 1989, des purges ethniques chassèrent des milliers d’afro-mauritaniens, redistribuant leurs terres à des alliés tribaux du régime.
L’emprise des tribus sur les institutions politiques mauritaniennes est profonde et multiforme. Au cœur du système se trouve un monopole parlementaire et exécutif sans précédent. Les tribus arabo-berbères contrôlent 72 % des sièges au Parlement et 85 % des postes exécutifs. Cette domination n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une stratégie délibérée de captation du pouvoir. Les clans Awlad Bu Sba et Smassid, en particulier, ont réussi à s’arroger les ministères-clés tels que la Défense, l’Intérieur et les Finances, leur permettant ainsi de verrouiller l’ensemble des décisions stratégiques du pays. Cette mainmise sur les institutions trouve ses racines dans l’histoire post-coloniale de la Mauritanie. Sous la présidence de Moctar Ould Daddah (1960–1978), le Parti du Peuple Mauritanien (PPM) a institutionnalisé le tribalisme en cooptant systématiquement les chefs tribaux, transformant de facto l’État en un outil de légitimation et de renforcement des hiérarchies traditionnelles.
Le tribalisme comme doctrine d’État
Aujourd’hui, les tribus contrôlent 72% des sièges parlementaires et 85% des postes exécutifs. Les tribus dominantes (Awlad Bu Sba, Smassid, Oulad Delim) ont transformé l’appareil d’État en outil de prédation, utilisant les lois et budgets publics pour consolider leurs fiefs économiques.
Le processus électoral lui-même est devenu un théâtre où se joue la domination tribale. Le parti au pouvoir, El Insaf, alloue 65 % de son budget (estimé à 4,8 millions de dollars par an) à la mobilisation électorale des communautés arabo-berbères. Cette stratégie repose sur un système élaboré de clientélisme, où des concessions de terres et des promesses d’immunité judiciaire sont échangées contre des votes. L’oppression politique des opposants issus des communautés marginalisées est monnaie courante. En 2014, la candidature présidentielle de Biram Dah Abeid, militant anti-esclavagiste, a été systématiquement sabotée. Des partisans subissaient des confiscations de terres, illustrant la collusion entre pouvoir religieux, économique et politique au service des intérêts tribaux.
II- L’économie capturée : Tribus contre Trésor public
Les secteurs-clés sous contrôle tribal
La captation des ressources économiques par les tribus dominantes illustre de manière flagrante leur influence sur le gouvernement. Dans le secteur minier, stratégique pour l’économie mauritanienne, la tribu Awlad Bu Sba, étroitement liée à l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, a mis en place un système de perception de « royalties informelles » sur l’exploitation du fer à Zouérat. Ce mécanisme opaque permet de détourner entre 8 et 12 millions de dollars par an des revenus de la SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière), privant ainsi l’État de ressources cruciales pour son développement. Le secteur des pêcheries n’échappe pas à cette logique prédatrice.
Les coopératives tribales basées à Nouadhibou ont réussi à s’octroyer le contrôle de 38 % des exportations de poulpe vers l’Union Européenne, grâce à un système de quotas opaques négociés au plus haut niveau de l’État. Cette mainmise leur assure des revenus annuels de l’ordre de 14 millions d’euros, au détriment des communautés côtières non-arabo-berbères et du Trésor public.Soit:
• Pêcheries : Les coopératives tribales de Nouadhibou contrôlent 38% des exportations de poulpe vers l’UE, générant 14 millions d’euros annuels via des quotas opaques-
• Mines : La tribu Awlad Bu Sba perçoit des «royalties informelles » sur l’exploitation du fer à Zouérat, détournant 8 à 12 millions de dollars/an des revenus de la SNIM (société minière nationale).
Or et drogue : Les tribus Reguibat et Oulad Delim contrôlent 30 % du trafic de cannabis marocain (270 tonnes/an) et 15 % de la cocaïne sud-américaine transitant par le Sahel, avec des complicités douanières (150–300 €/véhicule).
Les systèmes de prédation sont variés et multiples. Parmi ceux utilisés: l’Intégration (Hawala) et la Syndication des ressources.
L’Intégration (Hawala): Des bureaux de change tribaux de Nouakchott ont traité des millions de dollars de dons intraçables du Golfe, tirant parti des liens tribaux pour contourner la surveillance de la Banque centrale mauritanienne.
La Syndication des ressources : Le contrôle sur les collectifs de pêche artisanale permet aux tribus de rediriger les cargaisons de poulpes à destination de l’UE vers les marchés de Dubaï, capturant des millions de dollars de profits illicites.
La prédation systémique
La structure étatique de Solidarité, destinée à lutter contre la pauvreté, canalise 40% de son budget (6 millions de dollars) vers des «projets» tribaux servant à acheter des loyautés tribales. Parallèlement, l’État perd 220 millions de dollars/an via la contrebande d’or, facilitée par l’absence de scanners financiers à 88% des postes frontaliers.
III. L’effacement de l’État de droit
Justice sélective et impunité tribale
Le Conseil Supérieur de la Magistrature, dominé à 60% par des tribus, bloque les enquêtes visant les élites tribales. En 2011, le président Aziz a gracié 30 trafiquants de drogue condamnés, tous issus de tribus influentes. En 2023, une saisie de 1,2 tonne de cocaïne à Nouadhibou a été étouffée quand les enquêteurs ont découvert des liens familiaux avec un ancien ministre de la Défense.
L’instrumentalisation du système judiciaire
L’instrumentalisation du système judiciaire au profit des intérêts tribaux est un autre exemple frappant de cette influence.
L’impunité dont jouissent les membres des tribus dominantes est devenue systémique. En 2011, un cas emblématique a choqué l’opinion publique : le président Aziz a gracié 30 trafiquants de drogue condamnés, tous issus de tribus influentes. Cette décision, prise par décret présidentiel, a démontré de manière éclatante la subordination du pouvoir judiciaire aux intérêts claniques. Plus récemment, en 2023, une affaire de trafic de drogue à grande échelle a mis en lumière les mécanismes de protection tribale. Une saisie de 1,2 tonne de cocaïne à Nouadhibou, qui aurait dû conduire à des poursuites judiciaires d’envergure, a été rapidement étouffée lorsque l’enquête a révélé des liens familiaux entre les trafiquants et un ancien ministre de la Défense.
En 2024, à l’occasion de l’enquête sur le clan Cheikh Eyah, un système de blanchiment de 30 millions de dollars via des bureaux de change à Nouakchott et des exportations frauduleuses de poulpe vers Dubaï a été mis à jour. Les charges ont été abandonnées en 24 heures pour « vice de procédure » – un scénario classique de protection tribale.Cette affaire, au-delà de la présomption d’innocence qui doit prévaloir à l’égard des présumés, illustre non seulement la sophistication des réseaux financiers tribaux, mais aussi leur capacité à neutraliser le système judiciaire.
Ces exemples illustrent comment le système judiciaire, censé être le garant de l’État de droit, est devenu un instrument au service des intérêts tribaux.
Armée et sécurité : des milices tribales déguisées
L’armée et les forces de sécurité n’échappent pas à l’emprise tribale, compromettant sérieusement la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’État mauritanien. 90 % des postes d’officiers supérieurs sont occupés par des tribus. Les promotions au sein de l’armée sont basées non pas sur le mérite ou les compétences, mais sur l’allégeance tribale, créant ainsi une force armée plus loyale envers les clans qu’envers l’État. Cette situation est exacerbée par l’existence de milices tribales quasi-autonomes. Le cas le plus flagrant est celui de la tribu Oulad Delim, qui dispose d’une force paramilitaire de 800 hommes, armée via des réseaux libyens. Cette milice patrouille les frontières et contrôle des territoires entiers sans aucune supervision ou contrôle de l’État central, illustrant la fragmentation de la souveraineté nationale au profit des intérêts tribaux.
Enfin, les alliances entre certaines tribus du nord et des groupes jihadistes représentent peut-être la manifestation la plus inquiétante de cette influence tribale.. Cette collusion entre intérêts tribaux et réseaux terroristes non seulement sape les efforts de lutte antiterroriste de l’État mauritanien, mais pose également un défi sécuritaire majeur pour toute la région sahélienne.
IV. Conséquences : un pays en déliquescence
La Mauritanie n’est plus un État au sens wébérien du terme (soit une communauté humaine, qui à l’intérieur d’un territoire déterminé (…) revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime), mais une constellation de fiefs tribaux régis par des lois parallèles.
Les « élections » ne sont que des mises en scène validant des rapports de force claniques.
Ainsi , pour faire face à ces mécanismes de prédation, toute réforme devra nécessairement passer par :
• La restitution de 30% des actifs miniers et halieutiques aux coopératives non tribales
• Le renforcement des tribunaux anticorruption sous supervision internationale
• Le déploiement de douanes intelligentes (IA, blockchain) à Nouakchott et Nouadhibou
Sans rupture radicale, la Mauritanie restera un État fantôme, où la citoyenneté s’efface devant l’appartenance tribale.
Les exemples concrets n’en finissent plus qui démontrent que l’État mauritanien fonctionne aujourd’hui comme une coquille vide, où les tribus dictent les lois, contrôlent les budgets et décident des nominations clés.
Cette hégémonie tribale, héritée de l’ère coloniale et renforcée par des décennies de clientélisme, explique l’échec persistant des tentatives de réformes démocratiques et la perpétuation des crises humanitaires et sécuritaires que connaît le pays.
Toute analyse ou initiative politique concernant la Mauritanie doit impérativement prendre en compte cette réalité tribale qui structure profondément la gouvernance du pays.
La Mauritanie se trouve, donc, à un carrefour critique. Sans une action décisive pour freiner le pouvoir tribal et reconstruire les institutions étatiques, le pays risque de compléter sa transition d’un État fragile à un simple consortium tribal, où la gouvernance est effectivement mise aux enchères au plus offrant et où la citoyenneté se réduit à l’allégeance clanique.
La disparition de l’État mauritanien n’est pas une menace lointaine ou une préoccupation théorique – c’est la réalité vécue par des millions de personnes piégées dans un ordre néoféodal, qui les détruit, les appauvrit et qui a supplanté la gouvernance moderne. Le défi à venir est monumental, nécessitant non seulement des changements de politique mais une réinvention fondamentale de la relation entre l’État, les tribus et les citoyens dans la société mauritanienne.
L’alternative – accepter la suprématie tribale comme un fait accompli – condamnerait la Mauritanie à un avenir d’inégalités croissantes, de dégradation environnementale et d’insécurité perpétuelle, avec des répercussions ressenties bien au-delà de ses frontières dans une région déjà volatile.
Il y a environ 1431 ans, le 9è jour de Dhul-Hijjah, alors qu’il se tenait dans la vallée d’Uranah au Mont Arafat, le Prophète Muhammad (SAW) a délivré son sermon d’Adieu (Khutbatul Wada) :
« Ô Peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais si après cette année, je serai de nouveau parmi vous. Par conséquent, écoutez très attentivement ce que je vous dis et apportez ces paroles à ceux qui n’ont pas pu être présents ici aujourd’hui.
Ô Peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette ville comme sacrés, considérez la vie et les biens de chaque musulman comme une responsabilité sacrée. Restituez les biens qui vous sont confiés à leurs propriétaires légitimes. Ne blessez personne pour que personne ne vous blesse. Rappelez-vous que vous rencontrerez en effet votre Seigneur et qu’il évaluera en effet vos actes. (….)
Mais qui aujourd’hui, l’entend encore ?
« Si vos cœurs n’étaient pas absorbés par les paroles et que vous n’en raffoliez, vous entendriez ce que j’entends. » (Hadith du Prophète Mohamed que la paix soit sur lui)
Certainement pas par des gouvernants d’un Etat pris en otage par des tribus, avec laquelle l’Alliance avait été formellement interdite par le prophète Mohamed (PSL) de son vivant.
Paix aux innocents.
Pr ELY Mustapha
Hindou Mint Ainina clarifie le dialogue politique en Mauritanie dans un contexte tendu

Invitée hier soir sur le plateau de l’émission « Zoom sur », présentée par le journaliste Cheikh Ould Zeinlessem sur la TVM, Hindou Mint Ainina, conseillère du Premier ministre chargée des affaires politiques, s’est exprimée sur le dialogue politique en Mauritanie. Cette intervention intervient alors que l’Assemblée nationale examine une loi controversée sur les partis politiques, qualifiée par « liberticide »
Un engagement réitéré par le président
Dans son allocution, Hindou Mint Ainina a rappelé que le dialogue politique est une priorité affirmée par le président de la République lors de son discours du 28 novembre dernier. Elle a souligné que cette volonté de dialogue est soutenue par une concertation permanente entre les différents acteurs politiques : à savoir le président, le Premier ministre, les partis politiques et le ministère de l’Intérieur.
« Ce dialogue politique, c’est un engagement. Il appartient aux protagonistes de le structurer et d’apporter des solutions aux grandes questions nationales, » a-t-elle affirmé.
Une réforme attendue des partis politiques
Au cœur du débat actuel se trouve un projet de loi visant à revoir le cadre organisationnel des partis politiques. Hindou Mint Ainina a rappelé que cette révision répond à une demande récurrente des acteurs politiques. Selon elle, il est nécessaire que les partis deviennent de véritables institutions capables de former une classe politique structurée, au-delà de l’informel.
« Les partis doivent être des lieux d’échanges d’idées, de propositions et de dialogue interne. Il est temps que les partis cessent d’être des structures centrées sur des individus pour devenir des groupes réfléchis et organisés », a-t-elle déclaré.
Elle a ajouté que le gouvernement est ouvert à toute proposition constructive venant des partis, notamment sur des thèmes comme l’organisation politique, la gouvernance ou encore le processus électoral. Hindou Mint Ainina a toutefois précisé que l’enjeu du dialogue va aujourd’hui bien au-delà des élections.
Une réflexion sur les grands enjeux nationaux
Pour la conseillère, ce dialogue doit être l’occasion de s’interroger sur le mode de gouvernance du pays, en abordant des sujets fondamentaux tels que l’unité nationale, la diversité culturelle, et la lutte contre les discriminations.
« Il s’agit d’unir les citoyens dans l’égalité et la dignité tout en respectant leur diversité culturelle. Nous devons combattre les discriminations sous toutes leurs formes, qu’elles soient raciales, liées à l’esclavage ou aux droits humains. »
Elle a également insisté sur l’importance des libertés fondamentales, notamment celles d’expression et de presse, comme piliers du dialogue et de la construction d’une société républicaine forte.
Une ouverture vers des propositions concrètes
Hindou Mint Ainina a conclu en appelant à une mobilisation collective des acteurs politiques pour atteindre des objectifs communs. « Le gouvernement est réceptif aux propositions positives qui permettront d’améliorer la gouvernance et de renforcer les bases de l’unité nationale », a-t-elle souligné.
Cette intervention de la conseillère intervient dans un contexte où les tensions autour de la loi sur les partis politiques restent vives. Il reste à voir si le dialogue pourra surmonter ces divergences et poser les jalons d’une transformation politique profonde en Mauritanie.
Ahmed Ould Bettar
Mauritanie – Kaaw Touré immortalisé dans « I’AM BLACK », un film documentaire

Kassataya — Figure de la lutte politique et de la défense des droits des noirs en République Islamique de la Mauritanie, le parcours de Kaaw Toure est aujourd’hui immortalisé à travers une œuvre cinématographique. En effet, le grand producteur Suèdois Matz Eklund a realisé un film sous le titre « I ́AM BLACK » (Je suis noir, Ndlr).
Ce documentaire retrace le parcours de ce militant de la des droits humains de la prison à l ́exil. Cette œuvre a été primé comme meilleur film documentaire au festival de films scandinaves de Boden en Suède.
Kaaw Touré plus connu sous le nom de Elimane Bilbassi est originaire de Jowol, dansle Sud de la Mauritanie, une des anciennes capitales du Fouta et village du légendaire guerrier peul Samba Guéladio Djégui. Il s’est engagé dans la lutte dès son jeune.
Malgré son jeune âge, le jeune lycéen de 15 ans s’est engagé à porter le combat des droits humains, notamment des noirs en Mauritanie. Cette lutte acharnée lui a valu un séjour en prison à l ́âge de 18 ans.
Ceci a fait de lui, le premier plus jeune prisonnier politique de Ould Taya en 1986. Cette arrestation est intervenue, selon Kaaw Touré, après la publi-cation du « manifeste du négro-mauritanien opprimé ».
Une vie d’exilée au Sénégal
« Cette expérience carcéral sous le régime militaire dur et pur m´a renforcé dans mes convictions»; confie-t-il. Loin de se décourager, il récidive aussitôt après sa sortie de prison en 1987. Mais cette fois-ci, il était avec d ́autres jeunes camarades au lycée de Kaëdi en dirigeant une grève pour protester contre l´exécution des 3 premiers martyrs noirs le 6 décembre 1987 au camp de Djreïda à Nouakchott.
« J ́ai été à nouveau recherché et poursuivi par la police mauritanienne, ce qui m´a plongé dans la clandestinité et ensuite vers un exil forcé le 15 décembre 1987 au Sénégal. De Dakar j ́ai continué mes études au lycée Seydina Limamoulaye de Pikine où j´ai obtenu mon Bac et admis à l’ENEA (école nationale d’économie appliquée) de Dakar où je suis sorti comme ingénieur en planification économique et travaillé comme consultant à l´ONG Plan international dans la région de Thiès », nous raconte Kaaw Touré.
En dehors de ses études et activités professionnelles, l’activiste a continué la lutte avec ses camarades mauritaniens exilés au Sénégal pour alerter l´́opinion internationale sur la situation politique en Mauritanie et l’apartheid méconnu. « Plus tard, je fus propulsé à la tête du département de la presse et de la communication des FLAM et directeur de publication de notre organe d ́information le FLAMBEAU, journal interdit en Mauritanie.
Cet activisme débordant auprès de la presse sénégalaise et internationale m´a valu des mises en demeure répétées de la police sénégalaise et j’ai échappé de justesse à une tentative d ́extradition suivie d ́une expulsion en juillet 1999, suite aux pressions diplomatiques du gouvernement mauritanien, notamment du régime du colonel-président Ould Taya qui ne voulait plus de ma présence au pays de la Téranga.
Grâce aux Nations Unies j´ai obtenu l ́asile politique en Suède où je vis depuis et continue mon activisme en tant que porte-parole du parti d´opposition mauritanienne, les FPC (Forces progressistes du changement).
En Suède, M. Touré a continué ses études jusqu ́au master en sciences sociales et histoire des langues dans lesuniversités suédoises et travaille comme responsable d´́insertion et d´intégration des chercheurs d´emploi et denouveaux établis (immigrés) en Suède et par ailleurs formateur en langues modernes.
« A mes heures perdues je suis poète pulaar, j ́ai déjà écrit un recueil de poèmes en pulaar ”Sawru gumdo” (la canne de l ́aveugle) et enregistré plusieurs audios de la poésie pulaar. Je suis dans la rédaction d ́un recueil de poèmes-pulaar-français». Sa page Facebook est l´une des pages francophone les plus suivies en Mauritanie et qui compte plus de 100.000 abonnés.
Dieynaba TANDIANG
Source : LE QUOTIDIEN Numéro 1218 du vendredi 24 janvier 2025



