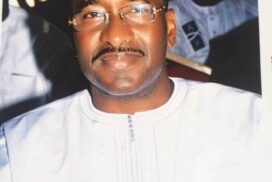Daily Archives: 29/03/2016
Loi sur le financement du terrorisme : La Mauritanie ne reconnaîtrait plus la résistance palestinienne
 L’Authentique – La loi sur le financement du terrorisme récemment adoptée par le parlement mauritanien va à contre-courant de la position diplomatique de la Mauritanie vis-à-vis des mouvements de résistance comme en Palestine. C’est ce que soutiennent nombre d’observateurs qui sont persuadés que cette loi n’exclurait pas les peuples qui luttent pour leur autodétermination.
L’Authentique – La loi sur le financement du terrorisme récemment adoptée par le parlement mauritanien va à contre-courant de la position diplomatique de la Mauritanie vis-à-vis des mouvements de résistance comme en Palestine. C’est ce que soutiennent nombre d’observateurs qui sont persuadés que cette loi n’exclurait pas les peuples qui luttent pour leur autodétermination.
Le débat a été houleux autour de la loi sur le financement du terrorisme, récemment adoptée par le parlement mauritanien. Le gouvernement aurait dans ce cadre refusé toute modification du projet de loi 016-080 portant lutte contre le financement du terrorisme.
Ces modifications proposées par le groupe parlementaire du parti islamiste Tawassoul, portaient sur des exceptions. Celles-ci portaient sur les mouvements populaires luttant pour l’autodétermination ainsi que les mouvements de résistance comme en Palestine. A ces mouvements, nulle confiscation de bien ou rétorsion juridique ne doivent être imposés, selon les partisans de la modification.
Ainsi, au sein de la commission parlementaire Justice, Intérieur et Défense, il a fallu passer au vote pour décider la saisie conservatoire, la confiscation et le gel immédiat des biens et propriétés des individus et groupes listés par le Conseil de sécurité de l’ONU ou par l’Etat mauritanien comme mouvements terroristes, ceux qui les financent ou leur achètent des armes de destruction massive.
L’exception demandée par les partisans de la modification portait sur les organisations reconnues par les Nations Unies comme des combattants de causes justes reconnues par le droit international, comme les peuples qui luttent pour leur indépendance ou pour leur autodétermination, comme en Palestine.
Mais les députés de la majorité membres de la commission se seraient opposés farouchement à ces modifications, soutenant qu’il n’y aura aucune exception dans le projet de loi sur le financement du terrorisme.
Ainsi, la Mauritanie ne reconnaîtrait plus la résistance palestinienne. Ce qui selon plusieurs observateurs, constitue un précédent dangereux et un alignement sur la thèse du sionisme international et de ses alliés du Golfe arabique.
Ainsi, le projet de loi proposé par le gouvernement est passé devant le Parlement comme une lettre à la poste, démontrant par là que le gouvernement contrôle totalement le Parlement à travers sa majorité.
Aucun débat contradictoire ne serait ainsi plus possible au sein des deux hémicycles du parlement mauritanien, par rapport aux lois que le gouvernement veut faire adopter. Le contrôle parlementaire est ainsi mort de sa vilaine mort, trouvent plusieurs parlementaires.
Mais le vote sur la loi sur le financement du terrorisme pourrait comporter une exception, car une seule député, Betoul Mint Abdel Haye de la majorité a voté contre, sous réserve des deux exceptions qu’elle propose d’introduire, celles portant sur les mouvements de résistance. Son parti, qui appartient à la majorité l’aurait tancé vertement.
JOB
Demandes d’autonomie, de sécession… : Faut-il diviser le territoire national entre ses communautés ?
 Après le parti FPC (Forces progressistes du changement, ex-FLAM), qui avait demandé l’autonomie pour les régions Sud de la Mauritanie, c’est au tour du mouvement TPMN (Touche pas à ma nationalité) de lancer aujourd’hui l’idée d’une sécession de la Vallée.
Après le parti FPC (Forces progressistes du changement, ex-FLAM), qui avait demandé l’autonomie pour les régions Sud de la Mauritanie, c’est au tour du mouvement TPMN (Touche pas à ma nationalité) de lancer aujourd’hui l’idée d’une sécession de la Vallée.
Ces revendications remettent en selle la question très sensible de la partition de la Mauritanie, jugée comme une atteinte à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale, et qu’une partie de la communauté négro-mauritanienne considère comme justifiée.
« Le temps est venu de procéder à la partition de la Mauritanie ou à sa Fédération » ! L’idée est de plus en plus développée dans certains cercles intellectuels noirs qui la considèrent comme une « solution à la juste et équitable répartition des richesses nationales au profit de l’ensemble de ses communautés.
Déjà, du temps de la Mauritanie coloniale, l’idée d’une Mauritanie noire au Sud, distincte de la Mauritanie blanche au Nord, aurait été introduite par certaines communautés négro-mauritaniennes. D’emblée, elle a été rejetée par la France qui voulait d’une Mauritanie unitaire dans ses frontières et dans ses composantes ethniques.
Mais cette conception de la Mauritanie était restée enfouie dans le subconscient d’une certaine élite qui trouvait impossible la cohabitation entre les communautés mauritaniennes, malgré le ciment de l’Islam de rite malékite.
Mais la coexistence pacifique restera tributaire des desiderata des régimes qui se sont succédé en Mauritanie et qui ont longtemps joué sur les tensions intercommunautaires pour nourrir des ambitions personnelles, ou parfois, se retrouvant à bout de souffle remuaient le couteau dans la plaie.
Ainsi, aux évènements de 1966 sur l’arabisation, devaient succéder les sanglants pogroms de 1989 à 1991, ce que certains ont nommé « l’épuration ethnique ». Il en découla un lourd passif humanitaire dont les fardeaux seront traînés sur plus d’une décennie pour s’achever par une prière à kaédi et une compensation financière qui n’a pas fini de satisfaire toutes les victimes.
L’enrôlement biométrique serait intervenu, créant ce que certains activistes négro-mauritaniens considèrent comme une forme de génocide contre les noirs de Mauritanie. Depuis, ils sont nombreux les courants politiques négro-mauritaniens qui s’érigent en porte-voix de la cause négro-mauritanienne, certains ayant choisi la voix soft dans leurs relations avec le pouvoir en place, et d’autres la confrontation, sinon la provocation, selon certaines grilles de lecture.
Il y a d’abord l’aile « repentie » des FLAM, notamment le courant des Samba Thiam, qui avait choisi le retour au bercail après un exil qui a duré vingt-sept ans. Reçu en grande pompe, par le président Mohamed Abdel Aziz au palais présidentiel, l’homme sera quelque temps porté aux cieux.
Cet amour éphémère ne dura que la vie d’une rose. Samba Thiam et ses amis comptaient mener le combat sur le terrain politique, avec comme objectif, une lutte interne pour une Mauritanie égalitaire, sans racisme et sans discrimination, ou à défaut, une autonomie régionale partielle.
C’est le pas qui sera franchi en août 2013 lorsqu’au détour d’une conférence de presse, le FPC lança sa proposition d’autonomie des régions de la Vallée du Fleuve. Cette revendication serait aux yeux du FPC, motivée par un constat d’échec.
« L’Etat centrale dans sa forme unitaire actuelle, n’a pas donné naissance à l’Etat Nation escomptée. Il nous incombe en conséquence le devoir explorer d’autres voies : pour la stabilité du pays et dans l’intérêt supérieur de nos enfants » lâche Samba Thiam.
Cette sortie du président des FLAM sera suivie d’une véritable levée de boucliers. Il fut estimé dans certains milieux que le mouvement FPC, flamiste, s’était revêtu de ses anciens oripeaux de regroupement de haineux racistes, ennemis de la patrie mauritanienne. L’attitude du pouvoir se durcit et c’est la rupture définitive qui aboutira à la non reconnaissance du parti par le ministère de l’Intérieur qui lui refusa le récépissé officiel.
Samba Thiam et son camp ont beau expliqué qu’ils ne demandaient pas la sécession des régions du Sud, mais juste une autonomie régionale dans le cadre de la nation et de l’Etat mauritanien, rien n’y fut.
Aujourd’hui, le débat est revenu sur la scène publique. « Avec plus de radicalité », estiment certains observateurs, à la lumière de la proposition lancée par TPMN tendance Wane Birane, exilé en France, qui réclamerait carrément la sécession des régions du Sud.
Des assises sont sous programmation à Paris pour « se prononcer sur la nécessité de revendiquer la sécession du Sud de la Mauritanie » a-t-on déclaré. L’annonce a faite au cours d’une assemblée générale du mouvement tenue le 20 mars 2016 à Paris.
Né des problèmes d’enrôlement auxquels sont confrontées les communautés noires en Mauritanie et qui aurait créé des milliers d’apatrides, TPMN expliquerait son attitude par selon lui, la montée du racisme, de la discrimination et de la marginalisation de la communauté négro-mauritanienne. De telles dispositions amènent d’aucuns a soutenir que l’issue d’une telle réunion est connue d’avance : il s’agira d’appeler à la partition !
Pour autant, pour nombre d’observateurs, la question de la répartition de la Mauritanie, celle de l’autonomie de certaines de ses régions ou celle de sa recomposition en Fédération, reste vaine. Même si par ailleurs, la partition de la Mauritanie pourrait séduire plusieurs autres partisans du régionalisme.
On se rappelle en effet que des voix s’étaient élevées dans la région de Dakhlet Nouadhibou il y a moins de dix ans, pour demander l’autonomie des régions du Nord, certains s’indignant du peu de retombées des ressources en fer, poisson, cuivre, pourtant extraits des sols et de la mer, à Zouerate, Nouadhibou, Inchiri, sans aucune incidence sur la vie des populations locales.
Des revendications identiques avaient surgi en même temps de certaines régions orientales du pays. Chaque fois, la question la problème a été balayé d’un revers de main par les Autorités nationales qui considèrent qu’elle relève de l’utopie.
Cheikh Aïdara
l’authentique
Une approche communautaire de la diversité culturelle mauritanienne/ Par Mohamed Fouad Barrada, enseignant-chercheur

Plus récemment, l’exode rural a favorisé l’émergence de grands ensembles culturels dans les zones urbaines – comme la ville de Nouakchott qui regroupe, selon le dernier recensement, le tiers de la population – où l’interdépendance centre-périphérie représente une nouvelle clé de lecture du brassage culturel qui caractérise, aujourd’hui, la société mauritanienne.
Cependant, les rapports entre les ensembles sociaux du centre et de la périphérie, demeurent caractérisés, dans une certaine mesure et malgré une part de communauté d’intérêts, par des tensions intercommunautaires accentuées par l’instrumentalisation, sous toutes ses formes, de la culture (langues nationales, langue d’Etat, etc.).
Sous la pression de la pauvreté, la conditionnalité économique relègue la culture au second plan. Faut-il, alors, développer une approche communautaire de la diversité culturelle, pour préserver l’apport distinct de chaque groupe social, et encourager les démarches novatrices et culturellement appropriées aux aspirations et aux perspectives propres à chaque ensemble ?
Il apparaît clairement, et c’est la thèse que nous soutenons ici, que la culture « ne peut s’incarner » dans l’originalité, « comme source d’innovation et de créativité », qu’à travers la reconnaissance de l’identité culturelle de chaque communauté mauritanienne, dans une approche démocratique.
On entendra, ici, que la démocratie communautaire est le socle impératif et nécessaire, pour dépasser le blocage politique, si prégnant en Mauritanie. Celui-ci n’est, de fait, qu’une manifestation de l’amère réalité de la pauvreté, source de déstabilisation sociale de notre République. A sa racine, un fonctionnement communautaire négativement exploité et intégrant, difficilement, les principes de la liberté responsable, permettant de reconnaître la dignité et la fraternité. Mais cette démocratie relève de notre héritage spécifique, basé sur l’expérience de notre passé, enrichi par le mode organisationnel des instances et institutions démocratiques internationales. D’où la question du but organisationnel des instances politiques et de son interaction avec l’organisation sociétale en communauté.
Introduction
Qu’adviendrait-il, si chaque communauté se repliait sur elle–même ? Cette question liminaire en appelle une autre, en amont : Qu’est-ce qu’une communauté ? « L’habitude et le langage scientifique, courant mais encore imprécis, veulent qu’on désigne cette forme de vie – au sens le plus large du terme – à partir du vocable « famille » : communauté de familles, communauté familiale. Ou, toujours en référence à la famille : famille étendue, joint family. Ou, en référence à seulement une des formes de la communauté : hauskommunion (« communion » domestique). Comme si la seule famille-type était la famille conjugale qui, unie à l’autre de même diamètre et de même nature, formerait, par extension verticale et horizontale, une communauté familiale ».
Si, par nature, c’est la préservation de la domination d’une majorité ou d’une minorité qui compte, pour certains, en matière de diversité culturelle, pour d’autres en revanche, c’est l’acceptation de l’autre qui prime, avec la spécificité propre de sa communauté. Mais cette unicité ne peut exister que si les individus s’inscrivent dans une histoire communautaire, dans une suite ordonnée de filiales et de nominations qui les décrivent : qui sommes-nous, par rapport aux autres ; d’où venons-nous, qui nous précède?
Dans cette étude, on présentera, contrairement donc à la tradition, la communauté, au sens large du terme, d’une part, et, d’autre part, l’intercommunalité, au sens spécifique, à travers une transposition sur le cas mauritanien. Il s’agit, ici, d’orienter la réflexion sur un groupe social ou une communauté de quartier ou des collectivités territoriales, partageant un intérêt commun.
C’est, en effet, là que la question de la valorisation de l’intérêt commun se pose avec le plus d’acuité, d’où la recherche des formes organisationnelles les plus adaptées pour une meilleure cohésion sociale, dans des espaces regroupant, banalement, plusieurs cultures différentes, avec, quasiment partout, en Mauritanie, un unique dénominateur commun : l’islam.
La présente communication vise donc à aborder la question de la diversité culturelle dans une approche systémique. C’est-à-dire une approche communautaire vivante, complexe, en mouvement, tenant compte du milieu des groupes sociaux et de leurs interactions, dans des structures à la fois organisées et désorganisées.
I- Diversité culturelle et communauté
La Mauritanie, dont les habitants sont, en quasi totalité, des musulmans sunnites de rite malékite, est perçue comme un lieu de convergence de divers courants de civilisations résultant, notamment, des empires, du Ghana, du Mali, et des Almoravides.
Les conditions naturelles notamment l’exode rural ont favorisé l’émergence de grands ensembles culturels dans ses zones urbaines. C’est le cas de Nouakchott qui regroupe, selon le dernier recensement, le tiers de la population. Là encore, la dichotomie centre-périphérie représente une nouvelle clé de lecture. On peut opposer, dans cette perspective, deux dimensions de la ville la plus peuplée du pays : d’une part, Nouakchott des périphéries et, d’autre part, Nouakchott du centre, plus moderne à travers ses édifices administratifs et ses villas qui regroupent les composantes culturelles dotées d’un niveau de vie élevé.
Cependant, les ensembles communautaires du centre et de la périphérie ne partagent que rarement l’intérêt commun, d’où la fréquence des tensions intercommunautaires, accentuées par l’instrumentalisation, sous toutes ses formes, de la culture (langues nationales, langue d’Etat, etc.). De fait, c’est sous la pression de la pauvreté que la conditionnalité économique relègue la culture au second plan.
Cette conditionnalité économique est appréhendée comme la résultante d’une défaillance du système de production et de prestation de services, tout à la fois renforçant et renforcé par la solidarité ethnique et tribale. Cette tendance se confirme, de plus en plus, sur l’ensemble du pays. Il semble bien qu’il existe, en Mauritanie, une corrélation, inversée, entre la position et la puissance de l’Etat et celles de la tribu. Plus la solidarité est forte, entre les membres de la tribu, plus le rôle de l’Etat est faible. Cette dialectique s’exprime dans une attitude d’intolérance à l’égard de l’autre, qui prend place dans une thèse portant spécifiquement sur la culture.
Face à ce châtiment qui diffame l’identité de l’autre, en la rejetant ou en l’instrumentalisant, nous trouvons, pourtant, l’attitude inverse qui accorde, à la diversité culturelle, le rôle inventeur de la cohésion sociale, à travers, notamment, des Comités de Concertation Communale (ou CCC) qui s’inscrivent, à titre d’illustration, dans le cadre d’un partenariat entre la Communauté Urbaine de Nouakchott et les neuf communes de la ville visant, ainsi, à renforcer les liens de proximité entre les élus, leurs services et leurs citoyens.
« Composés de plusieurs collèges (élus, services déconcentrés, société civile), les CCC sont toujours présidés par le maire qui nomme un secrétaire général parmi les membres de la société civile. Aussi, le Comité de Concertation Communale se définit-il comme un espace de dialogue pérenne (car fruit d’une délibération communale), entre les élus, d’une part, et la population de la commune, d’autre part. Instance consultative, le CCC aide et conseille le conseil municipal, dans sa gestion des affaires de la commune, par ses recommandations et propositions » . Important appui du conseil municipal, dans son processus de réflexion et de décisions prioritaires, il est notamment précieux dans le domaine socioculturel.
C’est sur ce constat qu’il nous faut, à présent, examiner l’éventuelle nécessité, sur le plan politique, d’une démocratie communautaire.
II – De la réforme collective
En cette occurrence, il faut, tout d’abord, ne jamais perdre de vue qu’en l’un ou l’autre excès de la dialectique évoquée tantôt, c’est toujours d’identité et de culture qu’il est question. Que le monde soit appauvri ou saturé par ses effets, cela prouve qu’en certaines circonstances, la culture est une arme à double tranchant. Voilà pourquoi faut-il recourir à une nature propre, valorisant la diversité, à travers l’interaction entre les différentes identités ethniques vivant dans un même espace urbain.
Imagination artistique, la culture devrait, ainsi, « retrouver une nature propre qui l’apparente à la lumière, son rôle spécifique de filage symbolique de l’unité du monde, sa fonction, centrale, de médiation entre l’intérieur et l’extérieur ; autrement dit, sa fonction réflexive qui exprime le double caractère, subjectif et objectif, de notre rapport au monde. Ni mélange ni séparation mais un monde chiral de rapports, un entrelacs de l’intérieur et de l’extérieur » . Telle démarche suppose, semble-t-il, l’organisation d’une démocratie communautaire « politiquement correcte », axée sur des élections « sélectives pour désigner l’autorité repère du Sens du bien commun ».
Et reposant, sur le plan économique, sur « la production et l’échange de biens et de services, au sein d’une communauté d’enjeux. Les valeurs économiques se mesurent sur les échelles de valeurs, caractérisant le Sens du Bien commun et ses valeurs de références. Elle suppose des régulations communautaires, intra- et intercommunautaires. » Culturellement, « chaque groupement tribal est appelé à développer ses modes de vie selon sa culture et à cultiver ses potentiels et ses talents, selon une vocation propre, au service de l’accomplissement des personnes et des groupes qui le constituent. Il est appelé à un développement approprié et, donc, durable, en cultivant les valeurs qui expriment son Sens du Bien commun ».
Dès lors, on entend en quoi la démocratie communautaire constitue une clé, sinon suffisante, du moins nécessaire, du déblocage politique. A cet égard, les canaux de diffusion de l’information, tels que les réseaux sociaux ou autres supports électroniques – notamment les GSM – représentent, à notre avis, une autre clé de lecture barométrique permettant d’apprécier l’efficacité, voire l’efficience, des médias, à travers la participation des citoyens . Cependant, si les politiques sont fortement déterminées par des intentions individuelles, guidées par les intérêts de certains groupes restreints, instrumentalisant leurs communautés appelées à véhiculer leurs intentions, en s’appuyant sur divers instruments – les médias, la technologie d’information, etc. – les autres communautés opteront, évidement, pour la confrontation.
Il s’agit, ici, de mettre en évidence la relation, très complexe, entre des vecteurs de transmission (numérisation innovatrice) de l’information, d’une part, et, d’autre part, des modes de fonctionnement sociétal, appropriés ou désappropriés, utiles ou inutiles à la bonne gouvernance communautaire. De fait, « le contrôle citoyen de l’action publique » voire communautaire constitue un mécanisme valorisant la bonne gouvernance. Mais des zones d’ombre subsistent : « le contrôle est-il un pouvoir qui doit être exercé par le citoyen ou est-il, tout simplement, quelque chose de donné ? ».
Il semble clair qu’un tel contrôle ne peut aucunement s’exercer sans des structures organisationnelles et citoyennes bien spécifiques, nanties de vocations existentielles pour préserver leur intérêt commun et, à travers elles, la société.
III Perspectives organisationnelles de la vie en communauté
Tenant compte de la question du but organisationnel des instances politiques du pays, son interaction, avec l’organisation sociétale en communauté, s’impose-t-elle ? Et, si l’on suppose qu’« il y a bien un but », peut-on admettre qu’« il n’existe aucun chemin qui y mène ? ».Franz Kafka en était persuadé mais on peut, à bon droit, penser le contraire.
De fait, la problématique du but organisationnel n’est toujours pas tranchée. En principe, la difficulté consiste à déterminer si les organisations ont des buts ou si cela concerne, seulement, leurs membres. Certes, les individus peuvent se ressembler, au sein d’une même organisation, parce qu’ils partagent le même but, mais il se peut que chacun des membres entretienne une vision différente, ce qui rend le processus d’élaboration d’un but commun plus complexe. « Le but des organisations (politiques ou associatives) serait-il d’assurer le bien-être de la population ou les intérêts de certains groupes d’influences communautaires ? » Dans tous les cas, comment évaluer un tel but ?
Ceci nous renvoie à la définition exacte du but. En toute « logique », définir un but amène à se demander le pourquoi de l’existence de l’ensemble organisé et déterminé, puis à déterminer les facteurs-clés de sa réussite, afin d’élaborer un plan d’actions, basé sur des critères d’évaluation bien précis. En somme, ne s’agit-il pas d’essayer de formuler des objectifs qui collent avec cette prétendue notion de bien-être commun à des personnes issues de différentes cultures ?
Le concept d’adhérents culturellement hétérogènes demeure, en ce sens, essentiel pour la détermination de la mission des organisations opérant dans le domaine politique ou associatif. Pour que ces organisations soient efficaces, il faut, impérativement, cibler une approche à la fois participative et communautaire de la prise de décision, impliquant, de plus en plus et, surtout, de mieux en mieux, de plus en plus précisément, les adhérents dans les activités de l’organisation. Pour qu’ils soient impliqués, ils doivent eux-mêmes sentir le besoin d’appartenir à l’ensemble organisé. D’où l’intégration d’une dimension anarchique de l’organisation de la base partisane ou associative.
L’anarchie consiste, à cet égard, à faire participer, à la prise de décision, toutes les parties prenantes issues de cultures différentes, ayant, en commun, un projet de communauté. Selon Mansour de Grange, le quartier est une bonne illustration de l’anarchie décisionnelle. Dans cette optique, il faudrait, même, dit-il en substance dans son ouvrage de référence , subdiviser les quartiers en sous-systèmes de cinquante à quatre-vingt maisons, pour mieux maîtriser le besoin quotidien de la population, la restriction du nombre autorisant l’effective expression de tous. En suivant cet ordre, la base serait en mesure de résoudre la plus minuscule organisation, permettant de bien cibler les objectifs des petits groupes et d’entreprendre les actions nécessaires pour atteindre ceux-là. On peut même envisager que ces sous-groupes aient le pouvoir d’élire les policiers, les pompiers, etc.
Parties prenantes, l’Etat et les bailleurs de fonds, financiers des projets du sous-groupe, assisteraient à la réunion, participant à la prise de décision et laissant les personnes les plus proches de la base prendre en charge la gestion de la « cité-miniature ».
Pour les partis politiques, l’intégration de cette approche s’avère difficile. Car l’idéologie et la domination des clans, qui guident ces organisations, ne sont que rarement une source d’union basique. En tout état de cause, chaque fois que le groupe s’élargit vers un ensemble plus grand, la situation se complexifie. Le but commun doit donc être le socle de l’organisation du parti politique, de la commune, de l’association, du département administratif, etc. Par ailleurs, si l’on se borne à penser que le but d’une telle organisation se limite à répondre à des préoccupations décisionnelles au niveau hiérarchique, l’évaluation de l’action de l’ensemble organisé devient difficile.
Par conséquent, nous pouvons affirmer que les organisations à but non-lucratif appartiennent au système qu’imposent certaines règles, en fonction d’un but qui n’est pas, forcément, partagé par l’ensemble des intervenants politiques ou associatifs. Mais, il doit y avoir quelque chose, au fond de la base organisée – et cela, d’une manière spontanée – qui la pousse à s’émanciper : la diversité culturelle, basée sur une approche communautaire valorisant les comités de quartiers ?
Source : Acte du colloque International sur l’Education et l’apport des médias dans la Promotion de la diversité culturelle / Publication commune entre l’Ecole Normale Supérieure et l’Institut Mauritanien de Recherche Scientifique
Références bibliographiques
-Encyclopaedia Universalis, 2004
-Le réel et l’imaginaire dans la politique, l’art et la science », notes de la huitième Rencontre internationale de Carthage ( 8-13 mars 2004), rencontre organisée par l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Edition Beït al Hikma, 2005.
-Contribution de la Communauté Urbaine de Nouakchott, AIMF, 31ième assemblée générale, Erevan, Octobre 2011
-Les Cahiers de l ‘Histoire, « l’Afrique des origines à la fin du 18ème siècle », 1966
-www.barrada.unblog.fr
-www.actualitix.com
-La Tribune n° 401
-Ian Mansour de Grange, « Le waqf, outil de développement durable ; la Mauritanie, fécondité d’une différence manifeste » – Editions de la Librairie 15/21, Nouakchott, 2012.
——————————
(1) Encyclopaedia Universalis 2004
(2) En paraphrasant Lidia Tarentini, répondre à ces questions permet à chacun d’entre nous de se donner un sens, c’est le récit d’un « roman communautaire », qui nous rend humain, voir « Le réel et l’imaginaire dans la politique, l’art et la science », notes de la huitième Rencontre internationale de Carthage ( 8-13 mars 2004), rencontre organisée par l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Edition Beït al Hikma, 2005, p 468.
(3) Voir Les Cahiers de l ‘Histoire, « l’Afrique des origines à la fin du 18ème siècle », 1966, PP 61, 62 et 63
(4) Contribution de la Communauté Urbaine de Nouakchott, AIMF, 31ième assemblée générale, Erevan, Octobre 2011
(5) Salah Hadj, « Le réel et l’imaginaire dans la politique, l’art et la science », notes de la huitième Rencontre internationale de Carthage, op.cit., p 70.
(6) Selon l’humaniste Roger Nifle, cité par Mohamed Fouad Barrada, in le journal « La Tribune » (Mauritanie) – (http://barrada.unblog.fr/2009/06/15/les-echos-de-la-tribune-par-mohamed-fouad-barrada-51/ – et, pour plus de précisions, voir « Le Sens du bien commun. Pour une compréhension renouvelée des communautés humaines », Paris, Temps Présent, juin 2011
(7) Idem
(8) idem
(9) D’après les statistiques le nombre d’internautes, en Mauritanie, ne dépasse guère 100 000 utilisateurs, soit quelque 3 % de la population totale (pour plus de précisions voir http://www.actualitix.com/base-de-donnees/fr/1_utilisateurs-d-internet-dans-le-monde.php).
(10) Mohamed Fouad Barrada, Barrada.unblog.fr
(11) C’est-à-dire l’intérêt général à travers la justice sociale
(12) Cité par Mohamed Fouad Barrada, in la Tribune Mauritanie n° 401
(13) Ian Mansour de Grange, « Le waqf, outil de développement durable ; la Mauritanie, fécondité d’une différence manifeste » – Editions de la Librairie 15/21, Nouakchott, 2012.
CRIDEM