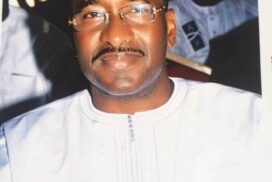Monthly Archives: March 2016
Une approche communautaire de la diversité culturelle mauritanienne/ Par Mohamed Fouad Barrada, enseignant-chercheur

Plus récemment, l’exode rural a favorisé l’émergence de grands ensembles culturels dans les zones urbaines – comme la ville de Nouakchott qui regroupe, selon le dernier recensement, le tiers de la population – où l’interdépendance centre-périphérie représente une nouvelle clé de lecture du brassage culturel qui caractérise, aujourd’hui, la société mauritanienne.
Cependant, les rapports entre les ensembles sociaux du centre et de la périphérie, demeurent caractérisés, dans une certaine mesure et malgré une part de communauté d’intérêts, par des tensions intercommunautaires accentuées par l’instrumentalisation, sous toutes ses formes, de la culture (langues nationales, langue d’Etat, etc.).
Sous la pression de la pauvreté, la conditionnalité économique relègue la culture au second plan. Faut-il, alors, développer une approche communautaire de la diversité culturelle, pour préserver l’apport distinct de chaque groupe social, et encourager les démarches novatrices et culturellement appropriées aux aspirations et aux perspectives propres à chaque ensemble ?
Il apparaît clairement, et c’est la thèse que nous soutenons ici, que la culture « ne peut s’incarner » dans l’originalité, « comme source d’innovation et de créativité », qu’à travers la reconnaissance de l’identité culturelle de chaque communauté mauritanienne, dans une approche démocratique.
On entendra, ici, que la démocratie communautaire est le socle impératif et nécessaire, pour dépasser le blocage politique, si prégnant en Mauritanie. Celui-ci n’est, de fait, qu’une manifestation de l’amère réalité de la pauvreté, source de déstabilisation sociale de notre République. A sa racine, un fonctionnement communautaire négativement exploité et intégrant, difficilement, les principes de la liberté responsable, permettant de reconnaître la dignité et la fraternité. Mais cette démocratie relève de notre héritage spécifique, basé sur l’expérience de notre passé, enrichi par le mode organisationnel des instances et institutions démocratiques internationales. D’où la question du but organisationnel des instances politiques et de son interaction avec l’organisation sociétale en communauté.
Introduction
Qu’adviendrait-il, si chaque communauté se repliait sur elle–même ? Cette question liminaire en appelle une autre, en amont : Qu’est-ce qu’une communauté ? « L’habitude et le langage scientifique, courant mais encore imprécis, veulent qu’on désigne cette forme de vie – au sens le plus large du terme – à partir du vocable « famille » : communauté de familles, communauté familiale. Ou, toujours en référence à la famille : famille étendue, joint family. Ou, en référence à seulement une des formes de la communauté : hauskommunion (« communion » domestique). Comme si la seule famille-type était la famille conjugale qui, unie à l’autre de même diamètre et de même nature, formerait, par extension verticale et horizontale, une communauté familiale ».
Si, par nature, c’est la préservation de la domination d’une majorité ou d’une minorité qui compte, pour certains, en matière de diversité culturelle, pour d’autres en revanche, c’est l’acceptation de l’autre qui prime, avec la spécificité propre de sa communauté. Mais cette unicité ne peut exister que si les individus s’inscrivent dans une histoire communautaire, dans une suite ordonnée de filiales et de nominations qui les décrivent : qui sommes-nous, par rapport aux autres ; d’où venons-nous, qui nous précède?
Dans cette étude, on présentera, contrairement donc à la tradition, la communauté, au sens large du terme, d’une part, et, d’autre part, l’intercommunalité, au sens spécifique, à travers une transposition sur le cas mauritanien. Il s’agit, ici, d’orienter la réflexion sur un groupe social ou une communauté de quartier ou des collectivités territoriales, partageant un intérêt commun.
C’est, en effet, là que la question de la valorisation de l’intérêt commun se pose avec le plus d’acuité, d’où la recherche des formes organisationnelles les plus adaptées pour une meilleure cohésion sociale, dans des espaces regroupant, banalement, plusieurs cultures différentes, avec, quasiment partout, en Mauritanie, un unique dénominateur commun : l’islam.
La présente communication vise donc à aborder la question de la diversité culturelle dans une approche systémique. C’est-à-dire une approche communautaire vivante, complexe, en mouvement, tenant compte du milieu des groupes sociaux et de leurs interactions, dans des structures à la fois organisées et désorganisées.
I- Diversité culturelle et communauté
La Mauritanie, dont les habitants sont, en quasi totalité, des musulmans sunnites de rite malékite, est perçue comme un lieu de convergence de divers courants de civilisations résultant, notamment, des empires, du Ghana, du Mali, et des Almoravides.
Les conditions naturelles notamment l’exode rural ont favorisé l’émergence de grands ensembles culturels dans ses zones urbaines. C’est le cas de Nouakchott qui regroupe, selon le dernier recensement, le tiers de la population. Là encore, la dichotomie centre-périphérie représente une nouvelle clé de lecture. On peut opposer, dans cette perspective, deux dimensions de la ville la plus peuplée du pays : d’une part, Nouakchott des périphéries et, d’autre part, Nouakchott du centre, plus moderne à travers ses édifices administratifs et ses villas qui regroupent les composantes culturelles dotées d’un niveau de vie élevé.
Cependant, les ensembles communautaires du centre et de la périphérie ne partagent que rarement l’intérêt commun, d’où la fréquence des tensions intercommunautaires, accentuées par l’instrumentalisation, sous toutes ses formes, de la culture (langues nationales, langue d’Etat, etc.). De fait, c’est sous la pression de la pauvreté que la conditionnalité économique relègue la culture au second plan.
Cette conditionnalité économique est appréhendée comme la résultante d’une défaillance du système de production et de prestation de services, tout à la fois renforçant et renforcé par la solidarité ethnique et tribale. Cette tendance se confirme, de plus en plus, sur l’ensemble du pays. Il semble bien qu’il existe, en Mauritanie, une corrélation, inversée, entre la position et la puissance de l’Etat et celles de la tribu. Plus la solidarité est forte, entre les membres de la tribu, plus le rôle de l’Etat est faible. Cette dialectique s’exprime dans une attitude d’intolérance à l’égard de l’autre, qui prend place dans une thèse portant spécifiquement sur la culture.
Face à ce châtiment qui diffame l’identité de l’autre, en la rejetant ou en l’instrumentalisant, nous trouvons, pourtant, l’attitude inverse qui accorde, à la diversité culturelle, le rôle inventeur de la cohésion sociale, à travers, notamment, des Comités de Concertation Communale (ou CCC) qui s’inscrivent, à titre d’illustration, dans le cadre d’un partenariat entre la Communauté Urbaine de Nouakchott et les neuf communes de la ville visant, ainsi, à renforcer les liens de proximité entre les élus, leurs services et leurs citoyens.
« Composés de plusieurs collèges (élus, services déconcentrés, société civile), les CCC sont toujours présidés par le maire qui nomme un secrétaire général parmi les membres de la société civile. Aussi, le Comité de Concertation Communale se définit-il comme un espace de dialogue pérenne (car fruit d’une délibération communale), entre les élus, d’une part, et la population de la commune, d’autre part. Instance consultative, le CCC aide et conseille le conseil municipal, dans sa gestion des affaires de la commune, par ses recommandations et propositions » . Important appui du conseil municipal, dans son processus de réflexion et de décisions prioritaires, il est notamment précieux dans le domaine socioculturel.
C’est sur ce constat qu’il nous faut, à présent, examiner l’éventuelle nécessité, sur le plan politique, d’une démocratie communautaire.
II – De la réforme collective
En cette occurrence, il faut, tout d’abord, ne jamais perdre de vue qu’en l’un ou l’autre excès de la dialectique évoquée tantôt, c’est toujours d’identité et de culture qu’il est question. Que le monde soit appauvri ou saturé par ses effets, cela prouve qu’en certaines circonstances, la culture est une arme à double tranchant. Voilà pourquoi faut-il recourir à une nature propre, valorisant la diversité, à travers l’interaction entre les différentes identités ethniques vivant dans un même espace urbain.
Imagination artistique, la culture devrait, ainsi, « retrouver une nature propre qui l’apparente à la lumière, son rôle spécifique de filage symbolique de l’unité du monde, sa fonction, centrale, de médiation entre l’intérieur et l’extérieur ; autrement dit, sa fonction réflexive qui exprime le double caractère, subjectif et objectif, de notre rapport au monde. Ni mélange ni séparation mais un monde chiral de rapports, un entrelacs de l’intérieur et de l’extérieur » . Telle démarche suppose, semble-t-il, l’organisation d’une démocratie communautaire « politiquement correcte », axée sur des élections « sélectives pour désigner l’autorité repère du Sens du bien commun ».
Et reposant, sur le plan économique, sur « la production et l’échange de biens et de services, au sein d’une communauté d’enjeux. Les valeurs économiques se mesurent sur les échelles de valeurs, caractérisant le Sens du Bien commun et ses valeurs de références. Elle suppose des régulations communautaires, intra- et intercommunautaires. » Culturellement, « chaque groupement tribal est appelé à développer ses modes de vie selon sa culture et à cultiver ses potentiels et ses talents, selon une vocation propre, au service de l’accomplissement des personnes et des groupes qui le constituent. Il est appelé à un développement approprié et, donc, durable, en cultivant les valeurs qui expriment son Sens du Bien commun ».
Dès lors, on entend en quoi la démocratie communautaire constitue une clé, sinon suffisante, du moins nécessaire, du déblocage politique. A cet égard, les canaux de diffusion de l’information, tels que les réseaux sociaux ou autres supports électroniques – notamment les GSM – représentent, à notre avis, une autre clé de lecture barométrique permettant d’apprécier l’efficacité, voire l’efficience, des médias, à travers la participation des citoyens . Cependant, si les politiques sont fortement déterminées par des intentions individuelles, guidées par les intérêts de certains groupes restreints, instrumentalisant leurs communautés appelées à véhiculer leurs intentions, en s’appuyant sur divers instruments – les médias, la technologie d’information, etc. – les autres communautés opteront, évidement, pour la confrontation.
Il s’agit, ici, de mettre en évidence la relation, très complexe, entre des vecteurs de transmission (numérisation innovatrice) de l’information, d’une part, et, d’autre part, des modes de fonctionnement sociétal, appropriés ou désappropriés, utiles ou inutiles à la bonne gouvernance communautaire. De fait, « le contrôle citoyen de l’action publique » voire communautaire constitue un mécanisme valorisant la bonne gouvernance. Mais des zones d’ombre subsistent : « le contrôle est-il un pouvoir qui doit être exercé par le citoyen ou est-il, tout simplement, quelque chose de donné ? ».
Il semble clair qu’un tel contrôle ne peut aucunement s’exercer sans des structures organisationnelles et citoyennes bien spécifiques, nanties de vocations existentielles pour préserver leur intérêt commun et, à travers elles, la société.
III Perspectives organisationnelles de la vie en communauté
Tenant compte de la question du but organisationnel des instances politiques du pays, son interaction, avec l’organisation sociétale en communauté, s’impose-t-elle ? Et, si l’on suppose qu’« il y a bien un but », peut-on admettre qu’« il n’existe aucun chemin qui y mène ? ».Franz Kafka en était persuadé mais on peut, à bon droit, penser le contraire.
De fait, la problématique du but organisationnel n’est toujours pas tranchée. En principe, la difficulté consiste à déterminer si les organisations ont des buts ou si cela concerne, seulement, leurs membres. Certes, les individus peuvent se ressembler, au sein d’une même organisation, parce qu’ils partagent le même but, mais il se peut que chacun des membres entretienne une vision différente, ce qui rend le processus d’élaboration d’un but commun plus complexe. « Le but des organisations (politiques ou associatives) serait-il d’assurer le bien-être de la population ou les intérêts de certains groupes d’influences communautaires ? » Dans tous les cas, comment évaluer un tel but ?
Ceci nous renvoie à la définition exacte du but. En toute « logique », définir un but amène à se demander le pourquoi de l’existence de l’ensemble organisé et déterminé, puis à déterminer les facteurs-clés de sa réussite, afin d’élaborer un plan d’actions, basé sur des critères d’évaluation bien précis. En somme, ne s’agit-il pas d’essayer de formuler des objectifs qui collent avec cette prétendue notion de bien-être commun à des personnes issues de différentes cultures ?
Le concept d’adhérents culturellement hétérogènes demeure, en ce sens, essentiel pour la détermination de la mission des organisations opérant dans le domaine politique ou associatif. Pour que ces organisations soient efficaces, il faut, impérativement, cibler une approche à la fois participative et communautaire de la prise de décision, impliquant, de plus en plus et, surtout, de mieux en mieux, de plus en plus précisément, les adhérents dans les activités de l’organisation. Pour qu’ils soient impliqués, ils doivent eux-mêmes sentir le besoin d’appartenir à l’ensemble organisé. D’où l’intégration d’une dimension anarchique de l’organisation de la base partisane ou associative.
L’anarchie consiste, à cet égard, à faire participer, à la prise de décision, toutes les parties prenantes issues de cultures différentes, ayant, en commun, un projet de communauté. Selon Mansour de Grange, le quartier est une bonne illustration de l’anarchie décisionnelle. Dans cette optique, il faudrait, même, dit-il en substance dans son ouvrage de référence , subdiviser les quartiers en sous-systèmes de cinquante à quatre-vingt maisons, pour mieux maîtriser le besoin quotidien de la population, la restriction du nombre autorisant l’effective expression de tous. En suivant cet ordre, la base serait en mesure de résoudre la plus minuscule organisation, permettant de bien cibler les objectifs des petits groupes et d’entreprendre les actions nécessaires pour atteindre ceux-là. On peut même envisager que ces sous-groupes aient le pouvoir d’élire les policiers, les pompiers, etc.
Parties prenantes, l’Etat et les bailleurs de fonds, financiers des projets du sous-groupe, assisteraient à la réunion, participant à la prise de décision et laissant les personnes les plus proches de la base prendre en charge la gestion de la « cité-miniature ».
Pour les partis politiques, l’intégration de cette approche s’avère difficile. Car l’idéologie et la domination des clans, qui guident ces organisations, ne sont que rarement une source d’union basique. En tout état de cause, chaque fois que le groupe s’élargit vers un ensemble plus grand, la situation se complexifie. Le but commun doit donc être le socle de l’organisation du parti politique, de la commune, de l’association, du département administratif, etc. Par ailleurs, si l’on se borne à penser que le but d’une telle organisation se limite à répondre à des préoccupations décisionnelles au niveau hiérarchique, l’évaluation de l’action de l’ensemble organisé devient difficile.
Par conséquent, nous pouvons affirmer que les organisations à but non-lucratif appartiennent au système qu’imposent certaines règles, en fonction d’un but qui n’est pas, forcément, partagé par l’ensemble des intervenants politiques ou associatifs. Mais, il doit y avoir quelque chose, au fond de la base organisée – et cela, d’une manière spontanée – qui la pousse à s’émanciper : la diversité culturelle, basée sur une approche communautaire valorisant les comités de quartiers ?
Source : Acte du colloque International sur l’Education et l’apport des médias dans la Promotion de la diversité culturelle / Publication commune entre l’Ecole Normale Supérieure et l’Institut Mauritanien de Recherche Scientifique
Références bibliographiques
-Encyclopaedia Universalis, 2004
-Le réel et l’imaginaire dans la politique, l’art et la science », notes de la huitième Rencontre internationale de Carthage ( 8-13 mars 2004), rencontre organisée par l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Edition Beït al Hikma, 2005.
-Contribution de la Communauté Urbaine de Nouakchott, AIMF, 31ième assemblée générale, Erevan, Octobre 2011
-Les Cahiers de l ‘Histoire, « l’Afrique des origines à la fin du 18ème siècle », 1966
-www.barrada.unblog.fr
-www.actualitix.com
-La Tribune n° 401
-Ian Mansour de Grange, « Le waqf, outil de développement durable ; la Mauritanie, fécondité d’une différence manifeste » – Editions de la Librairie 15/21, Nouakchott, 2012.
——————————
(1) Encyclopaedia Universalis 2004
(2) En paraphrasant Lidia Tarentini, répondre à ces questions permet à chacun d’entre nous de se donner un sens, c’est le récit d’un « roman communautaire », qui nous rend humain, voir « Le réel et l’imaginaire dans la politique, l’art et la science », notes de la huitième Rencontre internationale de Carthage ( 8-13 mars 2004), rencontre organisée par l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Edition Beït al Hikma, 2005, p 468.
(3) Voir Les Cahiers de l ‘Histoire, « l’Afrique des origines à la fin du 18ème siècle », 1966, PP 61, 62 et 63
(4) Contribution de la Communauté Urbaine de Nouakchott, AIMF, 31ième assemblée générale, Erevan, Octobre 2011
(5) Salah Hadj, « Le réel et l’imaginaire dans la politique, l’art et la science », notes de la huitième Rencontre internationale de Carthage, op.cit., p 70.
(6) Selon l’humaniste Roger Nifle, cité par Mohamed Fouad Barrada, in le journal « La Tribune » (Mauritanie) – (http://barrada.unblog.fr/2009/06/15/les-echos-de-la-tribune-par-mohamed-fouad-barrada-51/ – et, pour plus de précisions, voir « Le Sens du bien commun. Pour une compréhension renouvelée des communautés humaines », Paris, Temps Présent, juin 2011
(7) Idem
(8) idem
(9) D’après les statistiques le nombre d’internautes, en Mauritanie, ne dépasse guère 100 000 utilisateurs, soit quelque 3 % de la population totale (pour plus de précisions voir http://www.actualitix.com/base-de-donnees/fr/1_utilisateurs-d-internet-dans-le-monde.php).
(10) Mohamed Fouad Barrada, Barrada.unblog.fr
(11) C’est-à-dire l’intérêt général à travers la justice sociale
(12) Cité par Mohamed Fouad Barrada, in la Tribune Mauritanie n° 401
(13) Ian Mansour de Grange, « Le waqf, outil de développement durable ; la Mauritanie, fécondité d’une différence manifeste » – Editions de la Librairie 15/21, Nouakchott, 2012.
CRIDEM
Comment nos Communes Rurales peuvent développer la Mauritanie ?
 Ce théme s’apparente avec celui du colloque international intitulé : Comment le secteur rural développe les villes urbaines? organisée en 1988 par l’USAID à Abidjan à laquelle j’avais participée en compagnie du Ministre Sow Deyna et Sarr Mamadou en ma qualité de représentant des Agriculteurs de Mauritanie..
Ce théme s’apparente avec celui du colloque international intitulé : Comment le secteur rural développe les villes urbaines? organisée en 1988 par l’USAID à Abidjan à laquelle j’avais participée en compagnie du Ministre Sow Deyna et Sarr Mamadou en ma qualité de représentant des Agriculteurs de Mauritanie..
7ème partie du témoignage de Salah Ould Hanana «Témoin d’une époque » Al Jazeera : Coup d’état de 2004, entre traîtrise et amateurisme
 Dans cette 7ème partie de «Témoin d’une époque, l’ère des coups d’état en Mauritanie » diffusée par Al Jazeera avec le témoignage de l’ancien commandant Salah Hanana, ce dernier y relate les péripéties du coup d’état avorté de 2004, qui ne serait que la suite du putsch manqué du 8 juin 2003.
Dans cette 7ème partie de «Témoin d’une époque, l’ère des coups d’état en Mauritanie » diffusée par Al Jazeera avec le témoignage de l’ancien commandant Salah Hanana, ce dernier y relate les péripéties du coup d’état avorté de 2004, qui ne serait que la suite du putsch manqué du 8 juin 2003.
Ce récit est plein de mélancolie et d’amertume, face à la traîtrise et à l’amateurisme qui ont émaillé cette tentative tuée dans l’œuf, avec son lot de drame et la fin de l’équipée des «Cavaliers du Changement » et de ses ailes politiques et civiles.
Le récit commence par ce que Salah Ould Hanana décrit comme l’intrusion des Etats-Unis dans la crise qui avait suivi le coup d’état manqué du 8 juin 2003 contre Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya, l’allié dans la lutte contre le terrorisme de l’Oncle Sam. En effet, les Etats-Unis avaient accusé les «Cavaliers du Changement » d’avoir des accointances avec le mouvement salafiste djihadiste au Sahel.
Leur ambassadrice au Burkina Faso aurait même demandé au président Blaise Compaoré de les livrer pour activités terroristes. Ce que le président burkinabé, contrairement à d’autres dirigeants musulmans qui ont livré leurs compatriotes musulmans aux services américains, aurait refusé, selon Salah.
Blaise aurait exigé auprès de l’ambassadrice des preuves tangibles incriminant les salafistes dont elle demandait la remise à ses autorités, ainsi que le bien-fondé des soupçons qui pèseraient sur l’une des mosquées de Ouaga, qualifiée de gîte pour salafisites radicaux. Pour Salah Ould Hanana, c’était-là le cadeau que les Etats-Unis voulaient offrir à Ould Taya, sans succès, face au refus du président du Faso de se plier à leur exigence.
Le journaliste Ahmed Mansour qui menait l’interview mentionnera la lettre que Ould Taya avait adressée à l’OTAN le 17 septembre 2003 et où il offrait sa franche collaboration avec l’instance nord atlantique. Mieux, Salah dira que cette information ne faisait que confirmer l’intrusion américaine dans le dossier de la crise post-coup d’état en Mauritanie à cette époque.
Nouakchott démantèle le réseau intérieur sur une bourde de Mohamed Cheikhna
Le 9 août 2004, une vingtaine de soldats sont arrêtés, accusés de liens avec les «Cavaliers du Changement ». Salah reconnaîtra l’existence d’une cellule dormante au sein de l’institution militaire qui coordonnait les préparatifs d’un autre coup d’état en préparation avec les cerveaux, Salah Ould Hanana et ses compagnons, exilés en Côte d’Ivoire. Salah parlera d’une création, dès décembre 2003, d’un cadre politique du mouvement, le Front national. La structure militaire, formée par les officiers en exil, était renforcée par d’autres officiers toujours tapis au sein de l’armée, sous la houlette des commandants, Mohamed Lemine Ould Waer, Habib Ebou Mohamed, Mohamed Vall Ould Hendeya, et Ahmed Ould MBareck.
Ainsi, le rôle combiné de l’aile politique, de l’aile militaire et de l’aile civile ainsi que le rôle prépondérant joué par l’Observatoire mauritanien des droits de l’homme, démontreraient selon Ould Hannana, le degré d’impopularité au sein de l’armée et de la population du régime de Ould Taya. Cette masse de répulsion, dira-t-il, a été résumée dans un poème de Mohamed Ahid Sidi Mohamed dont il lira d’ailleurs les premiers strophes.
A la mi-août 2004, 53 militaires sont arrêtés, dont 13 commandants et 15 capitaines, tous de la ville d’Aioun et de la tribu des Oulad Naçer, comme les principaux auteurs du putsch manqué du 8 juin 2003, dont Salah Hanana. Toutes ces personnes ont été arrêtées selon Ould Hanana à cause de l’imprudence de Mohamed Ould Cheikhna.
Celui-ci aurait été accroché par un certain commandant Mekhalla Ould Mohamed Cheikh, avec qui il échangeait des mails. Mis au courant, le comité des officiers retranchés à Bouaké en Côte d’Ivoire, aurait sommé Ould Cheikhna de cesser ses échanges avec le bonhomme et de l’orienter vers l’un des éléments à Nouakchott. Ce fut Ould Waer. Pour Salah, le chapitre des échanges par Internet entre Ould Cheikhna et Mekhalla était clos. Il apparaîtra plus tard qu’il n’en était, reconnaît-il, amer. Ould Cheikhna avait poursuivi ses échanges jusqu’à fournir à son correspondant la liste complète des militaires impliqués dans le coup, y compris leur nom et leur grade. Il dit ne pas comprendre pourquoi Ould Cheikhna avait agi ainsi.
Et le journaliste Mohamed Mansour de récapituler les impairs causés par le commandant Mohamed Ould Cheikhna dans les deux tentatives de coup d’état, soulignant qu’en 2003 déjà, il n’avait pas respecté les consignes, puisqu’il avait quitté l’état-major qu’il était sensé contrôler pour se rendre à la présidence de la République. Et voilà encore, qu’en 2004, il fournit les noms de l’ensemble des acteurs du coup d’état en préparation, et l’offre sur un plateau d’argent aux Renseignements militaires, «en voulant faire un coup d’état par Internet » ironisa-t-il.
Cette bourde ou cet impair de Ould Cheikhna allait ainsi permettre à l’armée d’arrêter certains éléments qui étaient tapis dans l’ombre. Et c’est le commandant Ahmed MBareck qui travaillait au 2ème Bureau (B2) renseignements militaires qui en informera Salah et ses compagnons dans leur exil de Bouaké, leur fournissant les échanges mails qui s’étaient poursuivis entre Mohamed Ould Cheikhna et Mekhelle, avec les noms. Interrogé, Ould Cheikhna avouera avoir poursuivi ses contacts malgré les promesses qu’il avait faites à ses camarades des les interrompre.
Ce qui est malheureux, dira Salah Hanana, l’œil mélancolique, «beaucoup de ces gens n’avaient même pas de contact avec nous ».
Et le journaliste de répondre, «vous avez détruit des vies et des familles, défait des carrières et nuit à votre pays ». Salah d’acquiescer, vaincu par les évidences. «Nous aussi » répondra-t-il.
Selon Salah, une première cargaison d’armes et de munitions avait déjà été introduite, peu avant ces arrestations.
Ce qui permit à Mohamed Mansour de récapituler : «en 2000, votre première tentative de coup d’état a été déjoué 48 heures avant son exécution ; votre deuxième tentative le 8 juin 2003 a échoué alors que vous étiez parvenu à contrôler les principaux centres névralgiques du pays pendant au moins 16 heures de temps et la 3ème tentative a échoué car Mohamed Ould Cheikhna a offert à Ould Taya sur un plateau d’argent les noms des officiers, sous-officiers et soldats qui devaient exécuter le coup d’état »
Après ces arrestations, Salah qui était à Bamako revient dare-dare à Bouaké pour faire le point avec ses camarades. C’est là où ils ont su que c’est Mohamed Ould Cheikhna le responsable. En ce moment, le nombre de militaires arrêtés, tous grades confondus, était de 179.
Ces arrestations pèseront sur les consciences et créeront une grande pression morale sur Salah et ses compagnons, qui culpabilisaient, selon lui. Les purges au sein de l’armée, constate-t-il, avaient pris un tournant tribal et le régime avait perdu toute crédibilité selon lui, au sein de l’opinion, poussant Ahmed Ould Daddah dans une conférence de presse à déclarer qu’il n’y a pas eu tentative de coup d’état «mais qu’il s’agit d’un complot ourdi par Ould Taya pour justifier un règlement de compte régionaliste et tribal au sein de l’institution militaire contre des officiers dont le seul tort est d’avoir des liens de sang et de parenté avec les auteurs du coup d’état manqué du 8 juin 2003».
Fin de cavale pour Ould Mini
Le 30 juin 2004, le ministre de l’Intérieur, Mohamed Ghali Ould Chrif fait une déclaration radiotélévisée dans laquelle il annonce «que la Mauritanie a déjoué une tentative de coup d’état ; plusieurs militaires ont été arrêtés, dont le capitaine Abderrahmane Ould Mini », un des co-auteurs du putsch manqué de Salah Hanana le 8 juin 2003.
Dans cette partie, Salah Ould Hanana révèlera l’existence d’une aile civile qu’ils entraînaient par groupe de 10 à Bouaké en préparation du coup de 2004. Il parlera du rôle important joué par cette aile civile dans le domaine du renseignement et de l’information, mais aussi de la logistique.
Commentaire du journaliste Mohamed Mansour, «dans toutes ces tentatives, le problème venait des leaders et de leur manque de professionnalisme » insinuant même un manque de responsabilité.
Pour Salah, une autre décision à allure d’aventure allait être prise. Il s’agissait du retour de tous les officiers leaders du coup d’état retranchés jusque-là à Bouaké, en l’occurrence Mohamed Cheikhna, le défunt capitaine Mohamed Salem, le capitaine Ahmed Salem Ould Kaabach, le capitaine Hamoud Ould Baba et le capitaine Ould Mini. Salah et Mini iront à Bamako pour des préparatifs et là, sans aviser leurs autres camarades, ils décident de rentrer seuls à Nouakchott.
Ils passeront de Bamako, par Rosso, et entreront dans le territoire avec des documents maliens mais déjoueront tous les postes de contrôle. L’aile civile leur avait préparé toute la logistique, le gîte et le couvert. C’était par le même circuit, dira-t-il, qu’on avait voulu exfiltrer Mohamed Khouna Ould Haïdalla, mais il aurait désisté par la suite, raconte Salah Hanana.
Ils s’étaient donné une à deux semaines pour réorganiser tout le monde, dira-t-il en substance, notant le rôle du capitaine Ahmed Ould MBareck qui leur avait fourni les informations dont ils avaient besoin.
Salah déclare avoir demandé à Ahmed Ould Dèye, un officier membre du groupe qui était en poste à Aleg, de rentrer à Nouakchott. Il vint dare-dare. Salah dira avoir su plus tard, que Ould Dèye travaillait avec les services de sécurité. Ainsi, les deux rencontres qu’ils ont eu avec lui dont l’une avec Ould Mini, se seraient déroulés sous la surveillance des services de sécurité. Ould Mini fut ainsi pisté dès la fin de son entrevue avec Ould Dèye par des agents, mais ils perdront ses traces. La zone fut quadrillée et une perquisition de porte-à-porte fut déclenchée. Selon Salah, ils seront alertés par de forts tambourinements à la porte. Ils se cachèrent, lui, Ould Mini, et deux civils, le jeune Moulaye Ould Brahim et le chauffeur Sidi Mohamed.
Alors que les deux civils, parviendront à sortir, parce que non recherchés, Ould Mini sera capturé. Salah déclare pour sa part, avoir déniché une petite remise où il se cacha pendant toute la journée. Il profita de la nuit pour sortir, une fois les barrages de police levés.
Salah Ould Hanana sera rejoint par le capitaine Ahmed Ould MBareck du B2. C’est avec lui qu’il tentera de sortir du territoire en passant de nouveau par Rosso. Mais cette fois, toute l’armée et les forces de l’ordre étaient sur le pied de guerre. L’aventure allait-elle s’arrêter là, au bord du fleuve Sénégal à Rosso ? C’est ce que la suite du témoignage de Salah Ould Hanana dans la prochaine édition permettra de révéler.
En conclusion de cette 7ème partie, le journaliste d’Al Jazeera, Ahmed Mansour dira que Salah Ould Hanana et ses amis s’étaient basés sur un seul facteur dans leurs trois tentatives de coup d’état, l’impopularité de Ould Taya, au détriment de l’efficacité.
«Je crois que nous avons pêché par excès de confiance en nous, ensuite par la confiance aveugle et à la bonne intention présumée que nous avons donné aux autres» dira Salah Ould Hanana
l authentique
7e anniversaire de la journée de réconciliation nationale: « COVIRE prêt à concourir et de tout cœur et sans rancune à une réconciliation nationale véritable qui éclaire d’abord les consciences et retient les leçons de la tragédie» , déclare Sy Abou
 Le collectif des victimes de la répression militaire des années 86/91 (COVIRE) a célébré, le vendredi 25 mars, à Sebkha Loisirs, la journée de réconciliation nationale, sous le signe de l’espoir.
Le collectif des victimes de la répression militaire des années 86/91 (COVIRE) a célébré, le vendredi 25 mars, à Sebkha Loisirs, la journée de réconciliation nationale, sous le signe de l’espoir.Nouvelles d’ailleurs : Identités…
 Quand on fait d’une langue une psychothérapie pour « identités en crise » c’est que toute la construction par rapport à soi, à son rapport avec le monde, à sa perception de sa place dans le concert mondial, à ce que l’on désire pour bâtir un État Nation, etc, n’en sont même pas au début du tout début.
Quand on fait d’une langue une psychothérapie pour « identités en crise » c’est que toute la construction par rapport à soi, à son rapport avec le monde, à sa perception de sa place dans le concert mondial, à ce que l’on désire pour bâtir un État Nation, etc, n’en sont même pas au début du tout début.
La Semaine de la Francophonie vient de se terminer. Pas le concert habituel de critiques à l’encontre du français. Comme si nous ne pouvions, tout englués que nous sommes dans une orthodoxie intellectuelle, ne concevoir notre rapport aux langues, donc à nous mêmes, autrement que via le prisme politique, donc idéologique, donc doxa, donc artificiel…
Comme si, aussi, le seul regard que nous puissions porter sur la place et le rôle d’une langue ne puisse se faire que dans le conflit, dans l’opposition systématique entre deux langues, l’une étant, automatiquement, « l’ennemie », l’autre , la seule permise et acceptable.
Peut-on, doit-on faire d’une langue une construction réduite à la seule identité ?
Le français est -il seulement identité ? Quand une partie du monde s’est appropriée cette langue, véhicule-t-il, de fait, une identité « française » ?
L’arabe est-il seulement, là encore, identité ? Entre le fantasme de la Nation Arabe, l’usage d’une langue arabe littéraire réservée aux élites et les langues pratiquées par les citoyens de ce monde dit arabe, où est l’identité ?
Quelles identités pour quelles langues ? Ou, plutôt, quelles langues pour quelles identités ?
Et qu’est ce que l’identité ? Une langue ? Une manière de vivre ? Un ensemble de valeurs communes autour desquelles s’agglomèrent des cultures différentes ou semblables ? Une perception du monde?
Une langue est-elle religion ?
Une langue, en dehors de tout ce dont on la charge, est un peu tout cela. Elle est, d’abord, phonèmes afin de communiquer. Elle est outil de communication, premier lien entre les hommes. Elle permet de nommer le monde, de codifier, de mettre en sons et, plus tard, en mots et/ou écritures (toutes les langues ne sont pas écrites), ce qu’une culture, à un moment donné, dans un espace défini, perçoit comme étant son rapport au monde qui l’entoure. Elle est celui qui donne et celui qui reçoit ce langage.
Quand les ultra nationalistes arabes de chez nous crient au scandale face au français, quand ils ne réduisent cette langue française qu’à des considérations politiques, ils font preuve d’étroitesse intellectuelle, de misérabilisme, de sécheresse, d’aveuglement.
Ils sont dans la posture « complexés » d’une arabité mal comprise, mal pensée, mal véhiculée.
Et, à force de ne réduire l’arabe qu’à un fantasme de Nation Arabe, ils en viennent à rendre cette langue arabe quasi hideuse. Alors qu’elle est langue magnifique, langue de culture, langue des savants, langue de la poésie.
Elle n’est pas qu’instrument politique afin de bâtir ce que personne, jusqu’à aujourd’hui, n’a encore réussi à construire, nonobstant les réflexions des intellectuels du monde arabe, à savoir un « monde arabe ».
Monter une langue contre une autre, opposer farouchement deux langues, vouloir en éradiquer une coûte que coûte afin de n’apposer sur une société qu’une vision d’une seule langue parlée, formatant ainsi la pensée, est d’une stupidité terrible.
Et dangereuse…
Laminer le métissage, penser que l’on peut effacer le passé par le biais du massacre systématique d’une langue dite étrangère, rend la langue des détracteurs du français franchement odieuse.
Car instrument politique et idéologique.
Nul ne nie que le français est langue des colons. Comme l’arabe le fut il y a quelques siècles, apporté dans les bagages des Hassan. Ce qui ne l’a pas empêché d’être absorbé par les populations berbères qui vivaient ici. Le fait que c’est la langue du Coran a facilité cette appropriation de l’arabe par les populations vaincues.
L’arabe n’appartient pas aux élites nationalistes. Le français n’appartient pas aux francophiles.
Ces deux langues sont mémoires communes, quoi que l’on dise, quoi que l’on détricote au niveau de l’Histoire et de la mémoire.
Nous n’avons pas, nous ne devrions pas, avoir à rougir de ces deux langues. Et surtout pas de la langue française.
Une nation qui ne se crée que dans une identité partiale n’a aucun avenir. Une nation qui n’utilise sa langue que comme instrument d’opposition par rapport à une ou plusieurs autres langues est appelée à atteindre très vite ses limites.
Nous ne pouvons plus n’employer que le « JE » réducteur et oublier le « NOUS » qui est le propre de l’ouverture aux autres.
Faire d’une langue un instrument de domination idéologique rend cette propre langue infâme et vidée de son sens, de sa beauté, de ses particularités.
Le chauvinisme linguistique n’est pas avenir. Il est assemblage hétéroclite de fantasmes d’un passé que l’on brode à la hauteur des soubresauts actuels.
Une identité qui « tue » la diversité linguistique, qui fait d’une langue son bras armé pour justifier des positionnements politiques est une identité étroite, repliée, sclérosée…
Je reste persuadée que l’arabe et le français sont langues nationales chez nous, par le fait de l’Histoire.
Je reste intimement convaincue que ces deux langues racontent nos histoires communes, qu’elles sont sœurs et qu’elles ne peuvent que nous enrichir et s’enrichir.
L’arabe est une langue si belle, si riche, si profonde, si fascinante. Il n’appartient pas aux ultras nationalistes arabes. Il n’appartient pas à ceux qui le réduisent à sa forme la plus xénophobe.
Le français nous enrichit de sa diversité, de ses concepts, de sa « mondialité ». Il nous ouvre au monde. Il nous permet de penser « Nous », en communiquant et en vivant aux côtés de l’arabe.
Amin MAALOUF : « A l’ère de la mondialisation, avec ce brassage accéléré, vertigineux, qui nous enveloppe tous, une nouvelle conception de l’identité s’impose – d’urgence ! Nous ne pouvons nous contenter d’imposer aux milliards d’humains désemparés le choix entre l’affirmation outrancière de leur identité et la perte de toute identité, entre l’intégrisme et la désintégration.
Or, c’est bien cela qu’implique la conception qui prévaut encore dans ce domaine. Si nos contemporains ne sont pas encouragés à assumer leurs appartenances multiples, s’ils ne peuvent concilier leur besoin d’identité avec une ouverture franche et décomplexée aux cultures différentes, s’ils se sentent contraints de choisir entre la négation de soi et la négation de l’autre, nous serons en train de former des légions de fous sanguinaires, des légions d’égarés. »
( Extrait de « Les identités meurtrières »)
Salut.
Mariem Mint Derwich
le calame