Daily Archives: 24/10/2014
VINGT ANS DE GOUVERNANCE A LA TETE DU SENEGAL Abdou Diouf, entre ombres et lumières
 A la tête du Sénégal pendant 20 ans, l’ancien président Abdou Diouf a vécu les plus grandes difficultés qu’il ait été donné à un chef de l’Etat sénégalais d’affronter. Entre les graves contradictions internes au Parti socialiste que Senghor venait de lui offrir, l’instauration du multipartisme intégral, la libéralisation des ondes, les crises avec la Gambie et la Mauritanie, l’ajustement structurel, la dévaluation du franc Cfa, etc., Diouf aura marqué son époque.
A la tête du Sénégal pendant 20 ans, l’ancien président Abdou Diouf a vécu les plus grandes difficultés qu’il ait été donné à un chef de l’Etat sénégalais d’affronter. Entre les graves contradictions internes au Parti socialiste que Senghor venait de lui offrir, l’instauration du multipartisme intégral, la libéralisation des ondes, les crises avec la Gambie et la Mauritanie, l’ajustement structurel, la dévaluation du franc Cfa, etc., Diouf aura marqué son époque.
A quelques encablures de la fin de son dernier mandat à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie, EnQuête revient sur une gouvernance pas si banale que cela.
Aimé ou détesté, Abdou Diouf a de la chance : on lui reconnaît un certain statut d’«homme d’Etat». A 79 ans, l’ancien président de la République du Sénégal, éternellement placide, est sans doute un quidam comblé. Après plusieurs années passées à la tête de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), il s’apprête à passer le témoin, heureux d’avoir fait trois mandats successifs. Fort d’une riche carrière administrative et politique, ce natif de la région de Louga aura posé ses empreintes dans l’histoire du Sénégal indépendant. Mais son bilan est globalement jugé «mitigé». Loin d’être un long fleuve tranquille, son règne aura cumulé les bons et les mauvais points.
Multipartisme intégral
Arrivé au pouvoir le 1er janvier 1981 à la faveur de l’article 35 – qui faisait de lui Premier ministre le dauphin constitutionnel du président Senghor – Diouf a grandement contribué à l’ouverture démocratique au Sénégal. De quatre courants idéologiques tolérés par son mentor et prédécesseur, le pays passera, avec lui, au régime du multipartisme intégral, rappelle Abdoulaye Ndiaga Sylla, journaliste, et formateur à l’ISSIC. A ce propos, il retient encore cette fameuse phrase imagée lâchée à l’époque par Diouf. ’’Jakka jaa ngook, ku meuna nodd nodal’’ (L’arène politique est ouverte ; quiconque veut créer un parti est libre de le faire).
Et plus ou moins concomitamment, il a eu le courage de siffler «la fin du centralisme démocratique», explique Cheikh Sèye, secrétaire permanent du Ps et contemporain du deuxième président sénégalais. Mais Abdoulaye Ndiaga Sylla déplore les ‘’effets pervers’’ de cette ouverture démocratique. Celle-ci s’est traduite en effet par une floraison de partis politiques. «Aujourd’hui, constate-t-il, n’importe qui peut créer un parti politique. Cela n’aide pas à la visibilité du jeu démocratique et favorise plutôt la transhumance.»
Des avancées, le Sénégal en a connues au plan social. Selon Abdoulaye Ndiaga Sylla, Diouf a favorisé la naissance des syndicats (CNTS, Synpics, entrée en vigueur de la convention collective des journalistes). Et surtout, il a mis fin au «monopole de l’information» par l’Etat central à travers ses organes de presse. Ainsi, à partir des années 90, «Sud Fm» du Groupe Sud Communications devient la première radio privée à émettre au Sénégal.
Guerre interne fratricide
En dépit de ces acquis, le magistère d’Abdou Diouf sera parsemé d’embûches. Ses principaux déboires découleront de sa gestion du PS dont les prémices étaient perceptibles dès sa prise pouvoir, selon une source digne de foi. ‘’La première chose qu’il a faite à son arrivée, c’est d’écarter les barons du parti comme Amadou Cissé Dia, Maguette Lo, Karim Gaye. Il les soupçonnait d’être des pro-Senghor’’, indique notre interlocuteur. C’est que Diouf avait un objectif primordial, qui était de placer des hommes de confiance dans l’appareil du Ps. Ndiaga Sylla confirme mais avec un bémol : «il a ouvert le parti aux autres. C’est ainsi que des jeunes, comme le très brillant Babacar Sine, sont arrivés. Cela a permis au Ps de survivre à Senghor ‘’.
Cependant, à force de vouloir faire main basse sur le parti par l’entremise de ses fidèles, Abdou Diouf finit par braquer certains barons socialistes. C’est le cas de Moustapha Niasse et de Djibo Ka qui, s’opposant à sa volonté de confier les rênes du parti à Ousmane Tanor Dieng, seront exclus du PS. Ce que regrette Doudou Issa Niasse, responsable socialiste à Dakar. ‘’Diouf a commis l’erreur de les avoir évincés du parti pour des raisons de personne. Il voulait se retirer de la tête du parti et être dans une position d’arbitre. Mais il n’avait pas prévu cette disposition dans les textes du parti’’, explique le député-maire socialiste.
Cette thèse est contestée par son camarade Cheikh Sèye pour qui, ‘’cette crise interne’’ au PS s’expliquait par le ‘’bouillonnement politique’’ et ‘’la lutte de positionnement’’ qui prévalaient à l’époque. «Diouf ne pouvait pas étouffer les ambitions’’ des uns et des autres, dit-il. Soit ! Mais Doudou Issa Niasse demeure convaincu que Diouf était moins un homme politique qu’un commis de l’administration. A preuve, ‘’il avait mis de côté le parti pour se concentrer sur l’Etat. Il était d’accord sur tout ce que disait l’opposition à l’époque’’, se désole le maire de la commune de Biscuiterie.
Les remous politiques n’étaient pas seulement internes. Au plan national, le règne de l’ex-pensionnaire de l’Ecole nationale de la France d’Outre mer (ENFOM) n’aura pas été de tout repos. On se souvient encore des événements violents du 16 février 1993 qui ont conduit à la mort de huit personnes dont six policiers. Cela faisait suite à une manifestation organisée par les partis de l’opposition alors regroupés autour de la coordination des forces démocratiques (CFD) conduite par Me Wade.
Assassinat du juge Sèye
Et alors qu’on n’a pas fini d’épiloguer sur les raisons de cette tuerie, les Sénégalais apprennent avec stupéfaction la mort du vice-président du Conseil constitutionnel, Me Babacar Sèye, une après-midi du 15 mai de la même année, juste après une élection présidentielle contestée. Ces événements douloureux relèvent dangereusement un thermomètre politique déjà assez inquiétant. Accusé d’être l’auteur du crime contre le juge, Me Abdoulaye Wade et plusieurs de ses partisans sont arrêtés, jugés mais relaxés au ‘’bénéfice du doute’’. Un témoin des événements ayant conservé l’anonymat avoue n’avoir pas été surpris par ce verdict. ‘’Wade n’avait rien à voir avec le meurtre.
Avant la mort de Me Sèye, le président Diouf avait signé un accord avec Wade ; lequel accord faisait de Wade, nommé vice-président, le dauphin (constitutionnel) de Diouf. Cet accord n’avait pas plu aux barons socialistes. On se demande qui avait alors intérêt à commettre ce forfait», dit notre interlocuteur.
Bien auparavant, Abdou Diouf a dû gérer deux crises graves avec deux voisins. En 1989, Diouf entre en conflit avec son homologue gambien, Daouda Diawara, victime d’un coup d’Etat manqué. Cet épisode a directement provoqué l’éclatement de la confédération de la Sénégambie créée en 1982. Quelques mois plus tard, c’étaient les pogroms avec la Mauritanie, avec des débordements inhabituels de violences de part et d’autre de la frontière entre les deux pays.
Ajustement structurel
Comme si le mauvais sort s’était installé dans le pays, Abdou Diouf se devait également de répondre aux attentes pressantes des Sénégalais et relatives à la demande sociale. Mais sur exigence des institutions de Bretton Woods (Fmi et Banque mondiale), le Sénégal devait se soumettre à une politique hardie d’ajustement structurel dont les conséquences seront durement ressenties par les populations. Cette politique d’austérité tous azimuts s’est traduite, selon l’économiste Abdoulaye Seck, par la privatisation de plusieurs entreprises publiques, entraînant des conséquences incalculables. Celles-ci sont : suppressions massives d’emplois, réduction du volume de financement des investissements, désengagement de l’Etat du secteur agricole, réduction des subventions au secteur de l’éducation, mise à mort de la caisse de péréquation au profit de l’économie de marché…
Ancien secrétaire général de banque et membre de la Cnts, Doudou Issa Niasse s’en souvient encore. «Ils (FMI et BM) nous ont imposé la fermeture de la Bnds alors que cette banque n’a jamais fauté. Au contraire, elle a payé la dette des paysans qui s’élevait à 150 milliards de francs Cfa. Si la banque a eu des difficultés, c’était donc de la responsabilité de l’Etat» qui avait ordonné le paiement de cette ardoise, rapporte le député socialiste.
Dévaluation
Même si «c’était le prix à payer», le Pr Abdoulaye Seck trouve «la période d’ajustement relativement longue» car «il aura fallu attendre quinze ans après (De 1980 à 1995) pour récolter les fruits de la croissance». Pour y parvenir, le Sénégal a dû mettre en œuvre une série de programmes que le Pr Moustapha Kassé, doyen honoraire de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG), a relevé dans son ouvrage intitulé «Le Sénégal en mutation». Il s’agit du programme de stabilisation à court terme (1979-80), «aux résultats relativement satisfaisants en ce qui concerne la dette et les finances’’ ; du plan de redressement économique et financier (PREF) dont «les résultats globalement peu satisfaisants se justifient partiellement par le durcissement de l’environnement économique et financier international entre 1981 et 1986».
Pour ne rien arranger à une situation sociale plus que morose, le franc Cfa subit une dévaluation en 1994. Mais pour le Pr. Kassé, cette décision était un mal nécessaire. «La vigueur des mesures prises ont permis (…) une reprise des activités, le taux de croissance du PIB passant de 2% en 1994 à plus de 4,5% depuis 1995 après le recul de -2,1% en 1993, (…) une maîtrise de l’inflation, une réduction du déficit budgétaire global (3,7%)», énumère l’économiste.
Plan Sakho-Loum
Avec une économie pas au meilleur de sa forme, Abdou Diouf n’avait apparemment pas le choix face aux bailleurs de fonds. Ses marges de manœuvre étant réduites, il met en place, en 1993, un plan d’urgence conduit par le duo Sakho-Loum (respectivement ministre de l’Economie et des Finances et ministre du Budget). L’objectif était de «restaurer les capacités financières de l’Etat, (…) chahutées assez vertement par ce que nous avions analysé comme étant les conséquences du consensus politique qui avait cours entre 1991 et 1993», rappelle Mamadou Lamine Loum, dans une interview accordée au Quotidien.
Face au «risque (…) de connaître une crise financière», le gouvernement du Sénégal a essayé, selon le dernier Premier ministre de Diouf, «de répartir la charge entre les différents compartiments du segment social et de leur faire porter le poids idoine, de manière à ce que l’ensemble soit non seulement efficace en rapportant les ressources prévues, mais soit également équitable».
En dépit de tout ce volontarisme du pouvoir, les conditions d’un échec étaient déjà là. Le mécontentement populaire s’ajoutant à l’usure du pouvoir (20 ans), Diouf et son régime n’ont pas pu résister à l’alternance démocratique de 2000. Toutefois, Abdoulaye Ndiaga Sylla pense que l’ex-futur patron de la Francophonie n’a pas démérité. Notamment pour avoir fait preuve de grandeur après sa défaite. «Dans un continent perturbé par des coups d’Etat fréquents, le fait d’appeler (son adversaire) Abdoulaye Wade (au téléphone) pour le féliciter, a été un bien pour Diouf’’, se réjouit notre confrère.
DAOUDA GBAYA
Ahmed ould Daddah, président du RFD: ‘’Je n’ai pas de le problème personnel avec l’actuel chef de l’Etat, ni avec aucun de ceux qui l’ont précédé. Je me bats pour une cause que j’estime justice’’
 Le Calame : Vous venez de rentrer de vacances à l’étranger. Dans quel état avez-vous retrouvé le pays ?
Le Calame : Vous venez de rentrer de vacances à l’étranger. Dans quel état avez-vous retrouvé le pays ?
Ahmed ould Daddah : Dans un piteux état, un état pitoyable. Il ne pouvait, d’ailleurs, en être autrement, dans la mesure où le pouvoir militaire, qui prend le pays en otage, utilise ses ressources à sa guise, bien souvent à des fins d’enrichissement personnel, sans tenir compte des avis de ses amis politiques ni de l’opposition, conduisant unilatéralement les affaires du pays. Le pouvoir a pris la voie, dès le départ, de ne discuter avec personne, de considérer ses adversaires politiques comme des moins que rien. Il affiche d’ailleurs le même mépris pour ses propres amis. Dans ces conditions, évidemment, il va au mur et, hélas, le pays avec.
– Pendant votre absence, certaines rumeurs ont fait état de votre volonté de prendre votre retraite politique – passer la main, donc – comme elles ont fait croire à des dissensions au sein du RFD. Qu’en est-il ?
– Comme vous le savez, on ne peut pas gérer les rumeurs. Les personnalités politiques, en général, expriment publiquement leurs opinions, lesquelles opinions peuvent avoir des incidences sur leur parti, sur leurs partenaires politiques. Parler du RFD, du FNDU peut avoir des incidences sur l’arène politique. Ce ne sont donc pas des choses qu’on garde secrètes. Personnellement, je suis connu pour avoir des positions claires sur ce que j’entends faire, sur ce qui se passe dans mon pays, sur mes protagonistes, etc. Vous, vous pouvez trouver ça radical, c’est votre droit. Pour ma part, je le qualifie de droiture, de transparence. Je pense que, quand on fait de la politique, on ne s’appartient plus totalement, on s’est soumis aux jugements des autres. Par conséquent, on doit aux autres la clarté, dans votre part d’analyse et de jugement.
– Votre combat continue donc ?
– En ce qui concerne ces rumeurs, je dirais qu’elles sont sans intérêt. Le combat que mène le RFD dont je suis, peut-être, un primus inter pares, c’est-à dire le premier parmi les égaux, n’est pas personnel, c’est un combat contre la dictature, c’est un combat pour la démocratie, sans interférence aucune des forces armées dans le jeu politique. Je saisis ici l’opportunité pour dire que l’armée est un des piliers essentiels de la souveraineté nationale et le rempart contre les menaces sur l’intégrité territoriale. De ce point de vue, c’est un des corps les plus importants de l’Etat qui mérite, par conséquent, de rester en dehors des combats politiques, de garder une neutralité positive pour rester l’objet de consensus. Malheureusement, on oublie et l’on néglige souvent qu’en la matière, il y a, aussi, en plus du front pour la défense des frontières, un front intérieur très important où se forment et se recrutent les soldats, les sous-officiers, les officiers, au sein duquel peuvent se mouvoir des cellules dormantes de l’ennemi, qu’elles soient terroristes ou autres. Il s’ensuit que le front intérieur est très important mais, hélas, on a tendance ici à le passer en pertes et profits, ce qui est une grande erreur, en terme de stratégie et de conception de la défense qui doit être une conception globale, sensibilisant et mobilisant toutes les forces vives du pays. Ce front intérieur mérite plus d’égards.
Pour en revenir aux rumeurs, je dirais que je suis engagé au sein de mon parti, le RFD, dans un combat pour la démocratie, l’égalité, la justice, la justice sociale. Le RFD se bat pour l’unité nationale du pays et la fraternité entre les différentes composantes du pays, pour une politique où chaque mauritanien trouve la place qui lui convienne, sa part politique, sa part socio-économique, culturelle, civilisationnelle. Cette politique, vous l’imaginez bien, ne peut être menée que par un gouvernement démocratiquement élu par l’ensemble du peuple mauritanien auquel il doit être redevable de son élection et comptable de son action.
– A vous entendre, vous continuez à remettre en cause la légitimité de la réélection du président Mohamed Ould Abdel Aziz ?
– La légitimité est d’essence populaire, elle ne peut être acquise qu’à la suite d’élections libres, honnêtes et transparentes, conditions qui n’ont pas été réalisées jusqu’à présent. J’ajoute que je n’ai pas de problème personnel avec l’actuel chef de l’Etat, ni avec aucun de ceux qui l’ont précédé. Je me bats pour une cause que j’estime juste, transcendant les personnes et les clivages, un combat pour qu’une véritable démocratie s’installe en Mauritanie, une démocratie au service du citoyen, une politique d’équité, dans tous les domaines. De ce point de vue et de concert avec les militants du RFD, j’estime que le devoir et l’engagement me commandent de poursuivre le combat à la place où mon parti me désigne. Ce combat n’aura de répit que le jour où le peuple mauritanien aura retrouvé sa liberté de choisir ses gouvernants, sa liberté de faire le design de ses orientations politiques, de sa diplomatie, de sa politique économique, culturelle, sociale, de devenir un peuple assumant toutes ses responsabilités, un peuple souverain.
– Quelle forme prendra ce nouveau combat ?
– Je ne lui donne pas une forme particulière, cela fait vingt-deux ans que je me bats sur le terrain politique, avec mes collègues, mes partenaires. Ce combat ne commence donc pas aujourd’hui, les objectifs que j’ai énoncés précédemment ne datent pas d’aujourd’hui. Ce que je puis ajouter, c’est que nous menons un combat politique, non une guerre ou une guérilla. Nos armes sont politiques, non militaires. Vous savez, dans d’autres pays, les gens ont été poussés à recourir à des armes pour atteindre leurs objectifs. Ce n’est pas notre option, nous avons choisi une option politique pour gagner politiquement et démocratiquement notre combat, afin de sortir le pays de l’impasse où il a été enfoncé. C’est un combat de longue haleine, une course de fond mais aussi, un combat de chaque instant. D’ailleurs, beaucoup de gens finissent pas se lasser et jettent l’éponge. Mais, de mon point de vue, ce combat est le seul qui vaille, parce qu’il porte sur des objectifs fondamentaux, il porte, en lui une pédagogie, un travail de sensibilisation et d’encadrement, pour un meilleur devenir de la collectivité nationale dans son ensemble. Ce combat mérite d’être mené. Au sein du RFD, nous nous y sommes engagés dans des conditions difficiles que tout le monde connaît. Des conditions de marginalisation, de musellement, non seulement pour les dirigeants du parti mais, également, pour l’ensemble de ses militants et de l’opposition démocratique, en général, que le pouvoir ne considère pas comme des citoyens mais comme des ennemis. Le pouvoir doit comprendre que les militants de l’opposition, s’ils étaient dans l’administration, auraient constitué d’excellents fonctionnaires, en ligne avec leur formation et leur idéal politique. Leur marginalisation et leur exclusion ne sont pas seulement des injustices au plan moral mais sont, en même temps, un handicap pour les services publics auxquels ces citoyens auraient pu apporter, en toute logique, leur expérience politique et mis en œuvre l’idéal républicain pour lequel ils se sont toujours battus. Il résulte, de cette marginalisation-exclusion, un déficit de qualité et de bonne gestion dont seul le pouvoir assume la responsabilité. Et pourtant, c’est le pouvoir qui aurait pu tirer le meilleur profit de l’implication de tous dans la chose publique, ce qui n’exclut pas les différences idéologiques, de conception et d’orientation.
– Au cours de sa rentrée politique, le FNDU a tenu une réunion à laquelle a pris part le RFD. On a annoncé la mise en place d’un plan d’actions. En quoi consiste-t-il ?
– D’une façon générale, le FNDU travaille sur une plateforme arrêtée, consensuellement, depuis longtemps, tout en actualisant tel ou tel aspect, suivant les évolutions, et en définissant une feuille de route pour la mise en œuvre. Cet agenda va être rendu public dans quelques jours, incha Allah.
– L’opinion nationale se demande si l’opposition, qui n’a pas réussi à empêcher le pouvoir de dérouler son agenda électoral, pourra se relever du boycott des dernières élections, en restant cinq ans en dehors des mairies et de l’Assemblée nationale ?
– Votre question suppose que nous avons tenu, jusqu’à présent, parce que nous avions participé à des élections antérieures. Vous semblez oublier que nous n’avons pas toujours participé aux élections, durant notre parcours de vingt-deux ans, et cela ne nous a pas, pour autant, fragilisés. Je suis tenté de vous retourner la question, en demandant si Mohamed ould Abdel Aziz pourra se relever des dernières « élections » unilatérales et artificielles. Nous sommes et demeurons une opposition démocratique. Nous n’avons jamais cherché la confrontation avec le pouvoir, nous inscrivons notre action dans la durée, parce que c’est un combat de longue haleine. Mais dire que nous n’avons pas réussi à empêcher le pouvoir à dérouler son agenda électoral n’est pas approprié, ce n’est pas une expression pertinente pour qualifier le travail que nous faisons. Comme chacun le sait, nous avions déposé, pour une bonne organisation de ces élections, des propositions concrètes, de nature à garantir la transparence, condition sine qua non de la crédibilité des élections. En somme, nous avions demandé que chaque citoyen en âge de voter puisse voter une seule fois et que chacun reçoive les voix qui lui sont octroyées par les électeurs. Ces propositions n’ayant pas reçu de réponses satisfaisantes de la part du pouvoir – elles n’ont, en fait, pas reçu de réponses du tout – il était évident que nous ne pouvions pas participer à une nouvelle mascarade électorale pour cautionner un pouvoir illégitime et usurpé. Je ne suis pas sûr que Mohamed ould Abdel Aziz dispose d’un agenda, si ce n’est de demeurer au pouvoir. Je n’ai aucune connaissance d’un agenda de sa part, si ce n’est celui-là. Je suis un acteur politique, je suis censé le connaître, mais je n’en ai aucune idée. Ce dont je suis certain, aujourd’hui, c’est que sa seule ambition est de confisquer le pouvoir pendant encore très longtemps. Il va sans dire que nous n’avons pas, à l’opposition, les mêmes ambitions que lui. Ce faisant, Mohamed ould Abdel Aziz compromet et hypothèque dangereusement l’avenir de ce pays qui se trouve dans une zone de turbulences, entouré de conflits armés, de menaces terroristes, en pleine mutation interne. Je voudrais ici préciser qu’en dépit de notre opposition au pouvoir dictatorial – qui ne prendra fin que le jour où une véritable démocratie émergera dans le pays, où une alternance démocratique cessera d’être dramatique mais sera voulue, organisée et arbitrée, par le peuple mauritanien – en dépit de cette opposition, disais-je, nous avons toujours refusé la violence.
Je reviens pour dire que nous sommes dans une zone du Sahel allant de l’Atlantique à l’Océan indien, de Nouakchott à Mogadiscio. Cette zone est sensible, parce que c’est une zone de contacts entre le monde arabo-musulman et le monde africain, c’est une zone de brassage de civilisations. Savez-vous que c’est une reine d’Egypte qui rapporta, au cours d’un voyage à Mogadiscio, du henné à Louxor ? La Somalie est un vieux pays, victime, aujourd’hui, de guerres intestines interminables, de destructions… Je rends ici hommage à l’opposition mauritanienne qui a refusé, jusqu’ici, de céder à la tentation de la somatisation, de la terre brûlée. L’opposition a toujours refusé, malgré les provocations du pouvoir, de recourir à la violence destructrice. L’attitude de l’opposition mauritanienne est d’une grande probité, contrairement à celle du chef de l’Etat actuel. Bien que le peuple mauritanien subisse, depuis 1978, une marginalisation, en dépit des efforts de sa classe politique pour l’instauration et l’ancrage de la démocratie, de la justice et de l’équité dans le pays, cette opposition fait tout pour éviter les dérapages et refuse la politique du pire.
– Cela suppose le dialogue avec le pouvoir. Est-ce encore possible avec le président Mohamed ould Abdel Aziz ? Le cas échéant, à quelle condition ?
– Journaliste et observateur de la scène politique, vous savez que nous avons beaucoup favorisé le dialogue. Nous sommes passés par plusieurs étapes, dans ces dialogues à répétition, mais chaque fois que nous posons les vrais problèmes susceptibles de nous sortir de l’imbroglio, le pouvoir se cabre et se crispe. Vous connaissez la suite : tout finit, hélas, en queue-de-poisson. Nous ne pouvons continuer le jeu du chef de l’Etat actuel qui s’obstine à des semblants de dialogue. On ne peut pas faire confiance à un pouvoir absolu où seul le président régente tout, cherche, par tous les moyens, à rester au pouvoir. Nous ne lui donnons pas cette occasion, nous allons travailler à faire bouger les lignes. Regardez autour de nous : le Sénégal, la Guinée, le Mali et le Niger ont tous réussi des élections apaisées et des alternances pacifiques. Le Mali, qui a connu un long conflit armé, a réussi des élections acceptées par tous les protagonistes. La Côte d’Ivoire, qui a vécu une véritable guerre civile, est en train de se relever, après des élections maîtrisées. Et la Mauritanie, me diriez-vous ? Elle est la dernière de la classe, à cause des blocages orchestrés par le pouvoir en place. Mais, comme je l’ai répété, nous nous battons pour changer cette donne, pour donner, aux Mauritaniens, la chance de se choisir librement leurs dirigeants, à travers des élections libres, honnêtes et transparentes, arbitrées et reconnues par la Communauté internationale. C’est un combat qui mérite des sacrifices et c’est ce que nous faisons, au RFD et au sein de l’opposition démocratique.
– Dans les pays que vous venez de citer, il n’y pas peut-être pas cette méfiance constatable, en Mauritanie, entre le pouvoir et son opposition. Qu’est-ce qui vous empêche de vous entendre ?
– Il existe une grande méfiance de l’opposition vis-à-vis de l’actuel chef de l’Etat. Je n’ai pas besoin d’expliquer les racines du mal. En dépit de tout cela, nous n’avons jamais refusé d’aller à une table de négociations, parce que nous sommes convaincus que c’est la bonne méthode. Mais je dois vous dire que nous ne voulons plus d’un semblant de dialogue. Si nous allons au dialogue, c’est pour poser les problèmes qui entravent le bon fonctionnement du pays, pour écouter les propositions de notre vis-à-vis, en débattre sérieusement, nous faire des concessions mutuelles. Le dialogue suppose la présence de deux parties, ce qui n’est pas le cas avec le pouvoir actuel. Nous avons toujours réitéré notre volonté d’aller au dialogue pour aboutir à des compromis mais nous refusons la compromission. Notre souhait le plus ardent est de favoriser l’instauration d’une démocratie réelle dans notre pays, non une démocratie de façade. Nous ne sommes pas prêts à lâcher prise, nous allons continuer ce noble combat pour notre pays. Les ambitions personnelles ne représentent rien par rapport à l’avenir du pays qui, comme les autres, a besoin de vivre en paix et la quiétude ; en somme, dans la démocratie. Nous voulons un pays où règne la justice, la bonne gouvernance, un pays où tous les contrevenants à la loi répondent de leurs actes, où ceux qui détournent les biens publics soient interpelés et traduits devant des tribunaux ; en définitive, un pays où l’impunité sera bannie à jamais. La justice ne doit plus être instrumentalisée.
– Vous doutez donc de l’engagement du président de la République à éradiquer la gabegie dans notre pays ?
– Vous ne devriez pas poser ce genre de questions : vous savez bien que la Mauritanie n’a jamais connu autant de gabegie avant ce régime. Je peux vous citer des exemples à la pelle : où sont passés les cinquante millions de dollars que l’Arabie Saoudite a donnés à la Mauritanie ? Où sont passés les deux cents millions de dollars – prix de Senoussi – honte aujourd’hui de la Mauritanie qui vend des êtres humains. Vous savez, quand l’argent public ne passe pas par des procédures normales (engagements, contrôle financier, etc.), c’est source de suspicion, risque de détournements. Je n’oublie pas le fameux « Ghanagate » qui n’a pas fini de révéler l’origine et la nature de ses dollars. J’espère que ces dollars – vrai ou faux, je n’affirme rien – n’aient pas été injectés à la Banque centrale, qu’on n’ait pas constitué des contreparties en fausse-monnaie. J’invite à la méfiance car ce genre de pratiques fut dévastateur, pour les pays qui y faisaient recours. Les grands pays ne pardonnent jamais ces actes…
– Certains observateurs, tant du pouvoir que de l’opposition, trouvent monsieur Ahmed ould Daddah « trop radical » ; lui reprochent d’être à « l’origine des blocages », chaque fois qu’une perspective de dialogue avec l’opposition se dessine. Que répondez-vous à ces accusations ?
– Je les trouve, tout simplement, méprisables. Donc, Ahmed Ould Daddah est un empêcheur de tourner en rond ? Cependant il aurait pu, lui aussi, faire comme les autres, profiter de sa situation, se compromettre, se faire une place au soleil, prendre sa part du gâteau, comme on le dit malheureusement chez nous. Qui ne veut pas être ministre, directeur, ceci ou cela ? Ahmed ould Daddah veut bien le confort, être comme tout le monde. S’il est stigmatisé par certains, c’est parce qu’il ne pense pas comme eux, parce qu’il a des ambitions pour son pays, des ambitions pour ses compatriotes. Je me bats pour des principes, pour sortir la Mauritanie de l’ornière, pour que ce beau pays ne reste pas le dernier de la classe. Le RFD et l’opposition, en général, se battent pour un meilleur devenir de ce pays, pour l’unité et la prospérité de ce pays. Vous n’êtes pas sans savoir que l’opposition n’a jamais été confortable, c’est tellement plus facile d’applaudir et de sauter sur la première occasion pour devenir ministre, ambassadeur, directeur d’un grand établissement public, avoir, simplement, la paix. Mais, nous, nous n’avons jamais choisi l’opportunisme. Seulement l’opportunité de servir notre pays, de préparer l’avenir aux générations futures, pour que ces générations puissent, demain, lever la tête dans le concert des nations. Ce pays qui occupe une position géopolitique extraordinaire a été, dans le passé, façonné, auréolé par des oulémas de grand renom. Citons, à titre purement indicatif, Mohamed Mahmoud ould Tlamid (Cheikh Chinguitti à Al Azhar), Oulad Mayaba, Cheikh Abba ould Khtour, en Arabie Saoudite, l’Ecole Zoubeïriya, à Basra en Irak. Et je voudrais aussi saluer la mémoire et l’œuvre d’El Hadj Mahmoud Bâ dont l’action s’est propagée jusqu’en Afrique centrale. J’ai rencontré personnellement certains de ses disciples à Brazzaville (Congo). Au sud du Sahara, nous avons été de grands vecteurs de l’islam et du savoir. Au nord, nos oulémas ont brillé de mille feux au Machrek. Voilà l’œuvre spirituelle et culturelle qu’ont joué nos illustres hommes, toutes composantes confondues. Nous devons nous en réjouir et nous en inspirer. Vous savez, la grandeur d’un pays ne réside pas, nécessairement, dans le nombre de ses soldats ni même dans le nombre de ses habitants mais dans la qualité de ses hommes, la richesse de sa culture, la pertinence de ses engagements et des objectifs qu’il s’est assignés. Je voudrais rappeler, à ceux qui auraient tendance à l’oublier, qu’en dépit de sa diversité ethnique, la Mauritanie n’a jamais vécu une guerre entre ses composantes. Je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Il y a eu des guerres, entre les tribus maures, au sein d’autres ethnies, mais jamais de guerre ethnique, en dépit des troubles et vicissitudes de son histoire. Inspirons nous donc des leçons de sagesse et de maturité de notre peuple, tout en nous inscrivant dans la modernité, la science et la recherche.
– Les prix du fer chutent, l’extension de la mine d’or de Tasiast traîne et le poisson ne se vend plus. Ne craignez-vous pas que l’année 2015 soit une année difficile pour le pays, surtout que l’hivernage n’a pas été bon ?
– D’abord, je voudrais rappeler que nous avons connu deux années fastes : l’once d’or a atteint près de 1900 $, et la tonne de fer près de 160 $. Le prix du cuivre avait lui aussi augmenté. Mais nous oublions souvent, dans nos appréciations économiques, le cheptel, qui était, jusqu’à l’indépendance, la principale ressource du pays. Nous avons aussi oublié une ressource fondamentale : la pêche ; oublié l’agriculture avec, notamment 135 000 hectares de terres irrigables qui peuvent couvrir nos besoins en riz, en mil et en fruits tropicaux ; plus, maintenant, l’élevage, dans des conditions moins précaires que par le passé. Si ces ressources renouvelables sont négligées, le secteur de l’élevage dont nous avons une longue tradition, une longue expérience, a été complètement relégué aux oubliettes. La Mauritanie n’a pas non plus profité de la mise en valeur du fleuve Sénégal qui devait lui permettre de réaliser, au moins, deux récoltes de riz par an, avec dix à douze tonnes à l’hectare. Nous avons joué, avec la pêche, comme au casino, en laissant détruire la ressource, à cause d’une course effrénée aux licences et autres accords de pêches. Résultats du pillage, quelques personnes, en nombre très restreint, se sont enrichies trop rapidement. Mais, comme avec l’enrichissement illicite, certains se sont appauvris aussi vite et peu d’investissements économiquement utiles ont été réalisés dans le pays. Vous constatez donc que ces trois principaux secteurs de notre économie ont été complètement oubliés, laminés.
La Mauritanie dispose également d’importantes ressources minières. Là aussi, nous n’avons malheureusement pas évolué. Pour preuve, en 1976, deux ans donc avant le coup d’Etat de 1978, un grand projet de pelletisation d’une partie du minerai de fer avait été initié. Les Koweïtiens étaient disposés à engager, sur ce projet, ma somme d’un milliard de dollars. C’est encore une belle somme aujourd’hui. Il s’agissait d’enrichir et de transformer le minerai de fer pour fabriquer de l’acier, grâce à une réduction par le gaz. Voyez-vous, l’histoire a parfois des clins d’œil curieux. Si ce projet avait été mené à bien, peut-être que nous aurions pu réaliser cette réduction, puisque nous avons aujourd’hui du gaz. Si ce projet avait abouti, la quantité de gaz dont dispose le pays serait un grand atout. Au lieu de cela, nous sommes restés à la case départ et continuons à vendre de la poussière. On oublie qu’un jour, un trait sera tiré sur les mines de Zouérate, il n’en restera que les compétences en ressources humaines. La Mauritanie a malheureusement raté le coche. Il n’est cependant pas trop tard pour mieux faire. Ce qui est sûr, en tout état de cause, c’est que nous avons perdu quarante précieuses années, en termes d’acquisition de savoir et de savoir-faire mais, aussi, en termes d’enrichissement. Encore une fois, il n’est pas trop tard pour mieux faire. Attachons-nous à ne plus perdre, refusons de rester d’éternels rentiers. Œuvrons pour préserver nos ressources, pour leur bonne exploitation, pour leur transformation, pour qu’elles profitent à l’ensemble du peuple mauritanien et non à l’enrichissement illicite de tel ou tel groupe de personnes qui, d’ailleurs, se seraient honnêtement enrichies, comme les autres, si ces ressources étaient judicieusement mises en valeur.
De ce point de vue, l’avenir, c’est la Jeunesse. Je me souviens d’un ancien recensement démographique, réalisée par une société grenobloise, sur financement des Nations-Unies. Cette enquête faisait ressortir que 75 % de la population mauritanienne était constituée de jeunes de moins de 29 ans, c’est-à-dire que trois personnes sur quatre sont jeunes ou très jeunes. C’est un bon atout et un potentiel important. Mais, pour le capitaliser, il faut construire des écoles, des établissements professionnels, améliorer la qualité de l’enseignement et la santé, disponibiliser l’eau potable, réaliser des ouvrages hydro-agricoles, des infrastructures de transports et autres équipements et, évidemment, fournir des emplois aux jeunes.
De ce point de vue, je ne peux m’empêcher d’établir un lien entre le terrorisme et le chômage. Quand vous avez des jeunes gens, avec ou sans diplôme, sans formation professionnelle, sans ressources pour s’épanouir, sans emplois et, donc, sans espérance, vous faites le lit de toutes les dérives. Ces jeunes – pour ne pas dire ce cocktail explosif – peuvent facilement succomber à toutes les sirènes dont la plus redoutable reste le terrorisme. Ce sont nos gouvernants qui fabriquent des bras armés au terrorisme, pour n’avoir pas su offrir et garantir, à nos enfants, des lendemains plus heureux, les conduisant, ainsi, à l’autodestruction.
– Que pensez-vous de la proposition d’autonomie des Forces Progressistes du Changement (FPC), ancien FLAM ? Une proposition annoncée lors d’un congrès, tenu à Nouakchott en septembre dernier.
– Ce qui me paraît fondamental c’est de construire, dans ce pays, un véritable Etat de droit, assurant, sans aucune discrimination, l’égalité de tous, où chacun soit en situation d’apporter sa contribution à l’édifice commun, trouve la place qui lui convienne et se sente véritablement épanoui. Cela suppose, entre autres, que nos cultures soient mises en symbiose, comme elles l’ont toujours été, s’enrichissant les unes les autres par leur apport, leur sensibilité et leur expérience vécue.
Propos recueillis par
AOC & DL
L’éditorial de Biladi
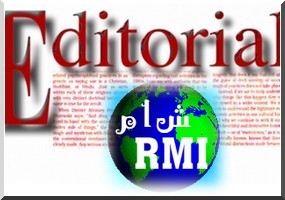 RMI Biladi – La situation de notre pays se caractérise actuellement par un véritable malaise, une grande détresse, un manque de confiance et une absence réelle d’espoir dans l’avenir. Paradoxalement, cet état de désespoir est plus présent et beaucoup plus apparent dans les rangs de la majorité qui soutient le président plus que dans ceux de l’opposition qui lutte, haut et fort, pour le destituer.
RMI Biladi – La situation de notre pays se caractérise actuellement par un véritable malaise, une grande détresse, un manque de confiance et une absence réelle d’espoir dans l’avenir. Paradoxalement, cet état de désespoir est plus présent et beaucoup plus apparent dans les rangs de la majorité qui soutient le président plus que dans ceux de l’opposition qui lutte, haut et fort, pour le destituer.
Au sein de cette majorité présidentielle, beaucoup de gens fondaient tous leurs espoirs sur le second mandat du président. Après la formation du gouvernement post présidentiel qui, à quelques exceptions, est le même qui était là, la déception fut grande et les rêves se sont soudainement brisés. Pire.
Certains soutiens du président se sont même sentis trahis. Exit la révolution des Jeunes, des femmes, des marginalisés, des couches fragiles de la société… Tout ce monde qui a cru dans quelque chose, qui a cru au changement –son changement qu’il désirait et dessinait en caractères gras, vit actuellement une véritable déprime.
Et envisagent même de se détourner de leur désormais ‘’faux espoir’’… Vers où peuvent-ils tourner leurs regards, ces déçus de la rectification ? Certainement pas du côté de l’opposition qui a été, jusqu’ici, incapable de trouver la parade pour abattre un adversaire atypique, ‘’souple’’ et ‘’non conventionnel’’.
D’ailleurs tous les changements qui se sont produit au sommet de l’Etat mauritanien ne sont jamais arrivés du camp de l’opposition. Ils sont tous venus de l’intérieur du système… Alors peut-on croire à la probabilité d’une nouvelle révolution de palais ? A un dialogue national ? Ce seront des schémas douillets, tant la situation est réellement préoccupante.
En tout cas, il y a un malaise au sein de l’opinion, palpable, visible à l’œil nu et qui peut mener le bateau, déjà ivre, vers n’importe quelle direction. Un scénario d’autant plus à craindre que tous les voyants économiques du pays, qui étaient au vert pendant les dernières années, ont tendance à évoluer, en cette fin d’année 2014, vers le rouge.
On évoque ainsi de graves difficultés financières provoquées par la chute des revenus tirés du fer, de l’or, de l’aide internationale et des accords bilatéraux tels que l’accord de pêche avec les européens qui brandissent une diminution sensible de la contre partie financière…
Si on ajoute à cela les tensions ethniques et les disparités sociales qui s’expriment déjà au grand, l’on ne peut qu’avoir peur pour l’avenir du pays et supplier sa classe politique à faire l’impossible pour sauver ce qui est encore récupérable des meubles…
http://www.rmibiladi.com/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2792&catid=2&Itemid=3




