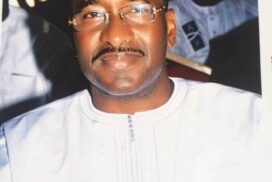Fary Ndao rappelle, études scientifiques à l’appui, qu’on apprend mieux en commençant l’école dans sa langue maternelle.
Fary Ndao rappelle, études scientifiques à l’appui, qu’on apprend mieux en commençant l’école dans sa langue maternelle.L’Afrique est le seul continent où les langues maternelles parlées au quotidien ne sont pas enseignées dans le cadre scolaire officiel. [Un sujet central qui a agité plusieurs des Débats que Le Monde Afrique a organisés à Dakar fin octobre sur le thème de l’éducation supérieure.]
Lire aussi : « Une Afrique moderne et pleine d’elle-même », le slam des futurs Einstein africains
La langue dite « maternelle » est définie par l’Unesco comme étant « la ou les langue(s) de l’environnement immédiat et des interactions quotidiennes qui construisent l’enfant durant les quatre premières années de sa vie ». Ainsi, beaucoup d’enfants africains, notamment en Afrique de l’Ouest, ont une langue maternelle africaine de portée nationale (wolof au Sénégal, bambara au Mali, fon au Bénin) et une seconde langue maternelle d’extension régionale parlée dans leur village, leur ville ou leur province.
Les langues internationales compliquent la diffusion du savoir
En délaissant ces langues maternelles au profit exclusif des langues internationales (français, anglais, arabe), les pays africains ne facilitent ni la diffusion du savoir au sein de leurs sociétés, ni l’intégration de leur intelligentsia à la communauté académique mondiale. Il est important de rappeler, pour convaincre les sceptiques, ce chiffre issu du rapport de l’Unesco sur la science : sur les 20 pays effectuant le plus de publications académiques dans le monde, l’on retrouve une majorité de pays (douze) où la langue officielle n’est parlée que dans ledit pays et ses zones frontalières. Ces douze pays sont : la Chine (mandarin), le Japon (japonais), la Corée du Sud (coréen), l’Inde (hindi), la Russie (russe), l’Italie (italien), les Pays-Bas (néerlandais), la Turquie (turc), l’Iran (persan), la Norvège (norvégien) et Israël (hébreu). La langue seule n’explique pas tout et il existe bien entendu plusieurs facteurs qui contribuent au dynamisme de la recherche dans un pays : tradition universitaire, moyens économiques, existence d’un tissu industriel, etc.
Lire aussi : La fausse réforme de l’éducation islamique enseignée aux enfants marocains
Cependant, la vitalité académique de ces pays démontre qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une langue parlée sur trois continents pour trouver des solutions originales aux problématiques endogènes ou pour contribuer à l’amélioration du savoir mondial. Les pays asiatiques ont le fait le choix d’une éducation basée sur la langue maternelle. Leur réussite académique et économique montre qu’il existe une différence significative entre la langue d’acquisition du savoir, c’est-à-dire la langue d’enseignement, et la langue de communication qui correspond à une langue de portée internationale utilisée pour partager ce savoir en dehors de ses frontières. Ceux qui en doutent pourront répondre à cette question : qui parle le coréen à part les Coréens ?
Lire aussi : Cédric Villani : « Les étudiants africains sont très intéressants, on sent l’appétit, l’enthousiasme »
En Afrique, il ne s’agira pas de remplacer le français ou l’anglais par une seule autre langue, fût-elle africaine. Il apparaît plus judicieux de se diriger vers un enseignement multilingue basé sur la langue maternelle comme le recommande l’Unesco et ses nombreuses études de cas pratiques depuis 1953. Cet enseignement pourrait se décliner comme suit : une langue africaine d’extension régionale pour la primo-alphabétisation, rapidement complétée par l’enseignement dans la langue africaine de portée nationale avant l’enseignement des langues internationales. Le triptyque « un territoire, une langue officielle, une nation » est davantage un fantasme qu’une réalité tangible dans les pays africains. Les langues internationales n’y sont bien souvent comprises que par une minorité qui les utilise pour confisquer les débats démocratiques, monopoliser l’information économique et contrôler l’appareil d’Etat. Il faut donc faire la promotion de nations africaines basées sur la reconnaissance de la diversité linguistique et culturelle.
85 % des enfants concernés en école primaire
L’enseignement en langue maternelle permet d’éviter le temps d’acculturation qui oblige l’enfant sénégalais ou malien découvrant l’école primaire à effectuer un sevrage brutal où il abandonne les acquis de sa ou ses langue(s) maternelle(s). Des études de l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) estiment en effet qu’au moins 85 % des enfants africains débutent leur vie scolaire avec l’obligation d’apprendre dans une langue qu’ils n’ont jamais parlée, ni souvent entendue. Il suffit d’imaginer la situation cocasse où 85 % des petits Français entrant au CP seraient alphabétisés en wolof ou en bambara. C’est pourtant une telle aberration qui se déroule, depuis des décennies, dans beaucoup de pays d’Afrique noire francophone.
Renverser ce paradigme linguistique permettrait aux enfants de ne pas subir cette rupture violente qui va à l’encontre de tous les résultats de recherches en sciences cognitives depuis plus de quarante ans. Ceux-ci montrent en effet qu’un apprentissage est plus efficace si l’apprenant possède déjà des connaissances, même rudimentaires, sur le sujet d’apprentissage. Il est par exemple beaucoup plus facile d’apprendre à programmer dans un nouveau langage informatique, lorsque l’on connaît déjà un autre langage informatique, quel qu’il soit. C’est ce que confirme le docteur Seynabou Diop, spécialiste des sciences cognitives, dans cet article paru en 2012 : « Les connaissances antérieures de l’enfant peuvent être inadéquates, peu structurées, mal structurées ou totalement fausses au départ (…) Les langues nationales, parce qu’elles offrent une pléthore de connaissances antérieures propres aux enfants, permettent de les engager dans un processus de restructuration et de construction active des connaissances. »
Faciliter l’alphabétisation
Ainsi, la primo-alphabétisation doit toujours être effectuée avec l’une des langues maternelles de l’enfant. Un enfant du Fouta, au Sénégal, devrait aborder les premières années de sa vie scolaire en pulaar. Dans d’autres régions ayant des identités linguistiques fortes, des concertations sur le choix de la langue de primo-alphabétisation pourraient être menées par les autorités administratives avec les parents d’élèves, les enseignants appuyés par des spécialistes en sciences cognitives. Un tel processus a été adopté avec succès au Burkina Faso au début des années 2000.
Lire aussi : Quel avenir pour la francophonie numérique ?
Un enfant apprenant dans sa langue maternelle a statistiquement moins de chances de redoubler à la fin du primaire. Il comprend mieux et peut se faire aider par ses parents, même si ceux-ci ne sont pas alphabétisés, car ils comprennent de fait la langue de primo-alphabétisation qui est celle qu’ils parlent à leur enfant à la maison.
Un enfant alphabétisé dans sa langue maternelle n’a généralement aucune difficulté pour apprendre une nouvelle langue. Plusieurs expériences, menées au Sénégal et en Ethiopie, montrent que les enfants qui sont alphabétisés en wolof ou amharique, obtiennent de meilleurs résultats en français ou en anglais que les élèves qui sont exclusivement alphabétisés dès l’entrée au primaire en français ou en anglais. Nul paradoxe ici : l’apprenant intègre les nouvelles langues en les comparant aux structures grammaticales et syntaxiques qu’il a apprises dans sa langue maternelle.
Enfin, l’enseignement du français et de l’anglais à la fin du primaire ou dès l’entrée au collège, permettra à nos (futurs) chercheurs de continuer à disposer de langues de communication internationales et ainsi rester en contact fécond avec le reste de l’intelligentsia académique mondiale. Ces langues font par ailleurs partie d’un héritage historique et culturel africain qu’il est inutile de nier.
Doper la recherche et consolider la démocratie
Au-delà de la primo-alphabétisation, la possibilité de mener des études supérieures dans une langue maternelle doit également être envisagée. L’étudiant africain ayant appris les bases des mathématiques, de la grammaire puis de la physique dans sa langue maternelle depuis ses premiers pas à l’école, voit se développer chez lui un sentiment naturel de banalisation du savoir scientifique et historique et arrive à ne plus considérer ce savoir comme un sanctuaire de vérité absolue. On s’épargnerait ainsi les scènes de mémorisation par cœur auxquelles l’on assiste dans les allées des grands temples de l’apprentissage machinal que sont les universités africaines.
Couplé à celui, plus tardif, des langues internationales, l’enseignement en langues africaines augmentera mécaniquement la base démographique potentielle de chercheurs, d’ingénieurs, de philosophes, de sociologues, d’écrivains, corps indispensables pour tirer l’Afrique noire de sa léthargie culturelle, et la mettre à l’abri des risques sécuritaires et idéologiques qui pèsent sur elle. Cela permettra également d’améliorer la vie démocratique au sein des pays africains, une urgence lorsque l’on voit la facilité avec laquelle les masses sont manipulées par les lettrés, politiciens ou intellectuels. Enfin, cela pourrait faire reculer l’obscurantisme religieux dans des pays où la masse communique avec ses « guides » dans les langues qu’elle comprend quand, dans le même temps, les lettrés s’enferment dans de nombreux colloques boudés par cette même masse. A l’heure où émergent de plus en plus de mouvements radicaux, la langue maternelle peut constituer un rempart contre le fanatisme, grâce à l’ouverture qu’elle pourra apporter sur d’autres horizons culturels.
Fary Ndao est ingénieur géologue, ancien membre du cercle de réflexion L’Afrique des Idées.
 Alakhbar
Alakhbar Le roi du Maroc, Mohamed VI entame dimanche une visite d’état au Sénégal au cours de laquelle il prononcera à Dakar le traditionnel discours à l’occasion de la marche verte.
Le roi du Maroc, Mohamed VI entame dimanche une visite d’état au Sénégal au cours de laquelle il prononcera à Dakar le traditionnel discours à l’occasion de la marche verte.