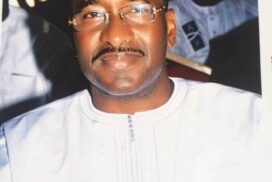Daily Archives: 18/02/2016
L’UMA: 27 ans après, un bilan toujours mitigé et en deçà des aspirations des peuples de la région
 MAP – Meriem RKIOUAK – publié le Mercredi 17 Février 2016 à 12:44
MAP – Meriem RKIOUAK – publié le Mercredi 17 Février 2016 à 12:44
Rabat – Vingt-sept ans, jour pour jour, se sont écoulés depuis la création de l’Union du Maghreb arabe (UMA), le 17 février 1989.
Le bilan reste mitigé: à peine une cinquantaine de conventions signées intéressant principalement les domaines économique, social et culturel, et six Sommets, en tout et pour tout, tenus pendant les cinq premières années de la vie de l’UMA.
A partir de 1994, date de la tenue du dernier sommet maghrébin, les réalisations et le rayonnement de cet ensemble régional sont restés en deçà des aspirations des peuples maghrébins. Pourtant, à ses débuts, l’UMA était vouée à un avenir florissant, forte en cela de plusieurs atouts : une rare proximité entre les cinq pays qui la forment aux niveaux historique, culturel et civilisationnel, une complémentarité des ressources naturelles et économiques, une population jeune, une élite politique et intellectuelle avisée et dynamique, une appartenance bien ancrée à la Oumma arabo-islamique.
Que d’opportunités gâchées et de potentiels galvaudés pour des considérations politico-politiciennes qui font qu’aujourd’hui, 27 ans après la signature à Marrakech du Traité constitutif de l’UMA, les frontières maroco-algériennes demeurent fermées, obstruant la voie à tous les efforts de réanimation de l’UMA et renvoyant aux calendes grecques le projet de (re)construction de ce Grand Maghreb tant désiré.
La responsabilité du pouvoir algérien dans la persistance de ce statu quo est un secret de Polichinelle. Outre les frontières, l’Algérie ferme les canaux de dialogue et multiplie désespérément provocations et manigances à l’encontre du Royaume et de son intégrité territoriale, faisant fi des appels, provenant de l’intérieur comme de l’extérieur, à faire prévaloir l’intérêt des pays et des peuples de la région aux intérêts étriqués d’un régime ou d’une classe dirigeante blasée et égoïste. Tous s’accordent donc à dire que le conflit artificiel autour du Sahara marocain, nourri et entretenu par le régime algérien qui fournit toit, fonds et soutien politique et diplomatique aux séparatistes, est la pierre d’achoppement à toute tentative de relance de l’UMA.
Il n’en demeure pas moins que l’évolution du contexte géostratégique ambiant, sur les cinq dernières années surtout, n’a pas été en faveur de cette entreprise. L’avènement brutal du “printemps arabe” notamment en Tunisie et en Libye, avec son lot de troubles socio-politiques, de risques sécuritaires et de difficultés économiques dont l’intensité diffère d’un pays à l’autre, a bousculé les agendas des Etats et les a amenés à revoir leurs priorités et se concentrer davantage sur le front interne afin de mener à bon port la transition démocratique en marche, combattre le terrorisme, relancer la machine économique et préserver l’unité nationale. En attendant que ces défis soient relevés, le projet d’édification de l’UMA, perçu vraisemblablement comme étant moins urgent, reste aux stand-by.
Force est pourtant de constater que cette vision des choses ne pourrait que s’avérer étroite et contreproductive à moyen et long termes, étant donné que le gel du processus d’intégration maghrébine a, chaque année, un coût politique, économique, social et géostratégique lourd qui se répercute sur chacun des pays de l’UMA. Puisque l’union fait toujours la force, les pays de l’UMA ont beaucoup à gagner, en termes de sécurité, de prospérité économique, d’influence et de positionnement international, de l’édification d’un espace maghrébin solide, cohérent et compétitif où chacun trouve son compte.
En ce sens, l’engagement des cinq pays maghrébins dans le processus, aussi laborieux et délicat qu’il puisse être, de reconstruction du Grand Maghreb, pourrait être la voie incontournable du salut et l’ultime solution aux problèmes des pays de la région, à condition d’y mettre la volonté politique, la bonne foi et les moyens nécessaires, et, surtout, “se concentrer sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous sépare”.
lemag.ma
Dialogue, élections anticipées : Un stratagème pour amadouer l’opposition ?
 Le pouvoir travaille à l’ouverture d’un dialogue avec l’opposition, compte supprimer le Sénat et organiser des élections municipales et législatives anticipées. Du moins c’est cela qu’affirme un membre du bureau exécutif de l’Union pour la république (UPR), le parti au pouvoir.
Le pouvoir travaille à l’ouverture d’un dialogue avec l’opposition, compte supprimer le Sénat et organiser des élections municipales et législatives anticipées. Du moins c’est cela qu’affirme un membre du bureau exécutif de l’Union pour la république (UPR), le parti au pouvoir.
Quelle est la raison qui pousse le pouvoir à agir ainsi ? Selon notre source il s’agit pour le régime en place de contrer la poussée islamiste devenue la première force politique d’opposition suite aux dernières élections municipales et législatives boycottées par la plupart des grands partis de l’opposition dont le RFD.
Mais d’aucuns pensent que l’idée d’ouverture d’un dialogue et d’organisation d’élections anticipées qui permettraient à l’opposition de se faire représenter dans les mairies et le parlement n’est qu’un stratagème auquel feraient recours les pouvoirs publics pour amadouer les partis politiques contestataires.
De l’avis d’autres analystes, la passe économique et les difficultés d’en venir à bout seraient tout aussi des raisons acculant le régime à lâcher du lest d’autant qu’il est comptable de la situation économique désastreuse et des contingences sécuritaires éventuelles pour le pays.
Les prédispositions dont fait montre le président Ould Abdelaziz pour un dialogue qui pourrait s’entamer le 3 mars prochain sont cependant reçues avec beaucoup de scepticisme tant la crédibilité et la confiance avec les autres acteurs semble s’émousser de jour en jour.
Mauriweb
L’éditorial du calame : Si les gens savaient…
 Devant les difficultés qui s’amoncellent, le ras-le-bol, général, face à la hausse de prix des denrées de première nécessité, le refus obstiné du pouvoir de baisser celui des hydrocarbures, la crise politique qui perdure, la dévaluation rampante de l’ouguiya, les scandales financiers qui se répètent, Ould Abdel Aziz – « en plein désarroi », selon « Jeune Afrique » – n’a pas trouvé mieux, pour divertir l’opinion, que de lui offrir un énième remaniement ministériel. Où un tribalisme de bas étage a trouvé toute sa consécration. Jamais, même au temps de Maaouya où cette tare établit ses lettres de noblesse, on s’est autant engouffré dans la mouise. Un « dosage » qu’on pourrait qualifier de tout, sauf de savant, a prévalu lors du choix des remplaçants des cinq hommes débarqués du gouvernement. Dont personne ne sait ni pourquoi ils furent choisis, ni pour quels motifs ils ont quitté l’équipe gouvernementale. Non pas qu’on ne puisse imaginer les raisons qui ont présidé au choix des entrants. Il est une constante, dans tous les régimes peu – ou prou – démocratiques : choisir les hommes selon des critères subjectifs, les pressurer jusqu’à la moelle et s’en débarrasser à la première occasion. Depuis près de quarante ans, c’est la règle en Mauritanie où la fonction ministérielle a été tellement dévalorisée que tout un chacun, sensé ou non, peut y prétendre. La valse des ministres est devenue le sport-roi de nos dirigeants qui y trouvent, à chaque fois, l’occasion de divertir un peuple qui vit de ragots, de médisances et de rumeurs. Et la dernière tempête dans un verre d’eau n’a pas dérogé à la règle. Le peuple a eu quelque chose à se mettre sous la dent, pendant quelques jours. Mais avant qu’il ne revienne sur la terre et à ses soucis, on lui a, aussi sec, servi un autre plat : le refus du Conseil constitutionnel de valider le projet de loi organique du gouvernement, prévoyant de renouveler, maintenant, deux tiers du Sénat et le dernier tiers dans deux ans. Réveillé subitement d’un long sommeil qui frôlait l’hibernation, ledit Conseil a recalé le projet de loi, au motif que tout le Sénat est périmé et qu’il faut donc le renouveler en entier. Rebelote donc !
Devant les difficultés qui s’amoncellent, le ras-le-bol, général, face à la hausse de prix des denrées de première nécessité, le refus obstiné du pouvoir de baisser celui des hydrocarbures, la crise politique qui perdure, la dévaluation rampante de l’ouguiya, les scandales financiers qui se répètent, Ould Abdel Aziz – « en plein désarroi », selon « Jeune Afrique » – n’a pas trouvé mieux, pour divertir l’opinion, que de lui offrir un énième remaniement ministériel. Où un tribalisme de bas étage a trouvé toute sa consécration. Jamais, même au temps de Maaouya où cette tare établit ses lettres de noblesse, on s’est autant engouffré dans la mouise. Un « dosage » qu’on pourrait qualifier de tout, sauf de savant, a prévalu lors du choix des remplaçants des cinq hommes débarqués du gouvernement. Dont personne ne sait ni pourquoi ils furent choisis, ni pour quels motifs ils ont quitté l’équipe gouvernementale. Non pas qu’on ne puisse imaginer les raisons qui ont présidé au choix des entrants. Il est une constante, dans tous les régimes peu – ou prou – démocratiques : choisir les hommes selon des critères subjectifs, les pressurer jusqu’à la moelle et s’en débarrasser à la première occasion. Depuis près de quarante ans, c’est la règle en Mauritanie où la fonction ministérielle a été tellement dévalorisée que tout un chacun, sensé ou non, peut y prétendre. La valse des ministres est devenue le sport-roi de nos dirigeants qui y trouvent, à chaque fois, l’occasion de divertir un peuple qui vit de ragots, de médisances et de rumeurs. Et la dernière tempête dans un verre d’eau n’a pas dérogé à la règle. Le peuple a eu quelque chose à se mettre sous la dent, pendant quelques jours. Mais avant qu’il ne revienne sur la terre et à ses soucis, on lui a, aussi sec, servi un autre plat : le refus du Conseil constitutionnel de valider le projet de loi organique du gouvernement, prévoyant de renouveler, maintenant, deux tiers du Sénat et le dernier tiers dans deux ans. Réveillé subitement d’un long sommeil qui frôlait l’hibernation, ledit Conseil a recalé le projet de loi, au motif que tout le Sénat est périmé et qu’il faut donc le renouveler en entier. Rebelote donc !
Un nouveau projet de loi sera approuvé en Conseil des ministres, avant de passer par le Parlement, pour revenir, devant le Conseil constitutionnel, et nous voici reparti pour au moins deux ans de statu quo ! D’ici là, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts. Qui ne connaît pas ce Conseil peut, aisément, imaginer que celui-ci a normalement rempli sa fonction mais, ceux, nombreux, sans aucun doute sur son inféodation à l’Exécutif, douteront que sa décision ait été bâtie sur le Droit et rien que le Droit. D’autant qu’entre le Droit et le Non-droit, il y a le courbe, la courbette, le louvoiement, le zigzag, j’en passe et de plus louches encore…
Autre pâture jetée à l’opinion : la promotion de six nouveaux colonels au grade de général. On en est, désormais, à dix-sept étoilés. Une inflation dont notre armée peut bien se passer. Au Sénégal voisin, par exemple et pour rester dans une logique chère à nos gouvernants qui veut toujours nous comparer aux pays frontaliers, seuls sept colonels – quatre de l’Armée et trois de la Gendarmerie – en vingt-cinq ans, entre Senghor et Diouf, atteignirent ce firmament. L’armée sénégalaise est pourtant plus nombreuse que la nôtre et ses chefs beaucoup mieux formés. Autre différence de taille avec ce voisin, démocratique s’il en est : Au Sénégal, le pays a son armée, républicaine, alors qu’en Mauritanie, c’est l’armée qui a son pays : elle en fait ce qu’elle veut. En se donnant de grands airs. Je veux dire : des airs de grands. Forts. Puissants. Mais si les gens ouvraient, tout simplement, les yeux, ils ne tarderaient pas à comprendre « par quels petits hommes ils sont gouvernés ». Et « se révolteraient vite », ainsi que le prédisait Talleyrand, voici plus de deux cent cinquante ans. Mais, avec des si et des mais, ne mettrait-on pas, dans une même bouteille, Nouakchott, la Mauritanie entière et… toutes ses autruches, la tête obstinément plantée dans nos sables chéris, aussi piètrement dosés soient-ils ?
Ahmed Ould Cheikh