Monthly Archives: February 2016
Cheikh Anta Diop: «Les Egyptiens étaient des Nègres»
 Le 7 février 1986, disparaissait le Sénégalais Cheikh Anta Diop, auteur du célèbre Nations nègres et cultures. Ses thèses iconoclastes, fondées sur une érudition scientifique et pluridisciplinaires, avaient fait l’effet d’une bombe à la parution de l’ouvrage en 1954. A l’occasion du 30e anniversaire de la disparition de l’historien, RFI a interrogé le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne sur la portée de l’œuvre de Diop. Souleymane Bachir Diagne, 61 ans, vit aux Etats-Unis où il enseigne la littérature et la philosophie à l’université de Columbia. Entretien.
Le 7 février 1986, disparaissait le Sénégalais Cheikh Anta Diop, auteur du célèbre Nations nègres et cultures. Ses thèses iconoclastes, fondées sur une érudition scientifique et pluridisciplinaires, avaient fait l’effet d’une bombe à la parution de l’ouvrage en 1954. A l’occasion du 30e anniversaire de la disparition de l’historien, RFI a interrogé le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne sur la portée de l’œuvre de Diop. Souleymane Bachir Diagne, 61 ans, vit aux Etats-Unis où il enseigne la littérature et la philosophie à l’université de Columbia. Entretien.
Nous commémorons cette année le 30e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop. Je crois que vous l’avez connu personnellement. Quel genre de personnage était-il ?
Je l’ai rencontré une seule fois. Je m’en souviens encore. Je sortais de mon agrégation de philosophie lorsque mon oncle Pathé Diagne, qui était l’un de ses amis, m’a amené le voir. C’était un monsieur très courtois et attentif. On a parlé de mes études et de l’importance qu’il attachait à la réflexion philosophique. Il m’a dit que l’Afrique avait besoin de philosophes pour penser son présent et son avenir. J’étais un peu intimidé par ce grand personnage dont j’avais lu, comme tous les Sénégalais, les écrits sur l’Egypte, et notamment son livre intitulé Antériorité des civilisations nègres : mythe ou vérité historique ? que j’avais dévoré au sortir de la terminale.
Quel impact ces lectures ont-elles eu sur vous ?
Elles ont eu un impact immense sur moi comme sur beaucoup de jeunes Africains grandissant dans des sociétés postcoloniales et dominées. Elles m’ont aidé à structurer ma pensée. Tous les Africains qui ont lu Cheikh Anta Diop sont marqués à jamais par la simplicité et la force de sa narration. Moi, j’ai retenu de mes lectures « diopiennes » trois grandes idées. Primo, la civilisation égyptienne est une civilisation profondément africaine et d’ailleurs l’Egypte n’est pas compréhensible sans son ancrage africain, tout comme l’histoire africaine ne se comprendrait pas sans sa connexion avec l’Egypte.
Quelles sont les deux autres idées que vous avez retenues ?
La deuxième leçon importante, ce fut la découverte que l’Afrique ne se réduisait pas à sa tradition orale et que l’érudition écrite avait une longue histoire sur notre continent. Comme l’a écrit Diop, on ne peut pas parler de philosophie africaine en ignorant que cette discipline était enseignée dans des grandes villes comme Tombouctou ou Djenné dans une tradition écrite depuis des époques médiévales. La lecture de Cheikh Anta Diop m’a convaincu que la démarche ethnologique ne suffisait pas et qu’il fallait une démarche proprement historique pour pouvoir situer l’histoire intellectuelle de l’Afrique à l’intérieur de celle du monde musulman et plus généralement, à l’intérieur de la tradition de l’érudition écrite. Enfin, la troisième grande idée que Diop développe dans son œuvre, c’est celle de l’unité culturelle et politique africaine. Son volontarisme panafricaniste n’est pas sans rappeler l’appel à l’unité africaine d’un Senghor ou d’un Nkrumah.
Vous avez connu Cheikh Anta Diop, mais aussi Senghor. Il semblerait que leurs relations étaient plutôt tendues ?
On a exagéré sur les divergences intellectuelles entre ces deux grands Sénégalais. Certes, Senghor et Diop n’étaient pas sur la même longueur d’onde sur le plan politique, mais maintenant que tous les deux sont morts et que la passion politique est retombée, les points de convergence apparaissent davantage, notamment sur les questions de l’unité culturelle du monde noir.
Parmi les thèses iconoclastes de Cheikh Anta Diop, il y a aussi son affirmation que les Grecs auraient tout appris des Egyptiens, de la philosophie jusqu’aux sciences. Faisait-il de l’afrocentrisme ?
C’était évidemment excessif d’affirmer que les Grecs avaient tout appris des Egyptiens, mais Cheikh Anta Diop avait eu raison de questionner la présentation de l’histoire intellectuelle de l’Occident comme un parcours totalement exceptionnel, sans lien avec d’autres parcours civilisationnels. Les Occidentaux nous disent que tout a commencé par la Grèce. On nous parle de « miracle grec », ce qui impliquerait que la Grèce ne naît que d’elle-même et que sa civilisation n’aurait eu aucun lien avec le monde antique environnant. Diop a montré, avec des preuves à l’appui, puisées autant dans l’archéologie, l’histoire que dans la linguistique, que les échanges avaient bel et bien eu lieu entre le monde grec et le monde égyptien. Platon lui-même a reconnu dans ses dialogues la dette de la Grèce à l’égard de l’Egypte. C’est à partir de Hegel que la démarche philosophique est conçue comme étant propre à l’Europe, alors qu’avant Hegel les philosophes européens étaient tout à fait conscients que la philosophie était le produit d’une conversation entre des cultures, entre des penseurs venant des aires culturelles différentes. Avant d’être « afrocentriste », Cheikh Anta Diop interpelle l’européocentrisme de la pensée occidentale. D’où la méfiance et la condescendance dont celui-ci a été victime si longtemps.
Pourquoi les idées de Cheikh Anta Diop semblent déranger moins aujourd’hui ?
Dans les années 1950 lorsque Cheikh Anta Diop a été empêché de présenter sa thèse sur l’africanité de l’Egypte à la Sorbonne, l’université occidentale vivait encore sur l’héritage de la domination de la pensée occidentale qui supportait mal les mises en cause de sa supériorité. L’Occident seul savait « philosopher »… L’Afrique était trop arriérée pour avoir abrité une civilisation aussi brillante que la civilisation égyptienne. Puis, les idées défendues par l’historien africain ont fait leur chemin et ont fini par s’imposer, notamment à la suite du colloque international du Caire de 1974, organisée sous l’égide de l’Unesco. Ce colloque est venu conforter les thèses de Diop sur l’Egypte africaine.
Vous enseignez depuis plusieurs années aux Etats-Unis. De quelle réputation Cheikh Anta Diop jouit-il aujourd’hui auprès de l’intelligentsia américaine ?
Son œuvre fait partie aujourd’hui de ce qu’on appelle le « canon » de la littérature postcoloniale. Elle est associée à l’affirmation de l’africanité de l’Egypte. Antériorité des civilisation nègres est sans doute son ouvrage le plus connu parmi les intellectuels américains.
RFI.FR –
Monsieur le Président, vers où nous conduisez-vous ?
 “Quant on peut tout ce que l’on veut, il est difficile de vouloir ce que l’on doit’’. Louis XIV
“Quant on peut tout ce que l’on veut, il est difficile de vouloir ce que l’on doit’’. Louis XIV
Il faut aimer son pays pour le servir.
Aux actes citoyens !
Je n’écris pas comme d’autres préparent des coups d’Etat.
Je ne convoite ni pouvoir ni honneur, je veux seulement dire devant mon pays ce que j’ai vu et ce que je pense. Nous vivons des temps incertains et difficiles. Hélas ! Chômage, insécurité, flambée des prix, corruption, faiblesse des services publics et de l’Etat.
Jamais dans l’histoire de ce pays, les interrogations n’ont été aussi nombreuses sur tout ce qui touche à l’avenir et aux perspectives d’une nation qui jusque – là avait su faire face à toutes les incertitudes politiques, économiques et sociales, quels qu’en fussent les causes, les manifestations et les effets. Après tant de promesses non tenues.
Sans doute, depuis 1960, le fossé n’a été aussi grand entre ceux qui sont csensés assurer la Direction du pays et nos populations. Un pays en loques où l’opulence côtoie la misère et le désespoir, où les yeux hagards des enfants affamés, agglutinés aux feux rouges d’une capitale ensevelie sous les ordres, sont éblouis par les voitures rutilantes d’une classe dirigeante arrogante, incompétente et corrompue.
Je connais, je les ai vus, le désespoir et le désordre qui sont le quotidien des laissés-pour-compte, avec leurs conséquences désastreuses sur les enfants des rues de Nouakchott. Je sais combien est ténue pour eux la frontière entre l’humiliation et la fureur dévastatrice, je sais avec quelle facilité ils glissent dans la violence et le désespoir.
Je sais que la réponse des puissants à ce désordre qui alterne l’indifférence complaisante avec l’usage de la force aveugle, l’alourdissement constant des peines de prison. Je sais que la Jeunesse de notre pays vit une situation endémique d’inquiétudes profondes. Je sais que le durcissement des attitudes, l’expression du fondamentalisme et du communautarisme nous menacent tous.
Un pays délabré. L’insalubrité y règne en maître. Les rues de la capitale économique sont redevenues nauséabondes, pour traverser Nouadhibou, il faut savoir retenir sa respiration ou tenir un mouchoir sur la bouche et les narines. La ville, une cité poubelle. La Zone Franche, un pas en avant, deux en arrière. Une véritable période d’incertitude.
Quelle honte ! Quelle misère ! La Nation est abandonnée à elle-même. Le renchérissement du coût de la vie, la faillite du système éducatif, les défaillances dans les secteurs de la santé et de la sécurité publique sont autant de maux dont souffrent plus que jamais les Mauritaniens !!! Tous les mythes ses sont effondrés.
L’inflation et la pauvreté fissurent les familles. Le possible n’ayant jamais été accompli. Deux Républiques dans une ! L’une à genoux sans repères, déçue, frustrée, voire trahie et l’autre, une véritable industrie de fabrication en séries d’une nouvelle classe bourgeoise se payant des palais de luxe et des voitures rutilantes.
Les Mauritaniens réclament le droit, le droit souverain de jeter un regard sur la situation de leur pays et de rechercher de trouver les solutions les plus convenables à leurs problèmes, à la situation de la Mauritanie. La morale doit les y aider.
L’éthique républicaine doit en garantir le droit. La violence verbale, la violence physique ou politique n’a jamais été un moyen de rapprocher les hommes, des idées. Elle n’est qu’un raccourci pauvre de contenu humaniste, à effet peu durable, destructeur.
Ce climat assurément malsain dans lequel nous baignons en dépit des rodomontades de ceux qui veulent nous faire croire que nous sommes à l’orée d’un décollage vers les prairies du bonheur sur terre. L’enjeu est suffisamment grave, important pour que nous fermions les yeux sur l’ambiance morose d’une fin d’année sans guirlandes ni feux d’artifices, sous la psychose de l’hydre terroriste. Aucune tête, dans ce pays n’est à la fête.
Tous sont conscients que la vie de l’écrasante majorité des mauritaniens et la marche de leurs activités professionnelles (s’ils en ont d’ailleurs !) ou encore leurs relations sociales ses résument à une désespérante angoisse existentielle vire à une fuite en avant pour oublier un insoutenable présent.
Impôts-aux pauvres contribuables – et recette douanières parfois perverses sont restés les mamelles de l’économie nationale. Le doute sur l’Etat de la Nation et donc là, indéniable !
Chômage, mendicité, fermeture d’entreprises, marchés de gré à gré, expression d’une mal gouvernance réelle, sont plus que jamais les marqueurs d’une société soudainement plombée. Surtout que l’incertitude politique avec des tensions continues, fait le reste. Aux actes, citoyens ! Que chacun s’engage à jouer sa partition. Nous sommes tous concernés… c’est en agissant que le rêve sera une réalité !
Ahmed Bezeid Ould Beyrouck
Chroniqueur Politique
PS: Si les insulteurs professionnels pensent pouvoir imposer un crépuscule sur les idées et les idéaux qu’ils se détrompent.
le calame
Dossier de la drogue : Ould Haidalla réclame l’audition d’un conseiller du Président
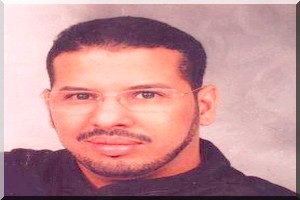 Alakhbar – Sidi Mohamed Ould Haidalla, arrêté dans la vague des interpellations policières liées au dossier du trafic de la drogue, a demandé l’audition de l’un des conseillers du Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, pour avoir intervenu, il ya 3 semaines, en faveur de la mise en liberté de trois touaregs en connexion avec le dossier de la drogue.
Alakhbar – Sidi Mohamed Ould Haidalla, arrêté dans la vague des interpellations policières liées au dossier du trafic de la drogue, a demandé l’audition de l’un des conseillers du Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, pour avoir intervenu, il ya 3 semaines, en faveur de la mise en liberté de trois touaregs en connexion avec le dossier de la drogue.
Ould Haidalla a insisté au cours de sa comparution devant le Procureur de la wilaya Ouest de Nouakchott et en présence de son avocat, sur l’implication dudit conseiller, le citant nommément dans le dossier narcotique.
Le responsable a usé de son statut protocolaire pour relaxer trois personnes accusées de trafic de la drogue, a-t-il ajouté, affirmant avoir déjà fait l’objet de menaces du conseiller susmentionné et précisant qu’il l’avait même entrainé devant les policiers et les juges.
Ces deux faits suffisent pour convoquer le conseiller du Président et son audition dans le dossier de l’enquête relative au dossier de la drogue voire sa punition si sa culpabilité est confirmée.
Traduit de l’Arabe par Cridem
Nouvelles d’ailleurs de Mint derwich : Des pauvres, du gasoil, des ânes et des Nous Z’Autres…
 J’ai décidé de m’acheter un âne. Un vrai âne, un âne de compétition, un âne dans toute sa splendeur d’âne, un âne membre de la grande confrérie des Nous Z’Autres, ânes assermentés et rectifiés. Non pas que je ne puisse m’offrir autre chose qu’un âne. Un chameau par exemple, animal presque « frère » de mes ancêtres et dont nous avons – le « nous » est pour les Nous Z’Autres du grand Nord – hérité du caractère sympathique et quelque peu querelleur. Je pourrais aussi décider de m’acheter une chèvre, ou une vache « Z’à cornes » et à mamelles. Et pourquoi pas un coq ?Non. Je veux un âne. Un âne bien âne. Un âne qui serait chargé de me trimballer. Ok, j’entends d’ici les (rares) défenseurs des animaux qui crient déjà au drame national et dénonçant la maltraitance à animal. A cela, je rétorque qu’un âne de chez nous est habilité à transporter mes rondeurs… Il n’est habilité qu’à ça, d’ailleurs, au vu de certaines matrones plus que pulpeuses que je vois transportées de ci, de là, de par les rues de notre capitale… Mes rondeurs à moi n’ayant, ni plus ni moins, le même charme et le tampon estampillé « pur produit féminin du bled, à consommer avant le … » que les autres rondeurs, je ne vois pas pourquoi je me passerais de m’acheter un âne.
J’ai décidé de m’acheter un âne. Un vrai âne, un âne de compétition, un âne dans toute sa splendeur d’âne, un âne membre de la grande confrérie des Nous Z’Autres, ânes assermentés et rectifiés. Non pas que je ne puisse m’offrir autre chose qu’un âne. Un chameau par exemple, animal presque « frère » de mes ancêtres et dont nous avons – le « nous » est pour les Nous Z’Autres du grand Nord – hérité du caractère sympathique et quelque peu querelleur. Je pourrais aussi décider de m’acheter une chèvre, ou une vache « Z’à cornes » et à mamelles. Et pourquoi pas un coq ?Non. Je veux un âne. Un âne bien âne. Un âne qui serait chargé de me trimballer. Ok, j’entends d’ici les (rares) défenseurs des animaux qui crient déjà au drame national et dénonçant la maltraitance à animal. A cela, je rétorque qu’un âne de chez nous est habilité à transporter mes rondeurs… Il n’est habilité qu’à ça, d’ailleurs, au vu de certaines matrones plus que pulpeuses que je vois transportées de ci, de là, de par les rues de notre capitale… Mes rondeurs à moi n’ayant, ni plus ni moins, le même charme et le tampon estampillé « pur produit féminin du bled, à consommer avant le … » que les autres rondeurs, je ne vois pas pourquoi je me passerais de m’acheter un âne.
Oui, je veux un âne ! C’est devenu l’urgence du moment. J’ai décidé ceci en écoutant notre ministre chargé des relations avec le Parlement nous expliquer le pourquoi du comment de la non-baisse du prix du gasoil. Exercice jouissif, truculent, bien à la sauce de chez nous, blédards festifs. Quand il nous a expliqués que, non, le prix à la pompe ne baisserait pas ; que, non, notre république dattière ne se passerait pas de la manne des taxes sur l’essence, au moment où tout va mal ; que, oui, nous étions gonflés, nous les râleurs, de râler en rond devant la facture salée, gonflés alors que nous étions les « riches » car possédant une voiture ; je me suis dit : « La Derwichette, achète toi un âne ».
C’est la première fois qu’on me fait un truc pareil : m’expliquer, à moi simple quidame, que les « heureux » propriétaires de voitures sont des riches, donc à même de se payer le gasoil au prix où il est. Que les pauvres, ne possédant pas de voitures, ne râlent pas et qu’ils sont même très heureux d’être pauvres car ils bénéficient du programme social Emel ! Et, datte sur les niébés, qu’ils bénéficient des transports gratuits.
Mouais… Et re mouais… On ne nous l’avait jamais faite, celle là. Du moins, personne n’avait encore osé : « Les pauvres ne sont pas affectés par le prix élevé des hydrocarbures…. ». Une belle lapalissade, si l’on s’en tient à la pauvreté fantasmée, selon nos dirigeants qui veulent nous faire avaler qu’être pauvre, c’est ne pas avoir de voitures… Basique, d’une simplicité enfantine. Tellement simple qu’on se demande pourquoi nos économistes en herbe n’avaient jamais encore osé ce genre de raccourci.
Bref. Notre Ministre a illuminé ma semaine. Grand merci à lui et toutes les bénédictions sur lui. Devant tant d’à propos ministériel et de démonstration savante, je me demande si je vais oser gâcher la fête et émettre quelques petites remarques. Oh, des remarques insignifiantes, juste histoire de ne pas rester bouche bée, devant tant d’intelligence politique et sociale. L’ânesse en moi ne peut s’empêcher de braire un peu, braire de rire d’abord, puis braire de désespoir. Car je suis une ânesse, à l’image de la majorité de mes compatriotes, vos administrés, soit « émelisés », soit « riches » ou, si vous préférez, « Z’A voitures » ou « Z’A sans voitures ».
Mais, toujours à l’image de mes compatriotes (très chères sœurs et très chers frères…), mon porte-monnaie prend ses babouches à son cou quand il passe à « l’essencerie ». Si vous avez déjà tenté d’ouvrir un porte-monnaie récalcitrant et en grève de paiement, vous savez de quoi je parle… Souvent le porte-monnaie n’abrite que de maigres billets bleus – au fait, bravo pour les billets en plastique, ça fait Monopoly des sables ! – Dans mes jours fastes je lance un royal « 5000 UM » au pompiste qui s’empresse d’abreuver ma machine auto mais, la plupart du temps, je me contente d’un « elfein » contrit… Et je vous prie de croire que ces 2000 UM de gas-oil, je les use jusqu’à la dernière goutte, avant de me représenter devant une pompe à gasoil !
Si tous ceux qui possèdent une voiture étaient riches, ça se saurait, Mheusieur le Miiinistre ! On peut être pauvre et avoir une voiture, du moins la version « carcasse » de ce que, sous d’autres latitudes, on appelle voiture. Chez nous, tant que ça roule, ça roule. Et quand ça ne roule plus, ça roule quand même ! Chaque Mauritanien fait sa prière rituelle, tous les jours, en regardant sa voiture ou autre objet roulant et à quatre pneus qui lui sert de véhicule : « Mon Dieu, Mon Dieu, Ya Rabbi, évite-moi le mécanicien et la panne ! ». Car aller chez le mécanicien, c’est un peu comme la roulette russe. Tu as plus de chance de te prendre la balle que de l’éviter. Et, après, tu dois rentrer chez toi annoncer à toute la famille que, ce mois-ci, ça sera pâtes et patates à tous les repas et la viande que le vendredi…
Bref. Ce Nous Z’Autres-là, qui est, quand même la grande majorité, est pauvre mais pas pauvre au point de bénéficier des boutiques Emel. Il se démerde comme il peut. Il zigzague entre sa carcasse à moteur, le prix de l’essence, les pots de vin aux autorités en uniforme censées nous protéger sur la voie publique, les amendes pour non assurance – ça coûte cher, une assurance… – ses factures, son loyer, les soins onéreux pour le petit dernier, ses crédits, sa famille qui pense qu’il est un arbre à ouguiyas, etc., etc.
Et ce péquin-là, toujours la grande majorité, je vous le rappelle respectueusement, Monsieur notre ministre des « Pauvres non affectés », il trouve, quand même, que l’essence coûte un bras, et une jambe, et la tête entière… Il trouve que tout augmente trop. Que le riz qu’il mange, le midi, doit être en or, vu son prix ; que le sucre qu’il met dans son thé lui coûte les yeux de la tête ; que la viande est devenue produit de luxe ; que le poisson, le lait, le pain, l’huile, le beurre, etc., etc., que tout ça devient inabordable ; que les commerçants s’en mettent un peu trop dans les poches, quand ses poches, à lui, rétrécissent, elles. Il trouve que ce qu’il met dans sa voiture, pour la faire avancer, est devenu produit de luxe. Et il trouve qu’il a le droit de protester et de s’indigner, quand il entend les propos tenus par votre grandeur gouvernante et ministrée.
Vous comprendrez, Monsieur le Ministre, mon désir d’âne à quatre pattes (un âne à deux pattes ne me servirait à rien…) : un âne ne tète pas de gas-oil. Un âne ne passe pas à l’essencerie. Un âne n’enrichit pas mon mécanicien. Un âne, on lui donne à manger, on lui parle gentiment et il fait son boulot d’âne. Un âne à quatre pattes ne me raconte pas de sornettes. Il n’en a que faire, des « pauvres » ou des « riches ». Et il n’en a que faire du prix de l’essence et des ministres chargés des relations avec le Parlement… C’est le propre des ânes à quatre pattes : ils ne font pas dans la sculpture sur les nuages, ils sont dans la vraie vie.
Je rejoins donc le cri de guerre des soi-disant « riches Z’à voitures », véritables vaches à lait du politique : « Maa ni chaari gas-oil ! », slogan des mécontents après la sortie peu éclairée de notre ministre… et je m’achète un âne. Serais-je, alors, assez pauvre pour être « Pauvre non affectée » ? Plus pauvre que pauvre ? Tellement pauvre que je serais l’argument ultime pour expliquer et cautionner une politique économique qui étrangle les Mauritaniens ? Tellement pauvre, encore plus bas que le tellement pauvre, que j’expliquerais, à moi toute seule, la non baisse des prix à la pompe ?
Nous n’avons pas édifié de pyramides, ni inventé le zéro, ni le fil à couper le beurre, mais nous inventons des concepts – chacun fait ce qu’il peut, hein ? – après celui du coup d’Etat permanent, le concept de la Rectification, le concept du Dialogue, nous voilà avec le concept du « pauvre riche, du riche pauvre, du pauvre, du riche et du Ministre » ou, si vous préférez, du « Manuel d’économie à usage des ânes ». Sur ce, je vous laisse. Je dois trouver un nom à mon futur âne. Les choix ne manquent pas… Salut.
Mariem mint Derwich
Torture en Mauritanie: la vive inquiétude des Nations unies

En Mauritanie, le rapporteur spécial de l’ONU déplore la non-application des lois contre la torture. En septembre dernier une série de lois sur la prévention et la répression de la torture ont été promulguées.
Le rapporteur de l’ONU a salué cette initiative, mais au terme de sa visite de dix jours dans le pays, Juan Ernest Mendez a regretté hier que ces mesures contre la torture et les mauvais traitements ne soient pas appliquées par les autorités. La Mauritanie a déjà été épinglée par plusieurs ONG de défense des droits de l’homme.
Notamment Amnesty International, qui rapporte de nombreux actes de tortures et de mauvais traitement infligés aux détenus pour leur arracher des aveux. Un constat partagé par le rapporteur des Nations unies contre la torture, Juan Ernest Mendez.
Pour Juan Ernest Mendez, « il y a un décalage entre la législation et les pratiques sur le terrain… mais il est aussi vrai que le gouvernement mauritanien fait des efforts significatifs pour adapter la législation aux standards internationaux, notamment en matière de protection contre la torture ».
« Nous pensons, poursuit le rapporteur des Nations unies contre la torture, qu’il est important que ces nouvelles normes adoptées il y a quatre mois soient appliquées le plus vite possible. Il faut que certains procureurs aient une attitude plus ferme, en déterminant si les aveux et les déclarations ont été obtenus sans aucune forme de contraintes ».
« Il en va de même pour les traitements cruels et dégradants, termine M. Mendez. Il est important que le gouvernement reconnaisse que des engagements formels doivent être pris pour atteindre les standards internationaux parce que, pour le moment, dans les prisons que nous avons visitées, les détenus ne bénéficient pas de conditions de vie humaines ».
Rfi





