Daily Archives: 22/03/2017
Castes, Tribus et Communautés en Mauritanie : socles de stabilité ou facteurs de désunion ?
 DuneVoices – Pays multiethnique et multiculturel à cheval entre le monde arabe et l’Afrique noire, la Mauritanie compte un peu plus de trois millions d’habitants. Sa population se compose, essentiellement, de quatre grands ensembles : Maures, Peuls, Soninké et Wolofs.
DuneVoices – Pays multiethnique et multiculturel à cheval entre le monde arabe et l’Afrique noire, la Mauritanie compte un peu plus de trois millions d’habitants. Sa population se compose, essentiellement, de quatre grands ensembles : Maures, Peuls, Soninké et Wolofs.
Chacun de ces quatre ensembles se subdivise en plusieurs communautés, castes et fractions tribales. Celles-ci confère un certain rôle à chaque individu dans la société mauritanienne, auquel il est difficile d’échapper et qui la rend profondément inégalitaire.
Quelle que soit la communauté à laquelle on appartient, c’est le même système de caste et la même organisation sociale qui régit la société mauritanienne. Chez les Maures (arabo-berbères) comme chez les Afro-mauritaniens (peuls, soninkés et wolofs) l’ordre social hiérarchique place les nobles (guerriers et marabouts) en haut de l’échelle, suivis par les artisans et en bas de l’échelle les affranchis et les esclaves.
Les basses castes sont continuellement discriminées, et les mariages “intercastes” sont, dans les faits, interdits. « Aussi longtemps que je me rappelle, les choses ont toujours été ainsi. La Mauritanie s’est créée sur des bases tribales et aujourd’hui encore, malgré l’existence d’un état central, c’est le même système qui se perpétue.
C’est d’ailleurs ce qui explique la persistance des pratiques esclavagistes qui se traduisent par le maintien et l’exacerbation des rapports entre dominants et dominés » confie à Dune Voices, Boubacar Ould Messaoud Président de SOS Esclaves. Si l’esclavage a été officiellement aboli en 1981, 150 000 personnes en seraient encore victimes aujourd’hui (soit 4% de la population) selon l’ONG Walk Free Foundation.
Ce que réfutent les officiels mauritaniens avec à leur tête le Président Ould Abdel Aziz qui ne manque aucune occasion pour nier l’existence de ce phénomène en Mauritanie.
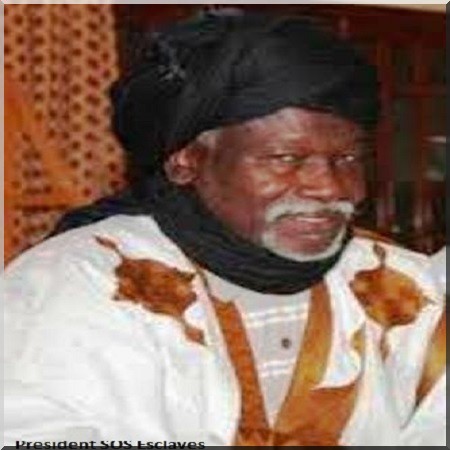
Mais selon le Président de SOS esclaves, activiste de première heure de la lutte contre l’esclavage en Mauritanie, chez les arabo-berbères, la tribu ne libère pas « au contraire, même affranchis par leurs maîtres les esclaves n’en restent pas moins esclaves s’ils continuent d’être liés à la tribu.
C’est le cadeau de l’écureuil : on lui remplit la peau des pépites d’or qui ne lui appartiennent pas. La solidarité tribale n’a jamais bénéficié aux esclaves, seuls les plus forts bénéficient des privilèges, les autres sont écrasés » indique-t-il.
L’esclavage n’est pas la seule tare héritée du système tribaliste, comme l’explique un sociologue, professeur à l’université de Nouakchott : « En Mauritanie, plusieurs groupes sociaux à l’image des forgerons, griots, Znaga, Rimaybes, Hamriyas sont considérés comme étant de basse classe et victimes de tous les stéréotypes.
C’est le cas des forgerons (Maalmines) qui, malgré les précieux services qu’ils assurent, sont considérés comme des personnes guignardes, gourmandes, toujours pressées et toujours promptes à commettre des bêtises. Les griots sont assimilés à des délateurs à la langue fourchue et les Znagas, Rimaybes et Hamriyas ne sont ni plus ni moins qu’à des parias ».
Montée en puissance des revendications identitaires
Ces cloisonnements communautaires, du fait de leur persistance et leur caractère intolérable, ont fini par créer des frustrations poussant certains à braver l’ordre établi pour briser le carcan de la domination.
Les militants anti-esclavagistes notamment ceux d’El Hor, SOS esclave et IRA (Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste) ont été les premiers à tirer la sonnette d’alarme « Au lieu de nourrir, d’éduquer et d’assurer la protection à tous ses membres, la tribu en milieu maure a toujours privilégié les maîtres esclavagistes qui peuvent disposer de leurs esclaves que nous sommes comme ils l’entendent » indique Hamoud Ould Saleck coordinateur régional de SOS esclave du Tagant qui dénonce notamment l’esclavage domestique.
D’autres mouvements ont basé leur lutte sur la remise en cause d’un système inégalitaire, comme l’Association pour la promotion de la langue wolof en Mauritanie (APROLAWO RIM), le collectif Touche pas à ma nationalité (TPMN), l’Association pour la promotion de la langue et la culture Soninké, le Mouvement des Maalmines.
Tous sont montés au créneau pour revendiquer plus de considération, plus d’égalité et plus de justice. Pour APROLAWO RIM et l’Association pour la promotion de la langue et la culture Soninké, les revendications sont modérées.
Elles sont plus fortes chez le mouvement Touche pas à Ma Nationalité (TPMN) dont les membres ont organisé plusieurs marches pour dénoncer ce qu’ils qualifient de « génocide biométrique » en liaison avec le recensement biométrique en cours en Mauritanie et auquel n’aurait accès, selon eux, qu’un nombre limité de la communauté afro-mauritanienne.
Le but du pouvoir –concentré entre les mains des maures- serait selon eux, d’en faire des apatrides. L’une de leurs marches organisées à Maghama (ville du sud mauritanien) s’est soldée par la mort du jeune manifestant Lamine Mangane tué par un agent de maintien d’ordre.

Cette thèse est pourtant réfutée par les autorités mauritaniennes qui promettent de recenser tous les Mauritaniens quelle que soit leur appartenance communautaire. A plusieurs reprises, Mrabib Rabou, l’Administrateur Directeur général de l’Agence Nationale du Registre de la Population et des Titres Sécurisés, a soutenu que le recensement en cours n’a aucun caractère sélectif et qu’il est ouvert à tout individu.
Les actions menées par TPMN s’inscrivent en droite ligne du combat que livre la communauté noire de Mauritanie pour faire reconnaître ses droits. Le Front de Libération Africaine de la Mauritanie (FLAM) dont l’une des tendances vient de se muer en parti politique dénommé FPC mène un combat similaire.
De leur côté les Maalimines (forgerons) ont vu leurs revendications prendre une autre tournure avec le procès intenté contre un des leurs, Ould Mkheitir, accusé de blasphème pour son écrit intitulé « Religion et Religiosité ». Après l’arrestation d’Ould Mkheitir, les Maalimines se sont désolidarisés de lui et depuis lors le mouvement affiche le profil bas.
Entre temps, une partie de la communauté Beïdane s’est, elle aussi, radicalisée en adhérant au discours et aux idéaux développés par le leader extrémiste Daoud Ould Ahmed Aicha président de la toute nouvelle formation politique « le Parti de l’Appel de la Nation ». Ould Ahmed Aicha n’exclut pas, s’il le faut, de faire usage des armes pour défendre sa communauté contre les « arrivistes ».
Ces propos à forte connotation communautariste ont même trouvé des échos au niveau de l’hémicycle de l’Assemblée nationale où des députés maures et des députés afro-mauritaniens s’en sont affrontés verbalement en s’accusant mutuellement de racisme et de xénophobie.
Sans compter que, des rencontres tribales, à l’image de celle d’Ehel Abdy Ould Abdarahmane à Meksem (l’ancêtre commun de la tribu maure Ehel Abdy) dans la province du Tagant, sont organisées régulièrement à l’intérieur du pays au vu et au su de l’administration mauritanienne qui ne fait rien pour l’empêcher. Ces rencontres constituent un danger pour la cohésion nationale en contribuant à accentuer l’esprit sectaire et à créer l’adversité entre les tribus dont les intérêts sont la plupart du temps antinomiques.

« La tribu en Mauritanie n’est pas un facteur d’unité, elle est au contraire le lieu de toutes les injustices sociales. Elle nourrit, entretient et perpétue les inégalités. Elle a un rôle plutôt négatif parce qu’elle est aux antipodes de la notion d’Etat central garant de la liberté et l’épanouissement de tous ses citoyens. La tribu en Mauritanie est un système mafieux basé sur une solidarité factice et partiale » renseigne Boubacar Ould Messoud de SOS Esclaves.
Cette opinion du Président de SOS Esclaves est similaire de celle défendue par Ladji Traoré, activiste des droits de l’homme et secrétaire général du parti Alliance Populaire et Progressiste : « Je suis contre la politisation des tribus et des communautés nationales. C’est une récupération malsaine et dangereuse. L’instrumentalisation communautaire a eu de fâcheuses répercussions au Congo. Ce pays devait servir d’exemple pour dissuader les pyromanes de tous bords » confie-t-il à Dune Voices.
Ladji Traoré reconnait toutefois que les langues maternelles sont des vecteurs de développement. « J’ai toujours eu l’intime conviction et ce depuis les années 70 que les Africains n’accéderont pas à la culture, les sciences et la technologie tant qu’ils n’enseigneront pas dans leurs langues maternelles.
Ce qui ne veut pas dire qu’ils doivent s’enfermer, ils doivent, une fois enracinés, s’ouvrir également aux autres » conclut Traoré qui regrette que la communauté Bambara dont il est issu et qui compte des milliers de membres en Mauritanie, ne soit pas reconnue.
Khalil Sow
http://dune-voices.info/public/index.php/fr/francais/item/1471-castes,
La présidence s’adresse à la Commission électorale
 Selon des sources citées par Saharamedias, le ministre secrétaire général de la présidence a adressé une correspondance écrite à la Commission électorale nationale indépendante pour lui demander de faire une proposition en vue de l’organisation d’un référendum populaire sur la réforme constitutionnelle. Selon les sources précitées, Moulaye Ould Mohamed Lagdaf, qui préside le comité de suivi de l’application des résultats du dernier dialogue politique, aurait demandé à la CENI de faire la proposition afin que le référendum puisse être organisé juste après la fin du mois du Ramadan, c’est-à-dire d’ici trois mois. Ould Mohamed Lagdaf a présidé mardi une réunion de ce comité de suivi à laquelle ont assisté de hauts fonctionnaires de la présidence à côté de quelques présidents de partis politiques ‘’dialoguistes’’ notamment Naha Mint Mouknass, Boidiel Ould Houmoid et Messaoud Ould Boulkhair entre autres. Le comité est composé de membres appartenant à toutes les forces politiques ayant participé au dialogue et comptent mener une vaste campagne en faveur d’un vote populaire favorable aux amendements constitutionnels dans la perspective au recours à l’article 38 de la constitution qui donne le droit au président de pouvoir consulter le peuple par voie de référendum direct dans toute ‘’affaire d’importance nationale’’. Tout cela, malgré que tous les grands spécialistes du droit constitutionnel sont unanimes sur le fait des dispositions de l’article 99 de la Constitution qui oblige le passage par les deux chambres (Assemblée Nationale et Sénat) pour entreprendre n’importe quelle reforme constitutionnelle.
Selon des sources citées par Saharamedias, le ministre secrétaire général de la présidence a adressé une correspondance écrite à la Commission électorale nationale indépendante pour lui demander de faire une proposition en vue de l’organisation d’un référendum populaire sur la réforme constitutionnelle. Selon les sources précitées, Moulaye Ould Mohamed Lagdaf, qui préside le comité de suivi de l’application des résultats du dernier dialogue politique, aurait demandé à la CENI de faire la proposition afin que le référendum puisse être organisé juste après la fin du mois du Ramadan, c’est-à-dire d’ici trois mois. Ould Mohamed Lagdaf a présidé mardi une réunion de ce comité de suivi à laquelle ont assisté de hauts fonctionnaires de la présidence à côté de quelques présidents de partis politiques ‘’dialoguistes’’ notamment Naha Mint Mouknass, Boidiel Ould Houmoid et Messaoud Ould Boulkhair entre autres. Le comité est composé de membres appartenant à toutes les forces politiques ayant participé au dialogue et comptent mener une vaste campagne en faveur d’un vote populaire favorable aux amendements constitutionnels dans la perspective au recours à l’article 38 de la constitution qui donne le droit au président de pouvoir consulter le peuple par voie de référendum direct dans toute ‘’affaire d’importance nationale’’. Tout cela, malgré que tous les grands spécialistes du droit constitutionnel sont unanimes sur le fait des dispositions de l’article 99 de la Constitution qui oblige le passage par les deux chambres (Assemblée Nationale et Sénat) pour entreprendre n’importe quelle reforme constitutionnelle.
SAHARAMEDIAS
EDITORIAL DU CALAM : Tistet Aziz
 Ils l’ont fait. Les sénateurs ont dit non aux amendements constitutionnels proposés par le Président et pour lesquels il n’a ménagé aucun effort. Il aura tout fait pour les faire passer : distribuer gracieusement des terrains aux parlementaires, les recevoir, ensemble puis un à un, et tous, du moins ceux de sa majorité (pardon, minorité !) lui avaient juré, main sur le cœur, que les amendements passeraient comme lettre à la poste. Comme l’ont fait les députés qui n’avaient, eux, rien à perdre dans cette bataille : pas voués à dissolution ni gémonies, ni accusés de tous les maux, depuis le fracas d’Ould Abel Aziz, l’an dernier à Néma, beuglant que la Mauritanie pouvait bien se passer d’un sénat aussi coûteux qu’inutile. Ah, on s’en souviendra, de ce branlebas de combat ! Tous les ministres, députés, responsables de l’UPR au charbon, chacun de son couplet, à ne ménager les pauvres sénateurs interloqués, réduits à se demander à quelle sauce seraient-ils mangés. Mais, à quelques exceptions près, nos honorables ont gardé leur calme. Attendant le jour J pour ne pas rater, comme la mule du pape, l’occasion de se venger. Si bien que, depuis ce vote historique, la majorité – Président, parti et gouvernement en vrac – se trouve tête à cul dans le même sac, « out », comme disent les Anglo-saxons. Aucun des partis dits dialoguistes n’a, non plus, pipé mot. Personne n’a encore compris ce qui s’est passé, tous à guetter la réaction d’Ould Abdel Aziz. A part un député zélé qui a écumé les radios et les télés pour se contredire, les laudateurs font profil bas, en attendant de voir de quoi sera fait demain.
Ils l’ont fait. Les sénateurs ont dit non aux amendements constitutionnels proposés par le Président et pour lesquels il n’a ménagé aucun effort. Il aura tout fait pour les faire passer : distribuer gracieusement des terrains aux parlementaires, les recevoir, ensemble puis un à un, et tous, du moins ceux de sa majorité (pardon, minorité !) lui avaient juré, main sur le cœur, que les amendements passeraient comme lettre à la poste. Comme l’ont fait les députés qui n’avaient, eux, rien à perdre dans cette bataille : pas voués à dissolution ni gémonies, ni accusés de tous les maux, depuis le fracas d’Ould Abel Aziz, l’an dernier à Néma, beuglant que la Mauritanie pouvait bien se passer d’un sénat aussi coûteux qu’inutile. Ah, on s’en souviendra, de ce branlebas de combat ! Tous les ministres, députés, responsables de l’UPR au charbon, chacun de son couplet, à ne ménager les pauvres sénateurs interloqués, réduits à se demander à quelle sauce seraient-ils mangés. Mais, à quelques exceptions près, nos honorables ont gardé leur calme. Attendant le jour J pour ne pas rater, comme la mule du pape, l’occasion de se venger. Si bien que, depuis ce vote historique, la majorité – Président, parti et gouvernement en vrac – se trouve tête à cul dans le même sac, « out », comme disent les Anglo-saxons. Aucun des partis dits dialoguistes n’a, non plus, pipé mot. Personne n’a encore compris ce qui s’est passé, tous à guetter la réaction d’Ould Abdel Aziz. A part un député zélé qui a écumé les radios et les télés pour se contredire, les laudateurs font profil bas, en attendant de voir de quoi sera fait demain.
En tout état de cause et d’effet, c’est à une mini-révolution qu’on a assisté, vendredi dernier. Pour la première fois, Ould Abdel Aziz à qui tout souriait, depuis sa prise de pouvoir, se retrouve dans une situation pour le moins inconfortable. Désavoué par une partie de sa propre majorité, exactement comme en 2008, lorsqu’un bataillon de députés se rebella, sous son impulsion, contre le Président Sidioca. Qui a tué par l’épée… Persuadé que tout se passerait bien, voilà notre guide éclairé tombé des nues. Complètement groggy, il a commencé, deux jours après le coup de tonnerre, à recevoir du monde : Premier ministre, présidents de l’UPR, de la Coalition de la Majorité et des partis dialoguistes… Il ne veut pas, dit-on, prendre de décision dans la précipitation. Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura un avant et un après 17 Mars. La « rébellion » du Sénat sonne-t-elle le glas d’une majorité appelée, probablement, à nouvelles lézardes ? Les Mauritaniens ayant, tout comme la nature, horreur du vide, il y a fort à parier qu’avec le renoncement public d’Ould Abdel Aziz à se porter candidat en 2019, tout partira en vrille. Tout comme le départ de Maaouya, en 2005, fit voler sa majorité en mille morceaux, 2019 risque d’être un tournant. Et si le non du Sénat en était déjà l’amorce ? Le point de départ d’une refondation ? Il serait très optimiste d’aller aussi vite en besogne mais quelque chose est en train de changer dans ce pays. Les citoyens en auraient donc assez d’être traités en éternels moutons de Panurge ? Refuseraient-ils, enfin, de cautionner le pillage, à ciel ouvert, de leurs ressources ? Puisse le Sénat être le déclencheur d’une révolution contre un système qui nous a fait tant de mal ! Et qui s’apprêtait à commettre de nouveau l’irréparable, en 2019…
Le tourmenteur de la fameuse mule du pape s’appelait Tistet Védène, s’est souvenu la mémoire populaire provençale, immortalisée par Alphonse Daudet. La nôtre, mauritanienne, ne retiendra-t-elle au final, que le souvenir de Tistet Aziz pulvérisé, un fameux vendredi 17 Mars 2017, à Nouakchott, d’un coup de sabot sénatorial si terrible, si terrible, que du fond du Majabat al Koubra, on en vit la fumée ?
Ahmed Ould Cheikh
Les Sénateurs font l’Histoire !

Il faut toujours se méfier du pouvoir de nuisance des Sénateurs. On les croit faibles et soumis et voilà qu’un jour ils font l’Histoire.
Le 15 mars 44 avant Jésus Christ, les Sénateurs romains assassinèrent Jules César qu’ils venaient de nommer dictateur à vie. « Tu quoque, mi fili (Toi aussi mon fils)» fut sa célèbre réaction quand il découvrit celui-ci parmi les conspirateurs. Le 27 avril 1969, le général De Gaulle quitta le pouvoir après le résultat négatif du référendum qu’il organisa pour réformer, entre autres, le Sénat français. L’intérim du grand Charles sera assuré, ironie du sort, par le président du Sénat Alain Poher. Il y a quelques jours, les Lords britanniques, qui ne sont pourtant pas élus mais désignés, infligèrent un revers au gouvernement de sa Majesté en réclamant que le parlement puisse avoir le dernier mot sur le futur accord final avec l’UE dans ce qui est appelé communément le Brexit.
Dans notre pays, en 2007, l’Inspecteur Général de l’Etat Horma Ould Abdi failli être emporté par le courroux des Sénateurs et ne dût son salut qu’après avoir présenté des excuses officielles. La semaine passée, les Sénateurs ont aussi frappé en rejetant les amendements constitutionnels voulus par le gouvernement. Cette fois ils ont bien caché leur jeu en acceptant, à une exception près, tous les présents donnés par le pouvoir et en laissant ce dernier dans l’ignorance de leurs intentions.
Dans cette histoire de réforme de la Constitution, le pouvoir n’a perdu, certes, qu’une bataille. Mais une bataille qui laissera des traces sur la suite des plans envisagés pour la sortie en 2019. En voulant faire des économies, le gouvernement a choisit la mauvaise procédure de révision et s’est donc tiré par la suite une balle dans le pied. Ses stratèges auraient dû savoir qu’une institution qui concoure à l’édiction des lois d’un Etat, qui lui donne sa deuxième personnalité (article 40 sur l’intérim du Président) et dont les membres bénéficient d’avantages substantiels, ne se saborde pas du jour au lendemain.
Pourtant il aurait été plus simple de passer par le référendum directement. Il suffisait – et il suffit toujours ! – de lire la Constitution. L’article 2 stipule que « le peuple est la source de tout pouvoir ». L’alinéa 2 du même article donne au peuple le pouvoir d’exercer sa souveraineté nationale par voie de référendum (en plus de ses élus). L’article 38 donne au Président le pouvoir, « … sur toute question d’importance nationale» de « saisir le peuple par voie de référendum ». Et la boucle est boulée. Une révision de la Constitution n’est-elle pas « une question d’importance nationale » ? A mon avis, assurément ! C’est aussi l’avis du juriste Vadily Ould Raïss, exprimé avec compétence et rigueur sur Sahel TV. Que serait d’ailleurs cette « question d’importance nationale » si toutes les dispositions de notre Constitution en sont exclues ?
L’incompétence du gouvernement et de ses juristes est ici manifeste. Ils ont pourtant à leur disposition les éléments de plusieurs cas similaires dont celui que j’ai noté plus haut : la réforme du Sénat français. Le référendum prévu à l’article 11 de la Constitution française a été utilisé pour modifier celle-ci alors que d’autres disposions passant par le parlement existent. La situation actuelle est d’un ridicule ! Le Président de la République et l’Assemblée nationale élus tous les deux au suffrage universel, le Gouvernement, qui plus est soutenus par une flopée de partis politiques, sont bloqués dans leur initiative par une assemblée, le Sénat, « à laquelle la Constitution n’a pas voulu permettre qu’elle pût s’opposer à l’aboutissement d’une loi même ordinaire » (formule de George Pompidou, Extrait du débat de l’Assemblée Nationale du 4 octobre 1962). En effet, l’article 66 de notre Constitution, alinéa 4, donne pouvoir au Gouvernement, s’il n’y a pas eu de vote sur un texte identique, et après déclaration de l’urgence, de « demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement ». Cette humiliation restera au travers de la gorge du pouvoir actuelle pour toujours et quelque soit l’épilogue de la crise actuelle.
Que reste-il au Président pour contourner ce blocage ? Comme je l’ai mentionné plus haut, il peut toujours mettre en œuvre l’article 38. L’inconvénient à déclencher cette procédure après le vote négatif du Sénat est double : le oui n’est plus assuré de gagner et le scrutin apparaitra comme un bras de fer entre le pouvoir exécutif et un pouvoir législatif qui n’a fait qu’exercer ses prérogatives constitutionnelles. Le Président peut aussi dissoudre les mairies. Dans ce cas aussi de figure, il n’est pas certain d’obtenir une majorité aux élections sénatoriales qui suivront.
Alors que Faire ? La seule solution, celle qui fera entrer définitivement le Président Mohamed Ould Abdel Aziz dans l’Histoire du pays par la grande porte, est d’organiser un dialogue politique entre tous les partis reconnus (les partis non reconnus par le ministère de l’Intérieur sont, au regard de la loi, légaux puisque le régime auquel sont soumis les partis en Mauritanie est déclaratif).
Ce dialogue devra déboucher sur l’avènement d’une 3ème République dont la Constitution devra :
- mieux organiser les pouvoirs dans un sens plus juste et plus équilibré entre un parlement aujourd’hui atone et un Président OMNISCIENT;
- permettre l’alternance ;
- prévoir une décentralisation qui donnera aux collectivités plus d’autonomie et de moyens pour pouvoir prendre en charge leur développement ;
- inscrire notre identité plurielle dans le marbre de la Constitution en donnant plus de moyens aux structures chargées de mettre en valeur cette richesse et en rendre visible sa diversité ;
- Constitutionnaliser la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
- Retenir toutes les avancées obtenues au cours des différents dialogues précédents.
La présente liste n’est pas exhaustive et n’est là qu’à titre d’exemple de proposition. Je sais qu’il existe une appréhension et même une peur chez certains de voir le Président profiter de cette refonte des institutions pour vouloir se maintenir au pouvoir. Dans ce cas il faut modifier seulement mais en profondeur cette constitution de 1991 afin de répondre aux obligations démocratiques du pays. Nous avons là une occasion de faire avancer les choses dans l’intérêt de notre chère patrie. Alors il ne faut pas perdre cette occasion comme on a perdu celles de 2005, 2009, 2011 et 2016.
http://atlasinfo.info/fr/node/1125



