Monthly Archives: December 2015
Le franc Cfa : 70 ans, ça suffit ! Mokhtar Ould Daddah avait compris avant ses pairs de la zone franc
 «La France est le seul pays au monde à avoir réussi l’extraordinaire exploit de faire circuler sa monnaie-rien que sa monnaie-dans des pays politiquement libres»
«La France est le seul pays au monde à avoir réussi l’extraordinaire exploit de faire circuler sa monnaie-rien que sa monnaie-dans des pays politiquement libres»
JosephTchundjang Pouemi, auteur de Monnaie, servitude et liberté : la répression monétaire de l’Afrique
Introduction
Le 26 décembre 2015, le franc Cfa aura 70 ans ! D’aucuns pensaient qu’avec la fin de l’empire colonial français, à partir des années 1950, les principaux symboles de cet empire disparaîtraient avec lui. L’exemple du franc Cfa prouve le contraire.
Le franc Cfa : un des piliers de l’empire colonial français
L’histoire du franc Cfa est liée à celle de l’empire colonial français en Afrique. A la veille de la deuxième Guerre mondiale, la France avait décidé de renforcer son autorité sur les territoires qu’elle contrôlait outre-mer. C’est ainsi que les décrets du 28 août, et ceux du 1er et 9 septembre 1939 instituèrent un contrôle des changes entre la France et ses colonies d’une part, et entre elle et le reste du monde d’autre part. Ce fut la naissance de la Zone franc. En effet, l’inconvertibilité du franc métropolitain et la mise en place du contrôle des changes délimitèrent un espace géographique à l’intérieur duquel les monnaies demeuraient convertibles entre elles et jouissaient de règles de protection communes vis-à-vis de pays hors de la zone.
La réforme monétaire du 26 décembre 1945 vit la création des francs «des colonies françaises d’Afrique» (Cfa) et des francs des «colonies françaises du Pacifique» (Cfp). Après les «indépendances», le sigle Cfa deviendra «franc de la Communauté financière africaine» pour les pays membres de la Bceao, et «franc de la Coopération financière en Afrique centrale» pour les pays membres de la Beac. 70 ans après sa création, le franc Cfa apparaît comme le symbole d’une souveraineté confisquée et un obstacle majeur au développement des pays africains.
La négation de la souveraineté monétaire des pays africains
Statutairement, la Conférence des chefs d’Etat et le Conseil des ministres des pays africains ont des pouvoirs dans le fonctionnement de la zone Franc et la définition des politiques monétaires. Mais ces pouvoirs sont purement théoriques. En réalité, c’est la France qui décide, en dernière instance, et les pays africains se chargent de mettre en œuvre. Ce fut le cas lors de la dévaluation du franc Cfa en janvier 1994. Ce changement de parité, imposé par la France avec le soutien du Fmi, avait montré que le sort du franc Cfa se décidait ailleurs qu’au Sénégal et au Cameroun, sièges respectifs de la Bceao et de la Beac.
L’ancien Premier ministre français, M. Edouard Balladur, dont le gouvernement avait imposé la dévaluation, a dit à juste raison que «la monnaie n’est pas un problème technique mais politique, qui tient à la souveraineté et à l’indépendance d’un pays». L’épisode de janvier 1994 a montré que les pays africains n’exerçaient aucune souveraineté sur le franc Cfa, qui n’est pas leur monnaie, mais la monnaie de la France, mise en circulation dans ses anciennes colonies, comme le dit si bien Joseph Pouemi, cité plus haut.
Le franc Cfa est un obstacle au développement
Cette absence de souveraineté explique en partie pourquoi le franc Cfa est déconnecté des réalités économiques et sociales des pays africains. L’une des illustrations de cette déconnexion est la politique monétaire de la Bceao et de la Beac, alignée sur celle de la Banque centrale européenne (Bce), dont le credo monétariste donne la priorité à la lutte contre l’inflation.Selon l’Article 8 des Statuts de la Bceao : «L’objectif principal de la politique monétaire de la Banque centrale est d’assurer la stabilité des prix… Sans préjudice de cet objectif, la Banque centrale apporte son soutien aux politiques économiques de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), en vue d’une croissance saine et durable.»
Dans ce passage, on notera avec stupeur que des objectifs économiques et sociaux essentiels, comme la croissance et la création d’emploi, sont subordonnés à la «stabilité des prix», c’est à dire à la lutte contre l’inflation !
D’autre part, en contrepartie de la «garantie de convertibilité» du franc Cfa par la France, la Bceao et la Beac sont obligées de déposer la moitié de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Ce qui prive ainsi les pays membres d’importantes ressources financières pour investir dans leur développement. La perte de ressources est aggravée par la fuite des capitaux, rendue possible par la libre circulation des capitaux entre les pays africains et la France, une fuite jugée plus importante par rapport à plusieurs autres pays africains.1
Au vu de ce qui précède, il n’est dès lors pas étonnant que les pays qui utilisent le franc Cfa soient parmi les plus «pauvres» du monde, selon les classements internationaux.
L’émergence est-elle possible avec le franc Cfa ?
Selon les critères de développement définis par les Nations-Unies, 10 des 14 pays utilisant le franc Cfa se trouvent dans la catégorie des «pays les moins avancé» (Pma). Ceux-ci sont caractérisés par la vulnérabilité économique et de faibles indicateurs de développement humain. C’est pour cela que dans les rapports du Programme des Nations-Unies pour le développement (Pnud), les pays de l’Uemoa et de la Cemac sont au bas de l’Indice de développement humain (Idh).
Ces classements montrent que le franc Cfa n’a pas été un «atout», comme le prétendent de façon mensongère ses partisans. Les pays africains n’ont enregistré aucun des «avantages» qu’il était supposé leur apporter, comme la croissance, les flux de capitaux étrangers ou encore l’intégration sous-régionale. Au contraire, il constitue un des principaux obstacles à leur développement.2 C’est ce qu’avait compris le premier Président de la Mauritanie, Mokhtar Ould Daddah, dont le pays a quitté le système Cfa en 1972, en faveur d’une monnaie souveraine, l’ouguiya. Il justifiait ainsi sa décision : «Nous savons que nous ne pouvons pas être indépendants économiquement si nous ne battons pas notre propre monnaie, si nous n’avons pas la maîtrise totale de la politique de crédit.»
Une des ironies de notre temps est que la plupart des pays africains qui parlent «d’émergence» sont des membres de la Zone franc. Le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Sénégal et le Tchad, entre autres, ont leurs plans «d’émergence» ! En vérité, c’est une pure illusion de croire que ces pays peuvent se «développer» en continuant à dépendre d’une monnaie qui n’est pas la leur. L’expérience a montré que les pays qui ont «émergé» ou dits «émergents» ont la pleine souveraineté sur leur monnaie qu’ils peuvent utiliser comme un instrument-clé de politique économique. C’est le cas des «dragons» et «tigres» asiatiques, ou encore des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).
Perspectives
70 ans après sa création, le franc Cfa reste une des survivances les plus tenaces de la colonisation. Il est temps de le mettre au musée des antiquités et de s’engager dans une voie nouvelle. Certains Africains, qui n’arrivent pas à envisager un avenir en dehors de la France ou de l’Occident en général, continuent de penser qu’il faut encore «attendre», que nous ne «sommes pas encore prêts». La question qu’on pourra leur poser est alors la suivante : quand «serons-nous prêts» ? Si ce n’est pas maintenant, quand ? Dans 50 ans ? Dans 100 ans ?
En vérité, il est impératif de rompre d’avec ce système néocolonial et de recouvrer l’indispensable souveraineté monétaire sans laquelle il ne peut y avoir de développement. C’est pourquoi nous exhortons les pays membres de l’Uemoa à s’engager de manière résolue et irréversibles dans le processus devant aboutir à la création de la monnaie unique de la Cedeao en 2020. Cela marquerait une étape décisive vers le démantèlement de la Zone Franc et la disparition du Cfa.
Demba Moussa DEMBELE – Economiste/Chercheur Président de l’Arcade ( Dakar
1 Voir par exemple, Amet Saloum Ndiaye, «Une croissance forte et durable, est-elle possible dans le contexte d’une fuite massive des capitaux en zone franc ? Conférence économique africaine, Kigali, Rwanda, 2012
2Voir Demba Moussa Dembélé, Zone Franc et sous-développement en Afrique, publications d’Arcade, Dakar, 2015
lequotidien.sn
rapideinfo
Déchéance de nationalité : “C’est une proposition perverse qui divise les Français” –
 Le constitutionnaliste Dominique Rousseau rappelle que la loi permet déjà la déchéance à tout Français qui manque de loyalisme à l’égard de la France.
Le constitutionnaliste Dominique Rousseau rappelle que la loi permet déjà la déchéance à tout Français qui manque de loyalisme à l’égard de la France.
PAR, HUGO DOMENACH
Publié le 24/12/2015 à 12:33 | Le Point.fr
François Hollande l’avait annoncé devant le congrès réuni à Versailles, trois jours après les attentats de Paris du 13 novembre. Il a tenu parole. Le projet de réforme de la Constitution inclura l’extension de la déchéance de nationalité aux binationaux nés Français et reconnus coupables de faits de terrorisme. Professeur de droit constitutionnel à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, Dominique Rousseau explique pourquoi il est inutile, voire contre-productif, de constitutionnaliser la déchéance de nationalité.
Le Point.fr : Quel changement l ‘inscription de la déchéance de nationalitéentraînerait-elle dans la Constitution ?
Dominique Rousseau : Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement veut inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution. Il existe déjà l’article 23-7du Code civil qui permet d’enlever par décret la nationalité à tout Français qui aurait manqué de loyalisme à l’égard de la France. Cette possibilité a été instaurée en 1938 par un décret d’Édouard Daladier, qui était à l’époque Premier ministre et président du Conseil. Il suffit d’un décret pris après avis du Conseil d’État. La personne visée peut contester cette décision devant le Conseil d’État. Cet article a été appliqué à plusieurs reprises entre 1949 et 1970. Cette norme est conforme à la Constitution.
Pourtant, le Conseil d ‘État a remis un avis au gouvernement selon lequel la déchéance de nationalité, pour les binationaux nés en France et condamnés pour terrorisme, n ‘est probablement pas constitutionnelle …
C’est une invention du Conseil d’État pour faire plaisir au gouvernement. S’il y avait vraiment un principe fondamental reconnu par les lois de la République (à valeur constitutionnelle, NDLR) qui interdit de priver les Français de naissance de leur nationalité, le Conseil d’État aurait dû préciser quelle loi, quelle République et quel principe. Son silence sur ces trois questions est un aveu d’inexistence de ce principe.
Les motivations du gouvernement ne sont-elles donc pas juridiques ?
Il s’agit d’un débat politique et politicien. Il faudrait que la classe politique relise le droit avant de le malmener et de porter atteinte au “vivre-ensemble” qui est le but de la Constitution. C’est une proposition perverse qui divise les Français. Elle n’a pas été faite pour lutter contre le terrorisme mais pour recomposer le paysage politique.
Les binationaux qui sont les seuls visés par cette sanction sont-ils des citoyens de seconde zone ?
C’est vrai qu’il y a une différence objective de situation puisque seuls les binationaux sont visés par cette sanction. Le droit international que nous avons transposé, et notamment la Convention européenne des droits de l’homme, interdit à la France de rendre un individu apatride. Un Français qui n’a que la nationalité française ne peut donc pas la perdre. Mais les binationaux ont exactement les mêmes droits que les autres Français. Il ne faut pas confondre nationalité et citoyenneté. La distinction ne joue que sur la perte de nationalité.
Christiane Taubira a dénoncé un problème sur le principe du droit du sol. Qu‘en pensez-vous ?
Les hommes politiques feraient bien de relire le droit. Je le répète, l’article 23-7 du Code civil existe déjà. Et on ne peut déroger à l’acquisition de la nationalité française par le droit du sol si la personne n’a que la nationalité française. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 23 janvier 2015 selon laquelle les Français doivent être traités de la même manière, quel que soit le mode d’acquisition de la nationalité française, qu’on soit né français ou qu’on ait été naturalisé.
Le Président des FPC présente ses condoléances au président de la République
Nouakchott le 23 Décembre 2015
A Monsieur Mohamed ould Abdel Aziz
Président de la République
Monsieur le Président,
J’ai appris, non sans tristesse, le décès de votre fils survenu par un accident malheureux de circulation.
C’est une immense perte pour tout père de famille qui voit son adolescent partir pour toujours.
Je partage votre douleur et compatis profondément a la tristesse de la famille.
Que la terre lui soit légère et que Dieu l’accueille en son saint Paradis.
Paix à son âme.
Samba Thiam
President des FPC
L’Arabité en Mauritanie : Ce concept qui divise les Mauritaniens
 La Mauritanie a célébré jeudi 18 décembre 2015 la journée mondiale de la langue arabe. Contrairement aux années précédentes où les animateurs de la journée faisaient l’apologie de la langue arabe tout en vouant aux gémonies l’utilisation de la langue française en Mauritanie, cette année, la démarche a consisté à valoriser la langue Hassanya, considérée comme « fille fidèle de la langue arabe » comme l’a souligné le président et chantre de l’arabité, le Pr.Limam.
La Mauritanie a célébré jeudi 18 décembre 2015 la journée mondiale de la langue arabe. Contrairement aux années précédentes où les animateurs de la journée faisaient l’apologie de la langue arabe tout en vouant aux gémonies l’utilisation de la langue française en Mauritanie, cette année, la démarche a consisté à valoriser la langue Hassanya, considérée comme « fille fidèle de la langue arabe » comme l’a souligné le président et chantre de l’arabité, le Pr.Limam.
Un revirement qui rend encore la division autour de la langue en Mauritanie plus radicale, car si l’Arabe peut être considérée comme un patrimoine commun de l’Islam, notent certains observateurs, il n’en est pas de même pour le hassaniya qui n’est qu’une des quatre langues parlées dans le pays. « Prétendre lui donner une quelconque hégémonie sur les autres langues nationales pourraient entraîner davantage de crispation de la part des autres communautés du pays » fait-on remarquer.
La question identitaire en Mauritanie constitue l’un des points qui divisent les différentes sensibilités du pays, selon tous les observateurs. Le débat sur l’arabité, déclenché à l’occasion du 18 décembre 2015 consacrant la journée internationale de la langue arabe a suscité des réactions mitigées, souvent violentes sur les réseaux sociaux. Certains considèrent que « les chantres de l’arabité ont réussi la prouesse de faire détester l’arabe à une bonne partie de nos compatriotes ».
D’autres mettent en garde contre le danger qui consiste à faire l’amalgame entre arabité, Islam et ethnicisme, comme si tous les musulmans étaient arabes ou si comme la problématique de l’identité nationale pouvait avoir une priorité sur la citoyenneté et le vivre ensemble entre des communautés qui peuvent être complémentaires et non antagoniques.
Il y a même parmi les tenants de l’arabité, ceux qui vont jusqu’à évoquer le caractère sacré de la langue arabe, perçue non pas comme un simple outil de communication comme toutes les langues, mais comme unique liaison dans le rapport à Allah. Aussi, certains considèrent que la Mauritanité ne saurait s’identifier à une langue et qu’on peut être francophile ou anglophone et rester un bon Mauritanien.
La citoyenneté qui unit tous les ressortissants du pays, quelle que soit leur culture et leur sexe, semble être pour beaucoup, la seule solution pour sortir de cette pente suicidaire qu’est la recherche d’une suprématie d’une langue qui viserait à marcher sur les autres langues et sur les autres cultures pour les assagir puis les effacer.
Cette guerre autour de l’identité arabe serait, d’après quelques analystes, une bataille menée depuis des décennies par des nationalistes arabes qui seraient à l’origine des tristes pogroms de 1989-1991, au cours duquel des dizaines de milliers de négro-africains ont été déportés de la Vallée vers le Sénégal et plusieurs autres milliers massacrés au bord du fleuve ou dans des casernes militaires.
Au temps où Moulaye Ould Mohamed Laghdaf, pur produit de la langue française et Bruxellois jusqu’aux os, coiffait le gouvernement mauritanien, beaucoup avaient décelé une volonté forte de l’Etat mauritanien à évacuer le français des programmes de l’enseignement et de l’administration publique, au profit de l’arabe.
Cette attitude avait entraîné une crispation de la communauté négro-africaine qui voyait dans cette démarche une menace hégémonique réelle de la culture et de la langue Maure sur leurs référentiels identitaires. Cette tendance manifestement exprimée par le Premier ministre de l’époque, Moulaye Mohamed Laghdaf, avait entraîné des remous graves notamment au sein du monde estudiantin, divisé entre pro et anti-arabisation et qui avait failli déboucher sur des affrontements à caractère racial.
Aujourd’hui encore, la question de l’arabisation reste un sujet sensible dans un pays tampon entre le Maghreb et l’Afrique noire. Elle rappelle surtout l’usage qui en a été fait sous le règne de Ould Taya et les souffrances qui en avaient découlé en termes de déportation et d’exécutions extra-judiciaire. L’arabisation à outrance constitue en effet pour la communauté négro-africaine une source d’exclusion qui viserait à les maintenir hors des circuits de l’emploi dans des postes civils et militaires.
Elle est selon eux une forme de colonisation qui vise à les dépouiller de leur propre identité. Des penseurs nationaux ont proposé à la Mauritanie de s’inspirer des exemples algériens et marocains, car pour eux, le prix à payer pour l’arabité est fort. « L’arabité, dans le cas mauritanien particulièrement, est un concept dangereux à manipuler avec beaucoup de prudence et de doigté » fait remarquer Séni Dabo, un journaliste burkinabé du journal « Le Pays » dont la contribution a été reprise par le site de l’AVOMM en 2010.
En couverture, l’ouvrage de Pierre Robert Baduel « Mauritanie, entre arabité et africanité » publié en 1989 dans la Revue du monde musulman et de la Méditerranée.
JOB
L’ authentique
Mohamed Abdelaziz réélu à la tête du Front Polisario: retour sur le parcours d’un vrai combattant
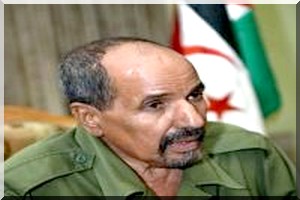 SPS – Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a été officiellement réélu mercredi à une écrasante majorité à la tête du Front Polisario à Dakhla (camps de réfugiés sahraouis), pour un nouveau mandat, une réélection, qui témoigne de la détermination du peuple sahraoui à poursuivre son combat pour la décolonisation du Sahara occidental et son droit à l’autodétermination une direction.
SPS – Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a été officiellement réélu mercredi à une écrasante majorité à la tête du Front Polisario à Dakhla (camps de réfugiés sahraouis), pour un nouveau mandat, une réélection, qui témoigne de la détermination du peuple sahraoui à poursuivre son combat pour la décolonisation du Sahara occidental et son droit à l’autodétermination une direction.
M. Abdelaziz, qui occupe depuis 1976 le poste de secrétaire général au sein du Front Polisario (Front populaire de libération de la Saquia El Hamra et Oued al-Dahab), a été réélu pour un 12ème mandat à l’écrasante majorité des voix exprimées lors de la 6ème journée du 14ème congrès du Front Polisario.
Mohamed Abdelaziz, assumera aussi la fonction de président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), conformément à la Constitution sahraouie en vigueur. Elu pour la première fois président de la RASD en octobre 1982, M. Mohamed Abdelaziz, a été reconduit dans ses fonctions en 1985, 1989, 1991, 1999, 2003, 2007 et 2011.
En 2002, a l’occasion de la proclamation de l’Union africaine (UA) qui succède à l’OUA (Organisation de l’unité africaine), la RASD a été nommée membre du bureau et devient l’un des cinq vice-présidents de l’UA, et le président Abdelaziz élu parmi les trois représentants nord-africains au sein du futur Conseil de paix et de sécurité de l’UA (15 délégués), après avoir occupé le poste de vice-président de l’OUA en 1985.
Âgé de 68 ans, Mohamed Abdelaziz est membre fondateur du Front Polisario depuis son congrès constitutif, tenu à Zouerate en Mauritanie le 10 mai 1973.
A la suite de la mort de El-Ouali Moustapha Sayed, (ancien dirigeant du Front Polisario), le président sahraoui a été élu secrétaire général du front Polisario et président du conseil de commandement de la révolution en août 1976.
Le renouvellement par les congressistes de leur confiance au président Mohamed Abdelaziz, témoigne de l’estime que lui porte le peuple sahraoui pour son combat et son militantisme pour la libération du Sahara occidental et le droit des Sahraouis à l’autodétermination.
cridem




