Monthly Archives: April 2015
Diplomatie mauritanienne : Entre nausées, retard des règles et seins tendus
 L’’application d’Alger du principe de réciprocité en expulsant un premier conseiller de l’Ambassade mauritanienne en Algérie, en riposte au renvoi de son collègue au sein de la chancellerie algérienne à Nouakchott, fait de nouveau souffler le chaud et le froid sur les relations diplomatiques entre les deux pays.
L’’application d’Alger du principe de réciprocité en expulsant un premier conseiller de l’Ambassade mauritanienne en Algérie, en riposte au renvoi de son collègue au sein de la chancellerie algérienne à Nouakchott, fait de nouveau souffler le chaud et le froid sur les relations diplomatiques entre les deux pays.
Des voix s’élèvent pour condamner la précipitation manifestée par la Mauritanie, qui aurait pu selon des observateurs, mieux gérer l’incident diplomatique en réduisant les éventuels dégâts et en évitant d’embraser des relations bilatérales demeurées relativement fortes , les rendant tributaires d’une humeur de nausées, de retard des règles, des seins tendus et d’anxiété.
Certes le mal a été déjà fait, mais il n’est pas possible de ramener la situation à des meilleurs sentiments diplomatiques si Nouakchott évite de mettre l’huile sur le feu, en versant dans l’escalade pour élargir sa colère à des niveaux plus élevés du froid entre Alger et Nouakchott.
Sur un autre plan, des analystes qui se sont prêtés au décryptage de l’incident diplomatique entre Alger et Nouakchott, estiment que la Mauritanie ne fait que payer sa pertinente politique de neutralité vis-à-vis de la question du Sahara Occidental qui préoccupe actuellement l’ONU.
Une impartialité qui fait régulièrement l’objet de secousses diplomatiques non avouées destinées sans succès à faire pencher la position mauritanienne au profit du Maroc ou d’Algérie, qui se livrent une guerre sans merci, par mains interposées, pour se créer un soutien diplomatique grandissant et décisif dans leur politique d’autonomie pour Rabat et d’indépendance du Sahara Occidental pour Alger.
Dans la foulée de cette position restée constamment égale à elle-même, la Mauritanie qui avait expulsé par le passé un diplomate marocain pour avoir tenté de brouiller les relations entre Nouakchott et Alger vient d’appliquer aujourd’hui la même mesure à l’égard d’un premier conseiller algérien indexé également d’avoir franchi cette ligne rouge.
Manifestation à Paris le samedi 25 avril 2015

Répondant à l’appel du collectif des organisions Mauritaniennes de France, les Mauritaniennes et mauritaniens se sont mobilisés le samedi 25 avril 2015 à Paris pour commémorer les déportations des milliers de noirs mauritaniens au Sénégal et au Mali dans les années 1989 à 1991 sous le régime raciste et dictatorial de Maouya Ould Sid’Ahmed Taaya.
Il faut rappeler que prés de 190 000 personnes ont été déportés au Sénégal et au Mali et plus de 860 civils enterrés dans les fosses communes à Wothie et à Sorimale, des femmes violées et éventrées et villages brûlés dans le sud de la de Mauritanie, plus de 750 militaires noirs exécutés extra judiciairement dans toutes les casernes militaires du pays et dont 28 soldats ont été pendus à Inal dans le nord du pays plus précisément dans la région de Dakhat de Nouadhibou, dans la nuit 27 novembre 1990 pour fêter l’anniversaire de la Mauritanie.
Les manifestants ont marché de place Trocadéro jusqu’à l’ambassade de la Mauritanie à Paris et exigent :
-Que le retour effectué soit officialisé par des actes et le rétablissement plein et entier, de tous ceux qui sont revenus, dans leur droit et une indemnisation de tous les préjudices subis.
– Demandent à la communauté internationale d’user de tous les moyens en sa possession pour amener la Mauritanie, dès lors qu’elle a reconnue sa pleine responsabilité dans les déportations d’avril 1989, à assumer concrètement les engagements pris devant les communautés nationales et internationales
– Appellent tous leurs compatriotes à un réel sursaut patriotique contre cette injustice qui n’a que trop duré.
Par la même occasion les manifestants dénoncent vivement l’enrôlement raciste et discriminatoire des mauritaniens de France comme en Mauritanie.
boolumbal
Les visites d’Aziz ou l’ombre de Taya
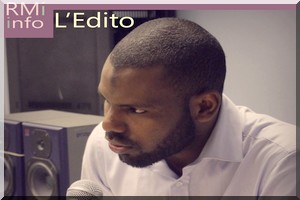 L’histoire est un éternel recommencement. Il est plus facile de l’écrire que de la marquer dignement et glorieusement. Tous les Mauritaniens se souviennent encore que les dernières années du règne de Maouiya Ould Sid’Ahmed Ould Taya étaient marquées par des visites tous azimuts. Trop pompeuses, pour une démocratie digne de ce nom. Et surtout, extrêmement coûteuses pour le pays. Mais sous Taya, les caisses de l’Etat ne tarissaient jamais.
L’histoire est un éternel recommencement. Il est plus facile de l’écrire que de la marquer dignement et glorieusement. Tous les Mauritaniens se souviennent encore que les dernières années du règne de Maouiya Ould Sid’Ahmed Ould Taya étaient marquées par des visites tous azimuts. Trop pompeuses, pour une démocratie digne de ce nom. Et surtout, extrêmement coûteuses pour le pays. Mais sous Taya, les caisses de l’Etat ne tarissaient jamais.
Du Ministre au dernier cadre du parti d’Etat, chacun pouvait justifier une facture, sortie de nulle part, pour « brouter » de l’argent public. Sauf que ceux qui ont connu Taya sont unanimes pour dire qu’il avait considérablement changé au crépuscule de son règne.
Des salons aux couloirs de l’état major militaire, la légende populaire raconte que, avant de bercer dans le culte du tribalisme, l’homme était un solitaire. Isolé, têtu. Il n’était que peu familier de la culture maure et de ses rouages. Celle-là même qu’il découvrira lorsque les ténors de sa tribu l’inviteront sous la khaima, pour lui relater les gloires des Smassides.
Ils lui souffleront au creux de l’oreille qu’un marabout qui manie les armes ne peut être qu’un signe du ciel. Ainsi, il déduira des conciliabules qu’à la maitrise de l’art de la guerre, il faudra ajouter celle des calculs politiques.
Son premier acte fut un retour aux sources pour se réapproprier les codes culturels, rompre avec De Vigny, divorcer avec l’Esprit des lois de Montesquieu, et épouser « l’individualisme tribal » beidhane. Machiavélique, Taya savait bien que « l’influence d’un homme de pouvoir dépend de l’appui d’une clientèle ».
Il s’agissait d’apprendre à gouverner avec les guerriers en limitant le terrain, à convaincre sans avoir raison, à persuader que seule son opinion compte, à dissimuler les plus importantes rentes publiques au détriment de l’intérêt général, à décimer lorsque l’ennemi veut détruire son système. Tout cela, Taya l’a fait afin de conserver le plus longtemps possible son pouvoir.
Pendant vingt ans, il mena la danse. Les officiers de l’armée et la classe politique l’ont suivi en maintenant la même cadence. Ainsi naquirent nos malheurs : le tribalisme, le régionalisme, l’opportunisme et le clientélisme. Tout le monde était le fils de quelqu’un.
L’être ne suffisait point, il fallait le justifier. Maure, Peul, Wolof, Hartani ou Soninké, chacun avait sa tribu. Maouiya nommait ses ministres selon les humeurs des maitres tapis dans l’ombre d’une khaima ou d’un hangar. Et il les démettait lorsqu’un notable tribal ne faisait pas bonne moisson.
Voilà qu’aujourd’hui Mohamed Ould Abdel Aziz emprunte les mêmes sillages. Bien sûr, l’homme ne pouvait que suivre le chemin frayé par son mentor. Depuis deux ans, il arpente le pays accompagné de ses acolytes composés – comme à l’époque de Taya – de ses ministres, des officiers, des « gens du parti UPRDS », quelquefois des élus de l’opposition, ignorés et infantilisés ça et là par les responsables du protocole présidentiel.
Quand une région est désignée par le Rais, tout le monde doit acter sa présence. Et chacun se manifeste, qui par une banderole sur laquelle est mentionnée la tribu, le village ou le regroupement qu’il représente, qui par une mise à disposition de moyens financiers et matériels.
Aziz et ses collaborateurs ne daignent même pas voir en face la pauvreté dans laquelle les citoyens croupissent. Après la claque des employés de la SNIM, à Zoueratt, il a été accueilli par des « Zéro Aziz », mais, il l’esquiva par son air hautain habituel. Dans les Hodhs, il a découvert des jerricanes vides, alignés en signe de protestation contre la soif qui décime des cheptels et met la vie des citoyens en danger.
Partout où il passait, les pauvres qu’il prétend défendre lui ont signifié que la famine risque de provoquer des ravages humains. Il a écouté des citoyens de la Mauritanie profonde confirmer que les boutiques « Emel » profitent à d’autres qu’à eux. Il a vu des écoles en état de décrépitude et des élèves assis par terre, alors que l’année 2015 a été décrétée année de l’enseignement.
La réalité n’a pas de bouche pour mentir comme un ministre. Sinon, que dire des centres hospitaliers qui ne peuvent même pas soigner des fractures de tibia ? Le cas du ministre et porte-parole du gouvernement Izidbih Ould Mohamed Mahmoud, évacué de Guerou après sa chute, suffit pour justifier l’état de déliquescence de nos hôpitaux et centres de santé régionaux.
En somme, les agissements et manières d’Aziz prouvent que l’ombre de Taya plane encore en Mauritanie. Taya n’est pas encore mort, mais son âme s’est réincarnée. Hier, Mohamed Ould Abdel Aziz était celui qui débarrassait les mains encombrantes accrochées à Taya. Aujourd’hui, il refuse de les serrer.
Jadis, Mohamed Ould Abdel Aziz avait le rôle d’aligner les rangs des pauvres citoyens, sujets des notables. Aujourd’hui, qu’il pleuve, qu’il vente, ou sous une chaleur de plomb, on s’aligne des heures durant pour lui. Il y a quelques années seulement, le colonel courrait derrière la voiture blindée du chef de l’Etat… Demain, à qui le tour?
Le premier est déjà tombé dans la plus grise des disgrâces : la déchéance et l’exil. Pour le second, il faut attendre la réalisation de l’invocation de l’opprimé. Allez savoir ce que Dieu confia un jour à son serviteur David.
Bâ Sileye
cridem
Nigeria : Boko Haram change de nom
 La secte islamiste Boko Haram a publié de nouvelles images dans lesquelles les membres appellent désormais leur organisation ‘’la Province ouest africaine de l’Organisation de l’Etat islamique’’.
La secte islamiste Boko Haram a publié de nouvelles images dans lesquelles les membres appellent désormais leur organisation ‘’la Province ouest africaine de l’Organisation de l’Etat islamique’’.
Sur les photos publiées sur leurs réseaux sociaux, les insurgés célèbrent, tels des martyrs, les combattants qui ont été tués.
En mars dernier, la secte islamiste a prêté allégeance à l’organisation de l’Etat Islamique.
Ce changement de dénomination intervient à un moment où l’armée nigériane poursuit ses opérations pour récupérer des villes sous le contrôle de Boko Haram.
Pour certains observateurs, c’est la preuve que cette organisation islamiste est en train de s’affaiblir.
Mais un soutien d’une organisation islamiste internationale, pourrait entrainer un changement dans leur tactique et une nouvelle façon d’opérer.
BBC Afrique
Source: BBC Afrique
Dr Fatoumata Nafo-Traoré : “Nous sommes à un tournant de la lutte contre le paludisme”
 Samedi a lieu la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. L’occasion pour le Dr Fatoumata Nafo-Traoré, directrice exécutive de l’organisme Roll Back Malaria, de faire le point sur la situation en Afrique.
Samedi a lieu la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. L’occasion pour le Dr Fatoumata Nafo-Traoré, directrice exécutive de l’organisme Roll Back Malaria, de faire le point sur la situation en Afrique.
Dans le monde, plus de trois milliards de personnes sont exposées au paludisme, une maladie souvent mortelle transmise par la simple piqûre d’un moustique. En 2013, l’Organisation mondiale de la santé a enregistré plus d’un demi-million de décès dans 97 pays. Mais c’est en Afrique où la maladie fait le plus de victimes : neuf cas mortels sur dix sont recensés sur le continent. Malgré des progrès, la lutte contre le paludisme demeure fragile en raison d’un manque de financement.
Jeune Afrique s’est entretenu avec le Dr Fatoumata Nafo-Traoré, directrice exécutive de Roll Back Malaria, une plate-forme de coordination internationale contre le paludisme. Pour elle, les progrès, réels, accomplis ces dernières années, sont menacés. Interview.
Le Dr Fatoumata Nafo-Traoré, directrice exécutive de Roll Back Malaria. © Roll Back Malaria
Jeune Afrique : Quels sont les progrès accomplis dans la lutte contre le paludisme au cours des dernières anneés ?
Dr Fatoumata Nafo-Traoré : Des progrès remarquables et substantiels ont été réalisés. Depuis le lancement des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), 4,3 millions de vies ont été sauvées en 15 ans mais la lutte n’est pas terminée. Le nombre de malades et de décès a été réduit de moitié. Cependant, ces gains sont aujourd’hui menacés si nous n’obtenons pas assez de financement dans les prochaines années. Il ne faut surtout pas lâcher la lutte contre le paludisme puisque nous sommes à un tournant.
Le financement n’est pas suffisant ?
Pas du tout. Nous aurions besoin de 5,1 milliards de dollars pour vaincre efficacement le paludisme dans une centaine de pays du monde. Actuellement, nous disposons de moins de la moitié de ce financement. Paradoxalement, il faut savoir que les pertes économiques liées au paludisme sont énormes. En moyenne, les pays africains perdent 1,3 % de leur produit national brut et au total, le continent perd 12 milliards de dollars par année.
L’Objectif du millénaire pour le développement 6C, qui prévoyait, d’ici à 2015, d’avoir enrayé la propagation du paludisme et commencé à inverser la tendance actuelle, ne sera pas atteint. Quel est l’état des lieux ?
C’est vrai, malheureusement. Toutefois, environ six pays sur dix sont en voie de l’atteindre. Ce n’est pas idéal mais au moins des progrès sont réalisés et nous donnent de l’espoir. Quand le paludisme recule, les taux de mortalité néonatale, infantile et maternelle ainsi que le taux d’absentéisme à l’école reculent aussi. De plus, une diminution des cas de paludisme permet aux communautés d’être plus productives donc plus fortes au plan économique.
Lire aussi : Un premier vaccin contre le paludisme en 2015 ?
Est-ce que vous sentez un désintérêt pour la lutte contre le paludisme?
Le paludisme est une maladie plusieurs fois millénaire. Il y a une lassitude qui s’est installée et une certaine passivité qui existe. La maladie peut être prévenue, traitée et guérie. Elle ne fait pas aussi peur que d’autres affections terribles. Le travail doit se poursuivre pour que les communautés puissent comprendre que le paludisme n’est pas un problème mineur. Le message doit passer du haut vers le bas, des décideurs politiques jusqu’aux enfants.
Qui sont les premières victimes du paludisme ?
Plus de 90 % des victimes en Afrique sont des enfants de moins de 5 ans. Des voix qui ne sont pas entendues… ils souffrent en silence ! De plus, le paludisme est intimement lié à la pauvreté. On peut parfaitement calquer la carte du paludisme à la carte de la pauvreté en Afrique pour évaluer l’incidence de la maladie. Les personnes les plus pauvres n’ont souvent pas accès à l’éducation. Elles ont ainsi de la difficulté à comprendre les différents messages et à frapper aux bonnes portes pour se faire soigner.
Samedi a lieu la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. L’occasion pour le Dr Fatoumata Nafo-Traoré, directrice exécutive de l’organisme Roll Back Malaria, de faire le point sur la situation en Afrique.
Dans le monde, plus de trois milliards de personnes sont exposées au paludisme, une maladie souvent mortelle transmise par la simple piqûre d’un moustique. En 2013, l’Organisation mondiale de la santé a enregistré plus d’un demi-million de décès dans 97 pays. Mais c’est en Afrique où la maladie fait le plus de victimes : neuf cas mortels sur dix sont recensés sur le continent. Malgré des progrès, la lutte contre le paludisme demeure fragile en raison d’un manque de financement.
Jeune Afrique s’est entretenu avec le Dr Fatoumata Nafo-Traoré, directrice exécutive de Roll Back Malaria, une plate-forme de coordination internationale contre le paludisme. Pour elle, les progrès, réels, accomplis ces dernières années, sont menacés. Interview.
Le Dr Fatoumata Nafo-Traoré, directrice exécutive de Roll Back Malaria. © Roll Back Malaria
Jeune Afrique : Quels sont les progrès accomplis dans la lutte contre le paludisme au cours des dernières anneés ?
Dr Fatoumata Nafo-Traoré : Des progrès remarquables et substantiels ont été réalisés. Depuis le lancement des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), 4,3 millions de vies ont été sauvées en 15 ans mais la lutte n’est pas terminée. Le nombre de malades et de décès a été réduit de moitié. Cependant, ces gains sont aujourd’hui menacés si nous n’obtenons pas assez de financement dans les prochaines années. Il ne faut surtout pas lâcher la lutte contre le paludisme puisque nous sommes à un tournant.
En moyenne, les pays africains perdent 1,3 % de leur produit national brut à cause du paludisme et au total, le continent perd 12 milliards de dollars par année.
Le financement n’est pas suffisant ?
Pas du tout. Nous aurions besoin de 5,1 milliards de dollars pour vaincre efficacement le paludisme dans une centaine de pays du monde. Actuellement, nous disposons de moins de la moitié de ce financement. Paradoxalement, il faut savoir que les pertes économiques liées au paludisme sont énormes. En moyenne, les pays africains perdent 1,3 % de leur produit national brut et au total, le continent perd 12 milliards de dollars par année.
L’Objectif du millénaire pour le développement 6C, qui prévoyait, d’ici à 2015, d’avoir enrayé la propagation du paludisme et commencé à inverser la tendance actuelle, ne sera pas atteint. Quel est l’état des lieux ?
C’est vrai, malheureusement. Toutefois, environ six pays sur dix sont en voie de l’atteindre. Ce n’est pas idéal mais au moins des progrès sont réalisés et nous donnent de l’espoir. Quand le paludisme recule, les taux de mortalité néonatale, infantile et maternelle ainsi que le taux d’absentéisme à l’école reculent aussi. De plus, une diminution des cas de paludisme permet aux communautés d’être plus productives donc plus fortes au plan économique.
Lire aussi : Un premier vaccin contre le paludisme en 2015 ?
Est-ce que vous sentez un désintérêt pour la lutte contre le paludisme?
Le paludisme est une maladie plusieurs fois millénaire. Il y a une lassitude qui s’est installée et une certaine passivité qui existe. La maladie peut être prévenue, traitée et guérie. Elle ne fait pas aussi peur que d’autres affections terribles. Le travail doit se poursuivre pour que les communautés puissent comprendre que le paludisme n’est pas un problème mineur. Le message doit passer du haut vers le bas, des décideurs politiques jusqu’aux enfants.
Qui sont les premières victimes du paludisme ?
Plus de 90 % des victimes en Afrique sont des enfants de moins de 5 ans.
Plus de 90 % des victimes en Afrique sont des enfants de moins de 5 ans. Des voix qui ne sont pas entendues… ils souffrent en silence ! De plus, le paludisme est intimement lié à la pauvreté. On peut parfaitement calquer la carte du paludisme à la carte de la pauvreté en Afrique pour évaluer l’incidence de la maladie. Les personnes les plus pauvres n’ont souvent pas accès à l’éducation. Elles ont ainsi de la difficulté à comprendre les différents messages et à frapper aux bonnes portes pour se faire soigner.
Comment le continent africain se positionne-t-il par rapport au reste du monde ?
C’est le continent le plus affecté par le paludisme : 80 % des cas d’infection sont concentrés en Afrique. En 2014, les gouvernements ont augmenté leur budget de lutte contre la malaria de 4 % mais cela reste insuffisant. C’est possible d’arriver à zéro décès et de sauver des vies humaines mais pour y arriver, cela nécessite l’attention des donateurs, des communautés et un plus grand intérêt du secteur privé qui doit s’impliquer en matière de financements. Plusieurs pays africains ont rendu le traitement du paludisme gratuit pour les femmes enceintes et les enfants, et je crois qu’il est important de reconnaître ces efforts.
Quelle est la prochaine étape dans la lutte contre le paludisme ?
En septembre prochain, les Nations Unies adopteront des Objectifs de développement soutenables pour faire suite aux Objectifs de développement du millénaire. Nous espérons réussir à maîtriser le paludisme en 2030.
Lire l’article sur Jeuneafrique.com : Paludisme | Dr Fatoumata Nafo-Traoré : “Nous sommes à un tournant de la lutte contre le paludisme” | Jeuneafrique.com – le premier site d’information et d’actualité sur l’Afrique
Follow us: @jeune_afrique on Twitter | jeuneafrique1 on Facebook




