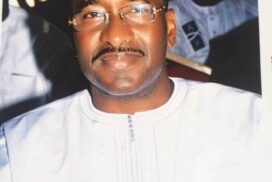Monthly Archives: January 2017
Le Premier ministre répond aux observations et interventions des députés à propos de l’action gouvernementale en 2016 et de ses perspectives
 L’Assemblée nationale a tenu, samedi, une séance plénière qui a été consacrée à la discussion de l’action gouvernementale pour l’année 2016 présentée mercredi dernier devant cette chambre par le Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine.
L’Assemblée nationale a tenu, samedi, une séance plénière qui a été consacrée à la discussion de l’action gouvernementale pour l’année 2016 présentée mercredi dernier devant cette chambre par le Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine.
La longue séance présidée par le président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ould Boïlil, s’est caractérisée par la présentation par les députés de leurs observation sur la déclaration de la politique générale du gouvernement et de leur lecture du bilan de l’action gouvernementale et de ses perspectives d’avenir.
Dans leur majorité, les interventions ont salué les réalisations sur les plans économique, politique et social durant les toutes dernières années et à leur tête les grands chantiers dans les différents domaines comme la santé, l’éducation et les ‘infrastructures de base, louant la grande amélioration qu’a connue la vie générale des populations.
Les députés ont également posé un ensemble de doléances dont principalement l’élargissement du champ des services offerts en matière de santé, d’éducation, d’habitat et des diverses autres prestations publiques en vue d’en faire bénéficier au maximum les populations où qu’elles se trouvent.
Les questions des députés se sont également axées dans leur ensemble autour de la baisse du prix des hydrocarbures, de la loi du genre, du dossier de la SONIMEX, des tribunaux de l’esclavage, de la formation des instituteurs et des professeurs, du déficit d’enseignants dans le secteur de l’enseignement privé, de la dette, de l’agriculture irriguée, des routes et du désenclavement, de l’organisation et du développement de la pêche et de l’industrie et l’importance de celle-ci dans le développement de l’économie nationale.
D’autres interventions ont critiqué le bilan de l’action gouvernementale dans ses aspects politiques, économiques et sociaux s’appesentant sur le projet de la loi du genre présenté actuellement devant le parlement au sujet de laquelle des députés invoquent des contradictions entre elle et la Charia islamique du fait que cette dernière est la première source de la loi, appelant à la préservation de l’identité islamique du pays.
L’enseignement a fait, lui aussi, l’objet des critiques d’une partie des députés tant en termes de qualité que des méthodologies suivies, rappelant dans ce sens que l’année 2015 n’a pas été celle de l’enseignement à la mesure du slogan clamé par le régime pour couvrir la gabegie que connait l’éducation.
Certains députés ont considéré que le bilan présenté cette année constitue une copie conforme de celui de l’année dernière, car les projets qui y sont présentés seraient les mêmes que les projets précédents, appelant dans ce cadre au respect des sentiments des députés et du peuple mauritanien.
Dans ses réponses à ses observations, le Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine, a souligné l’intérêt du gouvernement pour l’amélioration des conditions de vie des populations à travers les politiques que ce dernier met en oeuvre dans les différents domaines en exécution du programme du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.
Il a dit dans sa réponse à la question sur la baisse du prix des hydrocarbures que les prix de ces dernières ne devraient pas être vus de façon isolée, mais dans le cadre de l’ensemble électricité/gaz au moment où les études ont prouvé que la baisse des hydrocarbures est de l’ordre de 10%. Et qu’en conséquence, cette baisse ne profite pas aux classes fragiles, indiquant que l’Etat a adopté le choix de la protection de ces couches à travers le maintien des prix des hydrocarbures et la baisse du prix de l’électricité qui permet à ces couches fragiles d’en tirer partie de façon réelle.
Dans son exposé sur le réseau d’assainissement, le Premier ministre a rappelé que le système d’assainissement n’existait pas dans la capitale qui avait été construite sans tenir compte à l’origine de son existence, soulignant que c’est le gouvernement actuel qui a réfléchi à ce sujet et a oeuvré à la réalisation, dans une première phase, d’un système d’assainissement dans les moughataas basses de la capitale par rapport au niveau de la mer comme le Ksar, Sebkha et Tevragh Zeina. Le gouvernement a également pris des mesures pour l’évacuation des eaux de pluies des rues de la capitale, a-t-il ajouté, appelant dans sens à la maintenance du système d’assainissement et à son développement.
Dans sa réponse à ceux qui doutent que les routes bitumées sont passées de 3000 Km et 5000 km, le Premier ministre a énuméré les axes routiers qui ont été réalisés dont Barkéol-El Ghayra, Tinguent-Méderdra, Méderdra-Rkiz, Niabina-Mbaye, Néma-Bassiknou et Néma- Amourj et bien d’autres routes dont la longueur dépasse les 2200 Km, sans parler de celles qui sont en cours de réalisation comme Atar-Tidjikja.
A une question relative à la vente des écoles et le sort de leur produit de vente, le Premier ministre a précisé que l’Etat a procédé à la vente de quatre écoles, des blocs et à une partie de l’école de police à Nouakchott soit une superficie totale atteint 3.5 ha pour une somme de 10 milliards d’Ouguiyas au moment où 30.000 ha ont été attribués en 2009 sans qu’aucune ouguiya ne revient au budget de l’Etat.
Il a ajouté que 7,6 milliards ouguiyas du revenus de cette vente ont permis de construire 75 établissements scolaires à l’intérieur dont 45 écoles primaires, 9 lycées d’excellence, 2 lycées pilotes, 2 écoles pour les instituteurs en plus de la construction de 11 écoles, d’un lycée et d’un collège d’excellence à Nouakchott et une école à la cité plage dans la capitale, attirant l’attention que les motifs de la vente de ces écoles sont objectifs, car elles ne sont plus viables et dont les classes n’accueillent plus de 17 élèves qui suivent leurs études dans le brouhaha.
En ce qui concerne le programme Tadamoun et ce qui a été fait comme réalisations, le Premier ministre a souligné que le bilan de l’Agence Tadamoun pour l’année 2016 a dépassé celui de 2015 et que cette action va connaitre un accroissement en 2017, indiquant que dans ce sens elle a procédé à la construction de 34 écoles, 5 collèges, a finalisé l’édification de 14 écoles, a réalisé 43 dispensaires et 12 barrages dont les travaux de 7 d’entre eux sont achevés.
Dans sa réponse aux observations des députés à propos de l’agriculture, il a précisé que le gouvernement travaille suivant un plan d’action bien étudié basé sur la productivité, soulignant qu’au niveau de l’agriculture irrigué 45 ha ont été cultivés durant l’année qui vient de s’achever dont la productivité a atteint plus de 222 tonnes au moment où la culture sous pluie 2015-2016 a vu l’exploitation de 235 ha avec une production de 115 000 tonnes.
Il a ajouté que le gouvernement vise avec les réformes agricoles à venir en aide aux agriculteurs à travers les aménagements agricoles, la mise à disposition de l’eau, les engrais et semences, l’appui technique et la lutte contre les fléaux, rappelant que cela ne doit pas faire plaisir à ceux qui se sucrer sur le dos des agriculteurs.
Le Premier ministre a abordé les remarques suscitées autour de l’action gouvernementale dans le domaine de la santé, indiquant qu’un grand nombre d’hôpitaux ont été réalisés à l’heure actuelle et que d’autres sont en cours de réalisation dont la fin des travaux est prévue cette année.
Il a en outre ajouté que des résultats concrets ont été obtenus au niveau des infrastructures sanitaires faisant baisser progressivement le nombre des évacuations vers l’étranger des patients mauritaniens de 2013 à 2016 à concurrence de 52% comme il a été procédé au recrutement de plusieurs médecins et de divers staffs sanitaires.
En ce qui concerne le projet du Dhar et les délais de la fin de ses travaux, le Premier ministre a indiqué que ce projet est constitué de deux réseaux dont celui de l’Est qui doit s’achever en fin 2017, tandis qu’au niveau du second réseau, la fin des travaux est attendue en 2018, en plus de plus des 70 forages effectués entre 2014 et 2016 soit l’équivalent du total des forages réalisés depuis l’indépendance à aujourd’hui.
A la question relative à la compatibilité entre les lois nationales et les textes de la charia islamique, le Premier ministre a précisé que le gouvernement, sous la direction éclairée du Président de la République Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, est soucieuse de l’affirmation de l’identité islamique du pays dans la constitution, dans les lois et les pratiques, attirant l’attention que c’est devenu une habitude de taxer toutes les lois éditées par l’Etat de contraire à la Charia islamique et cela résulte du fait que les lois étaient éditées par l’Etat coloniale contrairement à la réalité aujourd’hui, appelant dans ce sens au changement de cette mentalité.
Il a souligné que les autorités nationales ont imprimé la charia dans leurs lois et ont rejeté tout ce qui la contredit comme elles ont toujours rejeté les questions liés à l’héritage, à l’homosexualité et à la peine de mort, en soutien aux constantes nationales sans en faire un fonds de commerce, exhortant à éviter l’usage de l’islam politique.
Dans sa réponse à la critique alléguant que le bilan de l’action gouvernementale présentée n’est qu’une copie de celle de l’année précédente, le Premier ministre a souligné que le plan d’action du gouvernement s’élabore sur la base du programme du Président de la République et de ses engagements et qu’il se fait sur trois axes qui sont la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance, la construction d’une économie compétitive et le développement des ressources humaines. Et c’est à partir de ces objectifs constants que l’action du gouvernement s’engage faisant du bilan de cette année une partie d’un tout jusqu’à l’achèvement du programme en entier en 2019.
Il a également dit que les doutes sur la sincérité de ce bilan doivent être étayés par des preuves à propos d’une réalisation déclarée effective et non exécutée ou par l’évaluation de la pertinence ou non des perspectives.
Le Premier ministre a conclu ses réponses en assurant tout le monde sur la situation du pays dont il a dit qu’elle est satisfaisante, que les relations avec les partenaires sont bonnes et que le programme de développement s’exécute avec des efforts sur des fonds propres à l’Etat et avec une bonne gouvernance.
AMI
L’éditorial de Benoit Ngom: Yaya Jammeh, pouvoir africain et communauté internationale
 Mugabe, Yaya Jammeh , Kabila et beaucoup d’autres dirigeants africains refusent d’accepter que la durée du Pouvoir qui leur a été délégué par le Peuple puisse être limitée dans le temps. Ce sont souvent des dirigeants qui pensent, à tort ou à raison, que le destin de la Nation doit être évalué à l’aune de leur longévité politique ou biologique. Cette conception du pouvoir, malgré les apparences, ne s’enracine ni dans les traditions culturelles africaines ni dans la pratique des démocraties modernes mais exprime la singularité des Systèmes politiques africains.
Mugabe, Yaya Jammeh , Kabila et beaucoup d’autres dirigeants africains refusent d’accepter que la durée du Pouvoir qui leur a été délégué par le Peuple puisse être limitée dans le temps. Ce sont souvent des dirigeants qui pensent, à tort ou à raison, que le destin de la Nation doit être évalué à l’aune de leur longévité politique ou biologique. Cette conception du pouvoir, malgré les apparences, ne s’enracine ni dans les traditions culturelles africaines ni dans la pratique des démocraties modernes mais exprime la singularité des Systèmes politiques africains.
D’une manière générale, les systèmes politiques en Afrique post-coloniale sont marqués par le syndrome de l’accoutumance au Pouvoir absolu exercé par le Chef de l’ Etat. Malgré les variantes selon les pays africains, cette donnée est une constante. En effet, même si certains pays sont plus respectueux des grands principes de la Démocratie que d’autres, la confusion des pouvoirs au profit de la Fonction exécutive est définitivement le modèle dominant depuis plus d’un demi siècle.
En vérité, les différents dirigeants africains sont guidés très rapidement dés leur accession à la tête de leurs Etats par une quête du Pouvoir absolu qui se matérialise par la gestion personnelle, patrimoniale au profit essentiellement des membres du Parti-Etat, du clan voire de l’Ethnie. Le Pouvoir absolu en Afrique ne s’embarrasse pas de vision, de projets ou de programmes d’intérêt général, mais il est souvent marqué par la cupidité et l’égoïsme de ceux qui l’exercent.
Singularité des Pouvoirs africains
La Singularité des Systèmes politiques fait qu’on ne peut les analyser sérieusement en essayant de s’inspirer de modèles extérieurs. Ces systèmes sont les fruits de l’imagination des africains dont les Dirigeants, d’une manière générale, accèdent au Pouvoir par la voie d’élections truquées ou de coups d’Etat.
En réalité, à de très rares exceptions, le seul régime politique qui a existé en Afrique depuis l’accession de nos pays à l’Indépendance , est celui du Parti Etat. Dans ce Régime, le Président de la République est issu du Parti dominant qui contrôle par les nominations et désignations la majorité des Individus qui animent les différents organes de l’Etat.
Dans ce système, les organes de l’Etat, en réalité, n’existent que pour remplir les fonctions formelles dans l’intérêt du Président de la République. Ainsi, certains Organes peuvent être dans la quasi léthargie parce que leur personnel n’est pas renouvelé ou parce que faute de moyens conséquents ils végètent. Dans l’histoire de l’Afrique, des exemples sont multiples qui montrent que certains Pouvoirs d’Etat ne s’exercent que quand celui qui détient le Pouvoir absolu a besoin de leur service.
Etat de non droit
Yaya Jammeh est une illustration caricaturale de ces Pouvoirs africains qui se sont érigés dans plusieurs pays du Continent et qui ont proliféré au gré des coups d’Etat réalisés souvent par de Jeunes officiers très peu expérimentés, parfois animés d’un esprit de justicier au départ et qui ont évolué en régimes dictatoriaux en s’appuyant sur des Intellectuels qui ont théorisé leurs pratiques pour leur conférer une dimension idéologique.
Ainsi Yaya Jammeh, après plusieurs années d’inertie de la présidence de Sir Dawda Jawara, avait effectivement réalisé des œuvres dans le domaine des infrastructures, saluées par ses compatriotes et à l’extérieur. Mais faute de boussole idéologique ou économique, le Président Jammeh a évolué au » petit bonheur la chance » en s’autoproclamant Professeur, Docteur et finalement guérisseur du SIDA. Ainsi, la Gambie après différentes péripéties a été proclamée récemment « République Islamique » par son Président..
Au lendemain de l’élection présidentielle de Novembre 2016, Yaya Jammeh a effectivement, d’une manière solennelle et publique, commencé par reconnaitre sa défaite et féliciter le Président élu dans un geste salué par la communauté internationale avant de se raviser quelques jours plus tard pour déclarer qu’il contestera les résultats devant la Cour Suprême dont il avait probablement oublié l’existence
Par ce geste, Jammeh se place en droite ligne de l’attitude de la majorité de ses pairs qui n’ont de cesse de modifier en cours de route les règles constitutionnelles pour rester au Pouvoir.
Exigence de la primauté du droit
Aujourd’hui , Yaya JAMMEH qui , naturellement, n’avait que du mépris pour sa Cour Suprême dont plusieurs anciens membres n’avaient jamais été remplacés, découvre que la seule voie pour contester légalement le résultat des élections passe par la saisine de cette Haute Juridiction.
Cependant, à cause de son mépris de la Loi et des formes constitutionnelles érigées en règle de Gouvernement, la Communauté internationale, la CEDEAO notamment, lui dénie le droit fondamental de pouvoir contester les résultats des élections auxquelles il a participé quand bien même il a pu déclarer qu’il saluait la victoire de son adversaire. En effet sa déclaration, il faut le souligner, n’a qu’une portée politique.
En effet, peut-on refuser valablement à Yaya Jammeh l’exercice d’un droit que lui garantit la Constitution de son pays au seul motif qu’il avait déclaré auparavent reconnaitre personnellement sa défaite ?
La position actuelle de la Communauté internationale , bien que politiquement justifiée et fondée, peut constituer un très grave précédent si les sanctions envisagées sont appliquées avant l’épuisement des voies de recours internes que lui offre le système électoral gambien.
Les Africains, et la Communauté internationale, doivent baser leurs jugements, leurs actions sur le seul socle qui puisse supporter durablement et d’une manière stable toute vie en société, c’est à dire le Droit. L’Afrique ne doit pas banaliser le Droit au profit de solutions bancales qui n’ont fait que semer la division et la haine dans plusieurs de nos pays. Nos Etats doivent éviter de poser des précédents qui peuvent se retourner demain contre eux.
Le droit est la seule garantie pour asseoir des relations équitables entre les forts et les faibles. Aujourd’hui, si nos Etats africains souvent débiles peuvent exciper de leur souveraineté, s’ils peuvent revendiquer la Réciprocité , c’est parce que le principe de l’Egalité souveraine des Etats est admis comme la règle absolue qui régit les relations entre les principaux acteurs des relations internationales que sont les Etats sans distinction de Continent.
Avenir des Dirigeants africains
Les Dirigeant africains, d’une manière générale, sont hantés par la peur lancinante de perdre le Pouvoir et le fait de ne pas savoir s’il y’a une vie après le « Pouvoir absolu ». En effet, comment peuvent-ils imaginer céder le Pouvoir à autrui, sans garantie et prendre le risque de s’installer eux-mêmes dans le purgatoire des très prévisibles poursuites judiciaires ?
L’Afrique doit réfléchir à la meilleure manière de rassurer ces Dirigeants qui ont du mal à imaginer ce que peut être la vie après le Pouvoir Absolu. A cet égard, l’initiative de Moh Ibrahim qui a créé un Prix pour récompenser des Chefs d’Etat qui auront d’une manière acceptable quitté le pouvoir en gérant au mieux leur nouvelle situation est une belle et noble initiative mais qui , sans aucun doute, ne cerne pas l’ensemble du problème. Les difficultés qui sont rencontrées chaque année pour trouver des personnes éligibles à ce Prix montrent les limites de la démarche qui mérite d’être complétée par d’autres initiatives.
En vérité , celui qui a goûté au Pouvoir absolu ne succombe pas aussi simplement aux promesses de récompense ou aux menaces de sanction.
Benoit NGOM est fondateur de l’Association des Juristes Africains et Président de l’Académie Diplomatique Africaine.
Source: http://www.financialafrik.com
Les Mauritaniens en Côte d’ivoire sont en sécurité (Diaspora)
 ALAKHBAR (Nouakchott) – Les Mauritaniens en Côte d’Ivoire sont en sécurité a rassuré Khaled Abass, le président de la communauté mauritanienne dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest.
ALAKHBAR (Nouakchott) – Les Mauritaniens en Côte d’Ivoire sont en sécurité a rassuré Khaled Abass, le président de la communauté mauritanienne dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest.
“La situation est généralement stable dans la plupart des villes du pays. Les gens vaquent à leurs occupations. Mais des Mauritaniens ont fermé leur commerce par mesure de prudence“, a indiqué Khaled Abass qui était interrogé par Alakhbar.
Ce dimanche, la situation semble être revenue à la normale en Côte d’Ivoire après l’annonce du président Alassane Ouattara d’un accord avec les mutins. Ces derniers réclament une amélioration de leurs conditions de travail.
La contestation des militaires qui avait débuté vendredi à Bouaké, la deuxième ville du pays, s’était étendue samedi à d’autres villes dont la capitale Abidjan.
alakhbar
MAURITANIE: DES SEMPITERNELS POURQUOI.
![Journée d'échanges des FPC à Massy: Les FPC et le dialogue national, quel bilan ? La communication de Kaaw Touré [PhotoReportage]](https://www.cridem.org/media/photos/photo/fpc_1302106521_n.jpg) Un certain nombre d’événements, plus ou moins récents, ont eu un tel retentissement dans notre pays, qu’ils laissent bien des Mauritaniens perplexes.
Un certain nombre d’événements, plus ou moins récents, ont eu un tel retentissement dans notre pays, qu’ils laissent bien des Mauritaniens perplexes.
Les réactions internes que ces événements ont entraîné et entraînent encore, la passion qu’ils déclenchent suscitent bien des questions, qu’on ne peut s’empêcher de poser. On ne peut également ne pas faire remarquer que s’il est légitime en effet de compatir aux souffrances du peuple syrien, palestinien car à notre sens, la compassion est normale vis-à-vis de tous ceux qui souffrent. On ne peut ne pas s’interroger sur le caractère discriminatoire et sélectif des actes posés.
– Pourquoi, en effet, la classe politique arabo-berbère dans sa majorité (pas toute bien sûr) exprime-t-elle, aussi visiblement, aussi passionnément sa solidarité avec le peuple syrien, palestinien, irakien depuis toujours, pour rester muette devant le martyr du peuple noir victime de l’apartheid et de l´esclavage en Mauritanie ?
– Pourquoi organise-t-on, ici et là, des quêtes en faveur des enfants Syriens, Palestiniens et reste-t-on indifférent devant le malheur des enfants des camps de déportés Noirs Mauritaniens au Sénégal et au Mali à quelques pas de la frontière ?
– Pourquoi jamais marche ni manifestation ne furent envisagées pour se démarquer (à défaut de les dénoncer) des actes génocidaires du régime raciste entre 1986 et 1990 ?
L’acte d’humanité ou les questions de principes peuvent-ils revêtir un caractère sélectif?
– Pourquoi enfin les événements extérieurs ont-ils plus de retentissements chez nous, que nos propres problèmes internes ?
– Pourquoi, surtout, la question de l’unité nationale-question centrale et grave- ne mobilise-t-elle pas autant d’énergie ?
Qu’est-ce qui nous importe au fait ?
C’est là autant de questions qui montrent que nos grilles de valeurs, notre sensibilité, notre philosophie même de la vie en dépit de toutes les dénégations sont différentes.
Il faut oser le reconnaître, oser l’accepter et le prendre en compte dans tout schéma de mise en place d’un cadre de coexistence.
La lutte continue!
KAAW TOURE
MAURITANIE : UN CADEAU DE MISE A MORT DU SENAT, LES ELUS OBTIENNENT DES TERRAINS.
 #Mauritanie : La mise à mort de la chambre du Sénat mauritanien est programmée par l’homme fort de la Mauritanie, Mohamed ould Abdel Aziz. Une décision qui n’enthousiaste pas les sages. Du coup, l’octroi de terrains de valeur donne un goût d’achat de conscience.
#Mauritanie : La mise à mort de la chambre du Sénat mauritanien est programmée par l’homme fort de la Mauritanie, Mohamed ould Abdel Aziz. Une décision qui n’enthousiaste pas les sages. Du coup, l’octroi de terrains de valeur donne un goût d’achat de conscience.
Dans le cadre de la réforme de la constitution mauritanienne, l’une des mesures phares a trait à la suppression du Sénat, la première chambre du parlement mauritanien. Une décision du président
Mohamed ould Abdel Aziz qui ne satisfait naturellement pas lesélus (indirectement) de cette institution. Ils ne souhaitent en effet pas perdre leurs avantages. En homme politique «avisé», le
président Mohamed Ould Abdel Aziz sait que la pilule sera très amère à avaler pour ces hommes qui l’ont toujours soutenu, notamment en se constituant en véritable «bataillon» d’élus frondeurs avant le
putsch «rectiþcatif» du 06 août 2008.
Face à cette situation et sachant que pour que cette réforme passe, il faut l’aval d’une majorité des 2/3 des élus du peuple (députés et sénateurs réunis). Devant aussi l’inefþcacité des pressions des
dirigeants sur les sénateurs, il fallait négocier avec les élus. Après plusieurs rencontres, ces sénateurs ont été longuement reçus en audience il y a quelques semaines par le président. Une rencontre riche en
témoignages de þdélité, à l’issue de laquelle les sénateurs se sont fermement engagés à voter en faveur des réformes constitutionnelles, sabordant ainsi leur institution, créée à l’aube du processus
démocratique en Mauritanie.
Depuis, la fronde semble avoir cédé du terrain à un accord entre le président et les élus de la chambre haute. Ainsi, les 56 sages sont appelés à voter sans broncher et sans état d’âme, la «mort» de leur
institution. Connaissant ces vieux, si attachés au côté matériel, il est certain que des garanties les ont été offertes par l’homme fort de la Mauritanie.
Lire la suite sur http://afrique.le360.ma/mauritanie/politique/2017/01/06/8752-mauritanie-…