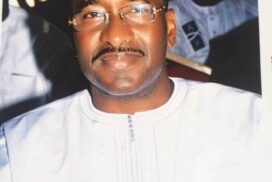Monthly Archives: May 2016
Jammeh : « Si vous déstabilisez ce pays, je vous enterre …»
 En tournée politique au centre de la Gambie, le président Yaya Jammeh a averti l’opposition de son pays. «J’avertis cette vermine appelée opposition : si vous voulez déstabiliser ce pays, je vais vous enterrer à neuf pieds de profondeur et aucun pays ne dira un seul mot», a déclaré Yaya Jammeh, hier. Des propos rapportés par «Enquête». Aux populations, il dira : «tout Gambien arrêté lors d’une manifestation de l’opposition ne verra plus jamais la lumière du jour». «Vous avez le droit d’adhérer à un parti politique.
En tournée politique au centre de la Gambie, le président Yaya Jammeh a averti l’opposition de son pays. «J’avertis cette vermine appelée opposition : si vous voulez déstabiliser ce pays, je vais vous enterrer à neuf pieds de profondeur et aucun pays ne dira un seul mot», a déclaré Yaya Jammeh, hier. Des propos rapportés par «Enquête». Aux populations, il dira : «tout Gambien arrêté lors d’une manifestation de l’opposition ne verra plus jamais la lumière du jour». «Vous avez le droit d’adhérer à un parti politique.
Vous pouvez voter pour qui vous voulez. Mais ceux qui veulent adhérer à un groupe de semeurs de haine pour les beaux yeux de l’Occident vont regretter pourquoi ils sont nés sur cette terre. Si vous ne me croyez pas, rejoignez-les et vous allez voir. Je mets en garde tous les Gambiens et je jure sur le Saint Coran, si vous avez un parent qui est enrôlé parmi les bénéficiaires de l’argent de l’Occident, ne pensez même pas à en profiter parce que vous irez également le rejoindre hors de ce pays.
Vous pouvez vous opposer par les urnes, mais si vous voulez vous opposer par la violence, je jure, Bilahi, Wallahi, Tallahi, personne ne vous verra pendant 7 millions d’années», promet-il. Yaya Jammeh pense que la population gambienne à un choix à faire lors de la présidentielle de décembre 2016 . Selon lui, ce sera l’occasion pour les gambiens de choisir entre le développement en votant pour lui ou celui de la régression représentée par l’opposition.
«J’ai tout fait pour vous et ceci depuis 21 ans et vous voulez que je batte campagne pour me comparer à une opposition qui ne peut même pas vous donner une miche de pain. A moins que vous soyez ingrats et stupides, je ne battrai pas campagne pour la présidentielle de décembre», annonce-t-il.
Auteur: SenewebNews – SenewebNews-RP
Suppression du Sénat : Plus du quart de la Constitution sera modifiée
 “La suppression du Sénat touchera 8 parmi les 12 chapitres de la Constitution et quelques 26 articles du texte fondamental, y compris les articles portant sur le nombre de mandats présidentiels”. Dixit le Pr. Mohamed Lemine Ould Dahi, expert constitutionnaliste.
“La suppression du Sénat touchera 8 parmi les 12 chapitres de la Constitution et quelques 26 articles du texte fondamental, y compris les articles portant sur le nombre de mandats présidentiels”. Dixit le Pr. Mohamed Lemine Ould Dahi, expert constitutionnaliste.
Lors de son discours le 3 mai 2016 à Néma, le président Mohamed Abdel Aziz avait déclaré son intention de supprimer le Sénat, accusé d’être une chambre inutile qui alourdit la machine législative et retarde l’adoption des lois, tout en coûtant cher aux contribuables. D’autres trouvent brusquement que cette chambre n’était qu’une planque pour notabilités.
Beaucoup considèrent cependant la démarche du président d’unilatéral et quelque que peu maladroite, car non seulement, aucune concertation n’a eu lieu autour de la question, y compris avec les organes concernés, le Parlement dans ses deux chambres, mais la décision pourrait être lourde de conséquence, car elle devrait bouleverser toute la structure de l’Etat, par le nombre élevé de textes de lois et d’institutions concernés de fait.
En effet, les constitutionnalistes soulignent que c’est le quart de la Constitution mauritanienne qui pourrait être défrichée, par la suppression du Sénat, 8 sur les 12 chapitres du texte fondamental et plus d’une vingtaine d’articles. Ils citent parmi eux, l’article 99 qui confirme le verrouillage des articles 26 et 28 relatifs au nombre de mandats présidentiels.
Ainsi, l’article 29 parle du serment prêté par le président de la République devant le Conseil constitutionnel en présence du bureau de l’Assemblée nationale, celui du Sénat, du président de la Cour Suprême et du président du Haut conseil islamique.
Ainsi, le Sénat a été cité dans 21 articles de la Constitution et sa suppression entraînera obligatoirement la modification de tous ces articles. L’expression « les deux chambres le Sénat et l’Assemblée nationale » est citée 16 fois dans la Constitution, il faudrait changer également ces articles. Dans trois autres articles, le Sénat est tacitement évoqué.
Lors d’un débat télévisé sur « El Mouritaniya », l’expert constitutionnaliste et professeur à l’Université de Nouakchott Ould Dahi estime que le retour à une chambre unique, l’Assemblée nationale, est un recul dans les acquis démocratiques, soulignant l’importance du Sénat dans la crédibilité du travail législatif en ce que par la double lecture qu’il donne aux textes de loi, il leur confère une plus grande solidité.
Il se demande si en définitive, il vaut la peine de supprimer une chambre qui fait la fierté de la Mauritanie et qui en fait une référence dans la région avec le 1er sommet international organisé en 2001 à Nouakchott sur les premières assises des Sénats.
Ould Dahi trouve cependant que si la suppression du Sénat va entraîner une avalanche de modification dans le texte constitutionnel, en aucun cas, la nature relative à l’alternance pacifique au pouvoir ne peut plus être modifiée, car elle constitue l’un des cinq éléments intangibles que nul ne peut changer.
Ainsi, la limitation des mandats du président de la République ferait parti de ces éléments, ce qui lui confère la même sacralité que le cadre immuable de l’Etat mauritanien dans sa forme républicaine, démocratique et pluraliste, ou encore dans l’intangibilité de ses frontières.
JOB
l’ authentique
MAURITANIE : «grand rassemblement» des Sénégalais, ce dimanche
 Les Sénégalais vivant en Mauritanie ont appelé le président Macky Sall à les sortir des moments difficiles qu’ils vivent au pays de Abdoul Aziz.
Les Sénégalais vivant en Mauritanie ont appelé le président Macky Sall à les sortir des moments difficiles qu’ils vivent au pays de Abdoul Aziz.
En les autorités de Mauritanie ont instauré aux Sénégalais vivant dans leur pays, une quittance jugée «très salée» de 30000 Um (monnaie locale) (50000 Fcfa), renouvelable par an.
Selon Amadou, un résident de ce pays qui a contacté Xalima.com au téléphone, cette somme «trop élevée» a mis ces Sénégalais dans tous leurs états.
C’est dans ce cadre qu’ils demandent le soutien de leur président, Macky Sall, pour ressouder leur problème dans les plus brefs délais. Pour rien au monde, ces Sénégalais ne payeront cette quittance, ont-ils dit. Ils préfèrent quitter le payer plutôt que de payer. Par ailleurs, ils ont fustigé l’attitude de l’ambassadeur du Sénégal dans leur pays de résidence. Selon eux, ce dernier n’a de respect pour personne.
Ainsi, ils demandent à Macky Sall de remplacer cet ambassadeur et de le remplacer par un jeune qui fera le bien de citoyens sénégalais. Selon notre contact, Amadou, ils comptent organiser un «grand rassemblement» ce dimanche pour contester la décision d’Abdoul Aziz. Ces Sénégalais ont également fustigé l’attitude de la police, de la douane de la Mauritanie qui les «dépouillent» de tous leur argent.
xalimasn.com
Source : Ndarinfo
Déclaration de fin de mission sur la Mauritanie, par le professeur Philip Alston, Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits humains
 Mauritania OHCHR – 1. Introduction
Mauritania OHCHR – 1. Introduction
Cette déclaration marque la fin d’une visite de dix jours en Mauritanie, à l’invitation du gouvernement. Je suis très reconnaissant envers le gouvernement, en particulier le bureau du Commissaire aux Droits de l’Homme et à l’Action Humanitaire, pour sa forte coopération pour faciliter ma mission.
J’ai eu la chance de pouvoir rencontrer le Premier ministre ainsi que les ministres de l’Economie et des Finances; de l’Intérieur et de la Décentralisation; Habitat, Urbanisme et Développement Régional; et des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille.
J’ai également rencontré un certain nombre de directeurs généraux et chefs d’institutions nationales, des représentants locaux des ministères et des institutions nationales, des gouverneurs (Wali), des préfets (Hakim), des maires, les représentants des institutions internationales compétentes, les ambassadeurs des Etats représentés en Mauritanie et des représentants de la société civile.
J’ai aussi rencontré beaucoup de personnes vivant dans l’extrême pauvreté dans plusieurs localités aussi diverses que les wilayas du Gorgol, Brakna et Trarza.
2. Obligations en matière de droits de l’homme
La Mauritanie a ratifié tous les principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ceux-ci comprennent le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le but de ma visite était d’évaluer et de faire un rapport au Conseil des droits de l’homme sur la mesure dans laquelle les politiques et les programmes de la Mauritanie qui se rapportent à l’extrême pauvreté sont conformes à ses obligations en matière de droits de l’homme.
3. Vue d’ensemble
À bien des égards, la Mauritanie est un pays riche. Elle est riche en minéraux, poisson, bétail et bonnes terres agricoles dans la vallée du fleuve Sénégal. Elle est également un pays dont le système juridique n’accepte plus l’esclavage, a maintenu la stabilité, et a, comparativement, bénéficié d’un niveau élevé d’aide international pour le développement.
Bien qu’il y ait eu des réalisations importantes au cours des dernières années, en particulier en ce qui concerne les zones urbaines, la situation est très différente dans des régions comme le Gorgol, le Trarza et le Brakna, dans lesquelles un grand nombre de personnes continuent à vivre dans une pauvreté écrasante.
Pour beaucoup d’entre eux, le seul impact tangible des politiques de développement du gouvernement jusqu’à présent a été l’expropriation de leurs terres et leur attribution aux investisseurs à grande échelle et cela sans aucune compensation.
4. Questions principales
Le rapport final sur ma mission sera présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en Juin 2017. Il abordera un large éventail de questions qui ne peuvent pas être traité ici.
En particulier, une attention particulière sera accordée à la question complexe, mais très problématique, des titres fonciers et l’expropriation effective des terres détenues par les communautés traditionnelles sans compensation et avec des conséquences souvent dévastatrices. Mais pour les besoins de la présente déclaration, je voudrais souligner six points.
(A) Exclusion
Les Haratines et les Afro-Mauritaniens sont systématiquement absents de toutes les positions de pouvoir réel et sont continuellement exclus de nombreux aspects de la vie économique et sociale. Ces groupes représentent plus des deux tiers de la population, mais diverses politiques servent à rendre leurs besoins et leurs droits invisibles.
J’ai été constamment informé par les fonctionnaires qu’il n’y a pas de discrimination en Mauritanie, et certainement pas en raison de l’appartenance ethnique, de race ou de l’origine sociale.
La répétition d’une telle réclamation plausible pourrait raisonnablement être considérée comme une preuve du contraire. L’engagement du gouvernement à mettre fin aux «séquelles de l’esclavage» doit s’accroître pour aborder et viser directement la séquelle la plus durable et conséquente, qui est la déresponsabilisation profonde continue dans la grande majorité des anciens esclaves.
L’insistance inflexible du gouvernement qu’il ne peut pas tenir compte de l’ethnicité dans ses politiques sert à renforcer le statu quo. Un exemple flagrant de ceci est le fait que les individus des deux groupes exclus constituent l’écrasante majorité de ceux qui n’ont pas été capables d’obtenir une carte d’identité nationale, sans laquelle très peu peut être fait en Mauritanie.
Quand j’ai demandé une estimation du nombre d’adultes en Mauritanie qui ne disposent pas d’état civil sous la forme de carte d’identité nationale, je n’ai pas reçu de réponses convaincantes. Cela semble clair que le gouvernement ne sait pas combien de personnes ne disposent pas de cet statut.
Sur la base des informations détaillées qui m’ont été fournies, il est clair que le problème est très répandu. Ceux qui n’ont pas le document ne peuvent pas voter, ne peuvent pas aller à l’école au-delà du niveau primaire, ne peuvent pas se qualifier pour de nombreuses prestations gouvernementales, et ne peuvent généralement pas posséder des terres. La bureaucratie responsable de la délivrance des cartes est lourde et ses fonctionnaires ne sont pas facilement accessibles.
L’obtention du document est cher pour ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté, pour des procédures d’appel il faut aller devant les tribunaux, et une série de critères bureaucratiques ont été prévus par la loi et la pratique ayant pour effet de dissuader de nombreux candidats, dont la plupart se trouvent être noirs.
Bien que pas seulement limité à eux, cela est particulièrement problématique pour les Afro-Mauritaniens qui ont été expulsés à la fin des années 1980 et au début des années 1990 dans le contexte du passif humanitaire, dont leurs documents d’identité ont été pris ou perdu, et au retour ont eu de graves difficultés pour restaurer leurs documents d’identité et de jouir de leurs pleins droits de citoyenneté.
La politique linguistique est un autre endroit où la discrimination existe dans la pratique. Un État est pleinement habilité à désigner une seule langue officielle, comme la Mauritanie l’a fait avec l’arabe. Mais dans un état multilinguistique, dans lequel beaucoup de gens ne parlent pas la langue officielle, il incombe au gouvernement d’adopter une flexibilité raisonnable au lieu d’insister que les communications soient en arabe.
(B) La reconnaissance des droits économiques et sociaux
Dans les instances internationales, la Mauritanie a constamment réaffirmé ses obligations en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Les droits économiques et sociaux sont mentionnés dans le préambule de la Constitution, mais il n’y a pas de dispositions de fond traitant ceux-ci.
Ils ne sont non plus reconnus de façon significative comme étant des droits essentiels dans la loi. Une reconnaissance officielle que des biens et de services tels que l’eau, les soins de santé, l’éducation, et l’alimentation sont des droits de l’homme pourrait commencer à transformer la façon dont sont formulées et mise en oeuvre les politiques de développement.
Au lieu d’être fondée sur les droits, les politiques nationales de la Mauritanie semblent être conçues plus avec une approche de charité envers ses citoyens. Bien que l’obligation d’être charitable soit une partie importante et admirable de la doctrine islamique, ceci ne tient pas en compte la nature et la portée des obligations formelles envers ses habitants en vertu du droit international des droits de l’homme.
(C) La nécessité d’un effort plus concerté pour éliminer l’extrême pauvreté Le gouvernement souligne à juste titre des diminutions importantes des taux de pauvreté et d’importantes initiatives de développement urbain pour mettre en évidence ses réalisations dans ce domaine. Mais ces réalisations doivent être considérées également à la lumière des sombres réalités persistantes.
44% de la population rurale continue à vivre dans la pauvreté. Les ménages dont le chef du ménage travaille dans l’agriculture ou l’élevage ont respectivement un taux de pauvreté de 59,6% et 41,8%. Le nombre exact des inscriptions à l’école primaire dans les wilayas tel que le Gorgol sont en dessous de 65,3%, et seulement 10% des enfants dans certaines zones rurales vont à l’école secondaire.
Le visage humain de la pauvreté au-delà des statistiques peut être illustré par référence au droit à la santé. Au cours de mes visites sur le terrain, un meilleur accès aux services de santé a été mentionné à plusieurs reprises comme une préoccupation majeure. Je suis allé au village de Kouedi au Gorgol, dont 350 résidents doivent parcourir 7 kilomètres pour parvenir à la ville de M’bout pour les soins de santé.
Dans la commune de Bath Moyt, composé de douze villages, le seul dispensaire de la commune est composé d’un infirmier et d’une sage-femme. Les enfants sont souvent touchés par le paludisme et la diarrhée. En cas de complications, les villageois doivent louer un taxi pour parcourir plus de 20 kilomètres pour se rendre à Monguel, au coût de 8.000 Ouguiya.
Pour les questions plus complexes, les patients doivent se rendre à Kaédi, au coût de 22.000 Ouguiya. La seule ambulance disponible pour transporter les patients des différentes localités de la commune au dispensaire est une charrette tirée par un âne. Dans le village de Keur–Madike dans le Trarza, il y a un dispensaire de santé, mais l’infirmière a quitté il y a deux ans et elle n’a pas été remplacée par le gouvernement.
Le dispensaire est désert et verrouillé, mais l’équipement et des médicaments de santé coûteux sont restés abandonnés. Comme il n’y a pas de soins de santé fournis dans le village et la route de Rosso ne peut pas être atteinte pendant la saison des pluies, les villageois sont forcés de traverser le fleuve Sénégal pour se rendre au Sénégal pour les urgences ou en cas de complications d’accouchements.
Les femmes sont particulièrement touchées par l’absence quasi totale des soins prénatal et post-natal. Les résultats de ce manque d’installations sont durement reflétés dans les statistiques nationales. La Mauritanie a toujours l’un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde.
Le recensement de 2013 a révélé un taux de 582 décès pour 100.000 naissances vivantes. Mais les données de la Banque mondiale indiquent que le taux était aussi élevé que 655 en 2013 et 602 en 2015. Dans la même année, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans était de 84,7 pour 1000, ce qui est une statistique tragique qui résume combien il reste à faire
(D) Vision et réalité
Alors que le ministre de l’Economie et des Finances a présenté une vision impressionnante et humaine de la Mauritanie, il reste un écart énorme entre cette vision et les réalités sur le terrain. Au fil des ans, la Mauritanie n’a certainement pas manqué de grandes stratégies, et elle n’en manquera pas dans les années à venir.
Des stratégies telles que la Stratégie de Croissance accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP), qui est actuellement en cours de préparation, continuera de faire trop peu de différence jusqu’à ce que les droits sociaux soient reconnus comme des droits de l’homme et des efforts soient faits pour cibler non seulement les plus pauvres des extrêmement pauvres, mais aussi pour adopter des politiques ethniquement inclusives.
(E) des données précises et ventilées
La Mauritanie dispose d’un Office Nationale de la Statistique fort et professionnel, mais la façon dont de nombreuses statistiques sont collectées, analysées et présentées par le gouvernement porte la marque d’ingérence politique.
En conséquence à la fois de la manipulation des données et le refus de désagréger en termes d’ethnicité, de la langue et d’autres dimensions essentielles, il est extrêmement difficile d’obtenir une image précise et cohérente de la plupart des domaines de la vie sociale, ce qui rend la conception d’une politique efficace beaucoup plus difficile par la suite. De ce fait, ce qui est caché aujourd’hui, reviendra surement hanter dans l’avenir.
(F) Développement
Trop de programmes de développement social du gouvernement sont ad hoc et répondent davantage aux circonscriptions électorales puissantes qu’aux besoins réels. Les donateurs internationaux n’ont pas réussi à encourager le gouvernement à fonder son approche sur des principes, ni à être systématique dans son approche, et ont ainsi consacré beaucoup trop peu d’attention au type de coordination qui renforcerait considérablement leur impact combiné.
Il faudrait envisager la création d’un groupe des Amis de la Mauritanie, qui rassemblerait les principaux bailleurs de fonds, pour discuter des priorités en amont de leurs réunions régulières avec le gouvernement.
Dans la présente déclaration, je vais me concentrer longuement sur deux questions spécifiques importantes. L’une concerne le rôle de Tadamoun et l’autre le système de transfert d’argent qui est actuellement mis en place.
(I) Tadamoun
Tadamoun est le principal organisme du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté. Il a été établi en 2013 avec trois fonctions distinctes mais connexes: lutter contre la pauvreté, faire face aux conséquences de l’esclavage, et concevoir et mettre en oeuvre des programmes visant à promouvoir la réintégration des rapatriés mauritaniens qui ont fui pendant le « passif humanitaire ».
En général, l’agence a choisi de prendre un profil très bas par rapport à ces deux derniers rôles. Sa gestion soutient que les projets généraux pour le développement dans la lutte contre la pauvreté s’adresseront mieux aux trois volets de son mandat, soulignant ainsi la nécessité de concevoir des programmes ou des politiques spéciales pour se concentrer sur les besoins particuliers des deux groupes spécifiques pour lesquels il a été mis en place.
Cette politique est défendue sur la base qu’il est préférable de ne pas isoler des groupes particuliers pour leur fournir un traitement avantageux, et encore moins de reconnaître qu’il y a des racines profondes sous-jacentes liées à l’origine ethnique dans beaucoup de ces questions.
Interrogé sur la composition de l’agence, et si elle a cherché à obtenir toutes sortes d’équilibre entre les groupes ethniques parmi son personnel, le Directeur général a répondu catégoriquement qu’une telle approche était impensable. Considérer l’origine ethnique comme un critère n’était ni pertinent ni approprié.
Cela semble particulièrement difficile à défendre dans une société dans laquelle pratiquement toutes les personnes à l’extérieur du gouvernement auxquelles j’ai parlé ont suggéré que la plupart des choses dans la société mauritanienne, et surtout en politique, sont décidées sur la base de considérations ethniques.
En tout état de cause, l’option politique globale qui a été choisi par le gouvernement signifie que son organisme chef de file n’est pas en train d’aborder directement deux des problèmes sociaux les plus urgents du pays.
Alors que le rôle accordé à Tadamoun dans son statut et dans ses aspirations est celui d’une agence de développement, à l’exception de ses travaux sur le programme de transfert de fonds (décrit ci-dessous), elle semble, dans la pratique, agir plus comme un organisme de bienfaisance majeur cherchant à laisser sa marque grâce à des activités de construction.
En général, l’agence elle-même n’est donc ni responsable, ni engagé dans le processus d’opérationnalisation de ses bâtiments. Les écoles et les centres de santé sont tout simplement remis aux autorités compétentes avec l’espoir que ceux-ci trouveront les ressources humaines et les capacités administratives pour faire fonctionner et réparer les installations, généralement dans des situations où cela ne s’est pas avéré être le cas auparavant.
Bien que son rapport annuel pour 2015 aurait déjà dû être publié, il ne l’a pas été, et l’agence a été incapable de me fournir un compte détaillé de ses activités globales récentes. Son budget d’environ 20 millions de dollars est désespérément faible, compte tenu de l’ampleur des problèmes qu’il est censé résoudre.
Dans l’identification des préoccupations ou des domaines prioritaires, et encore moins dans le choix des projets particuliers pour financer, elle ne semble pas fonctionner sur la base de critères établis et transparents. Quelle que soit la réalité de ses méthodes de fonctionnement, une telle approche laisse l’agence ouverte à des allégations de favoritisme et des suggestions qui considèrent que les besoins des membres les plus vulnérables de la société ne sont pas son but principale.
Les fonctionnaires de Tadamoun m’ont encouragé à visiter un certain nombre de ses grands projets réalisés dans les régions que je visitais. Etant donné que l’agenda de ma visite et son programme avaient été fixés bien avant que cette demande ne soit formulée, je n’ai donc pas pu visiter que l’un de ses projets. Il s’agit d’une école qui a été construite en 2015 à Dar el Barka, mais qui n’a pas encore ouvert ses portes aux étudiants.
L’école est un bâtiment impressionnant, dominant comme un Taj Mahal jaune, au milieu d’un très pauvre village dans une zone désertique qui n’est pas particulièrement peuplée. Elle faisait clairement l’objet d’une grande fierté pour Tadamoun aussi bien que pour les autorités locales et était équipé de bureaux impressionnants pour les administrateurs et des salles de classe avec des nouvelles rangées de pupitres et de vastes tableaux.
Elle a été construite à un coût de 84 millions d’Ouguiyas. Le contraste avec d’autres écoles que j’ai visités qui étaient extrêmement surpeuplés, largement sous-effectif, dépourvu de tout approvisionnement en eau potable, et dans certains cas dépourvus des toilettes fonctionnelles, ne pouvait pas avoir été plus dramatique et notoire. Mes interlocuteurs mont assuré qu’elle était sur une échelle inconnue même à Nouakchott.
Mais il n’est pas du tout clair si une telle école grandiose est viable sur des points clés tels que la disponibilité des enseignants, l’argent nécessaire à l’entretien, et la possibilité d’assurer des fournitures et des toilettes d’eau adéquates.
Même si cette école se révèle être l’exception, et reste viable, la question qui se pose est si les ressources limitées disponibles pour Tadamoun sont mieux dépensés pour la construction de gestes symboliques de ce genre, ou devraient plutôt être consacrés aux besoins urgents non satisfaits des écoles existantes à travers le pays dont les bâtiments sont en train de tomber, dont les toilettes ne fonctionnent pas, et qui ne peuvent pas attirer et retenir les enseignants parce que les installations et les logements disponibles sont tellement pauvres.
(II) Le système de transfert de fonds et les boutiques Emel
Une partie importante des dépenses sociales du gouvernement de la Mauritanie (hors éducation et soins de santé) est liée au programme Emel (espoir en arabe), qui a commencé en 2011 en réponse à une grave sécheresse et l’insécurité alimentaire liée. La composante la plus importante du programme Emel est l’ensemble des magasins Emel (Boutiques Emel), un réseau de magasins alimentaires subventionnés à travers le pays.
Les dépenses publiques sur le programme Emel ont culminé à 32.72 milliards d’Ouguiyas en 2012. Elles ont baissé entre 12,9 et 14,4 milliards d’Ouguiyas en 2013, mais ont augmenté jusqu’à 21 milliards d’Ouguiyas en 2015 et devrait s’élever à 21,79 milliards d’Ouguiyas en 2016.
La Mauritanie s’est basée en grande partie sur les ressources nationales pour financer ce programme. Il est clair, cependant, que le ministère des Finances et de l’économie, ainsi que les institutions financières internationales, considèrent que le programme est trop coûteux et une façon très inefficace de cibler les pauvres extrêmes.
En avril 2015, le gouvernement et l’Association internationale de développement de la Banque mondiale ont convenu sur le projet d’introduire un programme de transfert de fonds, accompagné d’un «registre social» de tous les ménages pauvres.
Le financement de ce projet de 29 millions de dollars proviendra de la Banque mondiale (15 millions de dollars), du Fonds d’affectation spéciale multi-donateurs pour la protection sociale adaptative au Sahel (4 millions de dollars du Royaume-Uni) et du gouvernement mauritanien (10 millions de dollars) sur une période de 5 ans.
Dans les documents de projet, l’idée est soulevée que le système de transfert d’argent pourrait permettre d’éliminer en grande partie le programme Emel, à la fois pour réaliser des économies globales que pour disposer de ressources suffisantes pour le programme de transferts monétaires du «cash plus». Bien qu’aucune décision n’ait encore été prise à cet effet, il est clair que l’option reste encore sur la table, et n’est pas celle qui est publiquement discutée.
La première phase du projet est de mettre en place un registre social national de suivi des plus pauvres 150.000 ménages en Mauritanie. 100.000 d’entre eux pourront éventuellement recevoir des transferts en espèces et le Registre peut aussi être utilisé à d’autres fins.
La méthodologie pour atteindre ces ménages enregistrés est la suivante. Tout d’abord, les quotas par localité géographique (non administrative) sont fixés pour le nombre de ménages pauvres qui peuvent être inclus dans le registre social. Deuxièmement, les comités de ciblage sont formés par zone géographique pour identifier les ménages pauvres dans ce domaine conformément au quota.
Troisièmement, les ménages sélectionnés sont invités à remplir un questionnaire pour filtrer les ménages qui ne sont pas considérés comme pauvres (proxy-means test). Un mécanisme de plainte est prévu pour ceux qui croient qu’ils auraient dû être inclus dans le Registre. La deuxième phase du projet est la mise en place d’un programme de transfert d’argent à l’échelle nationale qui payera d’abord 15 000 Ouguiyas tous les 3 mois à un total de 100.000 ménages pauvres, ce qui reviendrait à 6 milliards d’Ouguiyas par an.
Ce programme sera administré par Tadamoun. À l’heure actuelle, on ne prévoit pas d’effectuer les transferts monétaires conditionnels à la réalisation de certaines exigences par les bénéficiaires, tels que l’inscription des enfants à l’école ou leur participation à des programmes de vaccination. La raison pour éviter de telles conditions est révélatrice. Il démontre que le manque d’accès aux services d’éducation et de soins de santé en Mauritanie rendrait ces conditions déraisonnables.
Pour mieux comprendre l’introduction du registre social et le programme de transfert d’argent, j’ai parlé à un éventail d’acteurs pertinents sur le projet, y compris le ministre de l’Economie et des Finances et des experts de la protection sociale dans ce ministère, le Directeur général de Tadamoun, ainsi comme à la Banque mondiale et UNICEF.
J’ai aussi visité le département (moughatta) de M’bout au Gorgol où la première phase du projet est actuellement mise en oeuvre et j’ai rencontré le Hakim, un représentant de Tadamoun, et les travailleurs sociaux impliqués dans la sélection des ménages pauvres pour le registre social.
J’ai aussi rencontré des personnes, dans la ville de M’bout et les villages de N’Dadj-Béni Choufra et Kouedi, qui ont été sélectionnées pour l’inscription dans le registre social. Sur la base de ces discussions, je voudrais proposer plusieurs observations.
Tout d’abord, la Mauritanie a adopté une stratégie nationale de protection sociale (SNPS) en 2013, qui contient un concept large et multidimensionnel de la protection sociale, et reconnaît explicitement que la protection sociale est un droit de l’homme et lie la protection sociale à la mise en oeuvre de l’Initiative socle de protection sociale.
Depuis l’époque de l’adoption de la SNACN, la plupart des efforts de protection sociale du Gouvernement mauritanien ont été concentrés étroitement sur l’aide alimentaire, qui est seulement l’un des cinq piliers de la SNACN.
Bien qu’un programme de transfert de fonds à l’échelle nationale puisse, en principe, être un élément important de la politique de protection sociale d’un gouvernement, des préoccupations existent quant au fait que le programme de transfert d’argent pourra effectivement évincer tous les autres programmes de protection sociale pertinents liés aux différents piliers de la SNACN.
Alors que la SNACN a été accompagnée par la mise en place d’un mécanisme institutionnel pour coordonner les mesures de protection sociale, ce mécanisme a été décrit comme dysfonctionnel et sans «propriétaire» clair entre les ministères de tutelle.
Deuxièmement, divers interlocuteurs avec lesquels je me suis entretenu ont critiqué les boutiques Emel pour avoir une préférence pour les zones urbaines; ne pas atteindre les très pauvres qui ne disposent pas d’assez d’argent même pour acheter de la nourriture dans les magasins subventionnés; étant inefficace en raison des coûts élevés liés à l’exploitation des magasins; et offrant des possibilités de corruption.
En dépit de ces lacunes évidentes dans un programme qui a été initialement mis en place seulement en tant que mesure d’urgence temporaire, le programme Emel est maintenant dans sa sixième année et un nombre important de Mauritaniens se sont appuyé sur ce réseau de plus de 1000 boutiques.
Dans un pays pauvre comme la Mauritanie, où environ 70% de la nourriture est importée, la fermeture d’un programme qui prend en charge une partie importante de la population dans leur accès à la nourriture doit être abordé avec précaution.
Il doit être pris en compte que plusieurs pays à travers le monde ont déjà connu des troubles sociaux avec l’abolition des subventions alimentaires dans un contexte de volatilité des prix alimentaires mondiaux. Alors que les dépenses courantes sur le programme Emel sont d’environ 22 milliards d’Ouguiyas pour 2016, les transferts en espèces actuellement envisagées coûteront 6 milliards d’Ouguiyas, sans compter les coûts administratifs.
Alors que le ministre de l’Economie et des Finances a suggéré que la marge dans le budget à la suite d’un retrait progressif d’ Emel serait repris par le programme de transfert de fonds ou d’autres mesures de protection sociale, cela ne semble pas du tout être l’attente de tous les autres acteurs.
Alors que la Banque mondiale est convaincue de la possibilité de précision de «ciblage» des Mauritaniens les plus pauvres ; dans la pratique, il semble y avoir un fort risque que le programme sera loin d’être scientifique. Il n’est pas simple de savoir qui sont les plus pauvres dans une communauté.
Cela dépend de la définition utilisée ainsi comme les aléas de la procédure utilisée pour identifier «les plus méritants». La méthode actuelle peut comporter des «erreurs d’inclusion», mais il y a des doutes si elle peut éviter des «erreurs d’exclusion».
Tout d’abord, le choix des ménages a lieu par «groupement» des villages, ce qui ouvre la possibilité de la discrimination et des conflits entre les villages et les villageois; quelque chose qui est d’autant plus problématique dans le contexte de la Mauritanie où les minorités ethniques vivent étroitement ensemble et parfois partagent une histoire commune troublée.
Deuxièmement, il n’est pas tout à fait clair, à ce stade, qui a le dernier mot sur le choix des ménages pauvres et dans quelle mesure ce processus implique la consultation et la participation réelle. Un mécanisme de plainte sous la forme d’une ligne téléphonique est prévu pour ceux qui croient qu’ils ont été exclus à tort, mais dans le contexte mauritanien, il est douteux qu’un tel mécanisme de plainte puisse être à la fois indépendant et efficace.
En termes de la conception du programme de transfert de fonds, plusieurs observations doivent être formulées. Tout d’abord, le montant de 5.000 ouguiyas par mois semble trop faible pour avoir l’impact souhaité sur la vie des ménages ciblés.
Le montant représente seulement environ un tiers de la ligne de pauvreté nationale de 169,445 ouguiyas par an. Il n’ y a aucune raison d’accepter, comme suggéré par certains fonctionnaires du gouvernement, que tout montant supérieur encouragerait l’indolence et la dépendance. Deuxièmement, il est certainement problématique que le montant ne soit pas réglé pour la taille du ménage.
Troisièmement, le programme de transfert de fonds (ainsi que le registre social) ne sont pas ancrés dans la loi, ce qui signifie que le transfert de fonds pourrait être éliminé à tout moment, que les exigences d’admissibilité ne sont pas précisées, et qu’il n’y a aucune exigence pour la mise en place d’un mécanisme de plaintes. Enfin, on ne sait pas d’ où proviendrait le financement du programme de transfert d’argent dans le futur, ce qui soulève des doutes quant à la viabilité du programme.
Rien de tout cela ne suggère que le programme de transfert de fonds est en soi problématique. Mais il y a de nombreux aspects qui doivent être résolus avant que l’on ne puisse conclure que le programme sera efficace, viable et équitable. Pour parvenir à un tel résultat, les étapes suivantes sont recommandées:
a) Le gouvernement devrait procéder à une évaluation des conséquences de l’élimination progressive des boutiques Emel, si une telle action est sérieusement prise en considération. L’évaluation doit également tenir compte de l’impact sur les droits des bénéficiaires et d’autres personnes concernées.
b) les économies budgétaires qui pourraient résulter de l’arrêt du programme Emel devraient être réaffectées à des dépenses de protection sociale.
c) Le processus de ciblage pour le registre social et le programme de transfert de fonds devrait être soumis à une évaluation après que le processus de ciblage de M’bout ait été achevé. Une attention particulière devrait être accordée à l’impact du processus de ciblage sur les relations entre les membres des différents groupes ethniques.
d) Une façon de réduire les risques d’erreurs d’exclusion serait de changer l’ordre du processus de ciblage en démarrant le processus de sélection locale avec un proxy ce qui signifie tester et valider le résultat par les communautés locales d’une manière qui assure la participation de toutes les personnes touchées.
L’existence d’un mécanisme de plaintes qui est vraiment indépendant du gouvernement, transparent et facilement accessible et qui a le pouvoir d’ajuster les résultats initiaux de ciblage est d’une grande importance.
e) Le montant du transfert en espèce doit être évalué en tenant compte de l’expérience et la preuve régionales et internationales en termes de montant qui serait nécessaire pour avoir un impact transformateur sur le développement humain. Les transferts en espèces devraient également être adaptés pour tenir compte de la taille du ménage et d’autres circonstances pertinentes, telles que le handicap, la maladie et le chômage.
f) Le registre social et le programme de transferts monétaires doivent être ancrés dans une nouvelle loi nationale, qui énonce l’éligibilité pour les transferts en espèces, reconnaît le transfert d’argent en tant que droit légal, établit les procédures de ciblage et de plainte, et précise le montant initial du transfert d’argent.
g) L’introduction subséquente de conditionnalités pour se qualifier pour le programme de transfert de fonds doit être accompagné d’un avis motivé par le Ministère de l’Economie et des Finances et / ou Tadamoun qui montre que les conditions proposées pourraient être remplies par tous les bénéficiaires potentiels à la lumière de l’éducation disponible, les soins de santé et autres services sociaux pertinents.
Annexe: Détails de la Mission
Le Rapporteur spécial a visité la Mauritanie du 2 au 11 mai 2016 à l’invitation du gouvernement. Lors de la visite, le Rapporteur spécial a rencontré: le Président, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le ministre de l’Education nationale, le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et du développement régional, le ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la famille, et le ministre de l’Economie et des Finances.
Il a également rencontré le directeur général de l’Agence nationale “Tadamoun”, le directeur de l’Office national de la statistique, le Directeur général de l’Agence nationale pour l’enregistrement de la population et les documents sécurisés, le commissaire pour la sécurité alimentaire, et le Président de la Commission nationale des droits de l’homme. Il a également rencontré des experts techniques de haut niveau au sein du Ministère de l’Economie et des Finances et l’Agence Tadamoun.
A Nouakchott, le Rapporteur spécial a également rencontré des représentants des partis d’opposition, des organisations internationales, la communauté diplomatique et de la société civile. Il a également visité des bidonvilles dans le district de El Mina et du quartier Dar El Beida.
Du 4 au 8 mai, le Rapporteur spécial a effectué des visites sur le terrain dans les wilayas du Gorgol, Brakna et Trarza. Le 5 mai, le Rapporteur spécial a visité la wilaya de Gorgol et a rencontré le Wali du Gorgol. Il a visité le moughatta de Mbout où il a rencontré le Hakim, les travailleurs sociaux du Ministère de l’Economie et des Finances, ainsi que des représentants de l’Agence Tadamoun.
Il a visité et a parlé à des personnes vivant dans un district urbain de Mbout et deux villages ruraux de Kouedi et N’dadj-Béni Chourfa. Le 6 mai, le Rapporteur spécial a rencontré des gens dans le village de Bath Moyt et visité leur école et dispensaire. Le même jour, le Rapporteur spécial a également visité et rencontré les familles vivant dans la pauvreté dans le village de Bir Oulad Yara dans la wilaya de Brakna.
Le 7 mai, le Rapporteur spécial a visité Boghé et a rencontré le Hakim de la moughatta de Boghé, le maire de Boghé, et des représentants de la Commission des titres fonciers et l’Agence nationale pour l’enregistrement de la population et les documents sécurisés. Au cours de sa visite dans la wilaya de Brakna, le Rapporteur spécial a visité Dar El Avia Ould Birom et Dar El Barka et engagé avec les gens dans ces communautés. A Dar El Barka, il a rencontré le Hakim et a visité une école construite par l’Agence Tadamoun.
Le 8 mai, le Rapporteur spécial a visité la wilaya du Trarza et a rencontré le Wali, les représentants régionaux des ministères de l’Agriculture, de l’hydrologie et de l’assainissement, et de l’éducation nationale, et l’Agence Tadamoun, et un représentant de la municipalité Rosso. Il a visité et rencontré la population des villages Tekane et Keur–Madike et a également visité une école à Keur–Madike.
Au cours de sa visite à Kaédi et Rosso, le Rapporteur spécial a également tenu des réunions avec des représentants de la société civile dans les wilayas du Gorgol et du Trarza respectivement.
Nouakchott, 11 mai 2016
cridem
Dr Mariella Villasante Cervello : l’extrême pauvreté et la discrimination en Mauritanie. Commentaires aux déclarations du rapporteur spécial des nations unies Philip Alston et aux réactions gouvernementales
 Monsieur Philip Alston, rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme a effectué une visite en Mauritanie entre le 2 et le 11 mai 2016.
Monsieur Philip Alston, rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme a effectué une visite en Mauritanie entre le 2 et le 11 mai 2016.
Avant de partir, il a rendu publiques les grandes lignes de son futur rapport en soulignant que « Le gouvernement doit fournir davantage d’efforts pour tenir sa promesse de lutter contre les séquelles de l’esclavage, et doit aller au-delà d’une approche de charité pour aller vers une approche qui reconnaît que chaque Mauritanien a un droit fondamental à l’eau, aux soins de santé, à l’éducation, et à l’alimentation. » [Voir http://cridem.org/C_Info.php?article=684205].
Tout en reconnaissant que des réalisations importantes ont été faites surtout dans les zones urbaines, il a précisé que 44% de la population rurale continuait à vivre dans une pauvreté écrasante dans des régions comme le Gorgol, le Brakna et le Trarza, où il s’est rendu.
D’après lui : « Pour beaucoup de personnes, le seul impact tangible des politiques de développement du gouvernement jusqu’à présent a été l’expropriation de leurs terres et leur attribution aux investisseurs à grande échelle et cela sans aucune compensation. »
Sur la discrimination, Monsieur Alstom a noté que « Les Haratines et les Négro-Mauritaniens sont systématiquement absents de toutes les positions de pouvoir réel et sont continuellement exclus de nombreux aspects de la vie économique et sociale. [Or] Ces groupes représentent plus des deux tiers de la population, mais diverses politiques servent à rendre leurs besoins et leurs droits invisibles. »
Ces propos traduisent de manière objective la grave situation qui traverse la Mauritanie et qui s’aggrave chaque jour, alors que les autorités gouvernementales continuer à refuser la réalité sociale et préfèrent continuer à vivre dans le déni complet face aux pénuries d’aliments, d’eau, de santé et des services étatiques de la grande majorité de la population mauritanienne.
En effet, les déclarations de Monsieur Alstom ont soulevé des critiques absurdes de la part du Commissariat aux droits de l’homme qui « désapprouve fermement le contenu du communiqué de presse rendu public le 11 mai ». Pire encore, les autorités accusent Monsieur Alstom de « partialité » et considèrent qu’il a « clairement épousé les thèses de certains milieux et ONG hostiles au pays.»
Remettons les choses au clair. Dans la Chronique politique de Mauritanie de 2015, j’écrivais :
« Les indicateurs économiques actuels de la Mauritanie sont accablants. Sur une population totale de 3,970 millions de personnes en 2014, la pauvreté concerne encore 42% de la population [elle touchait 51% de la population en 2000], l’espérance de vie à la naissance est de 63 ans, et la vie économique des derniers mois est marquée par l’effondrement du prix du minerai de fer. En effet, selon la Banque mondiale[1] :
« En 2015, la croissance annuelle de son produit intérieur brut (PIB) réel devrait se tasser à 3,2 % sous l’effet de l’effondrement des cours du minerai de fer au second semestre de 2014. En revanche, l’agriculture et la pêche devraient progresser au rythme de 4 %.
Le secteur de la pêche reste dynamique et bénéficie de la finalisation (en juillet 2015) d’un accord bilatéral qui a été longtemps négocié avec l’Union européenne. Le secteur des services est le plus important contributeur à la croissance du pays, avec le secteur primaire.
Du côté des dépenses, un net repli de l’investissement privé a largement comprimé (de quelque 24 %) la formation de capital fixe au cours de l’année écoulée.
La profonde dégradation des termes de l’échange (-23 % en 2014 et -11 % en 2015) a contraint les autorités mauritaniennes à dévaluer l’ouguiya : la monnaie nationale s’est dépréciée de 5 % par rapport à 2014, après s’être appréciée en valeur réelle du fait du différentiel d’inflation avec les principaux partenaires commerciaux du pays. Cependant, l’inflation reste contenue. À 4,5 %, elle ressort en légère hausse par rapport à 2014. »
Selon le même rapport, le pays utilise de manière inefficace ses ressources naturelles, l’économie manque de diversification, et les affaires publiques sont mal gérées. En effet :
« La Mauritanie souffre de nombreux problèmes de développement, notamment de l’utilisation inefficiente des recettes provenant de ses ressources naturelles, de son déficit de compétitivité, de son manque de diversification et d’une mauvaise gestion des affaires publiques.
Utilisation inefficiente des ressources
Les industries extractives, qui sont le moteur de la croissance du pays, créent très peu d’emplois. Il est donc impératif que l’État mauritanien adopte un régime fiscal approprié, qui lui permette à la fois de recouvrer une proportion équitable des bénéfices financiers liés aux ressources naturelles et de promouvoir des politiques bien structurées, axées sur le réinvestissement de ces bénéfices ainsi que sur l’investissement, de façon à générer des rendements pérennes et mieux répartis. Les secteurs de l’agriculture et de la pêche, qui emploient la majeure partie de la main-d’œuvre et qui offrent un potentiel significatif, sont encore peu productifs et restent vulnérables aux effets du changement climatique.
Manque de diversification et déficit de compétitivité
La compétitivité de la Mauritanie pâtit de la petite taille de l’économie formelle, du manque de diversification et de la fragilité du cadre juridique. Depuis les années 1990, les exportations du pays se limitent aux produits des activités minières et de la pêche, qui, en moyenne, ont représenté les quatre cinquièmes du total exporté de 1990 à 2000.
Ces dernières années, exception faite du pétrole brut, la Mauritanie n’a pas diversifié son économie. Au contraire, elle a encore plus concentré ses exportations entre 2012 et 2013 : sur cette période, le minerai de fer est entré pour plus de la moitié dans le total exporté.
Mauvaise gestion des affaires publiques
La lutte contre les inégalités et la redistribution de la richesse sont deux grands défis que la Mauritanie est à même de relever, à condition de poursuivre ses efforts en faveur d’une bonne gouvernance, en particulier dans le secteur minier et dans les entreprises d’État.
La bonne gouvernance joue également un rôle essentiel dans le renforcement de la résilience sociale qui facilitera l’amélioration des services de santé (santé maternelle et infantile et diminution de la mortalité des enfants, en particulier) et la lutte contre la faim. »
L’effondrement du prix du fer a approfondi une crise qui dure depuis plusieurs années et qui risque d’empirer car le minerai de fer est excédentaire sur le marché mondial. (…) De fait, la Mauritanie continue à proposer des plans d’extraction du minerai brut sans tenir compte du fait que le fer n’est plus utilisé à l’état brut dans le monde ; ainsi, comme le signale Mays Mouissi, il serait urgent de créer un programme nationale de transformation et de valorisation du minerai de fer.
D’autre part, la situation des droits humains reste bloquée par le déni de réalité du gouvernement :
« Les tensions sociales actuelles restent identiques à celles des années précédentes, elles concernent d’une part la question statutaire, c’est-à-dire la revendication des droits civiques égalitaires des groupes serviles de la société hassanophone du pays, et les revendications d’égalité sociale des Noirs mauritaniens. (…)
• Le 12 août 2015, le conseil des ministres a adopté une Loi abrogeant et remplaçant celle de 2007, déclarant l’esclavage « crime contre l’humanité ». (…) Les sanctions sont désormais très lourdes, allant de 10 à 20 ans de prison et à de fortes amendes (de 700€ à 14 000€) (article 7).
Les autorités qui ne donnent pas suite aux plaintes peuvent être punies de peines de prison (de 2 à 5 ans), et d’amendes (de 1400€ à 2800€) (article 18). Les associations de défense des droits humains peuvent se porter partie civile, mais seulement celles qui ont une personnalité juridique depuis au moins cinq ans au moment des faits (articles 22 et 23).
Cependant, la nouvelle loi ne tient pas compte de la situation dans laquelle se trouve la majorité des groupes serviles, formellement libre et autonome, mais qui reste discriminée socialement à cause du lien idéologique établi entre l’ascendance servile et l’impureté sociale. Sur cette question la loi reste silencieuse, alors qu’en dernière analyse, c’est là que se situe le nœud du problème social posé par les groupes serviles hassanophones et africains en Mauritanie. »
Précisons maintenant que l’utilisation de termes « esclavage » et « esclaves » reste très délicate dans la mesure où ils ne traduisent pas vraiment la situation de dépendance et d’extrême dépendance de personnes et de familles insérés dans ce que je préfère appeler « groupes serviles ».
La connotation de « propriété des êtres humains » des termes esclavage/esclaves ne correspond pas à la situation de l’immense majorité des personnes soumises aux relations de servilité et de dépendance en Mauritanie. N’en déplaise aux militants « anti-esclavagistes » qui emploient ces termes pour mieux attirer l’attention sur leurs revendications d’égalité sociale et citoyenne.
On peut considérer, suivant les témoignages personnels rendus publics, que des formes extrêmes de dépendance persistent dans certaines zones du pays, urbaines et rurales, et il est évident qu’elles doivent être portées devant la justice. Cependant, ces cas restent exceptionnels.
Dans ce cadre, l’utilisation banalisée du terme « hrâtîn » pour classer les « esclaves » ou les « descendants d’esclaves » est un euphémisme ambivalent qui englobe les diverses formes de dépendance servile dans la société hassanophone, alors qu’elles existent aussi dans les sociétés halpulaar’en et soninké.
Enfin, les questions de discrimination des groupes serviles et des communautés africaines de Mauritanie, les Halpular’en, les Soninke et les Wolof, sont largement connues sur la scène internationale, et par les autorités mauritaniennes elles mêmes ; ainsi, les réactions offusquées actuelles semblent complètement déplacées. Dans la Chronique politique de 2015, je notais :
« Rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel portant sur la Mauritanie, Conseil des droits humains de l’ONU, Genève, 2-13 novembre 2015
• Lors de la 10e séance, tenue le 6 novembre 2015, le groupe de travail a adopté le rapport concernant la Mauritanie. Il a été présenté à Nouakchott le 10 décembre, jour international des droits humains, et j’ai eu la chance d’y assister. (…) Je note ici les points les plus importants.
(1) La délégation de Mauritanie a souligné l’engagement du président en faveur des droits humains, confirmé par la révision de la Constitution en 2012 pour réaffirmer la diversité culturelle et linguistique du pays, l’assimilation de l’esclavage et de la torture à des crimes contre l’humanité et la création d’une Commission nationale des droits de l’homme.
(2) La lutte contre les séquelles de l’esclavage et la traite de personnes sont une priorité pour la Mauritanie, et une nouvelle loi criminalisant ces délits a été adoptée en août 2015.
(3) Il en va de même des droits de la femme, de la protection des enfants, de l’éducation, de la lutte contre la corruption et de la lutte contre la pauvreté.
(4) Cependant, la délégation a reconnu que le pays manque de ressources pour assurer aux citoyens la pleine jouissance de leurs droits économiques et sociaux.
« En dehors des félicitations, les commentaires des délégations internationales portaient sur les problèmes de discrimination raciale (Sierra Léone), discrimination de l’ethnie (sic) des Haratines (Costa Rica), la persistance de l’esclavage (Suisse, États-Unis, Chili, Chypre), le manque de protection étatique des organisations anti-esclavagistes (États-Unis).
Or, la délégation a déclaré « qu’il n’existait pas de discrimination à l’égard de la communauté Haratin, et que toutes les communautés vivaient en harmonie depuis de siècles et concouraient au développement du pays » [point 103]. De toute évidence, cette perspective est loin de la réalité, et elle réitère le déni de réalité et le négationnisme adopté comme mode ordinaire d’interprétation des faits sociaux dans le pays.
En ce qui concerne la question du retour des 24 000 à 26 000 refugiés au Sénégal, la délégation a affirmé qu’elle « était définitivement réglée » [point 98] ; une autre contrevérité flagrante lorsqu’on sait que les exclusions et les discriminations des refugiés continuent jusqu’à présent.
Les conclusions et les recommandations sont divisées en trois sections, celles qui bénéficient du soutien de la Mauritanie [dont la protection des enfants et des femmes contre la violence domestique et les mutilations féminines], celles qui sont déjà mises en œuvre [dont le mandat donné à l’agence Tadamoun d’identifier les actes d’esclavage et proposer des programmes anti-esclavagistes] et enfin celles qui sont rejetées. Il faut souligner que sur un total de 63 points, la majorité (points 24 à 51, 61 et 62) a concerné la question de l’esclavage et la situation d’exclusion des hrâtin.
La délégation mauritanienne a rejetée 58 recommandations de la communauté internationale, en particulier les points suivants [liste non exhaustive] :
— La ratification du Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à l’abolition de la peine de mort (Belgique, Monténégro, Uruguay, Norvège, Slovaquie, Portugal, Australie). Transformer les peines de mort en peines d’emprisonnement, et/ou établir un moratoire de jure en vue d’abolir la peine de mort (Belgique, Suède, Togo, Mexique, Panama, Suisse, Namibie, France, Espagne, Italie, Chili) [18 pays].
— Accepter la compétence du Comité contre la torture de mener des enquêtes officielles [Espagne]. Les allégations de torture doivent être examinées de manière indépendante
[*Voir le Rapport préliminaire sur la torture de Monsieur Juan Mendez, janvier 2016[2]]
— Adhérer au Statut de Rome sur la création de la Cour pénale internationale [7 pays].
— Retirer le crime d’apostasie de la législation [Pologne, Belgique, Canada].
— Inviter le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires [Uruguay].
— Coopérer avec le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme en Mauritanie et avec la société civile afin de mener une étude sur la nature, la fréquence et les conséquences de l’esclavage, et assurer une collecte systématique de données ventilées pour mesurer les progrès réalisés dans l’application des lois et des politiques visant à l’éradication des pratiques esclavagiste et discriminatoires (Canada). Identifier et libérer les personnes réduites en esclavage, mettre fin à la discrimination fondée sur la caste ou l’ethnie, et recueillir des données détaillées pour faciliter l’éradication de l’esclavage (Royaume-Uni).
— Abolir le système des castes qui continue de promouvoir l’esclavage de facto par la servitude domestique ou le travail forcé (Ouganda).
— Libérer de prison les défenseurs des droits de l’homme (Allemagne, Irlande).
— Protéger la liberté d’expression de la société civile, dont les journalistes et les défenseurs des droits humains (Belgique).
— Poursuivre des mesures pour rétablir les droits des anciens refugiés rapatriés du Sénégal et du Mali et permettre le retour de ceux qui restent dans ces pays (France). Rapatrier et fournir des documents de citoyenneté aux personnes expulsées entre 1989-1991 (Brésil).
On apprécie de manière très claire et cohérente les points sensibles, tous reliés aux droits des groupes serviles et aux droits civiques, qui restent bloqués par le gouvernement mauritanien. La réalisation d’une enquête approfondie sur la situation des groupes et des personnes soumises aux diverses formes de dépendance semble urgente, et on se demande comment un État peut adopter une loi très précise sur « l’esclavage » sans avoir la moindre information chiffrée, ni la moindre analyse fondée sur la récolte de données de base. »
Ce fait est repris Philip Alston dans son Rapport de fin de mission [en anglais[3]], note que la Mauritanie possède un excellent Office national de statistique, mais la manière dont les données sont organisées signale une interférence politique évidente. Étant donné que l’État refuse de présenter les données détaillées en termes d’ethnicité, de langues ou d’autres dimensions importantes, il est extrêmement difficile de connaître la réalité de la vie sociale de la population du pays.
Nous attendrons la publication du Rapport final sur l’extrême pauvreté et la discrimination en juin 2017 pour avoir des informations plus fines. En attendant, il semble urgent que l’on prenne conscience du fait que l’on ne peut pas continuer à nier les évidences, et qu’il faudrait plutôt commencer à organiser des réponses cohérentes aux grands besoins de la population mauritanienne qui se trouve en situation de détresse profonde.
Dr Mariella Villasante Cervello
*
[1] Voir le rapport : http://www.banquemondiale.org/fr/country/mauritania/overview
[2] Voir http://cridem.org/C_Info.php?article=680179 Juan Mendez signale qu’aucune juridiction mauritanienne ne traite de cas de torture et qu’il n’existe aucun registre de plaintes pour tortures dans le pays.
[3] Voir : http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19948&LangID=E
adrar-info