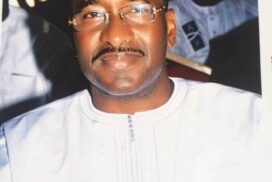Monthly Archives: May 2016
L’éditorial du calame: Basta de l’autocratie et du tieb-tieb !
 Le discours ‘’historique’’ de Néma n’arrête pas de susciter des vagues. Intervenant dans un contexte difficile, marqué, notamment, par la sortie, très médiatisée, du rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits humains, pour qui nous sommes assis sur une poudrière, et celle de l’institut américain Startfor (une CIA de l’ombre) qui n’exclut pas la possibilité d’un énième coup d’Etat dans le pays, cette sortie présidentielle était censée réconforter et apaiser. Elle s’est surtout appliquée à mettre de l’huile sur le feu. En flétrissant l’opposition, ramassis de « menteurs et de gabegistes » ; le Sénat, frein, inutile et coûteux, à la législation ; et en épinglant une certaine communauté qui « fait trop d’enfants », selon lui. Autisme politique, sécheresse des idées, bricolage… Et la campagne d’ « explications », menée, tambour battant, par l’UPR dont les responsables ont subitement découvert – autrement dit : beaucoup trop hâtivement – les vertus de la communication, n’aura, hélas, qu’un peu plus embrouillé les choses et amplifié la levée, sans précédent, de boucliers. L’opposition fustige une attitude haineuse. Biram, frais émoulu de prison, qui n’a rien perdu de sa verve, s’en prend au Président avec des propos peu amènes. Même les sénateurs, que les exégètes du discours présidentiel, n’ont pas ratés, s’offusquent, violemment, d’être ainsi vilipendés à moindre frais. Ils refusent de recevoir pas de moins de deux ministres et de répondre à une convocation de leur parti, l’UPR. Voués à disparaitre et n’ayant donc rien à perdre, les papys font de la résistance. L’un d’eux s’est même permis une sortie qui ne manque pas de courage. Pour lui, Ould Abdel Aziz doit être traduit devant la haute Cour de Justice, ni plus ni moins. Celle que préside toujours Sidi Mohamed ould Maham et qui allait juger l’ancien président Sidioca ? Utile rappel. « Qui creuse un puits pour son prochain », dit le dicton, « risque fort de s’y retrouver ». Version arabe de l’arroseur arrosé français. Que reproche notre vaillant sénateur à notre guide éclairé ? De s’être attaqué à une institution constitutionnelle et d’être intervenu dans le pouvoir législatif ? Comme si, dans notre démocratie militaire, la séparation des pouvoirs n’ait jamais été, un seul instant, réelle ou tant soit peu respecté, le texte fondamental de notre république. Que fit, de cette Constitution, en 2008, celui-là même qui s’attaque présentement au Sénat ? Ne la foula-t-il pas, tout simplement, du pied, en renversant un président élu ? Serait-il plus grave de médire le Sénat que de fomenter un coup d’Etat ? Bref, tout le monde s’affole. Alors que les limites de l’à-peu-près et de l’opportunisme, tant dans la conduite de l’Etat qu’en celle des affaires privées, craquent de partout, c’est pourtant de sang-froid et de compétences, réelles, cette fois, que la Mauritanie a plus que jamais, besoin. Et non pas d’un seul homme mais bel et bien d’équipes cohérentes, appliquées à des buts clairs et accessibles. Méthodiquement. Notre société et ses conditions de vie sont devenues complexes. Le deviendront encore plus. Cela implique des choix politiques. A l’opposé de l’autocratie et du tieb-tieb.
Le discours ‘’historique’’ de Néma n’arrête pas de susciter des vagues. Intervenant dans un contexte difficile, marqué, notamment, par la sortie, très médiatisée, du rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits humains, pour qui nous sommes assis sur une poudrière, et celle de l’institut américain Startfor (une CIA de l’ombre) qui n’exclut pas la possibilité d’un énième coup d’Etat dans le pays, cette sortie présidentielle était censée réconforter et apaiser. Elle s’est surtout appliquée à mettre de l’huile sur le feu. En flétrissant l’opposition, ramassis de « menteurs et de gabegistes » ; le Sénat, frein, inutile et coûteux, à la législation ; et en épinglant une certaine communauté qui « fait trop d’enfants », selon lui. Autisme politique, sécheresse des idées, bricolage… Et la campagne d’ « explications », menée, tambour battant, par l’UPR dont les responsables ont subitement découvert – autrement dit : beaucoup trop hâtivement – les vertus de la communication, n’aura, hélas, qu’un peu plus embrouillé les choses et amplifié la levée, sans précédent, de boucliers. L’opposition fustige une attitude haineuse. Biram, frais émoulu de prison, qui n’a rien perdu de sa verve, s’en prend au Président avec des propos peu amènes. Même les sénateurs, que les exégètes du discours présidentiel, n’ont pas ratés, s’offusquent, violemment, d’être ainsi vilipendés à moindre frais. Ils refusent de recevoir pas de moins de deux ministres et de répondre à une convocation de leur parti, l’UPR. Voués à disparaitre et n’ayant donc rien à perdre, les papys font de la résistance. L’un d’eux s’est même permis une sortie qui ne manque pas de courage. Pour lui, Ould Abdel Aziz doit être traduit devant la haute Cour de Justice, ni plus ni moins. Celle que préside toujours Sidi Mohamed ould Maham et qui allait juger l’ancien président Sidioca ? Utile rappel. « Qui creuse un puits pour son prochain », dit le dicton, « risque fort de s’y retrouver ». Version arabe de l’arroseur arrosé français. Que reproche notre vaillant sénateur à notre guide éclairé ? De s’être attaqué à une institution constitutionnelle et d’être intervenu dans le pouvoir législatif ? Comme si, dans notre démocratie militaire, la séparation des pouvoirs n’ait jamais été, un seul instant, réelle ou tant soit peu respecté, le texte fondamental de notre république. Que fit, de cette Constitution, en 2008, celui-là même qui s’attaque présentement au Sénat ? Ne la foula-t-il pas, tout simplement, du pied, en renversant un président élu ? Serait-il plus grave de médire le Sénat que de fomenter un coup d’Etat ? Bref, tout le monde s’affole. Alors que les limites de l’à-peu-près et de l’opportunisme, tant dans la conduite de l’Etat qu’en celle des affaires privées, craquent de partout, c’est pourtant de sang-froid et de compétences, réelles, cette fois, que la Mauritanie a plus que jamais, besoin. Et non pas d’un seul homme mais bel et bien d’équipes cohérentes, appliquées à des buts clairs et accessibles. Méthodiquement. Notre société et ses conditions de vie sont devenues complexes. Le deviendront encore plus. Cela implique des choix politiques. A l’opposé de l’autocratie et du tieb-tieb.
Ahmed Ould Cheikh
Contribution au débat : S’Arracher d’une Spirale Mortifère/Par Mohamed Salem Merzoug, Universitaire
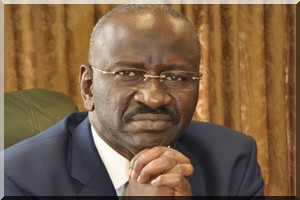 Au cours de son meeting tenu, à Néma, le 03 mai 2016, le Président de la République a parlé de la question du nombre d’enfants par famille et les effets nocifs du croît démographique non maîtrisé. C’est un fait. Un tel phénomène fait, on le sait, des ravages depuis, des lustres.
Au cours de son meeting tenu, à Néma, le 03 mai 2016, le Président de la République a parlé de la question du nombre d’enfants par famille et les effets nocifs du croît démographique non maîtrisé. C’est un fait. Un tel phénomène fait, on le sait, des ravages depuis, des lustres.
Il concerne tous les segments de la société mauritanienne à des degrés divers et selon des mécanismes à la fois globaux (polygamie) et endogènes (instabilité familiale).
A travers les âges, toutes les sociétés humaines en ont souffert. Chacune faisait de la forte fécondité un moyen de compensation d’un régime démographique cruel marqué par une mortalité massive et des pandémies graves.
L’inflexion associée à la Révolution Néolithique (agriculture, élevage, domestication des graminées, sédentarisation et, in fine, socialisation des hommes) n’aura pas eu les effets durables escomptés malgré, la multiplication par dix de la population mondiale d’alors, passée de quinze à cent cinquante millions d’âmes. Cette période n’aura pas changé la compensation classique qui permettait de gérer le croît démographique.
Il a fallu attendre le XVIIème et surtout le XVIII siècle pour que l’humanité connaisse le véritable tournant (transition démographique notamment en Europe) grâce à la convergence de nombreux facteurs : changement des mentalités avec l’amélioration des niveaux éducatifs et culturels, médecine, hygiène de vie, baisse de la mortalité, tendance haussière de l’espérance de vie. C’est, à tout cet ensemble, que l’Occident doit développement économique et progrès social puis, la révolution industrielle.
Donc, proposer cette question, au débat, est une démarche saine et nécessaire même si, elle bouscule, à raison, atavismes et mirages en tous genres.
Refuser les conservatismes
En l’évoquant, on s’adresse à tous, hommes et femmes, sans exception aucune, par delà les clivages et les appartenances. Et, pourtant, on a voulu, consciemment ou inconsciemment, faire croire qu’il ne pouvait s’agir que d’une frange, somme toute, important du peuple mauritanien. On a allumé une flamme, enclenché une bourrasque. Et, la surenchère a fait le reste. La question posée est au cœur du débat. Elle participe comme repère processuel de notre développement, de notre nécessaire ascension vers la modernité. Nous devrions en discuter sereinement et de manière froide. Car, ce sont les plus pauvres et les plus fragiles qui en subissent les ravages.
Je conçois, en effet, que si, pour la première fois, un tabou est brisé, un verrou est visé que les conservatismes, en tous genres, se hérissent. D’autant plus que les risques réels de mort précoce ont bâti un mythe rigide autour de la fécondité qui fonde encore, chez nous, les règles matrimoniales.
Or, il est indispensable que notre pays, nos populations soient édifiés sur certains verrous, certains obstacles structurels à notre développement. De quoi s’agit-il en pensant à ce vacarme ? De la question de la fécondité non maîtrisée avec son auréole de tragédies que chacun vit : mortalité, triptyque tragique de la faim, de la pauvreté et de la maladie. En l’abordant, on met, à l’ordre du jour, l’un des fondamentaux du moteur de l’histoire et une lame de fond de l’ascension de notre pays vers la modernité.
Si, la Mauritanie comme les autres états africains souffre de certains maux c’est bien à cause du blocage et/ou du retard accusé dans la transformation des mentalités et, dans la foulée, de l’inhibition de la transition démographique et du développement culturel.
Une telle inhibition participe de l’explication de la prolifération de la misère, des promiscuités, de la pauvreté de masse, de l’ignorance et du garrotage des forces productives. Jamais, un pays ne s’est développé sans résoudre cette question centrale. Avec les niveaux éducatifs et culturels, elle détermine la vraie trajectoire de l’évolution de toute société. Elle exprime et contingente les mutations et les transformations qualitatives structurantes comme socle de l’évolution des consciences et des mentalités et, in fine, de la modernité. Emmanuel TODD écrit « L’alphabétisation et la maîtrise de la fécondité apparaissent bien aujourd’hui comme des universels humains ».
Un leitmotiv : améliorer les conditions de vie
Donner tout son poids à ces variables qualitatives revient à reconnaitre ce que soutenait, avec prégnance, René DUMONT, à savoir que le développement est moins une question de ressources financières qu’un problème de rapport entre les personnes humaines et avec leur environnement. Il renvoie, à plusieurs choses à la fois, la maîtrise de son environnement, le taux de fécondité, l’éducation, les relations entre les sexes. En réfléchissant sur cette problématique, on ne saurait passer sous silence la loi du Révérend Thomas Malthus et aux enseignements de l’anthropologie sociale et culturelle moderne.
Que disait Thomas MALTHUS ? Il disait, très simplement, que les progrès techniques ne sauraient garantir, à eux seuls, une amélioration des conditions de vie dans la mesure où l’absence de contrainte pousse à une croissance démographique exponentielle et donc, à plus de personnes, à nourrir. Ce croît démographique s’est fracassé, tout au long de la longue odyssée humaine, sur l’impossibilité de retrouver de nouvelles terres, de nouvelles ressources frappées de dégradation et de finitude. D’où, au final, la misère et la faim. C’est un enseignement instructif de l’histoire des sociétés humaines, de toutes les sociétés humaines.
C’est surtout l’une des lois fondatrices de l’économie moderne. Elle explique, à travers la loi des rendements décroissants, l’émergence de la rente foncière et la liaison entre aristocratie et richesse. Faut-il en conclure que notre pays et l’Afrique de même que l’espèce humaine soient vouées à la faim, à la misère et à la pauvreté ? Bien sûr que non. La révolution néolithique précitée et la révolution industrielle sont là pour prouver le contraire.
En fait, il n’y a pas que les lois économiques pour comprendre l’évolution de la vie des sociétés humaines considérées comme des ensembles structurés ayant des règles et des modes de fonctionnement supra-individuels. Ceux-ci dépassent la simple rationalité individuelle. L’anthropologie sociale et culturelle permet, aujourd’hui, la compréhension de ces phénomènes qui dépassent l’individu. C’est cette discipline qui autorise une autre lecture du monde de Malthus confronté à un croît démographique supérieur à l’offre agricole. Aussi, favorise-t-elle une bien meilleure compréhension des problématiques de développement auxquelles nous sommes confrontées de même que nos frères africains.
Quelques études anthropologiques, démographiques et historiques montrent que chaque civilisation aura géré, selon ses croyances religieuses, son système de valeurs, son mécanisme particulier de régulation et les données contextuelles, la rareté des ressources et la pénurie et donc, l’exigence de survie du groupe. Certaines sociétés choisissaient l’abstinence, d’autres l’infanticide, la polyandrie etc. C’est un mécanisme de régulation anthropologique en l’absence des moyens modernes de contraception et d’une meilleure hygiène de vie.
On retrouve cette problématique dans la plupart des Etats Africains et Asiatiques sous des formes diverses et variées mais, le fond demeure le même: assurer une meilleure qualité de vies aux populations. L’acceptation d’un tel postulat renvoie à ce processus qu’on appelle « la transition démographique » comme moteur du changement qualitatif des conditions de vie. Elle permet de se sortir de ce cercle infernal. En mettant l’accent sur l’éducation, l’obligation de la scolarisation des mauritaniens, le rôle de la femme, le changement des mentalités et le développement culturel, le Président de la République donnait, à juste titre, la priorité, au capital humain. C’est à la fois légitime, pertinent et utile pour notre pays comme pour les autres africains.
En effet, la transition démographique, comme moteur du changement et d’ascension vers la modernité, est en panne, en Afrique, dans 50% des cas ou à peine amorcée dans 38% des cas.
Les pays africains ont, majoritairement, des taux de fécondité compris entre 4 à 5, avec un indice moyen de 4,86.
Maîtriser notre démographie
En nous fondant sur les données disponibles, l’Afrique apparaît comme une entité démographique relativement homogène avec des taux de dispersion assez tenus. Cinq pays ont, durablement, amorcé leur transition démographique : la Tunisie (2,04), l’Afrique du Sud (2,8), le Maroc (2,5), l’Algérie (3,2) et le Botswana (3,8).
Par contre, l’indice de fécondité atteint les niveaux records dans les pays suivants : au Bénin (5,3), au Burkina Faso (6,3), au Burundi (5,8), au Libéria (5,8), au Malawi (6,1), au Mali(6,1), en Mauritanie (6,2) en Ouganda(6) et au Tchad(6,2).
Le premier mouvement d’explication pourrait être recherché du côté de la religion (polygamie). La situation dans le monde arabe et musulman invalide une telle explication. Dans le Royaume d’Arabie Saoudite, en Egypte et en Jordanie, le nombre d’hommes polygames est respectivement de 30% et 8%. Un tel phénomène est totalement éradiqué en Turquie et en Tunisie. L’Irak l’a aboli en 1958 avant de le rétablir en 1994.
Par ailleurs, en termes de fécondité, le retard de notre pays par rapport à d’autres états musulmans est considérable : l’Iran (2,1), la Turquie (2,5), la Malaisie (1,98) et l’Indonésie (2,37) (le plus grand pays musulman au monde en termes de poids démographique). Les écarts sont encore plus creusés avec le Royaume Uni (1,7), la Chine (1,8), la France (2) et les Etats-Unis d’Amérique (2,6).
Donc, évoquer cette problématique est une responsabilité collective et un devoir d’avenir. Une telle situation est à mettre en relation avec l’ignorance, la pauvreté de masse, la forte magnitude de la mobilité maritale, la fragilité de la cellule familiale.
Or, développer notre pays dépend, entre autres facteurs, de la sortie d’une telle spirale mortifère. A cet égard, rien n’est plus nécessaire ni mieux adapté que le fil d’Ariane de la transition démographique et du développement culturel pour affronter les défis du progrès et de la modernité. Les variables en jeu constituent le vrai moteur de l’histoire et le réacteur des indispensables mutations qualitatives.
Maîtriser la fécondité, savoir lire et écrire, gérer au mieux son environnement fondent et structurent l’ascension vers la modernité. C’est, par biais, que les autres sociétés ont créé les conditions indispensables à la double exigence de la transformation mentale et de l’évolution des consciences. La profondeur et l’ampleur de l’impact de ces variables qualitatives engendre les conditions nécessaires à l’émergence d’une démocratisation véritable et d’une transformation sociale durable.
Un avenir pour notre jeunesse
La corrélation forte entre ces variables qualitatives évoquées et le progrès sont confirmées en convoquant l’histoire : la domination de l’Europe au XVIIème et XVIIIème siècle et le rôle actuel de l’Asie et de l’Amérique Latine de même que les Etats émergents. Le rôle dominant de ces continents confirment les relations quasi mécaniques entre baisse de la fécondité, éducation, alphabétisation de masse, évolution des consciences et des mentalités.
Celles-ci ont conduit Francis Fukuyama à soutenir la thèse d’une universalisation de la démocratie par l’extension massive de ce socle. C’est, dans la perspective de transformer et de développer le pays, qu’il faut remettre, à l’ordre du jour, l’exigence de l’accomplissement de la transition démographique et l’ampleur des innombrables dégâts inhérents à la forte fécondité. Ce n’est pas un hasard si tant d’hommes, de femmes, de pays se battent pour s’arracher d’une telle spirale mortifère.
L’inaction et l’immobilisme face à de telles tragédies constituent des fautes. Il appartenait aux Pouvoirs Publics et à nous tous d’indiquer un nouveau chemin qui brise le silence coupable face à une réalité inique devenue presque immuable. Il s’agit de nouer les fils du progrès, de stimuler l’imagination pour rendre possible et accélérer la nécessaire transition démographique en inventant de nouvelles règles. Ne laissons point la surenchère et la démagogie prendre le dessus sur la raison. L’avenir de nos jeunes, de nos enfants et de la libération des femmes est en jeu. Il s’agit de rendre le sursaut possible en leur dessinant des perspectives de nature à redonner confiance en l’avenir.
Mohamed Salem MERZOUG
Universitaire
le calame
Sénégal-Gambie : reprise du transport de marchandises à la frontière –
 Après trois mois de blocus, la frontière sénégalo-gambienne a été rouverte au trafic aujourd’hui à 8h, ont confirmé à “Jeune Afrique” le ministère des affaires étrangères et des syndicats de transporteurs sénégalais.
Après trois mois de blocus, la frontière sénégalo-gambienne a été rouverte au trafic aujourd’hui à 8h, ont confirmé à “Jeune Afrique” le ministère des affaires étrangères et des syndicats de transporteurs sénégalais.
C’est l’épilogue surprenant d’un blocus qui était entré en vigueur après que le fantasque président gambien Yahya Jammeh a décidé le 11 février de multiplier par cent le montant de la taxe douanière imposée aux camions sénégalais qui traversent quotidiennement son pays pour acheminer des marchandises en Casamance.
Le point de passage frontalier entre le Sénégal et la Gambie bloqué depuis février dernier par les groupements de transporteurs routiers sénégalais vient d’être rouvert au trafic ce matin à 8h, ont confirmé à Jeune Afrique le ministère des affaires étrangères et des syndicats de transporteurs sénégalais.
La levée intervient une semaine après l’échec des gouvernements sénégalais et gambien à trouver un accord à ce sujet à Dakar.
Selon un correspondant de la Radio Futurs médias (RFM), un média sénégalais, au point de passage de Karang situé dans la région de Kaolack, le trafic a normalement repris en milieu de journée, et le flux se fait dans les deux sens.
Toutefois, la nouvelle surprend autant qu’elle divise les principaux syndicats de routiers sénégalais à l’origine du blocus. Jointes par Jeune Afrique, les directions des deux tendances de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS et CNTS/FC), déplorent la décision et assurent n’y avoir pas été associées.
« Au moment du blocus, nous nous étions concertés avec le gouvernement avant de prendre la décision, on aurait dû aujourd’hui procéder de la sorte. Mais hélas ! », se désole Bassirou Ndiaye secrétaire général adjoint du syndicat des routiers affilié à la CNTS.
Jusqu’ici, les transporteurs contournaient l’enclave anglophone par l’est, en passant par la région de Tambacounda, pour se rendre en Casamance, la région méridionale. Gambie et Sénégal s’étaient donnés rendez-vous en juillet pour de nouvelles négociations.
jeunefrique
Le Spectre de la présidence à vie

Le Tadjikistan, ex république soviétique d’Asie centrale vient de permettre par un référendum au chef de l’Etat Emomali Rahmon de devenir «président à vie» ! Le référendum constitutionnel du 22 mai a révélé ses résultats ce lundi : 94,5% des électeurs approuvent notamment que, le président Emomali Rahmon, 63 ans, peut désormais briguer un nombre illimité de mandats, alors que la précédente constitution l’aurait obligé à quitter le pouvoir en 2020. Cette possibilité d’être « président à vie » ne s’applique qu’à Emomali Rahmon, en raison de son statut particulier de « dirigeant de la nation ». Un statut que lui a attribué le Parlement l’an dernier et qui lui confère, à lui et à sa famille, l’immunité pénale. « Rahmon nous a apporté la paix, il a mis fin à la guerre et il devrait diriger le pays aussi longtemps qu’il en a la force », décrètent certains de ses thuriféraires. On croirait entendre nos ’’ânes verts !’’ Un des amendements proposés lors du référendum visait aussi à baisser l’âge minimum requis pour un candidat à l’élection présidentielle de 35 à 30 ans. Une mesure qui pourrait faciliter l’avènement de Roustam, fils d’Emomali Rahmon âgé de 28 ans, comme successeur de son père à la présidence. En Afrique, malgré la progression de la démocratie un peu partout, de vieilles habitudes persistent et connaissent même des poussées dans plusieurs pays. En effet des chefs d’Etat manipulent sans vergogne la Constitution pour prolonger indéfiniment leur règne et mainmise sur les pays. Au pouvoir depuis 1979 — avec une interruption de cinq ans, entre 1992 et 1997 —, le président Denis Sassou-Nguesso a prolongé son règne par un tripatouillage constitutionnel, qui s’apparente à un coup d’Etat. Au Burundi, son homologue Pierre Nkurunziza s’est lui aussi permis de passer en force, en juillet dernier, au bout de deux mandats, sans prendre la peine pour sa part de modifier la loi fondamentale mais en l’interprétant en sa faveur. Au Congo RDC, le président Joseph Kabila parvient lui aussi après moult hésitation à se maintenir au pouvoir grâce à un subterfuge grossier à savoir ne pas organiser les élections sous prétexte de l’impréparation matérielle. En janvier 2015, des émeutes ont éclaté à Kinshasa contre une révision de la loi électorale impliquant un recensement de la population. Cette tâche titanesque, impossible à réaliser avant le vote, aurait donné à M. Kabila un bon prétexte pour prolonger son pouvoir, de report en report du scrutin. La répression de janvier a fait au moins 42 morts. Face à ces échecs il y a heureusement l’autre Afrique, celle qui progresse avec à la clé des élections à peu près normales comme au Benin, au Cap-Vert, en Afrique du Sud, au Ghana au Nigeria et à Maurice. Le Burkina Faso, pour sa part, fournit un motif d’espoir, avec le soulèvement populaire contre toute modification de la Constitution, en octobre 2014, puis la lutte victorieuse contre le coup d’Etat du général Gilbert Diendéré, en septembre 2015. Au Sénégal, les rouages démocratiques paraissent bien huilés, avec des alternances qui se produisent sans remise en cause de l’unité nationale depuis l’an 2000. Pour les apprentis dictateurs africains, le texte constitutionnel est une feuille de choux sans grande valeur. Ils feignent d’ignorer qu’une constitution est le résultat d’un consensus entre les acteurs politiques, et qui régit les relations, non seulement, entre les institutions du pays, mais aussi, entre la classe dirigeante et la citoyenneté. Ce n’est pas un document qui doit faire l’objet de changements par la volonté de celle ou celui qui détient le pouvoir exécutif. Des normes sont prévues pour son changement. Ils n’ont cure des manifestations de l’opposition et de la société civile. Si elles gênent vraiment leurs desiderata, ils feront recours à la brutalité, à la force et à la violence mais aussi à…La Politique du ventre qui est un concept qui désigne une manière d’exercer l’autorité avec un souci exclusif de la satisfaction matérielle d’une minorité. Développé par Jean-François Bayart dans son ouvrage L’État en Afrique : la politique du ventre, il a pour caractéristique principale que ceux qui exercent une fonction politique, exercent cette fonction uniquement pour en retirer certains avantages personnels. Quels rapports avec la Mauritanie ? Que ceux qui reconnaissent en eux les défauts ou travers décrits ci dessus s’appliquent ce qu’on en dit ou plus prosaïquement : Qui se sent morveux se mouche !
BC
Mauritanie, La littérature s’enseigne !
 La littérature mauritanienne d’expression française est absente des programmes scolaires nationaux. Son enseignement à l’université et à l’ENES date de 2009, grâce à la volonté des professeurs M’Bouh Séta Diagana auteur d’Eléments de la littérature mauritanienne de langue française (Editions L’Harmattan, 2008) et de Manuel Bengoéchéa ayant lui commis une thèse sur cette même littérature.
La littérature mauritanienne d’expression française est absente des programmes scolaires nationaux. Son enseignement à l’université et à l’ENES date de 2009, grâce à la volonté des professeurs M’Bouh Séta Diagana auteur d’Eléments de la littérature mauritanienne de langue française (Editions L’Harmattan, 2008) et de Manuel Bengoéchéa ayant lui commis une thèse sur cette même littérature.
Sinon il faudra remonter dans le temps, pour trouver des travaux sur cette littérature jeune et tout autant prometteuse. Il s’agit de : Ouverture sur la littérature mauritanienne de Catherine Belvaude (L’Harmattan, 1989), Guide de la littérature mauritanienne, sous titré Une anthologie méthodique, écrit par Nicolas Martin-Granel, Idoumou Ould Mohamed Lemine et Georges Voisset (Ed L’Harmattan, 1992). En 1995, la revue Notre Librairie lui consacre un numéro spécial. Il sera de même en 2015 avec le numéro 26 d’Interculturel Francophonies intitulé Littérature mauritanienne de langue française. Et ce n’est pas faute d’engouement. Car, non seulement de plus en plus de publications sont produites, mais ils sont nombreux les étudiants, universitaires et chercheurs qui se passionnent pour ce qui s’écrit en Mauritanie. Et par des Mauritaniens.
Créé en 2012, le Groupe de Recherches en Littératures Africaines (GRELAF) a donc voulu combler un vide. Il vient de publier l’Anthologie de littérature mauritanienne francophone (Editions Joussour/ Ponts, 2016, 228 pages). Une équipe de six professeurs, tous chercheurs et enseignants au Département, a planché sur près d’une quarantaine d’œuvres. Au total, dix-neuf écrivains sont étudiés, suivant un ordre de graduation par date de naissance : Oumar Bâ, Tène Youssouf Guèye, Assane Youssoufi Diallo, Djibril Zakaria Sall, Moussa Diagana, Isselmou Ould Abdelkader, Ousmane Moussa Diagana, Abdoul Ali War, El Ghassem Ould Ahmedou, Moussa Ould Ebnou, Oumar Diagne, M’Barek Ould Beyrouk, Harouna Rachid Ly, Aichetou Mint Ahmedou, Idoumou Ould Mohamed Lemine, Abderrahmane Ngaïdé, Bios Diallo, Mama Moussa Diaw et enfin, le benjamin de tous, Mamoudou Lamine Kane.
Rencontre avec le Professeur Mamadou Kalidou Bâ, directeur du GRELAF et coordinateur de l’Anthologie.
Pouvez-vous nous introduire la première anthologie nationale sur la littérature mauritanienne d’expression française, que vous avez coordonnée?
Pr Mamadou Kalidou Bâ : Je pense que cette Anthologie de littérature mauritanienne francophone, que nous publions avec une maison d’édition locale, Joussour/Ponts, est un ouvrage critique phare. D’abord pour ce qu’elle peut constituer dans l’enseignement de la langue française et dans celui de la littérature en Mauritanie. Ensuite pour ce qu’elle a été dans les projets de recherche réalisés par le Groupe de Recherches en Littératures Africaines (GRELAF) que j’ai l’honneur de diriger depuis sa création en 2012. Unité de recherche qui, je le précise, est une composante de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Nouakchott.
Qu’est-ce qui a prévalu à cette initiative?
J’ai eu l’idée de ce projet d’anthologie lorsque je rédigeais mon mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches, HDR, en 2012. J’en ai dessiné les formes dans la dernière partie de ce document, consacré à mes perspectives. J’avais moi-même découvert la littérature mauritanienne quatre ans plus tôt en lisant l’ouvrage de mon ami et collègue Mbouh Séta Diagana intitulé Eléments de la littérature mauritanienne de langue française publié chez L’Harmattan en 2008. Je découvrais ainsi des textes d’une richesse que je ne soupçonnais nullement. Il faut dire que jusqu’à cette année, 2008, je poursuivais mes recherches dans la dynamique de ma spécialité doctorale : l’analyse du roman africain francophone post-colonial qui a d’ailleurs fait l’objet de mon premier livre que j’ai publié chez L’Harmattan en 2009 et intitulé Le roman africain francophone post-colonial. Radioscopie de la dictature à travers une narration hybride.
Je me suis d’abord étonné de ne découvrir la littérature de mon pays que si tard. J’ai compris que c’est parce que je n’ai jamais eu la chance de l’étudier, à aucun cycle de mon cursus. En effet, comme je le souligne dans l’avant-propos à cette anthologie, la littérature mauritanienne d’expression française est quasi absente dans les fascicules de lecture destinés aux élèves du collège et du lycée. Ce qui est, de mon point de vue, une aberration ! Dans tous les pays du monde, l’enseignement des langues, ici en l’occurrence le français, s’appuie sur celui de la littérature nationale. Cette approche didactique est d’autant plus cohérente que l’apprenant saisit très vite le sens de l’expression parce qu’elle exprime une réalité culturelle, sociale, géographique qui lui est familière…
Une prise de conscience à combler un vide…
Je m’étais dit qu’il nous revenait, nous autres chercheurs dans cette spécialité, de remédier à ce manquement. Evidemment que nous n’avons pas la latitude de décréter une réforme de l’enseignement, c’est une prérogative des décideurs politiques, mais, à notre niveau, nous pouvions donner plus de visibilité à la littérature mauritanienne francophone en lui consacrant une partie de nos recherches. De sorte que, quand un jour que j’espère proche, nos gouvernants se rendront compte de l’évidente nécessité de réformer notre système éducatif et donc de revoir, entre autres les programmes des enseignements, eh bien que nous ayons un contenu à suggérer.
Après la soutenance de mon HDR en 2012, et la création effective du GRELAF, j’ai proposé à mes collègues deux projets de recherche, dont celui de cette anthologie. Dès que j’ai obtenu leur aval, je me suis mis à la recherche d’un financement. C’est la coopération française, à travers son projet AFRAM qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette anthologie ainsi que dans d’autres projets. Les moyens alloués par l’université de Nouakchott à la recherche presque inexistants.
Hormis ce manque de moyens, ce qui vous réconforte c’est qu’on peut à présent parler de la littérature mauritanienne, comme on évoquerait les littératures marocaine, algérienne, tunisienne, sénégalaise ou encore malienne… Pour ne citer que nos voisins immédiats
Oui, je pense qu’on peut parler de la littérature mauritanienne comme on le fait pour les autres pays. Non par simple analogie, mais parce qu’elle existe dans les mêmes termes de définition que les autres littératures nationales. Toutefois, il importe de préciser que, comme la réalité culturelle et anthropologique mauritanienne, la littérature mauritanienne francophone n’est pas uniforme, elle est diverse et variée. Ainsi, si Idoumou dans Igdi, les voies du temps et El Ghassem ould Ahmedou dans Le Dernier des nomades ou Aichétou Mint Ahmedou dans La couleur du vent proposent une dépeinture de la société bidhane, maure, dans des espaces désertiques (le désert du Sahara), Tène Youssouf Gueye dans Rellà ou les voies de l’honneur, Moussa Diagana dans La légende du Wagadu et Harouna Rachid Ly dans Le Réveil agité déploient des récits où l’histoire et les cultures négro-africaines sont revisitées à travers des postures très critiques. Parallèlement à ces deux orientations qui consacrent le caractère multiculturel et multiethnique de la Mauritanie, il y a une tendance qui est celle de l’émergence d’une plus grande conscience quant aux défis de construction d’une nation mauritanienne viable. C’est ainsi que de nombreux écrivains de toutes les origines, arabo-berbères et négro-africains, planchent sur le crucial problème de la cohabitation et ses négatives conséquences sur la paix sociale, l’éducation, l’esclavage, la féodalité … Je pense notamment à Isselkou Ould Abdelkader avec Le Muezzin de Sarandougou, Ousmane Moussa Diagana, Notules de rêves pour une symphonie amoureuse, Moussa Oud Ebnou, Barzakh, et Bios Diallo, Une Vie de Sébile, entre autres.
Cela dit, vous ne semblez pas, non plus, avoir pris en compte tous les écrits
L’élaboration d’une anthologie impose toujours aux critiques de faire des choix d’autant plus difficiles qu’ils sont, à certains égards, aléatoires. Pour la présente anthologie, ce choix a été de deux ordres. Nous y avons circonscrit notre analyse à ce qu’il est convenu d’appeler les « belles lettres » : la poésie, le théâtre, les nouvelles et le roman. Ensuite, mes collègues et moi avons été obligés de limiter notre corpus à seulement 34 œuvres, écrites par 19 écrivains mauritaniens. Nous aurions bien voulu être plus exhaustifs, mais, vous savez ce qu’on dit, qui trop embrasse, risque de mal étreindre ! C’est d’ailleurs l’occasion de nous excuser auprès de nos écrivains dont des œuvres n’ont pas été traitées dans cet ouvrage. J’en connais beaucoup qui le méritent amplement.
Certes le champ était circonscrit au français, mais dans un pays où cohabitent d’autres expressions littéraires, autant en arabe, poular, soninké et wolof, le lecteur n’aurait-il pas été plus édifié par un texte même lapidaire sous une forme comparative. On aurait peut-être davantage mieux saisi les choix d’écriture en français, et offrir aussi un survol sur les choix de sujets chez les uns et les autres !
Certes, il existe dans notre pays des expressions littéraires en langues nationales très riches qui, c’est ma conviction, méritent une attention particulière parce qu’exprimant, plus que le français, l’âme profonde de nos composantes populaires. La promotion de ces littératures rime nécessairement, j’allais dire d’abord, avec celle de toutes les langues mauritaniennes. L’arabe est déjà promu, c’est une bonne chose, mais l’impératif de justice exige que le poular, le soninké et le wolof le soient tout autant. Avant que ces langues ne soient introduites dans notre système éducatif pour instaurer l’égalité entre tous, vouloir parler de visibilité de ces littératures est, de mon point de vue, inopportun.
On présume que vous avez pu rencontrer des difficultés dans l’aboutissement de cette œuvre…
Certainement ! La première et sans doute la plus importante, c’est qu’aujourd’hui encore, alors que nous avons des unités de recherches opérationnelles, capables de rayonner au plan international, toutes nos activités dépendent des subventions des bailleurs extérieurs. En effet, tous les projets réalisés par le GRELAF, l’ont été, grâce à l’appui de la Coopération française qu’il me plait d’ailleurs de remercier très sincèrement.
A chaque fois que nous présentons à nos autorités universitaires des projets de recherche, c’est presque toujours la même rengaine : « il n’y a pas de moyens à y consacrer », nous dit-on ! Et quant la direction de la recherche scientifique avoue, quelque fois, avoir vingt millions, à quoi servent vingt millions, à consacrer à la recherche, elle achète quelques ordinateurs qu’elle distribue, non aux unités qui produisent, mais à d’autres qui n’existent que de nom, mais qui sont dirigées par des « copains » ou ceux de sa « tribu ». Il va de soit qu’avec de telles pratiques, la recherche n’est pas prête à décoller à l’université. Il n’ya pas de recherches possibles sans un minimum de moyens, or c’est ce minimum qui n’est pas mis à notre disposition.
A présent que le travail est fait, à qui le destinez-vous?
D’abord à nos étudiants ! Ensuite à l’Institut Pédagogique Nationale, l’IPN, dont on espère qu’elle saisira cette occasion pour, enfin, introduire les textes de littérature mauritanienne dans les livres de lecture. Enfin à tous ceux qui aiment la littérature.
Vous avez parlé de l’IPN, et Joussour qui vous a édité. Mais le manque de maison d’édition d’envergure n’est-il pas un handicap à l’essor d’une littérature ? Puisqu’on entend très souvent des gens dire qu’ils ont des manuscrits sous le bras, et qui finissent dans les caves si ce n’est en décharges !
Oui, éditer au niveau national est aussi une nouveauté de cette anthologie. En effet, c’est la première fois que mes collègues co-auteurs de cette anthologie et moi, éditons au niveau national. Je saisis cette opportunité pour remercier le Professeur Mohamed Ould Bouleiba, directeur des maisons d’édition Joussour/Ponts, pour sa contribution à la publication de cet ouvrage. Je pense qu’en se spécialisant dans la publication des écrits critiques, en fournissant plus d’efforts dans la relecture et la fabrication, déjà de bonne qualité, cet éditeur aura toutes les chances de rayonner sur la sous-région ouest-africaine et maghrébine. Il pourra ainsi, aux côtés d’autres qui se spécialiseront dans l’édition d’autres genres, contribuer à résorber le grand déficit en édition francophone que nous connaissons dans notre pays. J’espère que le développement des éditions nationales aidera à rendre les livres plus accessibles à la bourse de la majorité des Mauritaniens.
Propos recueillis par Tougué
Anthologie de littérature mauritanienne francophone (Sous la direction de Mamadou Kalidou Bâ), Editions Joussour/ Ponts, Nouakchott, 2016, 228 p
Source : Traversees Mauritanides