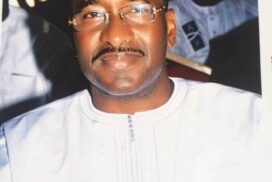Daily Archives: 14/01/2016
Trafic d’enfants : plusieurs véhicules transportant 48 enfants interceptés à la frontière guinéo-sénégalaise
 Le trafic d’enfants refait encore surface dans certaines localités de la Guinée notamment dans la préfecture de Koundara vers la frontière guinéo-sénégalaise. Selon une information rapportée par nos confrères de Guineematin.com, les services de sécurité de Koundara ont été plus que surpris lorsqu’ils ont intercepté au poste frontalier de Bhoundou Fourdou, un convoie de véhicules transportant au total 48 mineurs âgés de 4 à 15 ans.
Le trafic d’enfants refait encore surface dans certaines localités de la Guinée notamment dans la préfecture de Koundara vers la frontière guinéo-sénégalaise. Selon une information rapportée par nos confrères de Guineematin.com, les services de sécurité de Koundara ont été plus que surpris lorsqu’ils ont intercepté au poste frontalier de Bhoundou Fourdou, un convoie de véhicules transportant au total 48 mineurs âgés de 4 à 15 ans.
Selon le préfet de Koundara, Hassane Sanoussy Camara, les services de sécurité ont réussi ce coup de filets dans la nuit du samedi au dimanche 10 janvier 2016 suite à une alerte lancée par le directeur préfectoral de la Douane de Koundara qui, en partance à Boké, a entendu les cris des enfants dans de deux véhicules en provenance de Wendou M’bourou.
Au poste frontalier de Bhoundou Fourdou où le convoi a été intercepté aux environs de 4 heures du matin, les agents ont trouvé 17 enfants en partance pour la Mauritanie. Au commissariat central de police de Koundara, le convoyeur a déclaré qu’il envoyé les enfants pour aller étudier le coran au Sénégal et en Mauritanie.
Drôle de coïncidence, la même nuit, le commandant du Bataillon Autonome de Koundara qui était en patrouille à découvert 10 enfants en pleine forêt, dans un village du nom de Salémata. Dans de cas ci, le convoyeur était en moto et les enfants étaient embarqué dans un taxi immatriculé RC 9792 M.
L’enquête ouverte par le commissaire central de police de Koundara a démontré qu’il y a encore un autre groupe d’enfants en provenance de Saréboïdho et de Youkounkoun convoyés par d’autres personnes pour le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau et la Mauritanie dont le plus âgé n’a que 15 ans. Au total 48 mineurs.
Interrogé les enfants indiquent ne pas connaitre leur destination. L’un d’entre eux déclare avoir été enlevé la nuit à l’absence de sa maman qui était partie à une cérémonie de mariage. Le préfet de Koundara a promis de transférer ce dossier à la justice pour de vérifier s’il ne s’agit pas d’un réseau de trafiquants d’enfants qui vient d’être démantelé.
Ce trafic d’enfants inquiète d’autant plus qu’il intervient au moment des organisations terroristes sévissent dans la sous-région. Et on le sait, les mineurs constituent pour eux des proies facile à radicaliser pour éventuellement grossier leurs rangs dans le futur. Le cas des filles enlevées au Nigéria trotte encore dans les esprits.
Abdoul Malick Diallo pour Aminata.com
+224 655 62 00 85
dialloabdoul110@gmail.com
Rentrée politique: Quelles perspectives?
Les Mauritaniens attendent, depuis quelques jours, le retour du président de la République Mohamed ould Abdel Aziz, parti passer quelques jours de vacances, dans un Tiris, particulièrement verdoyant cette semaine grâce à une bonne pluviométrie. Des vacances qui ressemblent fort à un deuil, suite au tragique accident qui a emporté son fils et deux journalistes de sa fondation Rahma.
Surmontant sa tristesse, le président de la République aura certainement mis à profit ce repos pour avancer quelques pions, échafauder, loin des indiscrétions et des bruits du Palais gris, quelques scénarii pour marquer la rentrée politiques 2016. Selon diverses indiscrétions concordantes, il aurait même tenu une réunion avec les chefs de corps des forces armées et de sécurité. De quoi ont-ils parlé ? Mystère !
En tout cas, impatients de savoir par quel bout le Raïs va entamer la nouvelle année, les Mauritaniens spéculent à tout va. Beaucoup parient sur quelques touches ou retouches à son gouvernement. On imagine le stress – pour ne pas dire la trouille – qui frappe certains membres de celui-là, inquiets de leur sort. Une chose est sûre, l’immobilisme auquel on assiste ne peut pas durer : l’année 2016 s’annonçant très difficile, le Président devra vite trouver le moyen d’impulser une dynamique à l’action gouvernementale, anticiper les lourdes conséquences des prévisions généralement pessimistes des économistes. Cela passera-t-il nécessairement par un changement d’attelage gouvernemental ? Rien n’est moins sûr. Ce qui est, par contre, certain, c’est que le discours d’autosatisfaction du Premier ministre, il y a quelques jours, devant le Parlement, ne présage rien de bon. Yahya ould Hademine ne semble percevoir aucune des difficultés qui attendent les Mauritaniens en cette année 2016. La baisse des recettes minières, principales ressources financières du pays, et l’augmentation de la TVA sur divers produits vont peser lourdement sur le bas peuple. Une situation qui ne manquera, certainement pas, d’occasionner, de surcroît, une pression sur les recettes que l’Etat se hâte de combler par une pression fiscale accrue qui frappe, déjà, plusieurs entreprises de la place, avec un fort risque de troubles sociaux. Les dockers du PANPA viennent, d’ailleurs, d’en donner le coup d’envoi, en menaçant d’aller en grève. Les prix des produits de première nécessité flambent depuis quelques jours et rien n’est avancé, dans la déclaration du Premier ministre, pour rassurer les populations.
Mauvais exemple
Si la situation économique est loin d‘être rose, la politique reste, pour sa part, complètement bloquée, depuis l’échec de la dernière tentative de reprise des pourparlers, entre le pouvoir et le FNDU. La rencontre tant attendue, entre une délégation de celui-ci et le monsieur Dialogue de celui-là, le docteur Moulaye ould Mohamed Lagdhaf, s’est soldée par un énième bide. Le pouvoir refusant toujours de se prononcer, par écrit, sur la vision du FNDU remise, au gouvernement, en Septembre dernier. Même si le Premier ministre a laissé entendre, dans son discours, que notre démocratie serait « renforcée par la promotion de la culture du dialogue et du pluralisme politique », ce qui, du reste, ne signifie pas grand-chose, l’horizon demeure bouché. Soit dit en passant, opposition et pouvoir y ont, chacun, sa part de responsabilité. Interrogé sur l’avenir du dialogue en cette année nouvelle, un responsable de l’opposition affirme cependant que « tout dépend du gouvernement à qui revient l’initiative de débloquer la situation ». Le fera-t-il ? On attend la sortie du Président ou les décisions du premier Conseil des ministres de la rentrée.
En tout cas, le pays a vraiment besoin de sortir de cette situation de ni paix, ni guerre. Les différents camps doivent œuvrer à briser le mur de méfiance et aller de l’avant, pour ancrer davantage notre démocratie. Assez tergiversé ! Depuis 2008, on n’a pas réussi à tenir le moindre dialogue inclusif et sincère, alors que nous avons largement les moyens d’y arriver. Intellectuels de la diaspora, imams et érudits, qui ont surtout brillé, jusqu’ici, par leur silence, peuvent et doivent s’impliquer pour pousser les acteurs politiques à sortir de l’impasse. Toutes les chances ne sont pas épuisées. La Mauritanie aurait ainsi bien besoin de l’expertise d’un Ahmedou ould Abdallah, ancien ministre, ancien ambassadeur et représentant des Nations Unies ; d’un El Ghassem Wane, depuis peu aux Nations Unies, de Kane Mouhamadou, représentant de l’UA au Soudan, d’un Abdessalam ould Mohamed Salah, représentant de la FAO au Liban, avec tant d’autres intellectuels et sages, pour résoudre, en interne, ses divergences politiques. Le président de la République qui prêche et vante les vertus du dialogue se doit de lui donner, au moins, une chance d’exister. L’excès de velléités détruit notre capacité naturelle à négocier et trouver des solutions apaisantes : c’est bien là le pire exemple que peut donner un président de la République au peuple qu’il est censé représenter, en totalité, au-dessus des partis… alors même que l’amoncellement des difficultés pousse chacun à se replier sur lui-même, son clan, son ethnie, sa classe sociale…
DL
le calame
Aleg la cosmopolite
 Plus de cent ans après sa fondation, la ville d’Aleg nargue toujours le temps et ses aléas, du haut des dizaines de mètres de sa célèbre colline où les colons français construisirent, vers 1900, un fort militaire. Celui-ci surplombe encore toutes les constructions de la vieille cité. Dans sa route vers Tidjikdja, Xavier Coppoloni aurait passé un jour ou deux dans le nouveau fief établi par la puissance colonisatrice française. Sur la date exacte de la fondation de Lekdeya (montagnette) ou Goueibina pour les taquins – deux autres noms d’Aleg – chacun y va de sa version personnelle. Les campements dont sont issus plusieurs des premiers habitants de la ville datent de très longtemps. Le lac dont la ville tire le nom et la plaine dont elle tire la vie constituent des éléments naturels essentiels incontestables pour justifier amplement de l’aura de la cité, dans un environnement agropastoral emblématique de toute la wilaya du Brakna dont Aleg deviendra la capitale. Jusqu’aux années 1980, la ville est restée paisiblement calfeutrée sur ses trois principaux quartiers : Médina, Jedida, deux excroissances de sa plus ancienne favela : Liberté ou Derissa qui en est le noyau et où vinrent se regrouper les tout premiers esclaves rebelles qui quittaient leurs maîtres des campements environnants, les employés coloniaux indigènes, les commerçants venus, surtout, du Tagant voisin ou de l’Adrar, et quelques autres « coupés de chaussures », débarquant d’on ne sait où, en aventuriers ou errants. Ainsi, de la bâtisse de la brigade de gendarmerie à la célèbre grand-rue, en passant par les locaux de l’élevage et du dispensaire, c’est tout un cosmopolitisme de populations venues de partout. Certains noms peuvent même faire croire, aux visiteurs, qu’ils sont quelque part au Mali, en Guinée ou au Sénégal : Birama Dembélé, Tiécoura Moussa N’Diaye, Demba Faye, Meïmad Diallo (déformation de Mamadou Diallo), Mersou (déformation d’Oumar Sow), Louis Diallo, Boubacar Sarr, Mohamed Lemine Diallo, Cheikh Sarr, Amad Djibi (déformation d’Amadou Djibi), Mbey Diangou (déformation de M’Baye Ndiong), M’baye Guèye, Maga Traoré et autres Bakari Traoré, Mor Cissé, Mama Cissé, Kati Kamara, Ethmane Diop, Demba Ama, parmi beaucoup d’autres, sont d’illustres Alégois dont les maisons se situent en plein cœur de l’inénarrable quartier Liberté. Des chauffeurs et cuisiniers coloniaux, boulangers, postiers et autres puisatiers, partisans ou goumiers redevenus gardes ou gendarmes dont certains venaient du Sénégal, du Mali, de la Guinée et, parfois, même de la Haute Volta (actuel Burkina Faso). Tous ces noms sont assortis, systématiquement, d’un Ehel untel, complètement adapté aux us et coutumes d’une communauté qui n’a plus aucun secret pour eux. Aleg la rebelle est un véritable melting-pot : Les familles Lopez, Pedro et autres sont des ressortissants à part entière de cette vieille « guérite » militaire qui vit naître la Mauritanie, un certain 5 Mai 1958, lors de l’historique congrès d’Aleg.
Plus de cent ans après sa fondation, la ville d’Aleg nargue toujours le temps et ses aléas, du haut des dizaines de mètres de sa célèbre colline où les colons français construisirent, vers 1900, un fort militaire. Celui-ci surplombe encore toutes les constructions de la vieille cité. Dans sa route vers Tidjikdja, Xavier Coppoloni aurait passé un jour ou deux dans le nouveau fief établi par la puissance colonisatrice française. Sur la date exacte de la fondation de Lekdeya (montagnette) ou Goueibina pour les taquins – deux autres noms d’Aleg – chacun y va de sa version personnelle. Les campements dont sont issus plusieurs des premiers habitants de la ville datent de très longtemps. Le lac dont la ville tire le nom et la plaine dont elle tire la vie constituent des éléments naturels essentiels incontestables pour justifier amplement de l’aura de la cité, dans un environnement agropastoral emblématique de toute la wilaya du Brakna dont Aleg deviendra la capitale. Jusqu’aux années 1980, la ville est restée paisiblement calfeutrée sur ses trois principaux quartiers : Médina, Jedida, deux excroissances de sa plus ancienne favela : Liberté ou Derissa qui en est le noyau et où vinrent se regrouper les tout premiers esclaves rebelles qui quittaient leurs maîtres des campements environnants, les employés coloniaux indigènes, les commerçants venus, surtout, du Tagant voisin ou de l’Adrar, et quelques autres « coupés de chaussures », débarquant d’on ne sait où, en aventuriers ou errants. Ainsi, de la bâtisse de la brigade de gendarmerie à la célèbre grand-rue, en passant par les locaux de l’élevage et du dispensaire, c’est tout un cosmopolitisme de populations venues de partout. Certains noms peuvent même faire croire, aux visiteurs, qu’ils sont quelque part au Mali, en Guinée ou au Sénégal : Birama Dembélé, Tiécoura Moussa N’Diaye, Demba Faye, Meïmad Diallo (déformation de Mamadou Diallo), Mersou (déformation d’Oumar Sow), Louis Diallo, Boubacar Sarr, Mohamed Lemine Diallo, Cheikh Sarr, Amad Djibi (déformation d’Amadou Djibi), Mbey Diangou (déformation de M’Baye Ndiong), M’baye Guèye, Maga Traoré et autres Bakari Traoré, Mor Cissé, Mama Cissé, Kati Kamara, Ethmane Diop, Demba Ama, parmi beaucoup d’autres, sont d’illustres Alégois dont les maisons se situent en plein cœur de l’inénarrable quartier Liberté. Des chauffeurs et cuisiniers coloniaux, boulangers, postiers et autres puisatiers, partisans ou goumiers redevenus gardes ou gendarmes dont certains venaient du Sénégal, du Mali, de la Guinée et, parfois, même de la Haute Volta (actuel Burkina Faso). Tous ces noms sont assortis, systématiquement, d’un Ehel untel, complètement adapté aux us et coutumes d’une communauté qui n’a plus aucun secret pour eux. Aleg la rebelle est un véritable melting-pot : Les familles Lopez, Pedro et autres sont des ressortissants à part entière de cette vieille « guérite » militaire qui vit naître la Mauritanie, un certain 5 Mai 1958, lors de l’historique congrès d’Aleg.
Après cent cinquante ans d’existence, Lekdeya reste encore un gros village. Plusieurs de ses gouvernants, notamment le hakem de la ville, et la maison de son gouverneur restent toujours haut perchés sur la montagnette, comme pour bien voir les gens de la ville vaquer à leurs occupations dans le vieux marché au pied de la colline ou, là-bas, dans la plaine agricole de Lekleïla, à quelques centaines de mètres du vieux fort, vers le petit village de Teyba. Quelques bâtiments construits au cours de la colonisation narguent encore le temps et ses infortunes. Il y a, d’abord, la Sangu’a : une vingtaine de très anciennes petites maisons où logeaient les gardes coloniaux et leurs familles, demeures, aujourd’hui, de quelques éléments de la Garde nationale. Il y a, ensuite, la brigade de gendarmerie et le poste d’élevage, toujours d’aplomb, sans rien envier aux nouvelles constructions officielles qui les entourent. Il y a, enfin, l’école 1 d’Aleg, superbement construite dans les années 1930 et qui a vu défiler des générations et des générations de brillants élèves formés par de plus encore brillants et célèbres instituteurs. Ce n’est certainement pas un hasard que cette école est la seule du pays à pouvoir se vanter d’avoir « sorti » un président de la République, Sidi Mohamed ould Cheikh Abdallahi, et trois administrateurs directeurs généraux de la SNIM, Ismaïl ould Amar, Baba ould Ahmed Youra et Mohamed Abdallahi ould Oudaa. Autrefois célèbre pour ses moustiques, Aleg l’est aujourd’hui plus par son croustillant méchoui dont raffolent les voyageurs de toutes provenances qui ne manquent jamais de s’en délecter, à la moindre occasion. C’est aussi dans cette ville que se trouve la tombe de feu Mohamed ould M’sseïka, résistant pour les uns et bandit de grand chemin pour les autres. Comme par hasard, la tombe de cet homme qui fit tant parler de lui se situe à quelques encablures de la nouvelle prison, comme pour rappeler l’anecdote selon laquelle, averti, par les prisonniers, alors qu’il venait d’être incarcéré à Aleg, de la dangerosité des moustiques de Lekdeya, Ould M’sseïka répondit par une formule qui devint, par la suite, un adage : « Dites-le à celui qui passe l’hivernage à Aleg ». Les gens racontent que Mohamed ne passa, de fait, pas même une nuit en prison.
Après un siècle et demi d’existence, Aleg avance. Lentement. Juste onze écoles fondamentales, un lycée et un collège. Un hôpital régional et un dispensaire. Une école d’ingénieurs et une petite industrie de tuyauterie, made in SNIM. Une 7ème région militaire et une zone-centre de gendarmerie. Et, tenez-vous bien, la plus grande prison du pays. Pour plus de cent cinquante ans de vie, ce n’est pas beaucoup. Aleg la rebelle devra donc attendre l’avènement d’un providentiel second président. Qui restera, cette fois, un peu plus longtemps, espérons-le, pour faire, de sa ville, une des plus en vue du pays.
Sneïba El Kory
Le calame