Daily Archives: 01/03/2015
Il s’appelait Tenguella Ba : le symbole du refus de l’injustice et de l’arbitraire, de la domination et de la compromission est parti dans la dignité (14 septembre 1940 – 26 février 2015)
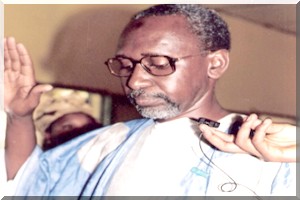 Sa dernière apparition publique en France remonte au 2 octobre 2011. Il sortait d’une longue hospitalisation en région parisienne, loin des siens. Il trouva tout de même, ce jour sans l’aval de ses médecins, les ressources pour se joindre à la grande manifestation pour exprimer son indignation contre l’assassinat du jeune Lamine Mangane à Maghama et sa colère contre l’opération d’enrôlement discriminatoire qui lui rappelle la déchéance de sa nationalité mauritanienne en 1969 déjà.
Sa dernière apparition publique en France remonte au 2 octobre 2011. Il sortait d’une longue hospitalisation en région parisienne, loin des siens. Il trouva tout de même, ce jour sans l’aval de ses médecins, les ressources pour se joindre à la grande manifestation pour exprimer son indignation contre l’assassinat du jeune Lamine Mangane à Maghama et sa colère contre l’opération d’enrôlement discriminatoire qui lui rappelle la déchéance de sa nationalité mauritanienne en 1969 déjà.
Dans l’élément vidéo mis en lien plus bas dans ce texte, il lance le message suivant aux manifestants de la place Trocadéro à Paris : http://www.dailymotion.com/video/xlgdjn_touche-pas-a-ma-nationalite-hommage-a-lamine-mangane-assassine-par-des-ss-de-mauritanie-2_news?start=2).
« Il faut vous regrouper et éviter que les gens vous divisent. Votre combat doit être un combat commun et vous ne pourrez le gagner que si vous restez unis ». Déjà en 1962, au sein de l’Union Générale des Originaires de la Mauritanie du Sud (UGOMS), tout jeune étudiant, il s’insurgeait contre ce qui, à ses yeux, prenait la forme d’une dérive : l’orientation de plus en plus arabe prise par la direction du pays.
Au bas de la page 3 de la longue liste des signataires du Mémorandum de ce mouvement naissant, figurait un certain Tenguella Ba, un des deux étudiants parmi la centaine de noms dont la plupart était instituteurs ou fonctionnaires, tous originaires de la Vallée. Il posait là un acte d’engagement fort contre une politique qu’il dénoncera tout au long de sa vie.
Les choses ne tarderont à se préciser avec la mesure rendant officielle la langue arabe et obligatoire son enseignement dans un pays dont les ressortissants ne sont pas tous Arabes.
Quand, en application de cette mesure d’arabisation du système éducatif, des manifestations éclatent, notamment la grève de janvier et février 1966, il n’hésita pas à apporter son soutien au mouvement des élèves noirs (il fait partie des 31 fonctionnaires noirs qui ont ouvertement approuvé et soutenu la publication du Manifeste des 19). La conséquence de ce soutien va être immédiate, radicale et déterminante pour la suite de la carrière et de la vie de l’homme.
Suspendu de ses fonctions (au Ministère de la Justice, en charge de la Législation), il se rendra au Sénégal où il retrouvera deux anciens dirigeants signataires du Manifeste des 19, exilés forcés dans ce pays, pour, selon ses propres mots « trouver un moyen de vivre » : son cousin et beau–frère Abdoul Aziz Ba (brillant magistrat, Président du Tribunal de Première Instance de Nouakchott jusqu’en févier 1966, qui deviendra Président du Conseil Constitutionnel du Sénégal, Président du Conseil d’Etat, Président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion de ce même pays) et Abdoulaye Sow (ancien Trésorier général de Mauritanie qui se reconvertira avec succès comme patron de l’une des plus grandes boîtes d’assurances du Sénégal).
Mais l’homme décide dans un premier temps de revenir au bercail. Il fut réintégré, mais ne renonce pas pour autant à la lutte dont les justifications demeurent. Avec des amis, ils mettent en place une organisation clandestine pour porter une opposition à la politique conduite par Moktar Ould Daddah.
Une clandestinité qui les privera de toute possibilité de promotion : Moktar Ould Daddah ayant annoncé dans une déclaration qu’il faudrait désormais être affilié au Parti du Peuple Mauritanien (PPM) pour prétendre à une promotion sur le plan administratif, en termes de responsabilité. Avec ses amis, ils font le choix douloureux de se démarquer du parti-Etat en refusant les responsabilités miroitées par Moktar Ould Daddah.
En 1969, pour une déclaration tenue sur le caractère raciste de l’Etat et le danger que celui-ci faisait courir à la Nation par sa politique, il fut révoqué de ses fonctions, et par la même occasion, déchu de sa nationalité au motif fallacieux qu’il avait acquis une autre nationalité.
Mais c’était sans compter avec la ténacité de l’homme. Sa réplique fut immédiate. Fait inédit et unique dans les annales de l’histoire de notre pays : Tenguella intente une action en justice contre l’Etat devant la Cour suprême de Mauritanie. Ironie de l’histoire, le Juge, un Français, qui s’est saisi de l’affaire était son collègue au Ministère de la Justice.
Tenguella lui apporte un argumentaire simple mais irréfutable à l’appui de sa plainte : la loi 61-112 du 12 juin 1961 (modifiée en 2010 par une loi de circonstances). L’article 1 de cette loi 61 -112 stipule en effet que : « est Mauritanien, l’enfant né d’un père mauritanien ». En appui à cet article, il joint le certificat de nationalité de son père et son acte de naissance, enregistré en 1940 à Aleg où il est né le 14 septembre 1940 et où exerçait son père.
L’affaire fut jugée et moins de deux années après, la Cour suprême condamne la Mauritanie et reconnait à Tenguella aussi bien la nationalité mauritanienne que la nationalité sénégalaise. Nationalités qu’il conservera tout au long de sa vie.
La nationalité pour Tenguella, c’était déjà « touche pas ». C’est « un fait préexistant » que nul n’a le droit de contester à l’autre, se plait-il à préciser. Elle était si sacrée, y compris pour l’Etat mauritanien, que le citoyen ne pouvait y renoncer par lui même. Il fallait pour ce faire suivre une procédure, arbitrée par la Cour suprême, seule habilitée à reconnaitre ou à déchoir éventuellement le citoyen de sa nationalité.
La permanence de l’injustice qu’il dénonce, la répétition des exactions contre ceux qui osaient dénoncer cette injustice, la compromission d’une certaine classe finiront de convaincre Tenguella à quitter définitivement la Mauritanie et retourner au Sénégal qui l’accueille à bras ouverts.
Administrateur de son état, il finit sa carrière dans la Chambre de Commerce de ce pays en qualité de secrétaire général à Kaolack puis à Tambacounda, décoré et fait Chevalier de l’Ordre National du Lion. Il quitte la Mauritanie, mais ne coupe pas avec le pays. Il a vécu avec beaucoup de peine les différents évènements qui l’ont secoué.
En 1986, quand arrivent au Sénégal les étudiants ayant fui la répression du régime de Ould Taya, il fut une des personnes ressources leur ayant apporté aide et accompagnement pour retrouver leur marque. En 1987, lorsque son cousin, ingénieur du génie, le Lieutenant Abdoul Ghoudouss Ba, en stage en Algérie, fut extradé en Mauritanie à la suite de la tentative de coup d’Etat, il envisagea de porter plainte.
Mais l’absence d’éléments probants sur le statut de ce dernier au moment de son arrestation en terre étrangère (la demande d’une protection internationale et surtout l’accord d’un pays tiers) dissuadera le juriste chevronné. La mort d’Abdoul Ghoudouss Ba en prison le 13 septembre 1988 à Oualata et la déportation de dizaines de milliers de Mauritaniens noirs au Sénégal en 1989 vont définitivement ranger Tenguella du côté de la résistance.
Mais qu’est-ce qui pouvait pousser cet homme, né et grandi dans le premier cercle de l’Etat mauritanien à emprunter cette piste, sinon le refus de l’injustice, de l’arbitraire et de la domination. Il pouvait s’accommoder de la réforme d’arabisation de 1966 et voir s’ouvrir pour lui, sa progéniture et bien plus largement, les facilités de tous ordres. Mais cela ne ressemble pas à l’homme.
Il préfèrera l’intérêt du grand nombre, quitte à en payer le prix. Son père Amadou Diadié Samba Diom Ba que Moktar Ould Daddah appelait Mawdo (ainé en Poular) était un grand pionnier de la construction de la Mauritanie, premier Noir à détenir un portefeuille de Ministre de la toute naissante République Islamique de Mauritanie, celui des Travaux Publics, des Transports, des Postes et des Télécommunications dans le 1er Conseil de Gouvernement de la Mauritanie autonome de 1957 à 1960.
De 1958 à 1961, cumulativement avec ses fonctions gouvernementales, Amadou Diadié Samba Diom Ba fut Président du Conseil d’Administration de la Société de Construction Immobilière (SOCIM), chargée de la Construction de Nouakchott nouvelle capitale de la République Islamique de Mauritanie.
C’est en cette qualité qu’il procéda en 1958 à la pose de la première pierre de la ville de Nouakchott en compagnie du Général De Gaulle, Président de la République Française et Maitre Moktar Ould Daddah, Président de la Mauritanie autonome.
De son père, ancien Chef de canton de Littama avec résidence à Maghama de 1929 à 1932 ; Administrateur dans plusieurs localités du pays entre 1920 et 1951 (Mbout, Kiffa, Saint-Louis, Aleg, Medredra, Sélibaby) et Conseiller à l’Assemblée territoriale de Mauritanie puis au Grand Conseil de l’Afrique Occidentale Française (AOF) en 1952 aux côtés de Senghor, Houphouët Boigny et Sékou Touré, il apprit l’estime de soi, le sens de l’honneur, du bien commun et de l’intérêt général.
Tout comme il découvrit cette Mauritanie plurielle dont il s’évertue sa vie durant à cultiver et à préserver la diversité. Cette Mauritanie d’antan, métissée, apaisée et reconnaissante à l’image de l’ancien Président de la République, Sidi Ould Cheikh Abdallah, qui témoignait il y’a quelques années à Nouakchott sa gratitude aux parents de Tenguella à l’occasion des funérailles de sa mère, Kardiatou Birane Wane (affectueusement surnommée Khadijettou Mint Almami par les Maures), eux qui ont accompagné ses premiers pas d’écolier.
Fier de son héritage comme rarement on pouvait l’être, parfait locuteur du Hassaniya, détenteur de précieux documents d’archives qu’il tient de son père et mis régulièrement à notre disposition, Tenguella qui était convaincu que le pays pouvait être à l’image de sa vie familiale (une veuve de la tribu des Oulad Bousba) ne verra pas poindre l’aube d’une Mauritanie unie dans sa diversité et égalitaire entre ses composantes.
Notre génération, celle qui l’a précédée surement, celles qui l’ont suivie certainement, garderont en mémoire le souvenir d’un homme qui fut un témoin engagé et toujours disponible. En digne héritière, Khar Tenguella, sa fille, poursuit le combat. Salut le Juste qui s’est toujours fait un point d’honneur à recevoir et aider ses compatriotes en visite au Sénégal, le combattant de la liberté, de l’égalité et de la justice.
Que ton âme repose en paix en terre sénégalaise, terre d’accueil et d’intégration. Amine.
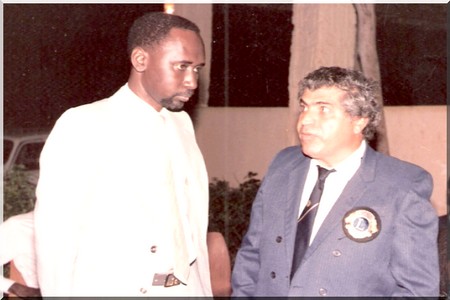
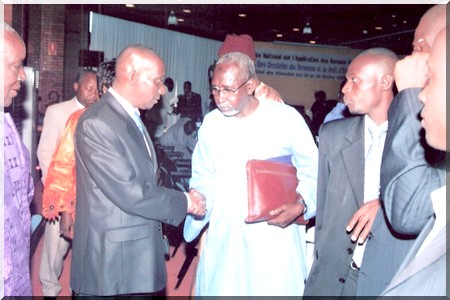
Ciré Ba et Boubacar Diagana – Paris, 27 février 2015
« Nous n’avons qu’une Mauritanie, ne l’abîmons pas ! »
 Vue de loin, la Mauritanie apparaît comme un pays tranquille, calme et stable. Or, voilà une image trompeuse qui égare bien des observateurs. C’est un pays complexe, secret, un volcan endormi, qui couve une crise interne découlant de la rupture d’un équilibre intercommunautaire.
Vue de loin, la Mauritanie apparaît comme un pays tranquille, calme et stable. Or, voilà une image trompeuse qui égare bien des observateurs. C’est un pays complexe, secret, un volcan endormi, qui couve une crise interne découlant de la rupture d’un équilibre intercommunautaire.
Depuis le discours de La Baule, la Mauritanie dispose de sa « démocratie ». Avec une constitution (sur mesure), des partis politiques qui foisonnent, une presse dite « indépendante » que je préfère appeler « presse privée » et de temps en temps un simulacre de compétition électorale. C’est bien là des attributs d’une parfaite démocratie.
Mais la Mauritanie recouvre une toute autre réalité ; dissimule une face cachée d’une démocratie raciale. Cette donne est tellement insidieuse que les plaintes et les réserves à l’endroit de cette « démocratie » mauritanienne ne sont souvent pas comprises.
Depuis l’indépendance, nos chefs politiques incapables de se départir de l’esprit partisan, tous issus du milieu maure, se sont attelés sans relâche à développer des politiques qui, loin de forger la Nation encore inexistante, ont conduit à des crises cycliques et répétées, conduisant à une déchirure profonde entre les deux communautés. Par ces politiques nocives développées au fil des années et des régimes que guidait un système inique, on mit en place un apartheid déguisé. Déguisé, car on le chercherait en vain dans les textes institutionnels. Or il existe partout.
Le racisme d’État est partout !
La discrimination raciale commença d’abord feutrée, subtile et insidieuse, pour un projet qui allait devenir obsessionnel: construire une Mauritanie exclusivement arabe !
Pour ce faire, des mécanismes furent mis en œuvre pour que l’Etat fut la « chose » des arabo-berbères. Progressivement, au rythme des résistances qu’opposaient les Négro-africains, ont fît de sorte que les arabo-berbères contrôlent la réalité du pouvoir politique et économique, la justice, l’éducation, l’armée. La diplomatie ne sera pas en reste car, à l’extérieur, il faut afficher l’image d’une Mauritanie arabe par la composition des délégations, le discours et les clichés culturels.
Évidemment pour masquer la nature discriminatoire des régimes, on va saupoudrer un peu par quelques « nègres de service », sans responsabilité aucune, personnalités aux genoux tremblants, figurines sans aucun pouvoir de décision!
Un des rouages essentiels de cette machine à discriminer fut l’usage qu’on fit de la langue arabe. Cette langue introduite très tôt dans le système éducatif, à des fins « d’indépendance nationale » selon le discours officiel. Ce fut une vaste supercherie qui visait en fait à cacher de sordides motivations. On lui fît jouer un rôle, non pas d’intégration, non pas d’épanouissement pour tous, mais d’instrument de sélection et de discrimination dans l’emploi et l’éducation pour éliminer les Négro-africains. Les enfants négro-africains commencèrent à échouer massivement.
Ce fut la période où il y eut un raz-de marée sans précédent de cadis, de magistrats, d’enseignants, de centaines de jeunes sautant à pieds joints dans le système, sans aucune formation,et dont le seul critère de recrutement fut le passage à l’école coranique. Comme si passer par cette école procurait automatiquement les compétences et les capacités requises aux métiers qu’ils exerçaient.
Ce fut un vrai gâchis au plan national, à la base de l’impasse et de la déchéance actuelle du système éducatif. Il a été instauré ainsi une politique de marginalisation massive des Négro-africains qui allait atteindre son apogée avec l’avènement du colonel Maaouiya Ould Taya.
Beaucoup d’observateurs ont présenté à tort les crises en Mauritanie sous une orientation inter-ethniques, comme si la communauté arabo-berbère et négro-africaine, se dressaient, par animosité, l’une contre l’autre. Ce ne fut jamais le cas. Ces crises étaient à l’image de ce qui se passait au Kwazulu-natal du temps de Botha. Elles étaient orchestrées par nos dirigeants à des fins politiques pour les exploiter judicieusement.
Ce n’est pas par hasard si la déportation de 120. 000 noirs mauritaniens au Sénégal et au Mali, ne suscita que peu d’émoi du côté des intellectuels et de la classe politique beydane, où l’on notait un silence assourdissant. Seuls quelques jeunes du Mouvement des Démocrates Indépendants (MDI), allaient faire exception.
J’ai toujours eu le sentiment que l’intellectuel ne pouvait rester sans rien faire, sans rien dire devant l’injustice.
Pourquoi un tel silence? Le Régime du colonel-président avait-il réussi à les convaincre? C’est là du reste une dimension, entre autres, qui rend difficile la recherche d’une solution au problème, au regard de l’ambiguïté qu’entretiennent certaines formations politiques sur notre question nationale. Celles-ci, quand elles ne nient pas purement et simplement l’existence du problème, le réduisent à une simple question linguistique, ou de violation des droits de l’homme. A les entendre il suffirait, pour tout régler, que les déportés reviennent. Le débat, en général, au niveau de l’opposition politique au lieu de se focaliser sur les vrais problèmes, tournent hélas autour des questions périphériques.
En tout état de cause, ces déportations planifiées avaient des motivations sordides. Il s’agissait de profiter du « conflit » avec le Sénégal pour tenter de « dénégrifier » le pays, car le taux d’accroissement important des Négro-africains est devenu une hantise, au point que tous les résultats des recensements démographiques (par ethnie) sont tenus secrets, et ce depuis 1960 !
Il s’agissait aussi de saisir cette occasion pour faire passer enfin une réforme foncière qui rencontrait une forte résistance en milieu Négro-africain, pour servir des intérêts inavoués. La déportation justement, permit de redistribuer les terres de ces réfugiés en exil forcé au Sénégal, comme s’ils ne devaient plus jamais revenir.
Il s’agissait enfin de frapper les esprits en sévissant durement et partout pour intimider afin de décourager à jamais toute velléité de résistance, en décapitant la seule force politique organisée à l’époque que sont les FLAM, de manière à neutraliser l’avant garde éclairée de la contestation du projet hégémonique.
Dans le feu des événements, allait surgir une quatrième raison: récupérer le bétail peulh (150. 000 bovins) pour compenser les pertes matérielles subies par les maures rapatriés du Sénégal. Pour se venger du Sénégal voisin, les autorités mauritaniennes allaient se rabattre sans remords, sur ses propres citoyens qu’elles spolièrent et dépossédèrent pour les chasser ensuite comme des « vulgaires étrangers ».
Et dire que l’Afrique se tait devant ces actes barbares! Et qu’à côté, on garde un silence, à la limite de la complicité.
Ainsi donc, au fil des années et des régimes guidés par un même projet, la discrimination raciale allait s’accentuer, pour s’afficher violemment dans les années 80. Si avec les premier régime, un peu plus futé, elle fut feutrée, le règne du colonel Taya qui, lui, ne s’embrassera pas de scrupules, les Négro-africains passeront de l’état de marginalisation à l’exclusion totale ouvertement déclarée, dans laquelle, il faut replacer les déportations évoquées plus haut. Le colonel Taya allait, le premier, donner le cadre juridique de notre élimination par une constitution qui allait imposer désormais la langue arabe comme seule langue officielle.
Les plans d’ajustements structurels du FMI arrivant à point nommé, servirent pour vider l’administration des Négro-africains,surtout. Résolu, par une répression physique et mentale féroce, sans tergiverser comme ses prédécesseurs,Taya allait, à marche forcée, consolider le système et afficher l’option désormais déclarée d’une Mauritanie exclusivement arabe. « La Mauritanie n’est pas en voie d’arabisation c’est un pays Arabe » déclara t-il à Jeune Afrique en Janvier 1990.
En Mauritanie, on est en face d’une minorité qui, pour pérenniser son pouvoir abuse de l’État et use d’un soubassement idéologique pour assimiler et asservir les autres composantes culturelles, une minorité qui confisque le pouvoir depuis plus de 50 ans, qui ne veut ni en partir, ni le partager. Voilà la réalité de notre « démocratie ».
Notre « démocratie » arrive donc et se plaque sur cette triste réalité qu’elle recouvre, intacte, sans rien changer, se muant ainsi en une « Démocratie raciale », à l’image de ce qu’a connu l’Afrique du sud.
Nous ne nous sentons pas concernés par une pseudo-démocratie qui nous exclut, nous avons cessé de croire en notre « État », qui a fait de nous des spectateurs passifs du jeu de compétitions électorales réservées aux citoyens à part entière. Nous sommes, nous Négro-africains, au stade où nous luttons pour notre survie, pour notre reconnaissance en tant que citoyens, en tant qu’hommes simplement, dans un milieu hostile où l’homme voue l’homme au racisme et à l’esclavage.
Pour sortir de cette impasse, il faut une attitude, un climat et des conditions. Une attitude courageuse d’ouverture sincère et de reconnaissance du problème. Un climat de décrispation sociale grâce à un train de mesures positives à l’endroit de tous ceux qui, victimes et blessés dans leur chair, ont subi des préjudices matériels et moraux. La sanction des crimes commis pour rendre leur dignité aux victimes, à leurs familles et aux orphelins.
Il faut instaurer un dialogue, car ce formidable potentiel de révolte enfoui commence à gronder. Il serait erroné de croire que toutes ces années de calme plat pourraient exclure toute éventualité de soulèvement populaire.
Après une concertation nationale proposée dès 1986 par notre “Manifeste du Négro-mauritanien opprimé”, et dont les conclusions pourraient éventuellement être soumises au peuple, on aborderait enfin la phase d’une véritable démocratisation.
L’urgence de l’essentiel nous commande d’agir car voici ma conviction profonde : nous n’avons qu’une Mauritanie, ne l’abîmons pas !
La lutte continue!
Kaaw Touré
Porte-parole des Forces Progressistes du Changement (FPC- ex-FLAM).




