Category Archives: Uncategorized
Les plus grands changements législatifs aux Émirats arabes unis
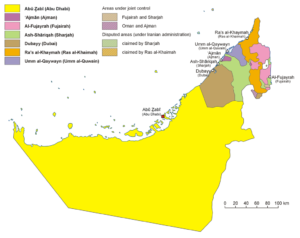
Les plus grands changements législatifs de l’histoire de l’État.” C’est ainsi que les Émirats arabes unis ont décrit les réformes qu’ils ont apportées à plus de 40 lois, samedi, dans un mouvement qui a suscité une certaine controverse, notamment en termes de lois relatives au statut personnel et à l’enregistrement. des enfants en dehors du cadre de la relation conjugale.
Les Émirats arabes unis ont dévoilé de nouvelles lois sur les crimes et les peines qui entreront en vigueur en janvier prochain et visent à “assurer une meilleure protection des femmes, des employés locaux et de la sécurité publique”, selon le texte du communiqué publié par les autorités.
L’annonce ajoute une explication qui n’était pas disponible auparavant pour le statut des relations sexuelles avant le mariage et les enfants comme fruit de ces relations, précisant que les parents n’ont pas besoin de se marier, ce qui a suscité une polémique sur le sort de l’enregistrement des enfants hors mariage. .
Le texte stipule que “ceux qui ont un enfant issu d’une relation se marient, ou l’un d’eux lui reconnaît la paternité de l’enfant et extrait des pièces d’identité et des documents de voyage conformément aux lois en vigueur dans le pays où l’un d’eux est un citoyen.”
Les amendements prévoient une peine de deux ans de prison si les parents nient la filiation de l’enfant et ne lui fournissent pas de soins.
L’avocat émirati Habib Al Mulla explique, dans une interview accordée au site Al-Hurra, que “le texte du nouvel article est venu compléter le récent amendement, et a supprimé la peine pour grossesse sans mariage, qui était un crime dans le passé, et a poussé beaucoup à pratiquer des avortements à l’étranger.”
Et en avril dernier, les Émirats arabes unis ont annoncé l’abolition de la décision de punir les femmes si elles tombaient enceintes hors mariage.
Selon un rapport précédent du journal britannique “The Times”, “les femmes qui sont tombées enceintes hors mariage risquaient d’être expulsées ou emprisonnées, y compris les bonnes qui ont été violées par leurs supérieurs et forcées d’accoucher en secret”.
Al-Mulla, qui a participé à la rédaction de nombreuses lois modernes en vigueur aux Émirats arabes unis, a ajouté que “si une grossesse survient et que les parents refusent de reconnaître le nouveau-né, leur peine sera l’emprisonnement à moins que l’un d’eux n’initie l’enregistrement, et la peine tombera inévitablement.”
Il a souligné que “lorsque la peine tombe, il appartient aux deux parents ou à l’un d’eux d’enregistrer séparément le nouveau-né”
DEVOIR DE MÉMOIRE ET REFUS DE L’OUBLI.
FLAM : DES RENCONTRES ET DES NOMS
Par Marion Fresia- Professeure à la Faculté des lettres et sciences humaines- Institut d’ethnologie- Neuchâtel- Suisse.
Ma première rencontre avec les FLAM remonte à 1998 : j’avais alors à peine 19 ans, et je travaillais comme stagiaire chez Sud Quotidien à Dakar. Un matin, mon chef Demba Ndiaye me présente un certain Kaaw Touré, « un vieil ami » me dit-il, et m’annonce que nous partirons ensemble dans la vallée du fleuve Sénégal faire un reportage sur la situation des réfugiés mauritaniens en vue de la couverture de ce qui était alors le 9ème anniversaire des événements de 1989. Demba m’avait parlé du combat politique de son ami et de ses compatriotes, de « grands militants », mais c’est un homme humble et réservé, dont je fis la connaissance ce matin là, un homme empli de « keersa ».
Quelques semaines plus tard, Kaaw, moi et une autre collègue journaliste embarquèrent dans un minibus blanc à la gare routière de Dakar. Direction : Ndioum. Le voyage dura une journée entière et je me rappelle encore les paysages qui défilaient sous nos yeux : des forêts de baobab jusqu’à Saint-Louis, auxquelles succédèrent des étendues toujours plus ensablées et désolées à partir de Richard Toll. J’appréhendais un peu ce séjour dans des « camps de réfugiés » : l’image de grands rassemblements de populations, entassées sous des tentes, souffrantes et dépendantes de l’assistance humanitaire, dominait mon esprit. Qu’allais-je découvrir et comment pourrais-je demander à ces personnes de livrer leur histoire à une simple et jeune étrangère de passage qui n’aurait rien à leur offrir en retour ?
Arrivée à Ndioum, mes inquiétudes s’estompèrent : après bientôt 10 ans d’exil, les réfugiés n’étaient bien entendu pas restés les « bras croisés », mais avaient su mobiliser leurs forces et leurs ressources pour reconstruire, progressivement, un semblant de vie normale. Devant moi, se tenait un gros village, d’environ 1500 habitants, souffrant d’une évidente stigmatisation spatiale et de conditions de vie encore précaires, mais grouillant de monde et d’activités, et semblant malgré tout disposer d’une certaine organisation sociale et d’un minimum d’infrastructures. Kaaw nous amena chez le « Président du camp », un certain Amadou Boubou Niang, dont j’allais comprendre seulement des années plus tard le rôle clé qu’il avait joué, avec les autres membres de son « bureau », dans l’aménagement du camp, de son école et de son dispensaire en particulier, et dans la naissance d’une forme de vie collective. Pour l’heure, je découvrais un homme incroyablement digne, calme et posé, qui non seulement nous accueillit chaleureusement dans sa modeste maison en banco, mais aussi nous livra son histoire sans hésitation et sans rien exiger en retour si ce n’est de « lutter contre l’oubli ». Il nous permit également de recueillir les témoignages d’une dizaine d’autres personnes, des récits très durs qui racontaient inlassablement la même chose : l’arabisation progressive de la société mauritanienne, la création des FLAM, la publication du Manifeste, les arrestations de 1986 et 1987, l’emprisonnement et les tortures (je me rappelle encore de certaines descriptions effroyables sur la technique du jaguar.), puis le déchaînement de violences intercommunautaires en 1989, les expulsions massives d’éleveurs peuls et d’agriculteurs, les arrestations ciblées de fonctionnaires civils et militaires et finalement les exécutions extrajudiciaires des années 1990-91. Des histoires de vie marquées par la dépossession, la violence et l’exil, mais aussi par la peur de l’oubli et le sentiment d’abandon depuis l’annonce, alors récente, du retrait de l’assistance humanitaire.
Ces vécus douloureux allaient rester en moi pendant longtemps : comment ne pas y être sensible et ne pas repartir en se demandant « pourquoi » ? Pourquoi certains naissent à Nice, en France, comme moi et connaissent une vie des plus paisibles, et d’autres voient le jour à Beylane, Goural ou Bounguel Thiellé et connaissent l’arrachement, la perte et la rupture. Je décidais alors de consacrer mon mémoire de sciences politiques sur les causes profondes de ces événements de 1989 afin de mieux comprendre comment de telles violences avaient pu éclater en Mauritanie. Comment des populations qui avaient tissé d’étroites relations politiques mais aussi matrimoniales au cours des siècles, faites de jeu d’alliances et d’oppositions complexes, avaient pu en venir à se mépriser et à produire autant de stéréotypes dégradants les unes envers les autres ? Le processus de racialisation des rapports sociaux en Mauritanie était sans doute – et reste toujours – la question qui me laissa la plus perplexe. Après avoir mené quelques enquêtes à Nouakchott, où j’avais eu le privilège de rencontrer de grands hommes politiques mauritaniens des différentes composantes de l’opposition et de recueillir différentes perspectives sur les violences de 1989, j’ai ainsi rédigé un premier travail sur cette problématique, qui restait celui d’une jeune étudiante française, avec toute la subjectivité et l’ignorance que cela implique. Je repartis à Dakar en 1999 pour présenter le résultat de mes analyses à mon ami Kaaw Touré, et je fis à cette occasion la rencontre avec une autre grande figure des FLAM, le Président Samba Thiam. Je me souviens encore de cette grande pièce dans laquelle il se tenait, avec tant de droiture, de présence et de charisme, mais avec pour seul décor un matelas mousse posé sur une natte, un drapeau des FLAM et des menottes suspendues au mur. Un décor sobre mais tellement évocateur, et une figure si forte qu’elle restera à jamais gravée dans ma mémoire.
Cette première rencontre avec l’histoire des réfugiés mauritaniens me marqua profondément. Après de longues hésitations sur mes choix professionnels, différents hasards de la vie m’ont amenée à m’inscrire en thèse de doctorat en anthropologie sociale en 2001. J’avais découverte cette discipline un an plus tôt et son approche m’avait séduite : comprendre le monde et comment il se transforme à partir d’une échelle d’analyse locale, se donner la peine de restituer la complexité des processus sociaux et d’interroger des notions qui nous semblent a priori aller de soi, ou encore analyser comment certains événements – comme par exemple un déplacement forcé de population ou une intervention humanitaire – peuvent contribuer à susciter du changement social, identitaire ou politique. J’entrepris alors de développer un projet de recherche sur les « Mauritaniens réfugiés au Sénégal » et de m’y consacrer cette fois sérieusement pour une durée de 4 ans. Mes questionnements n’étaient toutefois plus les mêmes qu’auparavant : plutôt que de m’interroger sur les causes des événements de 1989, j’espérais cette fois-ci comprendre comment l’exil, la vie dans les camps, le contact avec le HCR et l’attribution du « statut de réfugié » avaient pu contribuer à changer la vie des réfugiés. Je souhaitais restituer en quelque sorte le vécu de l’exil, comprendre comme des gens font face à une rupture de vie, comment ils reconstruisent des repères identitaires et se réapproprient leur stigmate de réfugié, quels moyens ils mettent en ?uvre pour mener leur combat politique, ou encore comment ils organisent une nouvelle vie collective dans des « camps » et s’évertuent à reconstituer un capital économique ?
Ces questionnements m’ont amenée vers une aventure autrement plus longue que la précédente. En janvier 2001, je suis ainsi retournée à Ndioum. Cette fois-ci, j’étais seule car mon ami Kaaw avait entre temps obtenu l’asile en Suède tandis qu’Amadou Boubou était parti en France et Samba Thiam aux Etats-Unis, leurs activités politiques étant devenues de plus en plus gênantes pour le Sénégal. J’avais en poche deux noms que Kaaw m’avait indiqués : Hamidou Ndiaye et Abou Sow mais à mon arrivée, l’un comme l’autre avaient voyagé. Le camp (baas) était d’ailleurs bien calme en comparaison avec mon premier séjour et je compris que tout un quartier s’était quasiment vidé de ses habitants : celui des « fonctionnaires ». Je fus alors abordée par un jeune qui revenait de l’école : un certain Papis, qui m’amena chez son père Sidi Ndiaye, l’une des rares personnes parlant le français. Celui-ci me proposa de m’héberger et devînt mon « njaatigui ». Quelques temps plus tard, je réalisais que Sidi n’était pas un militant des FLAM et que le hasard m’avait amené à découvrir l’implantation d’une autre formation politique dans le camp . Cette situation un peu délicate ne m’empêcha pas d’être bien accueillie par l’ensemble des habitants du site quelle que soit leur affiliation politique. Je fus baptisée « Mariam Ba tokossel », et chaque année entre 2001 et 2004, je me rendais et vivais à « baas » pendant plusieurs mois. Un grand nombre de personnes sont devenues des amis, chez qui j’avais plaisir à passer des soirées pour déguster du lacciri e hakko : je naviguais entre différents quartiers, SirenaaBe, WodaaBe, UururBe, DiawBe ou encore YirlaaBe, pour rendre visite à Dahirou Diallo, Hamidou Ba, Houley Alphaa, Oumar Magnirou, ou encore Mika Diallo ou Djiby Sy pour n’en citer que quelques uns. Outre Sidi Ndiaye, Oumous Sow et leurs enfants – ma famille d’adoption – j’avais également un protecteur : Hamidou Ndiaye qui me conseillait tel un père et me préparait toujours de délicieux poissons, et une grand-mère : Aayo, qui m’offrait à chaque départ un joli pagne. Ces séjours prolongés m’ont permis de m’immerger dans le quotidien de la vie du camp, et de mieux comprendre les souffrances de leurs habitants, leurs questionnements, mais aussi leur organisation sociale et politique, leurs espoirs et leurs stratégies pour aller de l’avant. J’ai été particulièrement admirative devant l’activisme de femmes comme Rougui Djibi Sow qui ont mis sur pied différentes dudal pulaar dans le site pour préserver la langue et les racines pulaar, mais aussi par la mobilité des jeunes qui quittèrent très tôt le camp pour « aller chercher de quoi manger ».
Mes recherches se sont aussi étendues à deux autres sites et groupes de réfugiés. Chaque année, je partais ainsi de baas pour me rendre chez les agriculteurs d’Ari Founda Beylane dans le waalo, puis chez les éleveurs GamanaaBe de Bouyli Jaabal, dans le proche jeeri. J’y avais aussi des njaatigui et j’y ai fait d’autres rencontres inoubliables, avec des militants politiques mais aussi avec des mawBe, comme Modi Diaw ou Dembourou Fall qui m’ont raconté l’histoire fascinante de la fondation de leur village, Beylane en Mauritanie. Enfin, je dois mentionner encore quelques rencontres importantes à Saint-Louis, où j’ai découvert l’impressionnante reconversion de certains éleveurs dans le commerce de vente au détail, ou encore de longues et fascinantes conversations à Ndioum ville avec des réfugiés originaires de Diaw et Ranéré tels que Sidi Niari ou Sada Aaw. J’ai ici une pensée pour ces-derniers dans le contexte actuel du rapatriement, leur village et leurs champs étant jusqu’à ce jour presque entièrement occupés par d’autres. De retour en France en 2004, pour la rédaction de ma thèse, j’ai eu le grand honneur de participer à différentes manifestations organisées par la diaspora en France, et notamment par l’AVOMM où j’ai fait la connaissance d’Ousmane et Abou Sarr et où j’ai réalisé à quel point les associations de réfugiés implantées en France étaient nombreuses et actives. Et comment oublier enfin la délégation de réfugiés venue assister à ma soutenance de thèse le 26 mars 2005 jusqu’à Marseille, avec à sa tête Ibrahima Sall – dont les écrits m’ont tant inspiré – et sa formidable et infatigable femme Habsa ! Dotés de leurs grands boubous, ils ont su apporter à cet événement ce qu’il manquait : la présence des principaux concernés .
C’est donc toutes ces rencontres et tous ces noms – et la liste est bien-entendu loin d’être complète ici – qui m’ont permis de resituer, à partir d’un certain point de vue, la complexité de l’histoire des réfugiés mauritaniens au Sénégal, de leur vécu et des nombreux et parfois douloureux changements qu’ils ont connu au cours de leur vie depuis 1989 et pour certains depuis 1986.. Ce sont ces rencontres aussi qui ont nourri ma propre vie d’une diversité de questionnements, de remises en question et de découvertes de l’Autre au cours de ces dix dernières années, et qui font donc entièrement partie de moi et de ma personnalité aujourd’hui. Je ne peux ainsi que leur rendre hommage en ce jour si particulier pour leur courage, leur combat, leurs idéaux mais aussi pour les valeurs humaines essentielles qu’elles ont su m’offrir, telles que l’amitié, la confiance et la générosité. Bien que je n’aie pas eu l’occasion de les rencontrer, je terminerai enfin en soulignant l’importance de ne pas oublier la situation des Mauritaniens réfugiés au Mali.LLC, la lutte continue! comme aime signer mon ami Kaaw.Marion Fresia.
NB: Marion Fresia, anthropologue, est auteure de « Les Mauritaniens réfugiés au Sénégal. Une anthropologie critique de l’asile et de l’aide humanitaire », L’Harmattan, 2009.
Neuchâtel- Suisse
AJD-MR : clarification.

Au moment où s’ouvrent les journées de concertation autour de l’éducation nationale auxquelles notre parti a été convié, il nous parait utile de décliner officiellement notre position sur l’opportunité de ces journées. Cette initiative nous questionne en ce qu’elle surgit au moment où est évoquée la possibilité d’un dialogue national. Nous ne comprenons pas la raison d’une telle précipitation à discuter de manière isolée de l’éducation et de la question des langues nationales. Ces problèmes n’ont-ils pas leur place dans un dialogue national serein entre toutes les forces vives du pays, aux côtés des autres thèmes nationaux ?
L’importance que requièrent pour nous la question de l’éducation et celle de l’officialisation de nos langues nationales n’est un secret pour personne. Mais nous n’entendons pas pour autant contribuer à des concertations mal préparées, dont on commence déjà à percevoir qu’elles s’orientent vers une course contre la montre, consistant à faire valider une orientation idéologique qui est tout sauf celle que nous pensons utile pour construire une éducation nationale de qualité, respectueuse à la fois de notre diversité et de notre unité.
Rien pour nous ne peut redonner à notre éducation nationale ses lettres de noblesse, si celle-ci n’est pas replacée dans une vision générale et prospective de notre nation, et du citoyen de demain que nous souhaitons voir émerger. Dans ces conditions, imaginer des journées de concertations autour de l’éducation nationale, isolées du problème de fond de la construction nationale, nous parait être une démarche dont l’arrière-plan demeure opaque.
L’Ajd-mr est profondément attachée à la reconstruction de notre éducation nationale. Elle est profondément attachée à l’enseignement de nos langues nationales Pulaar, Soninke et Wolof et à leur officialisation. Elle est enfin profondément attachées à garder au français sa place au sein de cet enseignement, comme du reste au sein de notre administration ; car le contraire a pour conséquence de discriminer nos compatriotes formés dans cette langue, et notamment ceux dont la langue maternelle n’est pas l’arabe : les négro-africains.
Mais nous estimons que ces thèmes sont suffisamment structurels de notre question nationale pour ne pas être débattus dans un dialogue national. Ainsi, si nous estimons utile la tenue d’un véritable dialogue entre toutes les forces vives de notre pays, nous situons l’opportunité de ce dialogue autour de la seule question de fond qui traverse notre nation et menace sa stabilité et son unité : le problème de la cohabitation mis à mal par la discrimination qui frappe les communautés noires du pays. L’Ajd-mr et ses partenaires ne participeront à un tel dialogue que s’il prend en charge ces questions de fond.
Le Bureau Politique
OMVS : Les étapes d’une expertise exemplaire : 1 – 1972/2000 : l’ambition à l’épreuve des réalités

L’Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) fêtera en mars 2022 le cinquantième anniversaire de sa création. L’occasion pour Le Calame de revisiter le parcours de cette organisation symbole d’une intégration sous-régionale réussie.
Le mois de décembre 2013 aura marqué l’histoire sous-régionale, avec l’inauguration du barrage hydroélectrique de Félou et la pose de la première pierre du chantier du barrage de Gouina, deux nouveaux sites d’exploitation,par l’OMVS, du fleuve Sénégal, en présence des quatre chefs d’Etat (Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal) gestionnaires associés de son bassin. Source de toute vie, l’eau construit, pour le pire et le meilleur, la société internationale…

Elle en est, de fait, la sève. C’est au milieu de ses cours qu’elle fait, ordinairement, partage, et, de l’équité de celui-ci, découlent les relations entre les nations. De sa bonne gestion, la santé et l’harmonie sociale, avant toute autre considération socio-économique. En tissant, depuis plus de cinquante ans, un réseau d’obligations et de services réciproques, du plus local au plus global, en faisant preuve d’autocritique et d’adaptation à l’imprévu, l’Organisation de Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a développé une vraie communauté de vie, fondement indispensable de toute intégration régionale durable. Mais cela n’a pas été sans mal – le potentiel de l’eau submerge toujours nos plans – et bien des efforts restent à accomplir.
Dès les premiers pas, la difficulté s’est imposée en maîtresse. La fondation, en mars 1972, de l’OMVS, par trois des quatre pays riverains du fleuve – Mali, Mauritanie et Sénégal,la Guinée de Sékou Touré ayant, à l’époque, décidé de suivre des voies plus retranchées (1) – s’est, en effet, effectuée en pleine crise climatique. Quatre années, déjà, que le Sahel était en cycle de profonde sécheresse et toute la vallée était dévastée. Dans ce contexte où le repli sur soi et la compétition éventuellement belliqueuse pour la survie constituaient des risques majeurs, ces Etats choisissaient la voie de la solidarité.
Rendons, ici, justice à l’Histoire et au colonisateur. Il faut avoir l’honnêteté de reconnaître ce que celui-ci aura déblayé, de cette voie, dans la gestion du fleuve Sénégal. Certes, ses études de mise en valeurde la vallée eurent, longtemps, de strictes visées de domination, ainsi qu’en témoignent le « Plan de colonisation agricole » de 1802 ou les « Instructions nautiques entre Saint-Louis et Kayes » de 1908. Mais le souci, au demeurant plus technique que politique, de cohérence et de cohésion fait apparaître, au cours de la première moitié du 20ème siècle, des vues beaucoup plus amples : Projet d’Union Hydroélectrique Africaine (1927) ; Mission d’Etudes et d’Aménagement du Fleuve (1934) ; Mission d’Aménagement du fleuveSénégal (1938)…
Après la seconde Guerre mondiale, cette MAS évolue dans le mouvement des indépendances. Organisme commun au service des pays riverains en 1959, elle débouche sur divers accords internationaux : Convention relative à l’aménagement général du bassin (1963), instaurant un Comité Inter-Etats (CIE) chargé de promouvoir et coordonner toutes les études s’y rapportant ; Convention sur le Statut du fleuve (1964) ; Statut général de l’Organisation des Etats Riverains du fleuve Sénégal (OERS, 1968), amendé, deux ans plus tard, à Conakry, par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement.
D’innovantes mais solides bases juridiques et institutionnelles
Les quatre conventions qui vont présider, deux années plus tard, à la fondation de l’OMVS, dépassent tous les cadres existants d’exploitation de bassin fluvial, donnant, au projet, une réelle et très innovante dimension d’intégration régionale, grâce à la prééminence accordée au processus coopératif et à la mutualisation des décisions et des efforts. L’internalisation du fleuve (2), la propriété commune de grands ouvrages (barrages et centrales hydro-électriques) et le principe d’accord unanime (3), pour toute nouveauté affectant le projet global, sont les trois points les plus saillants de cette approche. Le souci d’équité est partout visible. Si la répartition des coûts voit le Mali s’investir à hauteur de 35,3%, la Mauritanie 22,6 et le Sénégal 42,1, celle des bénéfices escomptés en suit la logique : Mali, 52% de la production hydro-électrique, irrigation de 15 000 hectares de terre et désenclavement assuré, grâce à la navigabilité du fleuve ; Mauritanie, 15% de la production hydro-électrique et irrigation de 120 000 hectares ; Sénégal, 33% de la production hydro-électrique et irrigation de 240 000 hectares.La définition de quatre volets d’action – agriculture, énergie,environnement et navigation– permet d’entrevoir la durabilité du développement proposé.
Dotée d’une personnalité juridique indépendante et de ressources humaines conséquentes, l’organisation reste cependant solidement cadrée par les Etats-membres, engagés, sans équivoque, dans son fonctionnement. L’OMVS est, ainsi, chapeautée parla Conférence annuelle des chefs d’Etat et de gouvernement qui définit les grandes orientations et prend les décisions économiques générales, le tout à l’unanimité de ses membres. La conception et le contrôle des actions relèvent du Conseil semestriel des ministres, tandis qu’un Haut-commissariat (4) en applique les décisions et rend compte des résultats.
1972-1994 : méfaits de la pensée fragmentée
Si l’énoncé des missions de l’OMVS voit poindre une attention aux réalités écolo-sociales localisées – préserver l’équilibre des écosystèmes du bassin, réaliser l’autosuffisance alimentaire des populations de la vallée, sécuriser et améliorer leurs revenus, notamment – l’époque est encore très largement dominée par les priorités macro-économiques et cette pensée mécaniste qui s’acharne à mesurer le progrès agricole en tonnes de production à l’hectare. On ne perçoit, en aucune manière, sinon, de façon trop parcellaire, les potentiels conflits d’intérêts entre les diverses missions assignées à l’organisation interétatique. On ne suit, pas plus, les retombéesen cascadedes barrages monumentaux (Diama, 1986 ; Manantali, 1987) sur les écosystèmes et, par voie de conséquence, sur les établissements humains qui en sont parties étroitement prenantes, en dépit d’une disposition statutaire stipulant que « les projets devront faire apparaître leurs incidences sur […] l’état sanitaire des eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune et de sa flore […] ». A un niveau de décision plus globale – les grandes institutions internationales – on ne tient aucun compte des lourdes perturbations causées, par le Programme d’Ajustement Structurel (PAS) – libéralisation des importations de céréales et désengagement de l’Etat de son soutien aux cultures irriguées, par exemple – sur un projet de si grande ampleur. Enfin, réalité d’un Sahel entré tardivement dans la modernité, de grosses lacunes subsistent, dans l’appréhension pratique et la conduite, au quotidien, des logiques techniques.
Les résultats d’une telle fragmentation des actions et de la pensée commencent à s’enchaîner dès le début des années 90. Salinisation accélérée du delta, en aval du barrage de Diama ; invasion, en amont, des plantes aquatiques, obstruant canaux d’irrigation et stations de pompage,gênant la circulation des pirogues et détruisant de nombreuses frayères où s’assurait la reproduction des poissons; surdéveloppement de l’avifaune, notamment granivore qui pille jusqu’à la moitié des récoltes ;pullulation des insectes, notamment l’anophèle, vecteur du paludisme, qui connaît un spectaculaire accroissement ; et des mollusques, hôtes privilégiés du schistosome, vecteur quant à lui, de la bilharziose, tandis que diverses autres maladies hydriques – choléra, diarrhées, onchocercose et filariose lymphatique, chez les humains ; fasciolose ouparamphistomose, au sein du bétail – prennent un caractère endémique, affectant dangereusement le quotidien des populations riveraines.
Le changement brutal de la valeur et du régime du foncier, multipliant les conflits spéculatifs, entre les populations riveraines (5) ; la fin, tout aussi brutale, des cycles naturels de crue et décrue, peu ou prou compensée par d’inadéquats lâchers de barrage, perturbant gravement l’agriculture traditionnelle ; le coût, faramineux, de l’aménagement des périmètres rizicoles où l’emploi, massif, d’engrais et de pesticides a pollué les eaux ; le retard, considérable, dans la mise en valeurdes terres irriguées, ou leur abandon pur et simple, faute de financement ;débouchent, au tournant du 21ème siècle, sur un constat accablant, ainsi résumé par la Banque Africaine de Développement (BAD) : « La riche vallée du Sénégal est devenue la région la plus pauvre du pays ». Faillite des volets agricole et environnemental, inactivité des volets énergie et navigation : l’OMVS est submergée par la complexité des problèmes, ne parvient pas à mettre en œuvre de bonnes solutions et, exsangue, se révèle incapable de rembourser ses dettes.
Tournant du siècle et début du redressement
Les bailleurs rechignent, alors, à poursuivre leur appui et ce n’est qu’au prix de longues et fastidieuses négociations que les trois Etats-membres de l’OMVS parviennent à arracher le financement de la première tranche du volet énergie. Deux clauses de l’accord vont se révéler particulièrement déterminantes : d’une part, la fondation de deux sociétés chargées de la gestion financière des ouvrages, y compris le remboursement des dettes contractées pour leur réalisation, et le recours, d’autre part, à une entreprise privée, pour leur gestion technique. Les Société de Gestion de l’Energie de Manantali (SOGEM) et Société de Gestion et d’Exploitation de Diama (SOGED) voient ainsi le jour en 1997, tandis que l’entreprise sud-africaine ESKOM se voit attribuer, sur appel d’offres, la responsabilité technique des ouvrages hydro-électriques.
Mais c’est surtout la capacité d’adaptation de l’OMVS qui va, ici, se mettre en évidence, avec la mise en œuvre, en 1999, d’un Programme d’Atténuation et de Suivi des Impacts sur l’Environnement (PASIE), bientôt officialisé par une Déclaration de Nouakchott. Financé par la BAD, la Banque Mondiale (BM), l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI), le PASIE entreprend une réforme profonde de l’organisation, en mettant en place plusieurs outils de suivi et de concertation, en prise directe sur la réalité du terrain, comme l’Observatoire de l’Environnement, la Commission Permanente des Eaux (CPE), les Comités Nationaux de Coordination (CNC) et les Comités Locaux de Coordination (CLC). La leçon de la première étape de l’aménagement de la vallée semble avoir été tirée : aucun projet d’envergure ne peut se développer harmonieusement et durablement sans une attention constante à son évolution, en communication étroite et permanente entre le local et le global.
(A suivre)
Ahmed OuldCheikh
NOTES
- Suite au différend entre les présidents sénégalais et guinéen, lors de la crise de Guinée-Bissau (1970).
- Une solution, ingénieuse mais incomplète, à l’aberration qui avait consisté à situer la frontière sénégalo-mauritanienne sur la rive droite du fleuve.
- Article 4 de la convention Statut : « aucun projet susceptible de modifier, d’une manière sensible, les caractéristiques du régime du fleuve, ses conditions de navigabilité, d’exploitation agricole ou industrielle, l’état sanitaire des eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune ou de sa flore, son plan d’eau, ne peut être exécuté sans avoir été, au préalable, approuvé par les Etats contractants ». C’est en respect de cette clause que le Sénégal renoncera, en 2000, à son projet de revitalisation des vallées fossiles, auquel la Mauritanie s’opposait résolument.
- Huit hauts-commissaires se sont succédé à sa tête : Mamadou Amadou Aw (1975-1979), MoctarOuldHaïba (1979-1987), Mohamed Ag Hamani (1987-1992), Baba Ould Sidi Abdallah (1992-1998), CheikhnaSeydiHamadi Diawara (1998-2002), Mohamed Salem Merzoug (2002-2013) et KabinéKomara (2013-2017), Hamed Diagne Semega (2017-en cours). Le sixième, Mohamed Salem Merzoug, s’y est à ce point distingué, qu’il y aura été effectué, à l’unanimité des chefs d’Etat, près de trois mandats (quatre années chacun) successifs. Il restera, dans les mémoires, comme l’exemplaire artisan du redressement de l’OMVS, exécutant rigoureux et fidèle des réformes pensées sous ses deux prédécesseurs.
- A cet égard, la réforme foncière de 1983, en Mauritanie – deux ans après la pose de la première pierre du barrage de Diama, trois ans avant sa mise en service : un timing difficilement attribuable au fortuit – abusant des déshérences conjecturelles consécutives à la sécheresse des années 70, aura été le principal ferment des évènements de 89-92.
le calame
Urgent/CNRD-Guinée*

Salut, voici la copie du projet de la charte proposée pour la prochaine transition militaire en Guinée qui vient juste de nous parvenir
Bonne lecture à toutes et tous :
*Projet de charte de la Transition militaire*
Nous, peuple guinéen libre et souverain. Résolu à garder intact les acquis de la République et de l’indépendance de la Guinée proclamés le 2 octobre 1958 ;*-* Résolu à bâtir un État de droit garantissant à toutes les filles et à tous les fils de Guinée, l’exercice des droits individuels et collectifs, l’égalité, la liberté, l’équité, le bien-être, la transparence et la bonne gouvernance ;
*-* Résolu à construire une nation pacifiée, réconciliée et prospère, dans une société de concordance, à travers d’une démocratie consensuelle et une gouvernance de consensus ;
*-* Profondément attaché aux valeurs ancestrales de solidarité, de paix, de fraternité, d’entente nationale et de justice sociale ;
*-* Soucieux de maintenir la cohésion nationale et de promouvoir développement et l’émergence de la République de Guinée ;
*-* Considérant le caractère légitime et populaire de la prise d’armes historique du 5 septembre 2021, ayant conduit au dépôt du Président Alpha Condé ;
*-* Considérant le lourd tribut payé par les dignes fils et filles de Guinée, à travers des innombrables pertes en vies humaines, au cours d’une décennie de violence, d’injustice et d’arbitraire ;
*-* Considérant la légitimité de la lutte non-violente et du combat des forces de défense et de sécurité pour la restitution du pouvoir au peuple et la fin du machiavélisme constitutionnel ;
*-* Comprenant l’inquiétude de la communauté africaine et internationale ;
*-* Décidé à relever les défis majeurs auxquels la Guinée sera confronté tout au long de la période de la transition et après ;
*-* Considérant notre engagement à respecter des principes généraux et valeurs démocratiques prévus par la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance du 30 janvier 2007 de l’Union Africaine ainsi que le Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance ;
*-* Tirant les leçons de l’histoire politique de la Guinée marquée par la dictature de Ahmed Sékou Touré (1958-1984) et de l’autocratie du Général Lansana Conté (1984-2008) d’une part, et d’autre part, par la fébrilité militaro-politique du Capitaine du Dadis Camara (2008-2010) et du Général Sékouba (2010), jusqu’à la dérive anti-démocratique du Président Alpha Condé (2010-2020) ;
*-* Conscients de l’urgence absolue de doter la Guinée d’organes de transition fiables afin de combler le vide institutionnel dans la conduite des affaires de l’État ; *-* Approuvons et adoptons la présente Charte de la Transition qui remplace et annule la Constitution du 22 mars 2020.
*TITRE I :*
LE SYSTÈME DE VALEURS
*Article 1 :* Outre les principes généraux de droit et à l’effet de mener à bien la période transition, la présente Charte privilégie le système de valeurs suivant : *-* la paix et l’entente communautaire ; *-* la vérité, le dialogue et la tolérance ; *-* l’unité, le travail et la discipline ; *-* la justice et l’inclusion ; *-* l’inclusion et la fraternité.
*TITRE II :*
LES ORGANES DE LA TRANSITION
*Chapitre 1 :*
Du Président de la Transition
*Article 2 :* Le Président de la Transition occupe les fonctions de Président de la République et de Chef de l’Etat. Il veille au respect de la Charte de la transition. Ses pouvoirs et prérogatives sont ceux définis par la présente Charte. Son mandat prend fin au terme de la transition, après l’investiture du Président élu suite à la prochaine élection présidentielle.
*Article 3 :* De facto et de jure, le Président du Comité National de Redressement et de Développement est le Président de la Transition.
*Article 4 :* Le Président de la Transition n’est pas éligible à la prochaine élection présidentielle.
*Article 5 :* En cas d’empêchement provisoire, les prérogatives et pouvoirs du Président sont exercés par le Premier ministre.
*Article 6 :* Le Premier ministre est préférablement une personnalité consensuelle, à la compétence avérée et à équidistance entre les partis politiques.
*Article 7 :* Le Premier ministre est le chef de gouvernement. Les ministres nommés doivent être représentatifs de la société plurale composée de différentes communautés de la République de Guinée. Chapitre II : Du Conseil National de Transition
*Article 8 :* Le Conseil National de Transition (CNT) est l’organe législatif de la transition. Il est composé ainsi qu’il suit :
*-* Cinquante (50) représentants des partis politiques ;
*-* Quinze (15) représentants des organisations de la société civile ;
*-* Trente-cinq (35) représentants des forces de défense et de sécurité.
*-* Dix (10) représentants des Guinéens de l’Étranger ; Sa composition prend également en compte le quota des femmes et des jeunes. Le Conseil National de la Transition exerce les prérogatives définies par la présente Charte.
*Article 9 :* Les membres du CNT ne doivent pas être des personnes ayant ouvertement soutenu le référendum du 22 mars 2020. Ils ne doivent pas avoir fait partie des derniers gouvernements du Président partant.
Le Président du CNT est une personnalité civile élue par ses pairs. Il n’est pas éligible aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour clôturer la période de transition.
*Chapitre III :*
Du Gouvernement de Transition
*Article 10 :* Le gouvernement de transition est dirigé par un Premier ministre nommé par le Président de la Transition. Le gouvernement de transition est constitué de trente (30) départements ministériels et d’un Haut-Commissariat. Sa composition prend en compte les femmes, les jeunes, les partis politiques, les organisations de la société civile et les Guinéens de l’Étranger.
*Article 11 :* Les membres du gouvernement doivent remplir les conditions suivantes :*-* être de nationalité guinéenne
*-* avoir des compétences techniques et professionnelles requises
*-* être au-dessus de tout soupçon. Les membres du gouvernement de la transition ne doivent pas être des personnes ayant ouvertement soutenu le troisième mandat du Président partant. Ils ne doivent pas avoir fait partie du gouvernement dissout.
*Article 12 :* Les membres du gouvernement de la transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielle et législatives qui seront prochainement organisées à l’effet de clôturer la période transitoire.
*Article 13 :* Il est institué un Haut-Commissariat chargé de la Concorde nationale et des réformes institutionnelles et politiques.Dirigé par un Haut-Commissaire, membre du gouvernement, il comprend les commissions suivantes :
*-* Commission justice et concorde nationale ;
*-* Commission des réformes constitutionnelles et politiques ;
*-* Commission des réformes électorales et territoriales ;
*-* Commission audit et contrôle des comptes publics ;
*-* Commission de régulation des médias et de l’information. Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Haut-Commissariat chargé de la Concorde nationale et des réformes institutionnelles et politiques.
*TITRE III :*
LA REVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION
*Article 14:*L’initiative de la révision de la présente Charte appartient concurremment au Président de la Transition et au tiers des membres du Conseil National de Transition. Le projet-proposition de révision est adopté à la majorité des 4/5ème des membres du Conseil National de Transition. Le Président de la Transition procède à la promulgation de l’acte de révision.
*TITRE IV :*
LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
*Article 15 :* La durée de la transition ne peut excéder vingt-quatre (24) mois.
*Article 16 :* Les instances de la période transitoire fonctionnent jusqu’à l’installation effective de nouvelles institutions.
*Article 17 :* Dès sa signature par les parties prenantes, la présente Charte entre en vigueur. Sa promulgation intervient immédiatement.
*Article 18 :* En cas conflit d’interprétation des lois, la Cour constitutionnelle statue de plein droit.





