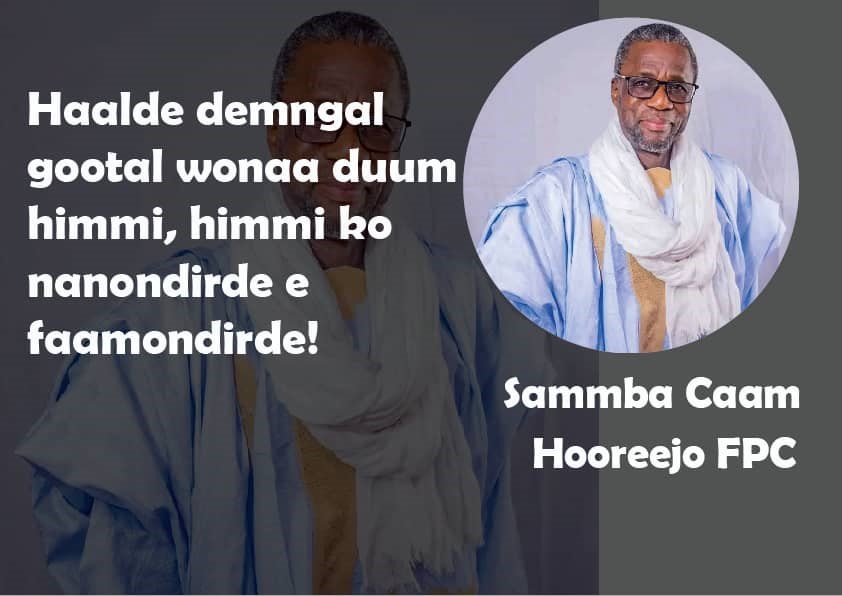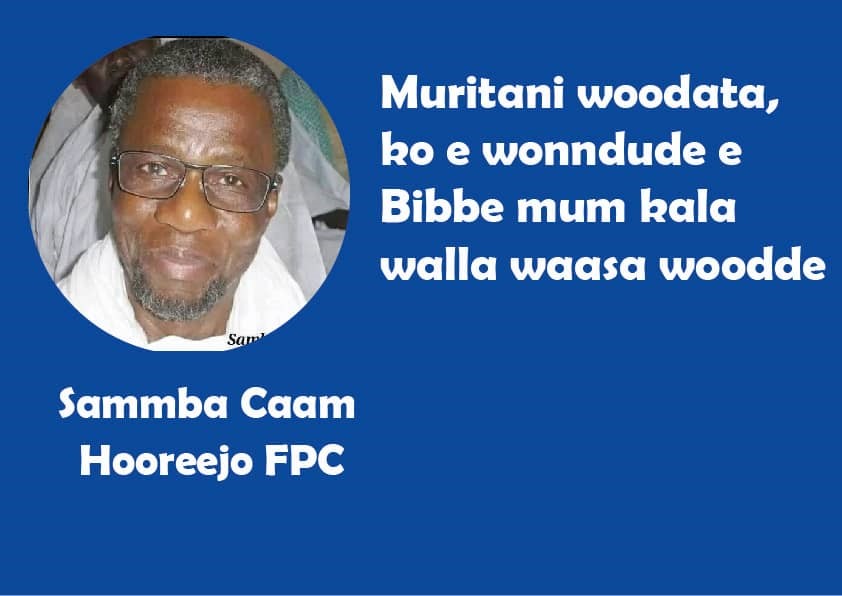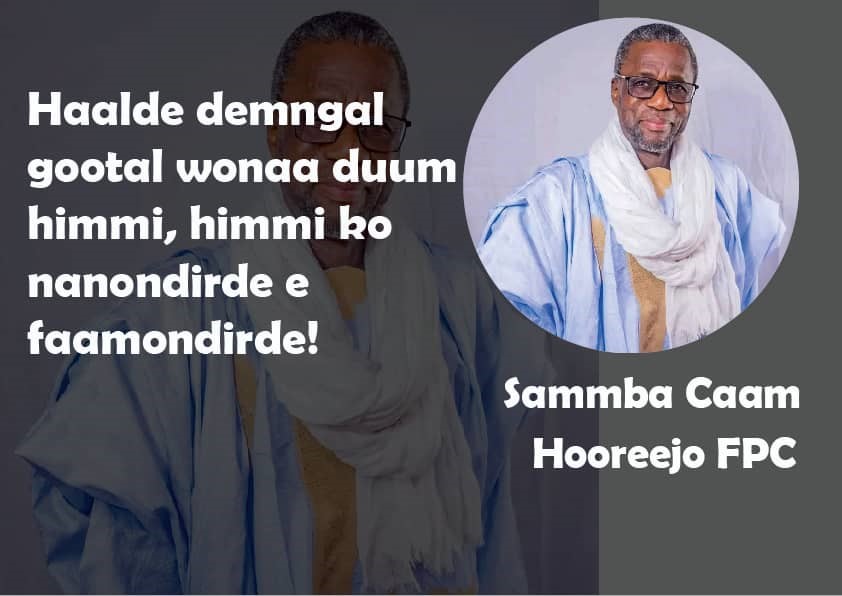Category Archives: culture
A DAKAR, UN MUSEE DES CIVILISATIONS POUR RENDRE LES AFRICAINS « FIERS DE LEURS RACINES »
 C’est une idée de l’ancien président Abdoulaye Wade, l’une des rares rescapées de son faramineux projet des « sept merveilles du Sénégal » qui devaient former le parc culturel de Dakar.
C’est une idée de l’ancien président Abdoulaye Wade, l’une des rares rescapées de son faramineux projet des « sept merveilles du Sénégal » qui devaient former le parc culturel de Dakar.
Le musée des civilisations noires ouvrira en novembre dans la capitale sénégalaise, à mi-chemin entre la gare routière Dakar-Niger et le Grand Théâtre national, l’autre « folie » de Wade.
Le nom du président déchu du pouvoir en 2012 a soigneusement été gommé de la communication officielle. Pour bâtir le pitch, on lui préfère celui plus consensuel de Léopold Sédar Senghor. « C’est un très vieux projet, qui date du premier festival mondial des arts nègres de 1966 à Dakar, raconte Hamady Bocoum, directeur de ce nouvel établissement. Senghor avait alors porté le projet d’un musée et travaillé en étroite collaboration avec l’Unesco qui avait financé l’avant-projet. » Le projet ne survit pas à la démission de Senghor en 1980 ni aux différentes crises que traversera le pays.
Circularité du bâtiment
L’idée renaît en 2009. Pour en financer la construction, le Sénégal se tourne alors vers la Chine, qui met environ 20 millions de dollars sur la table. Conçue par l’Institut d’architecture de Pékin, la silhouette du bâtiment privilégie la circularité, à l’opposé de l’angle droit occidental. L’édifice d’une superficie de 14 500 m2 dispose de 3 500 m2 de surface d’exposition et d’un amphithéâtre.
Reste à voir quel en sera le contenu. Selon Hamady Bocoum, ce ne sera pas un musée « chromatique », à savoir dédié aux seules cultures noires. « On ne veut pas faire un musée d’ethnographie ou d’anthropologie, s’enfermer dans un ghetto, prévient-t-il. On veut montrer de manière vivante les civilisations noires mais aussi s’ouvrir sur un dialogue des cultures, créer des ponts. Le rôle d’un musée n’est pas de créer un sentiment d’altérité, mais de porter un message de partage. On veut que les Africains soient fiers de leurs racines, qu’ils cultivent à nouveau l’estime de soi, mais qu’ils soient aussi ouverts au dialogue. »
Lire aussi : Paris lance sa première foire d’art et de design africains
Mais que mettre dans ce musée quand on sait que 80 à 90 % des pièces majeures d’art africain classique se trouvent hors d’Afrique ? « On ne peut pas être prisonnier de ce que nous n’avons pas, admet Hamady Bocoum. On aimerait que d’autres pays africains contribuent par des prêts. On voudrait aussi se rapprocher du musée de Tervuren, du Smithsonian et du British Museum. »
L’institution avait pris contact voilà quelque temps avec le Musée du quai Branly, à Paris, en vue d’un éventuel partenariat. Stéphane Martin, président du musée parisien et ancien président de la commission de vérification des comptes et de contrôle des établissements publics du Sénégal de 1986 à 1989, reconnaît avoir rencontré Malik Ndiaye, chercheur et historien d’art à l’université Cheikh Anta Diop. Mais pour l’heure rien de concret n’a été mis en place.
« J’ai travaillé cinq ans au Sénégal, je suis optimiste à moyen terme, confie Stéphane Martin. Je suis convaincu qu’il y aura un mouvement de retour du patrimoine. Quand ? Comment ? Je ne sais pas. Je serai le premier à y participer à partir du moment où il y aura des interlocuteurs loyaux, fiables, honnêtes. Si ce musée de Dakar se révèle une institution à la hauteur de la Fondation Zinsou, je ne demande pas mieux que de contribuer, si le gouvernement me suit, à ce qu’il y ait des dépôts importants. »
Faire vivre le musée
Mais d’ici là, le nouveau musée devra compter avec l’existant, c’est-à-dire la collection du musée de l’IFAN. « Tous les musées européens sont centrés sur l’objet, remarque Hamady Bocoum. Nous, on sera sur le vivant. » Comprenez sur le patrimoine immatériel, l’oralité, mais aussi l’art contemporain.
Quid du rôle des Chinois une fois le bâtiment livré ? « Ils avaient tendance à considérer le Grand Théâtre national, qu’ils ont aussi construit, comme leur antichambre, confie un observateur sénégalais avisé. J’espère qu’ils ne voudront pas non plus vampiriser le musée. » Hamady Bocoum, lui, est catégorique : « Ils ne vont pas nous imposer d’expositions. »
Reste une dernière inconnue, le budget de fonctionnement. « L’Etat mettra à disposition ce qu’il faut pour faire autre chose qu’un élément de divertissement », affirme le directeur de l’établissement, sans donner de détails chiffrés. Espérons qu’après les promesses, ce nouvel équipement ne se transformera pas en coquille vide. On le sait, il est facile d’ériger un musée, mais bien plus compliqué de le faire vivre…
Roxana Azimi contributrice Le Monde Afrique
Source : Le Monde
Démocratie et Bonne gouvernance en Afrique : Et si on s’inspirait de l’expérience de Thierno Souleymane Baal / Par Cheikh Diop
La démocratie comme la bonne gouvernance figure en bonne place parmi les questions les plus débattues par les analystes, politistes, économistes…
De telles questions sont si présentes dans la gouvernance actuelle des Etats et dans la place publique à tel point qu’aujourd’hui le profane même en parle à travers son propre analyse.
Dans un autre registre, il apparait clairement que les donneurs de leçons (européens et américains) de ce monde croient et pensent avoir été les premiers à opiner et parler sur ces sujets alors que déjà en Afrique et singulièrement au pays de la téranga (SENEGAL), un grand savant, sage et visionnaire avait montré la voie qu’il fallait entreprendre pour accéder à la réalisation pratique de ces idéaux.
Ce sage et imam se nomme Thierno Souleymane Ball
Ainsi, la question centrale qui taraude les esprits et qui mériterait d’être posée est celle de savoir : quels sont les principes prônés par TSB à l’endroit de la Bonne Gouvernance et de la Démocratie ?
Le Sage de Fouta Tooro préconisait durant son vivant de : « Détrônez tout imâm dont vous voyez la fortune s’accroître et confisquez l’ensemble de ses biens ; combattez-le et expulsez-le s’il s’entête»
Il sied de rappeler que le terme « imam », au-delà de celui qui dirige les prières, scelle les mariages… renvoie ici à toute autorité investie d’une charge publique au sein de la communauté. Selon la conception islamique, est imam: le chef de l’Etat, le Ministre, le gouverneur, le commissaire… voire toute personne qui, pèse sur ses épaules une quelconque responsabilité.
Ce premier principe peut renvoyer ici à l’idée (d’enrichissement sans cause). Et chez nous on parle de biens mal acquis, d’enrichissement illicite. Car estime-t-il l’autorité publique qui a pour mission principale de servir l’Etat donc les citoyens ne doit pas utiliser le pouvoir ou tout autre moyen pouvant la permettre de bâtir un empire financier ou d’accaparer des avoirs faramineux acquis généralement en toute illégalité.
Et par conséquent celui qui fait recours à une telle pratique qui est en déphasage avec la gouvernance vertueuse doit voir sa fortune acquise de façon malsaine récupérée et redonnée à la société. L’application de ce principe aiderait certainement à faire entrave aux capitaux illicites qui sortent chaque année du continent et qui pouvaient être utilisés pour faire face à un certain nombre d’urgences socio-économiques qui ont pour nom : éducation, santé, assainissement…
En un mot, disons que ce principe englobe tout ce qui est en croisade contre détournement de deniers public suivant des intérêts personnels, corruption… donc la mal gouvernance qui constitue aujourd’hui la problématique cruciale et la question la plus épineuse dont les Etats africains sont confrontés. . Le second principe avancé par Baye Thierno est de soutenir l’idée selon laquelle « veillez bien à ce que l’imâmat ne soit pas transformé en une royauté héréditaire où seuls les fils succèdent à leurs pères »
Ici l’érudit de Fouta alerte et met en garde ce que l’on appelle dans nos démocraties modernes la dévolution monarchique du pouvoir (un pouvoir qui se transmet de père en fils).
Une autre problématique très préoccupante qui se trouve au cœur de la vie politique africaine et qui fait l’objet de plusieurs débats virulents voire d’actions qui peuvent mener à la dérive. C’est dire donc que THIERNO S. BALL avait prévenu et montré la voie à suivre sur ce plan pour ne pas sombrer dans ces genres de problèmes qui ont tendance à nous détourner de l’essentiel. Dans ce même ordre d’idées, il ajoute aussi que : « l’imâm peut être choisi dans n’importe quelle tribu. Il ne faudra jamais limiter le choix à une seule et même tribu ».
Rattaché au second principe prôné par le grand sage dans sa constitution, nous pouvons dire que par-là, il soutient et fait référence à une autre dimension essentielle de la démocratie qui est le (pluralisme). Cela veut tout simplement dire que la démocratie constitue un système qui admet la diversité sous toutes ses formes (politique, religieuse ethnique…). En d’autres termes, il faut qu’il ait participation de tous et sur toute chose qui intéresse la bonne marche de la communauté dans les règles de l’art, gage d’un respect de l’idéal républicain. « Choisissez toujours un homme savant et travailleur ; fondez-vous toujours sur le critère de l’aptitude »
Enfin, il met en exergue le critère de compétence et d’aptitude dans la conduite des affaires de la Cité.
En sa qualité d’homme religieux, THIERNO s’est fortement inspiré de l’enseignement de l’islam pour édicter de tels principes O combien nobles et fondamentaux dans tout Etat. Le messager de Dieu avait dit à ses compagnons un jour de se préparer au venu du jour dernier quand la confiance sera banalisée. Et ces derniers de lui demander à quel moment la confiance sera-t-elle banalisée ? Il leur répondit quand la responsabilité sera confiée aux non ayant droits.
A travers ces deux derniers critères de choix du chef ( président, Ministres…) le savant de Fouta Tooro veut nous faire comprendre que même si la démocratie accepte le pluralisme, il n’en demeure pas moins que ceux et celles à qui on doit confier les charges et responsabilités dans la société en générale et au sein de l’Etat en particulier doivent être aptes à la fois au plan physique, mental et intellectuel sinon, c’est tous les citoyens qui empâteront et s’en suivra sans doute l’échec.
C’est dire donc que démocratie ne doit pas rimer avec incompétence. En définitive, partant de cette analyse, il apparait en toute évidence que le chemin des chantiers de la gouvernance vertueuse comme ceux de la démocratie ont été balisés depuis belle lurettes par cet éminent fils de l’Afrique si Sage et si éclairé.
Pourquoi donc nous africains, acceptons de suivre à la lettre les orientations en termes de démocratie et de bonne gouvernance venant de la part des occidentaux qui ont pensé alors qu’on a des réalités qui nous ont propres ? Pourquoi ces nobles principes dégagés par cet éminent personnalité ne sont pas jusqu’ici valorisés et enseignés dans notre système éducatif ?
Pourquoi ceux et celles qui se réclament de l’intelligentsia ne font pas recours à ses pertinentes idées lorsqu’il s’agit de parler de démocratie et de la vie politique en générale ?
Pourquoi acceptons-nous toujours de baigner dans une cécité intellectuelle et un complexe d’infériorité vis-à-vis aux intellectuels occidentaux ?
La réponse face à toutes ses interrogations est tout simplement de dire que l’occident ou les Etats-Unis n’ont aucune leçon à nous donner surtout quand il s’agit de parler de démocratie ou de bonne gouvernance en ce sens que les érudits et intellectuels africains de tout bord se sont toujours penchés sur l’idéal et le fonctionnement d’une société avant que d’autres ne s’en inspirent et en font une récupération.
Il est urgent pour nos décideurs de toute obédience confondue de se lancer dans une logique de valorisation de l’enseignement des savants et guides africains dans l’optique de refonder des systèmes politiques, économiques, éducatifs qui vont épouser nos réalités et laissé à l’occident son système caduque, archaïque dépassé, malsain, pourri et inadéquat face à nos besoin liés à l’édification d’une nation forte et saine et au développement tout court.
Par Cheikh Diop UGB, Tribune des idées de la dahira Tidiane
Etudiant en Sciences PO
Cinéma : Un film sur le conflit sénégalo-mauritanien
 Culturim – ”Tribunal du Fleuve”. C’est le titre d’un long métrage qui sera bientôt porté sur l’écran par le jeune cinéaste sénégalais Alassane Diago. Nous l’avons croisé sur les rives du fleuve Sénégal, sillonnant les camps de réfugiés mauritaniens, la caméra en bandoulière.
Culturim – ”Tribunal du Fleuve”. C’est le titre d’un long métrage qui sera bientôt porté sur l’écran par le jeune cinéaste sénégalais Alassane Diago. Nous l’avons croisé sur les rives du fleuve Sénégal, sillonnant les camps de réfugiés mauritaniens, la caméra en bandoulière.
”Je suis de Agnam, mais originaire de Néré en Mauritanie”, confie-t-il. Le film qu’il compte réaliser sera le troisième long métrage. L’homme est le réalisateur du long métrage documentaire ”Les larmes de l’émigration” sorti en 2010, de ”La Vie n’est pas immobile”, sorti en 2012.
Diago a assisté Chantal Richard dans la production de ‘‘Lili-et-le-baobab” en 2014 au village de Agnam Lidoubé dans le Matam.
Vivant à Paris, il est depuis plus d ‘un mois sur le terrain ”pour travailler sur le long métrage qui retrace le conflit senegalo- mauritanien. De nombreuses rencontres avec les réfugiés pour le montage de ce qui sera le Tribunal du Fleuve, ou procès, dans le but de reconstituer l’histoire d’un conflit en partant de l’indépendance à nos jours”.
Pour le cinéaste ”un diagnostic s’impose car estime-t-il il y a trop de zones d’ombres”. Il fera dans notre entretien un récapitulatif à partir du manifeste des 19, au conflit de Diawara. Il fera ressortir dans ces propos, le tâtonnement des organismes onusiens chargés de la question des déportés, le sort des apatrides dans leur propre pays suite au retour organisé en 2007.
Tribunal du Fleuve est un film produit par les sociétés française l’Atelier documentaire et sénégalaise Karoninka. Le film a bénéficié de l’aide au développement long métrage de la région d’Aquitaine, un fonds qui appuie des projets de développement ou productions audiovisuelles à l’image de sa production qui aurait été sélectionné. Alassane Diago, selon son enquête et sa documentation : ”Le Sénégal n’aura été qu’un prétexte, mais le conflit est inter-mauritanien et c’est ce que nous allons montrer à travers notre réalisation”.
Alassane a à son actif à la suite de sa production: Les Larmes de l’émigration, le salut de la critique et les félicitations de la critique internationale pour de nombreuses sélections dans des festivals avec primes à l’appui. Il a été grand prix du jury du meilleur documentaire, du prix Casa Africa au festival du ciné africano de Tarifa (Espagne). Le grand prix du public pour le meilleur long métrage documentaire au festival international du film francophone de Namur (Belgique).
Espérons que Tribunal du Fleuve en attente sur la rampe de lancement sera certainement couronné du même succès.
ADN
©Cridem 2016



L’Adrar est le coeur politique de la Mauritanie
 Pierre Messmer , ancien administrateur colonial du cercle de l’Adrar mauritanien ( 1950-1952), gouverneur de la Mauritanie (1952-1954) ancien Ministre des Armées ,et Premier ministre de la France a dit :
Pierre Messmer , ancien administrateur colonial du cercle de l’Adrar mauritanien ( 1950-1952), gouverneur de la Mauritanie (1952-1954) ancien Ministre des Armées ,et Premier ministre de la France a dit :
« L’Adrar (et surtout Atar), est le cœur politique de la Mauritanie. L’ile-de-France par rapport à la France, le lieu à partir duquel la République Islamique de Mauritanie s’est peu à peu constituée ».
La déclaration de ce Chancelier de l’ordre de la Libération , membre de l’Académie française , prononcée bien avant l’accession de la Mauritanie à l’indépendance nationale, s’est avérée « assertion vraie » ,scientifiquement parlant .
En jetant en effet, un regard rétrospectif sur la vie politique en Mauritanie depuis le retour en France de Pierre Messmer, le constat est évident.
C’est en Adrar qu’est né a Atar le 13/09/1916 Sid’El Moctar N’Diaye, le véritable fondateur de la République Islamique de Mauritanie dans ses frontières et indépendance actuelles :
Député de la Mauritanie à L’Assemblée Nationale française de 1951 à 1959 ; Président de l’Assemblée territoriale de Mauritanie de 1952 à 1958 ; Président de l’Assemblée Constituante de la RIM du 28 novembre 1958 à mai 1959 ; Président de l’Assemblée Nationale de Mauritanie de mai 1959 à mars 1961.C’est lui qui a signé le 28/11/1958 le document officiel proclamant la création officielle de la République Islamique de Mauritanie.
Et c’est ce Sid’El Moctar N’Diaye qui a choisi l’autre « père de la nation » , Moktar Ould Daddah pour diriger les destinées de la Mauritanie :
« … Sidiel à qui je rétorquais qu’il était lui, le leader politique, tout désigné me répondit, sans ambages, qu’il ne voulait pas exercer de responsabilité dans le domaine exécutif… (et) que donc il ne voyait que moi pour être ce homme politique « nouveau » appelé à diriger la Mauritanie « nouvelle … »dixit Moktar dans ses mémoires « contre vents et marées »
http://cridem.org/C_Info.php?article=650645
Pour concrétiser son choix sur le terrain , Sid’El Moctar a mis en jeu tout son charisme et réputation pour que Ould Daddah parvienne à se porter candidat au poste de conseiller territorial . Chose difficile en son temps car la circonscription administrative de Boutilimit par laquelle pouvait passer la candidature de Moktar est barrée par son parent, l’éminent notable Souleymane Ould cheikh Sidiya . Pour Sid’El Moctar, il fallait passer autrement.
L’anecdote que se content les Atarois est la suivante : « Par un soir de 1957, Ould Yahya N’Diaye (ainsi l’appelle-t-on à Atar) arrive par avion en compagnie de son ami Moktar daddah.
De l’aéroport, le président de l’assemblée territoriale de la Mauritanie, envoya un message verbal à Ehel ( gens d’) Adrar : « Je suis venu avec mon jeune ami Moktar . Je cherche à le proposer au poste de conseiller territorial. Si cela est possible, tant mieux. Si, non, je vais continuer ma route ». Le messager courut à pied et vint communiquer l’information au grand notable et richissime commerçant Homody Ould Mahmoud , beau père de Sid’El . Expectative !!! Casse-tete !!!
L’auguste Homody sait que la Jemaa de l’Adar a déjà choisi ses candidats aux postes de conseillers territoriaux , et non des moindres, en la personne de Dey Ould Sidi Baba , Sid’Ahmed Kabach pour Atar et Ould El Mounir pour Chinguetti .
Des « mastodontes politiques » aussi illustres et prestigieux, aux yeux d’Ehel Adrar , que Souleymane Ould Cheikh Sidiya pour Ehel Boutilimit. Que faire alors ?
Ne dit-on pas que : derrière chaque grand homme, se cache une femme. Salka Mint Ebdebba qui a tout entendu de la conversation entre son mari et l’envoyé de Sid’El , n’attendit pas la minute pour lancer toute son autorité, sa force d’âme, son intelligence, son aura, sa sagesse et ses nombreuses relations amicales pour que la Jemaa de l’Adrar se réunisse extraordinairement dans les plus brefs délais et que son gendre ait gain de cause.
Grace a la noblesse de sentiments, clairvoyance, ouverture d’esprit , amitié sincère ambiante entre les grandes notoriétés de l’Adar ( Allah Yarham Houm Jemi3an) , l’assemblée accepta sur proposition d’Ehel Chinguetti que Ould EL Mounir retire sa candidature pour permettre à Moktar Ould Daddah de porter le flambeau de représentation de la 7eme ville sainte, dont le nom est aujourd’hui fierté, porté par tous les Mauritaniens ou Chenaghita . »
Ainsi donc Moktar Ould Daddah est élu en mars 1957 conseiller territorial de l’Adrar.
Depuis lors ; il n’a cessé de manifester sa reconnaissance à l’endroit d’Ehel Adrar . Dans son discours fondateur le 1er Juillet 1957 à Atar (justement), il disait en guise d’introduction :
« Mes chers amis, mes chers compatriotes, C’est avec une émotion toujours renouvelée, que je me retrouve dans ce cadre de l’Adrar immortalisé par le poète qui a chanté les noms prestigieux de « Gour Hamogjar, du Batem, du Dhar Tiffojjar » et surtout au milieu de vous tous à qui je dois la place que j’occupe maintenant. Je tiens à vous remercier à nouveau de la confiance que vous m’avez accordée, me permettant ainsi d’accéder aux plus hautes responsabilités. Je puis vous assurer que cette confiance ne sera pas déçue. Je veux aussi remercier tout particulièrement l’Emir de l’Adrar à l’hospitalité duquel nous devons de nous retrouver tous ensemble ce soir. Je lui suis reconnaissant de vous avoir rassemblés ici pour entendre ce que j’ai à vous dire.
http://mauritanie-ouldkaige.blogspot.com/2012/12/un-discours-fondateur-celui-du.html
En mai 1957, Moktar Ould Daddah devient vice-président du conseil de gouvernement de la Mauritanie. Il fait alors décider le transfert de la capitale mauritanienne en territoire national, mettant fin à la situation surprenante d’un pays dont l’administration et les pouvoirs publics siègent à l’extérieur, à Saint-Louis, chef-lieu commun du Sénégal et de la Mauritanie à l’époque coloniale.
L’autonomie adoptée par référendum en novembre 1960 fait de Moktar le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie. Ould Daddah est ensuite élu président de la République par l’Assemblée en 1961.
Comme pour justifier les propos de Pierre Messmer qui parle du Grand Adar, couvrant en son temps l’Inchiri, Nouadhibou et Tiris Zemmour, la Mauritanie continue, après la proclamation de son indépendance en 1960, de battre au rythme du cœur de l’Adrar.
Ainsi , les cinq principaux présidents qui ont réussi a tenir la barre de commandement du pays et marquer de leur passage l’évolution du pays, sont issus de l’Adrar ou de localités qui lui sont satellites.
Moktar Ould Daddah « adoptif politique de l’Adrar » , le pays a connu les hauts et bas diplomatiques pour sa reconnaissance ; La sortie de la zone franc ; La Nationalisation de Miferma ; L’ entrée dans la guerre au Sahara. …
Mohamed Khouna Haidalla : Application de la Chari3a islamique et loi sur l’esclavage…
Maaouiya Ould Taya : Relation diplomatique avec Israël, événements sanglants 89-91 ; Introduction des technologies de communication :Internet ; premières élections municipales, parlementaires et présidentielles….
Ely Ould Mohamed Fall : transition démocratique et remise du pouvoir au civil….
Mohamed Ould abdel Aziz ……
L’Adrar a offert en martyr le premier maire de la ville d’Atar , Abdellahi Ould Oubeid pour avoir osé interdire aux soldats Français dés l’indépendance du pays, d’organiser des manifestations perverses dans sa commune les obligeant à se cantonner dans leurs casernes.
Tout comme l’Adrar a donné à la capitale du pays Nouakchott, son premier maire en la personne de Mohamed Ould Khayar….
Mais l’Adrar n’est pas que le cœur politique pour la Mauritanie. Il est aussi son cœur culturel : Hamam Fall , fils d’Atar, le fondateur du théâtre et cinéma modernes, Jeich Ould Seddoum avec sa troupe artistique , initiateur du « Jaguar » devenu universel; Brour Ould Mahmoud et la percée du Med’H et du Bendje ….La Guetna et cérémonies festives ; Baptêmes ; Gastronomie, Tajine à base de kebdé …..Dattes , Henné et D’Hinn (beurre)Adrar etc….sont devenues aujourd’hui culture partagée par tous les Mauritaniens .
Un autre sujet à aborder ultérieurement…
Ely Salem Khayar
adrar-info
Cheikh Anta Diop: «Les Egyptiens étaient des Nègres»
 Le 7 février 1986, disparaissait le Sénégalais Cheikh Anta Diop, auteur du célèbre Nations nègres et cultures. Ses thèses iconoclastes, fondées sur une érudition scientifique et pluridisciplinaires, avaient fait l’effet d’une bombe à la parution de l’ouvrage en 1954. A l’occasion du 30e anniversaire de la disparition de l’historien, RFI a interrogé le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne sur la portée de l’œuvre de Diop. Souleymane Bachir Diagne, 61 ans, vit aux Etats-Unis où il enseigne la littérature et la philosophie à l’université de Columbia. Entretien.
Le 7 février 1986, disparaissait le Sénégalais Cheikh Anta Diop, auteur du célèbre Nations nègres et cultures. Ses thèses iconoclastes, fondées sur une érudition scientifique et pluridisciplinaires, avaient fait l’effet d’une bombe à la parution de l’ouvrage en 1954. A l’occasion du 30e anniversaire de la disparition de l’historien, RFI a interrogé le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne sur la portée de l’œuvre de Diop. Souleymane Bachir Diagne, 61 ans, vit aux Etats-Unis où il enseigne la littérature et la philosophie à l’université de Columbia. Entretien.
Nous commémorons cette année le 30e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop. Je crois que vous l’avez connu personnellement. Quel genre de personnage était-il ?
Je l’ai rencontré une seule fois. Je m’en souviens encore. Je sortais de mon agrégation de philosophie lorsque mon oncle Pathé Diagne, qui était l’un de ses amis, m’a amené le voir. C’était un monsieur très courtois et attentif. On a parlé de mes études et de l’importance qu’il attachait à la réflexion philosophique. Il m’a dit que l’Afrique avait besoin de philosophes pour penser son présent et son avenir. J’étais un peu intimidé par ce grand personnage dont j’avais lu, comme tous les Sénégalais, les écrits sur l’Egypte, et notamment son livre intitulé Antériorité des civilisations nègres : mythe ou vérité historique ? que j’avais dévoré au sortir de la terminale.
Quel impact ces lectures ont-elles eu sur vous ?
Elles ont eu un impact immense sur moi comme sur beaucoup de jeunes Africains grandissant dans des sociétés postcoloniales et dominées. Elles m’ont aidé à structurer ma pensée. Tous les Africains qui ont lu Cheikh Anta Diop sont marqués à jamais par la simplicité et la force de sa narration. Moi, j’ai retenu de mes lectures « diopiennes » trois grandes idées. Primo, la civilisation égyptienne est une civilisation profondément africaine et d’ailleurs l’Egypte n’est pas compréhensible sans son ancrage africain, tout comme l’histoire africaine ne se comprendrait pas sans sa connexion avec l’Egypte.
Quelles sont les deux autres idées que vous avez retenues ?
La deuxième leçon importante, ce fut la découverte que l’Afrique ne se réduisait pas à sa tradition orale et que l’érudition écrite avait une longue histoire sur notre continent. Comme l’a écrit Diop, on ne peut pas parler de philosophie africaine en ignorant que cette discipline était enseignée dans des grandes villes comme Tombouctou ou Djenné dans une tradition écrite depuis des époques médiévales. La lecture de Cheikh Anta Diop m’a convaincu que la démarche ethnologique ne suffisait pas et qu’il fallait une démarche proprement historique pour pouvoir situer l’histoire intellectuelle de l’Afrique à l’intérieur de celle du monde musulman et plus généralement, à l’intérieur de la tradition de l’érudition écrite. Enfin, la troisième grande idée que Diop développe dans son œuvre, c’est celle de l’unité culturelle et politique africaine. Son volontarisme panafricaniste n’est pas sans rappeler l’appel à l’unité africaine d’un Senghor ou d’un Nkrumah.
Vous avez connu Cheikh Anta Diop, mais aussi Senghor. Il semblerait que leurs relations étaient plutôt tendues ?
On a exagéré sur les divergences intellectuelles entre ces deux grands Sénégalais. Certes, Senghor et Diop n’étaient pas sur la même longueur d’onde sur le plan politique, mais maintenant que tous les deux sont morts et que la passion politique est retombée, les points de convergence apparaissent davantage, notamment sur les questions de l’unité culturelle du monde noir.
Parmi les thèses iconoclastes de Cheikh Anta Diop, il y a aussi son affirmation que les Grecs auraient tout appris des Egyptiens, de la philosophie jusqu’aux sciences. Faisait-il de l’afrocentrisme ?
C’était évidemment excessif d’affirmer que les Grecs avaient tout appris des Egyptiens, mais Cheikh Anta Diop avait eu raison de questionner la présentation de l’histoire intellectuelle de l’Occident comme un parcours totalement exceptionnel, sans lien avec d’autres parcours civilisationnels. Les Occidentaux nous disent que tout a commencé par la Grèce. On nous parle de « miracle grec », ce qui impliquerait que la Grèce ne naît que d’elle-même et que sa civilisation n’aurait eu aucun lien avec le monde antique environnant. Diop a montré, avec des preuves à l’appui, puisées autant dans l’archéologie, l’histoire que dans la linguistique, que les échanges avaient bel et bien eu lieu entre le monde grec et le monde égyptien. Platon lui-même a reconnu dans ses dialogues la dette de la Grèce à l’égard de l’Egypte. C’est à partir de Hegel que la démarche philosophique est conçue comme étant propre à l’Europe, alors qu’avant Hegel les philosophes européens étaient tout à fait conscients que la philosophie était le produit d’une conversation entre des cultures, entre des penseurs venant des aires culturelles différentes. Avant d’être « afrocentriste », Cheikh Anta Diop interpelle l’européocentrisme de la pensée occidentale. D’où la méfiance et la condescendance dont celui-ci a été victime si longtemps.
Pourquoi les idées de Cheikh Anta Diop semblent déranger moins aujourd’hui ?
Dans les années 1950 lorsque Cheikh Anta Diop a été empêché de présenter sa thèse sur l’africanité de l’Egypte à la Sorbonne, l’université occidentale vivait encore sur l’héritage de la domination de la pensée occidentale qui supportait mal les mises en cause de sa supériorité. L’Occident seul savait « philosopher »… L’Afrique était trop arriérée pour avoir abrité une civilisation aussi brillante que la civilisation égyptienne. Puis, les idées défendues par l’historien africain ont fait leur chemin et ont fini par s’imposer, notamment à la suite du colloque international du Caire de 1974, organisée sous l’égide de l’Unesco. Ce colloque est venu conforter les thèses de Diop sur l’Egypte africaine.
Vous enseignez depuis plusieurs années aux Etats-Unis. De quelle réputation Cheikh Anta Diop jouit-il aujourd’hui auprès de l’intelligentsia américaine ?
Son œuvre fait partie aujourd’hui de ce qu’on appelle le « canon » de la littérature postcoloniale. Elle est associée à l’affirmation de l’africanité de l’Egypte. Antériorité des civilisation nègres est sans doute son ouvrage le plus connu parmi les intellectuels américains.
RFI.FR –