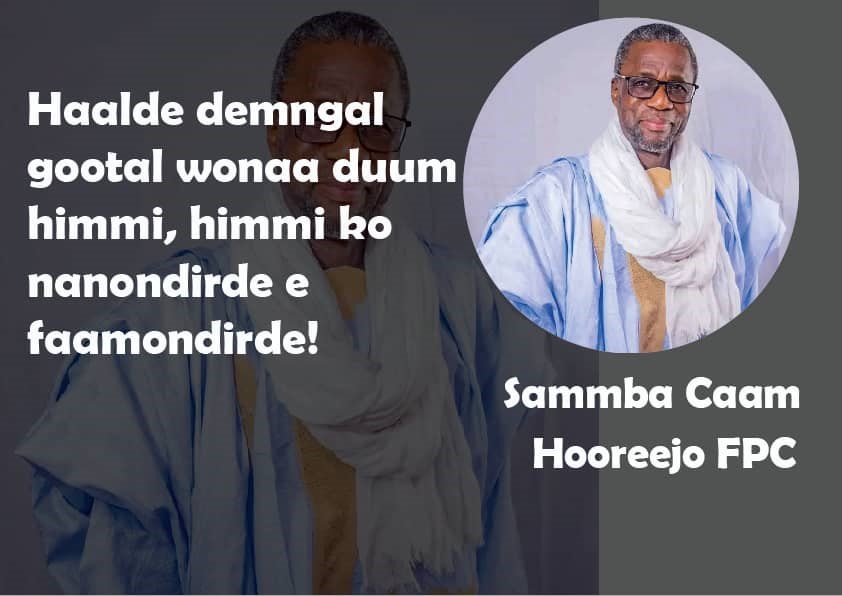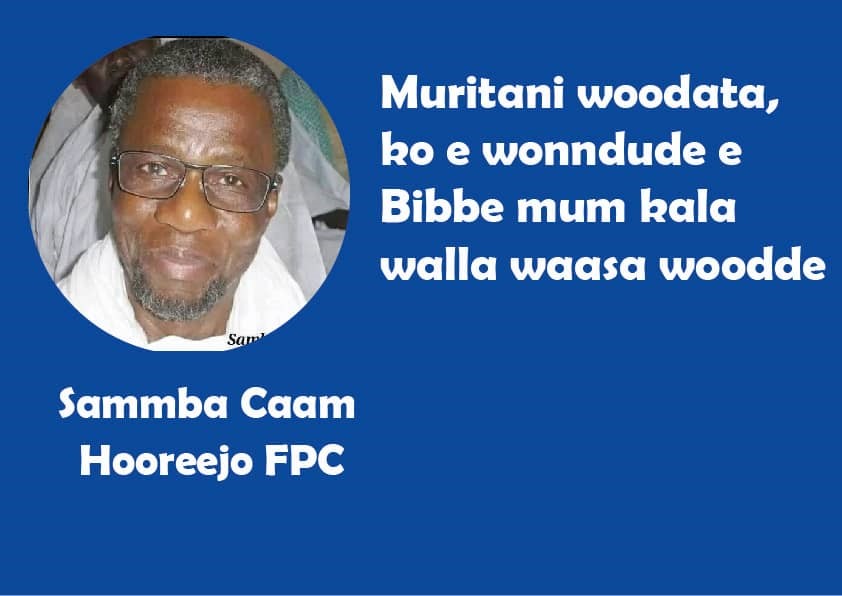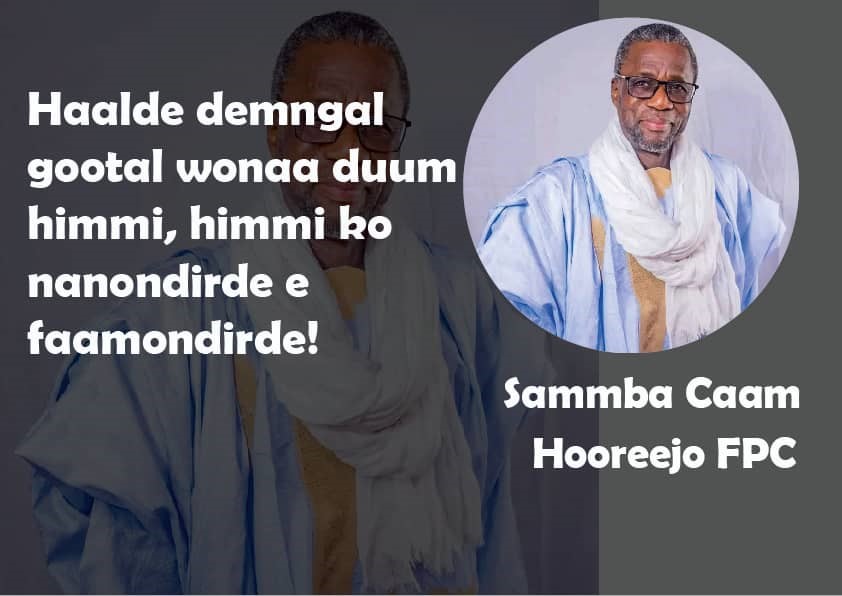Conflit et démocratie : le dilemme africain

Analyse · Les Africains sont-ils fondamentalement opposés à la démocratie ? Ou plutôt, sont-ils poussés, dans un réflexe de survie, à recourir à des moyens non démocratiques pour se protéger et exister ? Apparemment naïve, cette question est fondamentale pour les chercheurs qui travaillent sur la démocratie et les conflits sur le continent.
Analyse · Les Africains sont-ils fondamentalement opposés à la démocratie ? Ou plutôt, sont-ils poussés, dans un réflexe de survie, à recourir à des moyens non démocratiques pour se protéger et exister ? Apparemment naïve, cette question est fondamentale pour les chercheurs qui travaillent sur la démocratie et les conflits sur le continent.
De nombreux Africains interrogés sur le sujet adoptent une approche binaire : démocratie ou dictature. Cela conduit à qualifier de démocratie une autocratie électorale, simplement parce que des élections y sont organisées. Or, même si les élections constituent la forme d’expression la plus visible et l’une des plus importantes de la démocratie, elles ne suffisent pas : la démocratie exige bien plus. La classification des régimes du monde proposée par Anna Lührmann, Marcus Tannenberg et Staffan Lindberg est organisée en quatre groupes2, bien que certaines typologies en proposent davantage : les autocraties fermées, les autocraties électorales, les démocraties électorales et les démocraties libérales. Dans de nombreux pays africains, nous observons principalement des autocraties électorales, où, derrière une façade démocratique assurée par l’organisation d’élections, les régimes en place restent, en réalité, des autocraties.
En 2023, les variations des niveaux de démocratie entre différents pays sont saisissantes. Par exemple, la Norvège affichait un score de 0,84, la France de 0,80 et les États-Unis de 0,75, selon l’indice V-Dem3. Cela signifie que la Norvège et la France étaient perçues comme plus démocratiques que les États-Unis.
Penser au-delà des élections
L’indice V-Dem classe les pays en fonction de leur niveau de démocratie. Le chiffre 0 y représente une autocratie totale, c’est-à-dire un régime fermé et répressif, tandis que 1 correspond à une démocratie libérale idéale, où les libertés et les droits sont pleinement respectés. Pour faciliter l’interprétation des scores, ces indices sont souvent convertis en pourcentages. Ainsi, la Norvège se situe à 84 %, la France à 80 % et les États-Unis à 75 %. De la même façon, l’Afrique du Sud, avec un score de 0,75, et le Ghana, à 0,57, sont considérés comme des démocraties. En revanche, le Burkina Faso, avec un score de 0,13, et la Côte d’Ivoire, à 0,25, sont classés parmi les autocraties. Le Burkina Faso est une autocratie fermée, car son score est inférieur à 0,20, tandis que la Côte d’Ivoire, avec un score supérieur à 0,20, est qualifiée d’autocratie électorale, où les élections ne garantissent pas pleinement les principes démocratiques.
Il est donc essentiel de concevoir la démocratie au-delà des seules élections et d’intégrer d’autres dimensions fondamentales, telles que la liberté d’expression et de la presse, la liberté d’association et d’organisation en société civile, ainsi que le pluralisme démocratique, notamment4.
Un autre élément important ressortant des enquêtes d’Afrobarometer est la forte proportion des Africains qui estiment qu’en période de crise un régime militaire devrait prendre le pouvoir (environ 81,1 %). Ce groupe se répartit en trois sous-groupes : 16,5 % souhaitent qu’un tel régime se maintienne tant que cela est dans l’intérêt du pays ; 27,7 % pensent qu’il faut progressivement aller vers une transition civile ; et 36,9 % estiment qu’il faut restaurer un pouvoir civil le plus tôt possible.
Les effets politiques du stress
Les études empiriques et théoriques montrent qu’en période de crise ou de traumatisme les populations réagissent soit par le stress (la « stress response »), soit par la résilience (« growth response »). Cette dynamique est au cœur de la théorie de la réponse politique post-traumatique développée par Wayde Z. C. Marsh, dans « Trauma and Turnout : The Political Consequences of Traumatic Events » (American Political Science Review, 2023).
La première réaction face à un conflit est souvent la peur et l’anxiété. Dans ce contexte, l’individu dont la vie est menacée cherche une solution rapide contre cette situation intolérable. Des études en psychologie et en analyse comportementale montrent qu’en période de crise ceux qui éprouvent de la peur ou de l’anxiété sont souvent plus réceptifs aux discours populistes et aux narratifs proposant des solutions radicales et agressives, comme l’ont souligné Vázquez, Pérez-Sales et Matt5 ainsi que Vasilopoulos, Marcus, et Foucault6. Ces auteurs montrent que, dans des moments de vulnérabilité, les gens se rallient souvent à des « hommes forts » pour les tirer d’affaire. Les militaires et autres partisans des régimes non démocratiques profitent de ces opportunités pour proposer des solutions radicales et identifier des boucs émissaires, transformant la peur en colère contre une communauté « ennemie ». Ce narratif explique pourquoi, en période de crise, les « hommes forts » sont bien placés pour prendre le pouvoir.
Cette situation n’est pas nouvelle. Bainville et Dickès7 analysent les formes de dictature et établissent les profils des dictateurs dans l’Europe antique. Ils montrent qu’il existait, dans l’Antiquité romaine, un dictateur bienveillant choisi pour une période de six mois afin de rétablir l’ordre constitutionnel en période de guerre. Mais cette situation a souvent conduit à des dérives, les dictateurs bienveillants ayant accaparé le pouvoir et ainsi provoqué chaos et instabilité. La même dynamique permet de comprendre l’émergence des régimes autoritaires et des dictateurs en Afrique.
Le temps des « hommes forts »
En 2021, trente conflits interétatiques ont fait 19 325 morts, dont 8 917 en Éthiopie, selon Palik, Obermeier, et Rustad8. Les conflits non étatiques ont causé 3 498 décès, tandis que la violence unilatérale – c’est-à-dire les attaques ciblant des civils ou des groupes non armés et perpétrées par des acteurs étatiques ou non – a fait 4 170 victimes, dont la majorité attribuée aux forces gouvernementales.

Pour en sortir, les populations, selon la théorie de la réponse politique post-traumatique, se tournent vers tout leader qui leur semble solide et capable de répondre à la crise par la force. Cela donne lieu au règne des militaires et des régimes dictatoriaux.
Cependant, cette situation n’est pas désespérée pour les défenseurs de la liberté, des droits humains et des principes démocratiques. Car la deuxième réponse face à la guerre et à la violence est la résilience. Cette approche théorique de Marsh (2023) suggère qu’en cas de conflits chroniques les populations développent des formes de résilience orientées sur les réseaux familiaux, une réorganisation des institutions et des structures politico-économiques. Dans cette situation, l’individu distingue peu de perspectives de sortie de crise à court terme, et devient de moins en moins réceptif aux discours populistes et autoritaires car il a eu le temps d’observer les échecs des solutions violentes et non démocratiques.
Dans un régime militaire, l’audience est la junte
Quand la sécurité tarde à venir, les populations réclament à nouveau leur liberté, et entrent alors en conflit avec un régime non démocratique qui se maintient par la répression. Dans cette situation, le régime est susceptible de devenir de plus en plus violent et paniqué.
En utilisant la théorie du « coût de l’audience », Weeks9 montre que, dans une démocratie, le gouvernement en place doit tenir compte de l’opinion publique car celle-ci peut entraîner un changement de régime. Mais dans le cas de régimes militaires, l’audience est la junte. Le peuple peut se révolter, mais il est difficile, voire impossible, de changer la situation politique en place. Lorsque les mouvements populaires se multiplient et que la répression s’intensifie, une junte peut organiser un coup d’État pour remplacer un leadership impopulaire par un autre, prétendant représenter le peuple et lutter contre l’oppression. Et ainsi, le cycle recommence.
L’espace politique et l’éducation politique sont des armes fondamentales contre les régimes autoritaires. Lorsque les populations réagissent avec résilience et refusent de sacrifier leur liberté en échange d’une sécurité incertaine, il est crucial que l’espace politique soit occupé par des discours radicaux en faveur de la démocratie, plutôt que par des « hommes forts » issus des forces armées. Le conditionnement de l’opinion en période de crise est très important. Changer le narratif est essentiel si l’on veut modifier le rapport entre le peuple et les régimes autoritaires en période de guerre.
La guerre, fabrique de l’État profond
Chong et Druckman10 montrent que la manière dont l’information est présentée au public influence la façon dont elle est perçue et interprétée. C’est la théorie du cadrage. De même, la manière dont les conflits armés et le terrorisme sont présentés aux populations affecte leur perception du risque et de leurs besoins urgents. Lorsque les informations sur les conflits sont présentées en termes de menaces pour la vie et pour la sécurité personnelle, le public a tendance à y répondre en renonçant à sa liberté au profit d’une sécurité accrue et en recherchant un « homme fort ». En revanche, lorsque l’information est présentée en termes de menace pour la liberté individuelle et comme un instrument de domination et d’aliénation des droits, les populations adoptent une posture prodémocratique et refusent de renoncer à leur liberté. C’est pour cela que le contrôle de l’information en période de guerre se transforme en une course effrénée et mortelle pour les entrepreneurs de la guerre.
Un autre point essentiel est que les régimes militaires et autoritaires dans les pays en développement ne peuvent pas être véritablement révolutionnaires. L’économie politique de la guerre montre que celle-ci est contrôlée par des acteurs qui détiennent d’importantes parts de l’économie et se disputent des intérêts. Un État pauvre engagé dans la guerre sera, tôt ou tard, contraint de devenir un « État profond », en traitant avec des acteurs criminels pour financer et mener la guerre. Défini par Michaels11, l’« État profond » désigne un réseau parallèle de pouvoir officieux, caché et non responsable, opérant en dehors des structures démocratiques et transparentes de l’État. Plus la guerre dure, plus les leaders, même de bonne foi, se retrouvent impliqués dans des réseaux souterrains, tandis que leurs collaborateurs deviennent des « entrepreneurs de guerre » au détriment du peuple.
Finalement, la démocratie se voit contestée en Afrique non pas parce que les Africains rejettent ses principes, mais parce que, face à la crise et aux conflits, le besoin de sécurité prime souvent sur celui de liberté.
Une démocratie à l’africaine
Renforcer la résilience des populations, surtout en proie aux crises, est essentiel pour protéger la démocratie car la résilience est l’une des réactions possibles identifiées par la théorie de la réponse post-traumatique. De plus, la théorie du cadrage suggère qu’en présentant la démocratie comme le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme, surtout en période de conflits, on peut accroître le soutien populaire. Les travaux de Yameogo, Neundorf, et Aykut12 et Windsor13 confirment cette dynamique.
La démocratie – ou, du moins, les aspirations qui la composent, telles que le besoin de liberté, de s’exprimer et de pouvoir critiquer la gestion de la cité – n’est pas étrangère à l’Afrique, selon les travaux de Cheikh Anta Diop14. S’il est vrai que ces éléments ont été conceptualisés et vulgarisés par les Occidentaux, d’autres peuples auraient pu revendiquer ce concept sous une autre forme, tout en conservant ses composantes essentielles en matière de liberté et de droit à la vie. Certains proposent même aujourd’hui de penser la démocratie à l’africaine. Ce qu’ils expriment, c’est simplement la volonté de s’identifier aux principes et aux valeurs démocratiques à travers une approche endogène qui reflète leur réalité. Cela permettrait de définir, pour chacun, les limites objectives de son besoin de liberté et la manière dont les écarts peuvent être sanctionnés.
Une chose est certaine : un tel processus favorisera le désir de vivre, de s’exprimer, de critiquer la gestion des dirigeants choisis pour gouverner la cité, ainsi que le droit de protester en cas de désaccord. La démocratie possède une dimension universelle qui touche à l’essence même de l’être humain, même si les communautés ont le droit d’en proposer un contenu local.