Category Archives: culture
NANN “K”:L’ARTISTE BAABA MALL DEVOILE LE NOM DE SON MOUVEMENT CITOYEN
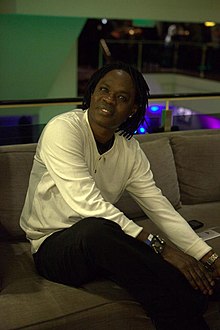 L’Artiste Sénégalais Baaba Maal vient de lancer un nouveau mouvement citoyen NANN “K”. Ce mouvement prône la lutte contre la pauvreté avec comme piliers : l’agriculture, l’élevage, la pêche et la culture, le tout s’appuyant sur les nouvelles technologie. Au-delà de son Sénégal natal, le mouvement se vaut africain. L’artiste longtemps sollicité par les organismes internationaux tels que le Pnud, l’Oxfam et autres se dit prêt à profiter de son riche carnet d’adresse et de ses partenaires qui il a soutenu des années durant, pour créer quelque chose de solide et qui pourra booster la pauvreté hors de ce monde
L’Artiste Sénégalais Baaba Maal vient de lancer un nouveau mouvement citoyen NANN “K”. Ce mouvement prône la lutte contre la pauvreté avec comme piliers : l’agriculture, l’élevage, la pêche et la culture, le tout s’appuyant sur les nouvelles technologie. Au-delà de son Sénégal natal, le mouvement se vaut africain. L’artiste longtemps sollicité par les organismes internationaux tels que le Pnud, l’Oxfam et autres se dit prêt à profiter de son riche carnet d’adresse et de ses partenaires qui il a soutenu des années durant, pour créer quelque chose de solide et qui pourra booster la pauvreté hors de ce monde
Le lancement officiel de NANN “K” aura lieu prochainement en présence des partenaires de développement et des bailleurs de fonds.
“Ils ont toujours utilisé ma voix, mon engagement pour atteindre la masse, il est maintenant temps pour moi d’utiliser leur force pour venir au bout de mon initiative” , déclare l’artiste devant un public qui a montré déjà son adhésion.
Hamet Ly
Le Coran, héritage de la culture grecque ? Reponse du Prof Makhtar Diouf au Prof Sankhare

Le Coran, héritage de la culture grecque ?
Réponse d’un universitaire
Notre collègue Oumar Sankharé (O.S.) a souhaité autour de son livre
‘’Le Coran et la culture grecque’’ une discussion entre universitaires. Des
musulmans, dont des universitaires, y ont déjà répondu avec brio et
pertinence. Je m’inscris dans cette voie avec le présent texte, et de façon
sereine. Ce texte s’adresse à O.S., mais aussi à tous les intégristes de
l’hellénisme qui perçoivent dans tout ce qu’ils lisent des traces d’on ne sait
quelle culture grecque.
I – Les sources lointaines et proches
« Nous avons imputé à l’Alcoran une infinité de sottises qui n’y furent jamais ».
Ainsi s’exprimait le pamphlétaire français Voltaire dans son ‘’Dictionnaire
philosophique’’ (1764). Adversaire résolu de l’Islam, mais de bonne foi, il
passait aux aveux, après avoir lu la traduction du Coran de l’arabe au
latin de Lodovico Maracci. Et Voltaire d’ajouter que « on pourrait faire un
très gros livre de toutes les imputations dont on a chargé les mahométans ». Un
des premiers gros livres de cette nature avait été de la plume même de
Maracci, ‘’Réfutation du Coran’’ en 1691. Depuis lors, on ne compte pas
les publications qui sont venues s’ajouter au panier-sottisier à l’endroit du
Coran.
C’est à l’intérieur même de l’Islam que sont venus se former des
mouvements réformistes en Egypte et en Inde au 19ème siècle et au début
du 20ème siècle. C’est leur influence qui s’est étendue aux Etats-Unis avec
la naissance il y a une trentaine d’années d’un mouvement dissident. Son
promoteur est Rashad Khalifa, un Egyptien naturalisé Américain, qui se
proclame ‘’envoyé de Dieu’’, inspiré par l’ange Jibril.
Il demande à ses adeptes d’abroger les deux derniers versets de la
sourate 9, (lakhad djâhakoum …‘’il vous est venu un prophète ?’’) et
déclare que c’est à lui qu’est adressé le troisième verset de la sourate
‘’yâsin’’ ( نَIJِ K رْ َ Gُ H نَ ا ْ Gَ ِ H كَ AD إِ (tu es certes du nombre des messagers). C’est
dans un long article de 1982 ‘’Le Coran, les hadîss et l’Islam’’ qu’il rejette
la sounna pour ne considérer comme seule source que le Coran.
A la suite de la disparition de Rashad Khalifa en 1990, le flambeau est
repris par trois de ses adeptes, tous professeurs dans des universités
américaines : Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban, et Martha Schulte-
Nafeh qui se présentent comme ‘’Coranistes’’. En 2007 ils publient leur
‘’Traduction Réformiste du Coran ‘’ de l’arabe à l’anglais : les deux
derniers versets de la sourate 9 y sont mentionnés en pointillé, mais pas
numérotés comme versets 128 et 129. C’est du rejet de la sounna que
s’installent les dérives et que prend forme la thèse selon laquelle le
prophète ( صلى الله عليه وسلم ) n’était pas non-lettré.
II – Le prophète ( صلى الله عليه وسلم) non- illettré ?
La thèse selon laquelle le prophète ( صلى الله عليه وسلم) n’était pas illettré a pour
conséquence que c’est lui qui a rédigé le Coran : il s’est donc inspiré de
sources et le texte coranique n’est pas parole divine.
Dans leur traduction du Coran, les ‘’Coranistes’’ intitulent une section :
‘’Muhammad était-il illettré ?’’. Et ils s’en prennent aux ‘’orthodoxes’’ qui,
aux versets 157 et 158 de la sourate 7 ‘’al-a’râf’’ traduisent ‘’ rassoûl
nabbiyy-il ummy’’’ ( ZG\ ُ] ا ْ ZD [ِ AD H ولَ ا K ر ُ D H ا) par ‘’ prophète illettré, ne
sachant ni lire ni écrire’’. Pour eux, écrivant en langue anglaise, la seule
traduction correcte est ‘’gentile’’ qui signifie : ‘’ni juif, ni chrétien, et
habitant la Mecque’’ ; si bien que ‘’Muhammad est un prophète gentile’’,
puisque répondant à ces trois critères.
En France, ce sont le Tunisien Youssef Seddik spécialiste de la Grèce
antique et l’Algérien Ali Merad, islamologue, tous deux professeurs dans
des universités parisiennes qui prolongent les thèses de Rashad Khalifa.
Youssef Seddik est l’auteur de ‘’Le Coran : autre lecture, autre traduction,
2002’’, et ‘’Nous n’avons pas lu le Coran, 2004’’. Ali Merad est l’auteur de
‘’L’exégèse coranique, 1998’’ et ‘’L’Islam contemporain, 2002’’. Des titres
très révélateurs de leur démarche. Ils ont pu s’appuyer sur la traduction
du Coran par Régis Blachère qui lui aussi utilise le terme ‘’gentil’’ pour
traduire ‘’ ummy’’.
Pourtant, le Centre national de ressources textuelles et lexicales (Cnrtl),
institution française, donne ces définitions du terme ‘’gentil’’ : (1) personne
étrangère à la religion juive ; (2) chrétien dans les premiers temps du
christianisme ; (3) païen.
Dans le ‘’Collins Concise English Dictionary’’ qui fait autorité dans
l’espace anglophone, on trouve ces définitions de ‘’gentile’’ : (1) chrétien
opposé à juif ; (2) pour les mormons (secte protestante américaine), toute
personne n’appartenant pas à leur église ; (3) païen ; (4) race ou religion
qui n’est pas juive.
Ce sont les mêmes définitions qu’on trouve dans le ‘’Arabic-English
Lexicon’’ (1863) de l’Anglais Edward William Lane, publié en 8 volumes
sur plus de 3000 pages. Dans le ‘’Elias Arabic English Dictionary’’, la
définition de ‘’ummy’’ est : ‘’illettré’’. Dans le ‘’Dictionnaire arabe-français
des élèves’’ de Dr Lili Maliha Fayad, la définition est : ‘’illettré’’ ; avec la
précision ‘’ne sachant ni lire, ni écrire’’. On y trouve aussi à la même page
‘’ummyat’’ : analphabétisme. Aux Etats-Unis, ce sont les chrétiens
antisémites qui se font appeler ‘’gentile’’ pour se distinguer des juifs. En
aucun cas, le prophète Muhammad ( صلى الله عليه وسلم) ne peut donc être un ‘’gentile’’. Ce
sont ces ‘’coranistes’’ qui ont inventé leur propre définition du terme pour
l’y inclure, pour montrer qu’il n’était pas non-lettré.
Si le prophète ( صلى الله عليه وسلم) sait lire, le premier mot qui lui est révélé رَأْ h ا ْ est :
‘’Lis !’’. Pour les tenants de cette thèse, comme O.S., ‘’l’infinitif’’ رَأَ h َ
(‘’qara’a’’) ne peut signifier que ‘’lire’’ ; seuls les orthodoxes comme les
ndongol’ dâra lui donnent comme sens ‘’réciter’’.
Alan Jones, professeur émérite de langue arabe à l’Université d’Oxford,
auteur d’une traduction du Coran et de nombreuses publications sur la
littérature arabe, donne comme seul sens à ‘’qara’a’’ : ‘’réciter’’ (dans le
lexique de son livre ‘’Arabic through the Quran’’, L’arabe par le Coran). Il
n’est pourtant pas un ‘’ndongo’l daara’’.
Dans le Arabic-English Lexicon de E.W. Lane, on trouve deux sens
pour ‘’qara’a’’ : (1) lire ; (2) réciter En effet, le terme ‘’qara’a’’ a les deux
sens dans la langue arabe. Dans toute langue, lorsqu’un mot a des sens
distincts, il faut le situer dans son contexte. Dans le Coran nous trouvons
deux exemples bien tranchés d’emploi de ‘’qara’a’’ dans les deux sens :
– Dans le sens de ‘’lire’’ :
كَ[َ klَ m رَأْ ِ h ا ْ
Lis ton registre écrit (Coran 17 : 14, Sahih international)
رَؤُهُ tْ AD k[ً klَ m ِ kAَ Iْ Jَ u زلَ َ \ Aَ l ُ nٰ lD o كَ َ I\ h ِرُ ِ H نَ G ؤْ ِ Ar َن H وَ
? Nous ne croirons pas ton ascension tant que tu ne nous apporteras pas un
livre que nous pouvons lire (Coran 17 : 93, traductions Sahih International).
– Dans le sens de ‘’réciter’’ :
xُ H وا َ yُ Gِ lَ Kْ kz رْآنُ َ tُ H ُرِئَ ا ْ h وَإِذَا
Lorsque le Coran est récité, écoutez- le (Coran 7 : 204, Sahih I.)
سِkAD H ا nJَ u رَأَهُ َ tْ lِ َ H هُ kAَ h رَ ْ z َ kA رْآ ً h وَ ُ
Et un Coran que Nous avons divisé pour que tu puisses le réciter aux gens
par intervalles (Coran 17 : 106, Sahih international).
On peut réciter ce qu’on a entendu, mais on ne peut lire qu’un texte
ouvert devant les yeux. Le prophète Muhammad ( صلى الله عليه وسلم) était non-lettré : il lui
a été demandé de réciter et non de lire. Le premier mot de la révélation ne
peut signifier que : ‘’Récite !’’ car il n’avait pas un texte devant lui.
O.S. cite dans sa bibliographie ‘’Une approche du Coran par la
grammaire’’ de l’orientaliste français Maurice Gloton. Celui-ci, dans un
autre texte ‘’Le Coran, parole d’Allah (avril 2008) écrit :
« Le Qur’ân est la Récitation ou re-citation de la Parole révélée ou descendue de
chez Allâh / Le Prophète ‘’non-lettré’’ reçoit la Parole de Dieu.
Du fait que le Prophète est “non-lettré”, il reçoit la Révélation dans une parfaite
disponibilité et réceptivité, sans pouvoir altérer, par une intervention individuelle,
le Message divin ainsi transmis. Le Prophète lui-même a donné une définition de
ce qu’il entendait par le terme ’ummî : “Nous sommes une Matrie non-lettrée (’innâ
’ummat ’ummiyyat, nous n’écrivons ni ne comptons“. Az-Zajjâj, commentant cette
nouvelle prophétique, transmise par Ibn `Umar, précise que ce nom
ummî concerne celui qui est resté dans la disposition en laquelle sa mère l’a mis
au monde, c’est-à-dire ne sachant ni lire ni écrire, comme à sa naissance, et
n’ayant pas encore reçu l’empreinte d’une quelconque connaissance humaine/.
L’Ange ne lui dit pas : ‘’Lis!’’, mais ‘’Récite! ‘’ (iqra’). »
Maurice Gloton n’est pas lui non plus un ndongo’l dâra.
Une fois posé le postulat que le prophète ( صلى الله عليه وسلم) n’est pas non-lettré, que
c’est lui qui a rédigé le Coran, il faut bien lui découvrir des sources dont
comme tout chercheur, il s’est inspiré. Pendant longtemps on lui a inventé
des sources chrétiennes et juives. On va lui trouver maintenant des
sources dans la pensée grecque. Pour puiser à toutes ces sources, il lui
aurait fallu connaître l’hébreu, l’araméen, le syriaque, le grec ? etc. Ce
qui est un non-sens.
III – Les soi-disant sources grecques du Coran
Youssef Seddik soutient que le Coran est l’héritage de la culture
grecque. Ce que O.S. reprend dès la préface de son livre : « Les Arabes
s’étaient déjà familiarisés avec la culture grecque qui constitue indéniablement une
des sources les plus importantes du Coran ». Il parle même de « grécité
coranique » et donne quelques exemples.
1. Alexandre le Grand dans le Coran sous le nom de Zul-Qarnayn ?
L’influence de la culture grecque dans le Coran se serait manifestée par
la mention de Zul-Qarnayn (sourate 18, versets 83-98), car il ne s’agirait
que du souverain grec Alexandre le Grand. Selon O.S. « Dieu mentionne
Alexandre le Grand dans le Coran ». O.S. va jusqu’à dire que « Dieu dans son
dessein a choisi Alexandre, l’élève d’Aristote, pour déclarer la fin de la mission
prophétique pour la relayer par la mission philosophique » (p. 185).
L’assimilation de Zul-Qarnayn avec Alexandre le Grand a duré
longtemps, même chez bon nombre de musulmans. Cependant, des
opinions différentes ont été émises sur ce personnage historique. Selon
l’Encyclopédie juive et l’Encyclopédie britannique, Zul-Qarnayn n’est autre
que le roi perse Cyrus qui régnait à l’Est et à l’Ouest. Le personnage
homme de foi juste décrit dans le Coran ne pouvait pas correspondre à
Alexandre le Grand qui était un païen croyant aux divinités grecques.
Cette dernière thèse est largement acceptée maintenant.
Pour Abdallah Yussuf Ali, traducteur exégète du Coran de l’arabe à
l’anglais, il n’y a pas lieu de se polariser sur la réalité historique du
personnage : Sa mention dans le Coran est une parabole dont il ne faut
retenir que la signification spirituelle.
2. Parménide source de la sourate ‘’al-ikhlâs’’ ?
O.S. soutient que la sourate (112) ‘’al-ikhlâs’’ du Coran se trouvait déjà
chez le philosophe grec Parménide : « Six siècles avant JC, il (Parménide)
vous dit ceci : «Dieu est incréé, Il n’a pas été engendré, Il n’a pas d’associé. Il est
l’Unique ».
Voyons ce que dit Parménide (traduction de G.M. James) : « II n’est plus
qu’une voie pour le Discours, c’est que l’être soit ; par là sont des preuves
nombreuses qu’il est inengendré et impérissable, universel, unique, immobile et
sans fin. I1 n’a pas été et ne sera pas ; il est maintenant tout entier, un, continu ».
Dans ce texte de Parménide qui est un court poème intitulé ‘’De la
Nature’’, où est-il question de Dieu, de création, d’associé, comme le dit
O.S. ? Pour les besoins de sa ‘’démonstration’’, O.S. fait dire au
philosophe ce qu’il n’a pas dit.
Et que dit la sourate ‘’al-ikhlâs’’ ? : « Dis : Il est Allah (qui est) Un. Allah
l’Eternel refuge. Il n’a pas engendré et n’a pas été engendré. Et nul ne Lui est
égal. » (traduction Sahih International).
Selon l’helléniste et philosophe guyanais George G. M. James, les
spécialistes s’accordent pour admettre que le texte de Parménide est
seulement une réponse au philosophe Héraclite connu pour sa dialectique
du mouvement et du changement : tout change dans la vie, tout est animé
de mouvement ; on ne se baigne jamais dans le même fleuve, car l’eau se
renouvelle constamment.
Ce à quoi Parménide rétorque que la vérité consiste à connaître que
l’être est, et que le non-être n’est pas, donc l’être est seul et unique, non
reproductible, inchangé, indivisible. L’être concerne toutes les choses :
leurs particularités, différentiations et mouvements ne sont qu’illusion. Là
où Parménide dit : « il n’a pas été et ne sera pas », cela signifie tout
simplement : « il est immobile, il est sans mouvement ».
Parménide passe pour être difficile à comprendre. Le premier à le
reconnaître est Platon : « Parménide me paraît être, selon l’expression
d’Homère, ‘’ à la fois vénérable et redoutable’’. J’ai approché l’homme quand
j’étais bien jeune encore et lui bien vieux, et il m’a paru avoir une profondeur d’une
rare qualité. Aussi j’ai peur que nous ne comprenions pas ses paroles et que sa
pensée ne nous dépasse bien plus encore (Théétète, 183e-184a, traduction Emile
Chambéry, 1967).
Le philosophe français Serge Thibault trouve « la compréhension de
Parménide ardue / une pensée extrêmement difficile d’accès, ce qui a engendré
un véritable quiproquo philosophique » (Klexis, Revue philosophique, 2010). Le
quiproquo est une erreur qui fait prendre une chose pour une autre. C’est
ce qui est arrivé à O.S., lui qui a compris Parménide, même mieux que
Platon, pour en faire l’inspirateur de la sourate ‘’al-ikhlâs’’.
C’est encore Serge Thibault qui dit que, avec sa philosophie de l’être,
« Parménide est probablement le philosophe qui a le plus marqué la philosophie
occidentale ». Comment pourrait-il alors inspirer le monothéisme pur de la
sourate ‘’al-ikhlâs’’ ?
3. La mythologie grecque dans le Coran ?
O.S. sans même relater l’évènement, nous dit que l’histoire de
Pénélope racontée dans la mythologie grecque par Homère se trouve
dans le Coran. De quoi s’agit-il ? Pénélope était l’épouse du roi Ulysse.
Durant la longue absence de son mari, selon Homère, elle a éconduit tous
les dignitaires qui l’invitaient à l’adultère, avec la promesse qu’elle
acceptera dès qu’elle aura fini de tricoter une pièce de vêtement ; mais
dans la nuit, elle défaisait tout ce qu’elle avait tricoté dans la journée ;
c’est par ce stratagème qu’elle aurait préservé sa fidélité.
O.S. reproduit ainsi sa version du verset 92 de la sourate 16 : « Ne
faites pas comme cette femme qui défaisait la nuit ce qu’elle avait tissé le jour pour
tromper son entourage ».
Le verset se présente ainsi : « Ne soyez pas comme celle qui détordait la
toile qu’elle avait solidement tissée, en prenant vos serments pour vous tromper
entre vous parce qu’une communauté est plus puissante (en nombre ou en
richesse) qu’une autre » ( Sahih international).
Où figurent le jour et la nuit, l’entourage, dans le verset ? On voit que
O.S. s’emploie à faire un placage entre le texte de Homère et le texte
coranique qu’il traduit à sa manière et incomplètement.
Dans le verset précédent 91, il est commandé aux musulmans de rester
fidèles au pacte d’Allah après l’avoir contracté, et de ne pas violer leurs
serments. Par-delà l’aspect universel du verset, il comporte sa particularité
de ‘’asbâb al – nuzûl’’: George Sale, premier traducteur du Coran du latin
à l’anglais en 1734 nous dit que la femme apostrophée dans ce verset est
Raita Bint Saad Ibn Taim de la tribu des quraïches qui, après sa
conversion à l’Islam avait apostasié. Cela semble confirmé par les versets
94 et 95de la même sourate 16. Donc, rien à voir avec Pénélope.
Les Sénégalais qui lisent ce verset pourraient plutôt penser à cette
transhumance politique bien de chez nous. Ce qui témoigne encore de
l’actualité du Coran qui est décidément de tous les temps.
4. ‘’L’Allégorie de la caverne’’ de Platon dans le Coran ?
Selon O.S. c’est Platon dans le livre 7 de ‘’La République’’ qui a inspiré
les versets 9 à 31 de la sourate 18 ‘’al- ahkaf’’ (la caverne).
Voici ce que dit Platon : « Visualise donc des hommes comme dans une
habitation souterraine ressemblant à une caverne ayant l’entrée ouverte à la
lumière sur toute la longueur de la caverne, dans laquelle ils sont depuis l’enfance,
les jambes et le cou dans des chaînes pour qu’ils restent en place. Examine
maintenant, repris-je, leur délivrance et leur guérison des chaînes de la déraison et
qu’il croirait les [choses] vues auparavant plus vraies que celles maintenant
montrées. Si alors, repris-je, de là quelqu’un le tirait de force tout au long de la
montée rocailleuse et escarpée, et ne le lâchait pas avant de l’avoir tiré dehors à la
lumière du soleil. Et celui qui entreprendrait de les délivrer et de les faire monter, si
tant est qu’ils puissent le tenir en leurs mains et le tuer, ne le tueraient-ils pas ? À
toute force !dit-il » (traduction de Bernard Suzanne).
Ce que Platon présente ici c’est sa théorie de l’acquisition des
connaissances qui exige un travail intense et soutenu. Il le fait en usant
de l’allégorie qui consiste à exprimer une idée par une image. L’helléniste
George James nous dit que Platon avait acheté ce texte à Pythagore et
que, si Pythagore parle de caverne, c’est parce que comme le maître qui
l’a formé, il enseignait dans une caverne.
Il serait trop long de reprendre ici la vingtaine de versets du Coran
relatifs aux compagnons de la caverne. Ce que raconte le Coran, c’est le
temps où à Rome, les chrétiens étaient persécutés. Un groupe de jeunes
chrétiens se réfugie dans une caverne avec leur chien. Allah les endort
pendant des années, et lorsqu’Il les réveille, ils croient n’avoir dormi que
quelques heures. L’un d’eux va en ville et constate les changements
(habillement, monnaie ? et.). Mais le changement le plus important est
que le Christianisme est devenu à Rome religion d’Etat et que ces jeunes
n’ont plus rien à craindre.
Quiconque fait la confrontation des versets du Coran avec le texte grec
verra qu’ils sont différents, tant dans leur présentation que dans leurs
enseignements. Celui-ci ne mentionne pas de chien, et le Coran ne parle
pas de chaînes, pour ne donner que ces exemples. Le Coran dégage ici
au moins trois enseignements : la relativité du temps ; la réalité de la
résurrection ; le secours divin pour les endurants.
A supposer que le prophète ( صلى الله عليه وسلم) ait été lettré et qu’il ait été l’auteur du
Coran, ce n’est sûrement pas avec ce texte grec qu’il aurait pu rédiger ces
versets de la sourate ‘’al -ahkaf’’.
5– A propos des emprunts linguistiques du Coran
« Le Coran est rempli d’emprunts linguistiques, c’est-à-dire de mots nonarabes
». C’est ce que dit O.S. en reprenant Youssef Seddik. Il s’agit là
d’un des procédés utilisés pour tenter de désacraliser le Coran, et il est
très ancien. Au 15ème siècle, l’imam As-Suyuti dans ’’al-mutawakkil’’ (cité
par Catherine Pinnachio) y avait ainsi répondu : il existe dans le Coran, en
ce qui concerne la racine, des mots perses, hébreux, abyssiniens, syriens,
grecs ? etc. mais ces mots ont été intégrés à la langue arabe,
naturalisés, et sont devenus arabes bien avant la révélation. Le Coran
étant adressé aux Arabes dans un premier temps ne peut leur être
présenté que dans les formes linguistiques qu’ils comprennent.
Cependant le problème est remis à l’ordre du jour en 1938 par
l’orientaliste australien Arthur Jeffrey avec son livre ‘’The Foreign
Vocabulary of the Qur’ân’’, (Le vocabulaire étranger du Coran). Il y
recense pas moins de 275 mots étrangers.
En 2011, Catherine Pinnachio, linguiste spécialiste des langues
sémitiques et professeur de langue hébreu, s’appuie sur la rigueur des
méthodes scientifiques actuelles pour contester le livre de Jeffrey. Dans
son article ‘’ Les emprunts lexicaux dans le Coran » publié par le Bulletin
du Centre de recherche français à Jérusalem, elle développe les
arguments suivants : (1) beaucoup de mots identifiés par Jeffrey et ses
prédécesseurs comme étrangers sont en fait arabes ; (2) d’autres mots
sont communs aux langues sémitiques comme l’arabe et ne peuvent donc
être des emprunts : c’est le cas entre autres pour ‘’habl’’ (corde), ‘’hinzir’’
(porc), ‘’zaït’’ (huile), ‘’tîn’’ (figue), ‘’ankabout’’ (araignée) ? etc. ; (3) les
emprunts linguistiques sont propres à toutes les langues, et il existe des
‘’mots voyageurs’’.
Dans sa thèse de Doctorat ‘’ Etude du vocabulaire commun entre le
Coran et les Ecrits juifs avant l’Islam’’ (Inalco, Paris, février 2011) elle
écrit : « L’emprunt est un phénomène à la fois linguistique et historique ».
Catherine Pinnachio, se plaçant sur le terrain strictement scientifique,
reconnaît que : « Le linguiste éprouve une difficulté réelle à déterminer l’origine
du vocabulaire technique religieux du Coran / Les découvertes linguistiques du
XXe siècle, notamment l’ougaritique en 1928 et l’épigraphie nord-arabique et sudarabique,
qui révèlent des milliers d’inscriptions, nous invitent à un nouvel examen
des emprunts lexicaux coraniques/ Elles permettent d’attester de l’ancienneté
d’un terme dans la langue arabe ».
Cheikh Anta Diop avait auparavant attiré l’attention sur le caractère
mixte des langues sémitiques : « C’est ainsi qu’on rencontre des racines
communes aux langues arabes, hébraïque, syriaque, et aux langues
germaniques » (‘’Nation nègres et culture, tome 1, p. 196).
Il n’existe aucun argument scientifique pour remettre en cause la nature
arabe du Coran (sourate 41, verset 3). Et puis, les différentes langues ne
nous viennent-telles pas du Créateur ? Le Coran nous le suggère bien
dans le verset 31 de la sourate 2 : « Et Il (Allah) instruisit Adama des noms de
toutes choses ».
IV – Des fautes de grammaire dans le Coran ?
O.S. s’abrite sous le parapluie de son mentor Youssef Seddik pour
traquer avec lui des fautes de grammaire dans le Coran. Mais ils n’en
signalent qu’une seule, au verset 12 de la sourate دَ : 7 .ُ Kْ l َ .D كَ أَ yَ Aَ G َ kG . َ
A la page 138, il se contente de reprendre Youssef Seddik qui en fait cette
translitération en lettres latines : « Mâ manahaka allâ tasdiouda ? » Ce qu’il
donne en traduction française : « Qu’est-ce qui t’a empêché de (ne pas) te
prosterner ? » ; pour eux, c’est ‘’ne pas’’ (‘’allâ’’ dans le texte coranique) qui
est de trop. O.S. rectifie ainsi : « Ma manahaka an tasdjouda ? Ce qui donne :
« Qu’est-ce qui t’a empêché de te prosterner ? ». Et il s’étonne avec Y. Seddik
que personne n’ait relevé cette faute (p. 138). Il a dû se dire que Seddik a
raison, puisqu’il est arabe.
Pourtant O.S., à la page 117 rappelle que la première grammaire arabe
est née sous le règne du khalife Ali, donc des décennies après la
révélation. Mais il se garde de dire que le Coran est la source, la base de
la grammaire arabe.
(1) Ce que ces hellénistes n’ont pas compris est que le terme ‘’a-llâ’’ ici
est composé de ‘’an + lâ’’ : la lettre n est avalée dans la contraction,
comme cela est fréquent dans certains versets coraniques (comme au
verset 1 de la sourate 78 : ‘’ammâ’’ = ‘’an + mmâ’’).
(2) Ensuite, ce ‘’a-llâ’’ ne renvoie pas à une négation, mais à une
affirmation–insistance. Nous en avons d’autres exemples dans le Coran :
4 : 3 ; 6 : 25 ; 7 : 105. 21 : 95 ; 75 : 1 ; 90 : 1. O.S. pour mieux
comprendre, devrait se reporter à ces versets.
O.S. cite dans sa bibliographie le livre du Pakistanais Yusuf Ali ‘’The
Holy Quran’’ (le Saint Coran) qui est une traduction exégèse du Coran de
l’arabe à l’anglais. Les sourates 75 et 90 commencent toutes deux par ‘’Lâ
ouqsimou’’. Yusuf Ali traduit ainsi : ‘’I do call to witness’’ (Je témoigne). Dans
la langue anglaise, lorsque ‘’do’’ est employé dans une affirmation, c’est
pour marquer l’insistance.
Ce ‘’lâ’’ s’inscrit tout simplement dans ce qu’on appelle une figure de
style , ou de rhétorique, qui modifie le langage ordinaire pour le rendre
plus expressif, créer un effet de sens, voire de sonorité. Les grammairiens
et linguistes s’accordent pour admettre que chaque langue a ses propres
figures de style ; ce qui peut poser parfois des problèmes de traduction.
Lorsqu’en 1919 en France, Gustave Flaubert est accusé de commettre
des fautes, ce sont les meilleures plumes de l’époque qui remettent les
pendules à l’heure. Marcel Proust estime que Flaubert n’a pas commis de
faute, il a développé une manière de s’exprimer qui n’appartient qu’à lui.
Céline lui, dira que chez un auteur, il n’y a que le style qui compte.
Depuis quelques décennies on parle de miracles scientifiques du
Coran : des propos émis par le Coran et confirmés des siècles après par
des découvertes scientifiques. Ces miracles du Coran viennent en
seconde position et se situent au niveau du contenu. Le premier miracle
du Coran se situe au niveau de la forme, c’est-à-dire le style du texte qui
est unique et qui avait émerveillé les Arabes contemporains de la
révélation, amoureux de l’art oratoire, de l’éloquence. O.S. lui-même
admet que « le Coran représente un livre inimitable » (p. 180). Aucun Arabe,
poète ou prosateur, n’est jamais parvenu à s’exprimer dans le style du
texte coranique.
Dans son chapitre 18, sur 28 pages, O.S. présente 33 figures de style
en prenant des versets du Coran comme exemples. Dans son chapitre 15
sur la Syntaxe, à la page 137, il présente la prolepse comme « une forme
de mise en relief et d’insistance » et cite le verset 17 de la sourate 88,
ainsi donné en translitération :
Afalâ yanzurûna ilal ibil kayfa khulikhat
Et il donne la traduction de Hamidullah :
Ne considèrent-ils donc pas les chameaux comment ils ont été créés ?
Dans le langage ordinaire, on aurait plutôt dit : « ? comment les
chameaux ont été créés », le ‘’ils’’ étant de trop. Mais ici, O.S. ne fait pas
de rectification, car il lui faut justifier la prolepse d’une phrase grecque qu’il
traduit ainsi : « Il dit l’enfant qu’il est beau ». Dans le langage ordinaire,
n’aurait-on pas dit : « Il dit que l’enfant est beau » ? Le second ‘’il’’ n’est-il
pas de trop ? La prolepse est aussi une figure de style.
Youssouf Seddik et O.S. ne savent pas que les grammairiens et
linguistes de la langue arabe ont depuis longtemps discuté sur ces termes
qui paraissent de trop. Le ‘’lâ’’ des versets cités plus haut est considéré
par certains comme une figure de style exprimant l’insistance ; d’autres le
considèrent comme un ‘’lâm extra’’ ( م. و …….JH ا) qui peut être sauté, sans
incidence sur le texte. Même un apprenant en langue arabe peut
comprendre ces subtilités grammaticales.
D’ailleurs dans le Coran, lorsque l’insistance n’est pas de mise, le ‘’lâ’’
n’est pas employé. Avec une lecture complète et attentive du Coran ces
hellénistes seraient parvenus à la sourate 38, verset 75 où il est dit,
toujours à l’adresse de Ibliss :
دَ.ُ Kْ l كَ أَن َ yَ Aَ G َ kG َ
Mâ manahaka an tasdjouda
L’insistance ayant été faite une première fois (sourate 7, verset 12), il
n’était pas nécessaire de la reprendre ici. Le terme ‘’manaha’’
(‘’empêcher’’, parfois ‘’refuser’’) figure 10 fois dans le Coran (2 : 114 ;
7 :12 ; 9 :54 ; 12 :63 ; 17 :59 ; 17 :94 ; 18 :55 ; 20 :92 ; 38 :75 ; 107 :7). Le
verset 12 de la sourate 7 est le seul où il est suivi de ‘’allâ’’, pour marquer
l’insistance.
A la page 180, O.S. écrit : « En définitive le Coran représente un livre
inimitable/ ». Mais comme sa grécité ne peut pas le quitter, il ajoute : « /
tant ses beautés littéraires puisées dans les fleurs de la rhétorique grecque brillent
d’un éclat à nul autre pareil ». Comprenne qui pourra ! Le Coran est la copie
de textes grecs dans le contenu comme dans la forme, tout en étant
inimitable. Pourtant aucun texte grec ne nous est dit inimitable ; la copie
serait donc meilleure que l’original ? Décidément O.S. passe son temps à
se marcher sur les pieds sans s’en apercevoir.
V – Incohérences et erreurs ‘’géniales’’ de l’helléniste
Les incohérences de O.S. apparaissent dès la préface. Comment peuton
prendre comme préface d’un livre un texte pris dans un quotidien, non
vérifiable, dans la mesure où son présumé auteur Amadou Samb n’est
plus de ce monde ? Ce n’est pas ce musulman que j’ai connu de près qui
(bien que formé aux Lettres classiques), aurait approuvé les thèses de ce
livre. Encore moins Serigne Abdou Aziz Dabakh (RAH) qui y est
maladroitement cité. Une préface est écrite pour présenter un auteur et
son texte. Ce qui n’est pas le cas ici.
Ce n’est pas le seul point où O.S. est en rupture avec la bonne tradition
universitaire : il fait des citations d’auteurs sans indication de page ; il met
en bibliographie des manuels, ce qui ne se fait pas. Espérons que ce n’est
pas avec le manuel de H. Atoui ‘’Arabe langue vivante’’ destiné aux élèves
des lycées (cité en bibliographie), que se situe son niveau de maîtrise de
la langue arabe pour traquer des fautes (ou plutôt une faute) dans le
Coran.
O.S. écrit que lorsqu’il montre la similitude entre les cultures hellène et
arabo-musulmanes il ne s’agit pas pour lui de « prétendre que la Grèce en est
l’origine. Certains faits de civilisation se perdent dans la nuit des temps et
appartiennent souvent à des ères culturelles et cultuelles beaucoup plus
anciennes, comme l’Egypte pharaonique. Souvent la Grèce ne représente qu’un
relai dans la longue chaîne de transmission des civilisations (p.17-18) ».
Admirable aveu ! Mais il ne s’agit là que d’une clause de style, c’est-àdire
une affirmation sans conséquence. Ce qui trahit son incohérence, car
que lit-on après ? :
« Dès lors la bédouinité arabe cède la place à la citoyenneté grecque » (p. 57)?
Le Coran se présente comme un ‘’dhikr’’, un rappel. N’est-ce donc pas la mémoire
de l’antiquité grecque que restitue le Coran ? / Quand le lecteur du Coran tombe
sur la description du Paradis, il ne peut s’empêcher de penser aux banquets grecs
(p. 67)? C’est la figure de Platon qui est omniprésente dans le Coran (p. 107). Il
se montre même très sûr de son fait : « La présence de la culture grecque qui
est le sujet de ce livre ne pourra désormais plus être mise en doute » (p.183).
Son incohérence se situe dans le fond comme dans la forme. Ce qui
l’amène à ne pas respecter l’uniformité dans la transcription des termes : il
écrit ‘’dhikr’’ (p. 17) et ‘’zikr’’ (p.183). Quant au prophète ( صلى الله عليه وسلم), il est
Mohamed (pp. 16, 19, 22), Mouhamed (p. 23), Muhammad (p. 51),
Mahomet (p. 183). Il n’a droit à la prière recommandée par le Coran (33 :
56) que dans la conclusion, en ces termes : « Prophète Mahomet (Psl) ».
Mais le plus grave est que son texte renferme des erreurs qui
procèdent simplement d’une lecture fautive du Coran.
A la page 34, O.S. écrit que « le mythe de la femme fatale à l’homme existe
aussi bien chez les Grecs que dans le Coran » ; et il parle de « la chute d’Adam et
de son épouse qui aurait eu pour nom Hawa » ; c’est ajoute-t-il, « la tradition qui
raconte que c’est Hawa qui aveuglée par Satan et poussée par la curiosité
persuada son époux de goûter au fruit de l’arbre défendu ». Il assimile Hawa à
une femme de la mythologie grecque appelée Pandore. D’abord le nom
Hawa ne figure nulle part dans le Coran. Ensuite, il n’est pas dit dans le
Coran que c’est Hawa qui a poussé son mari à la faute. O.S. dit se référer
à la tradition. Quelle tradition ? Il déclare ne se fonder que sur ce qui est
universel, le Coran, et que c’est pour cela qu’il ne prend pas le reste. La
punition infligée à Adama et à Hawa descendus du paradis à la terre n’est
pas présentée dans le Coran comme une malédiction. D’ailleurs ils ont
ensemble demandé pardon, ce qui leur a été accordé, (Copran 7 :23). Si
bien que le péché originel n’existe pas dans l’Islam.
Dans son texte, O.S. parle beaucoup d’enfants jumeaux de la
mythologie grecque en faisant des parallèles avec des récits du Coran.
Les jumeaux (en arabe ْkG وْأَ َ lَ Aِ ) ne sont mentionnés nulle part dans le
Coran.
Pour O.S. « un autre pilier de l’Islam serait d’origine grecque. Il s’agit de la
zakâte (‘’az-zakât’’) ». D’abord, pourquoi ‘’serait d’origine grecque’’ et pas
‘’est d’origine grecque’’ ? La certitude se mettrait-elle à flancher ? Il ajoute
qu’il s’agit « d’offrir la dixième partie de son revenu, dixième venant du grec
‘’dekatos’’ » (p. 49). C’est là qu’on voit que O.S. est loin de maîtriser son
sujet. L’assiette de la zakât n’est pas le revenu, mais la richesse, et la
base imposable est constituée par une partie de la richesse : ce que le
Coran appelle ‘’al afwâ’’, c’est-à-dire le surplus au-delà des besoins
(Coran 2 : 219) ; ensuite, le dixième (1/10) ne concerne que les récoltes
arrosées par l’eau de pluie ou par les cours d’eau ; dans le cas de culture
irriguée, c’est le vingtième (1/20) qui est donné sur les récoltes (Sahih
Muslim, n° 2143). Il ne s’agit là que du paiement en nature. Dans le cas
de paiement en espèces, la zakât est de « 1 dirham pour chaque 40
dirhams » (Sunan Abu Daoud, book 003, n° 1556) : soit 2,5 pour cent, le
taux tout à fait approprié dans une économie fortement monétarisée. Ces
taux ne figurent pas dans le Coran, ils ont été fixés par le prophète ( .(صلى الله عليه وسلم
Pourtant O.S. en toute modestie, écrit que « la compréhension de la
Révélation exige la maîtrise d’une culture encyclopédique » (p. 16). Dont il serait
certainement dépositaire. Ce n’est pas le pédantisme qui est absent dans
ce livre. Qu’est-ce-que le théorème de Pythagore qu’il cite (« Dans un
triangle rectangle, le carré de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des
côtés de l’angle droit » p. 103) a à voir avec tel ou tel verset du Coran ?
VI – Mystique de la culture grecque
Pour comprendre O.S., ce qui ne signifie pas le justifier, il faut faire un
détour par l’hellénisme.
Le terme ‘’hellène’’ est synonyme de ‘’grec’’ (Hellen est un personnage
de la mythologie grecque). L’hellénisme est présenté comme l’étude de la
civilisation grecque antique. Mais l’hellénisme est devenu une attitude
d’adoration, de vénération, d’adulation, de sublimation, de dévotion de la
culture grecque, au point d’en faire un culte. Le géographe français Michel
Bruneau présente l’hellénisme comme une façon de vivre, d’appréhender
la nature et la culture, une façon de croire, une idéologie (Géocarrefour
2002, vol 77/4, p.p. 319-328).
Certains intellectuels formés aux Lettres classiques (grec, latin) sont
souvent subjugués par la pensée de la Grèce antique au point d’en faire
leur modèle de référence, si ce n’est unique, pour tout ce qui touche aux
choses de l’esprit. Même si leur éducation familiale s’est faite dans l’une
ou l’autre des confessions révélées.
Des historiens allemands ont été parmi les pionniers de la promotion de
l’hellénisme au 19ème siècle. C’est dans ce terreau que les dignitaires
nazis vont puiser pour s’estimer être les héritiers légitimes de la civilisation
de la Grèce antique. L’historien français Johann Chapoutot, dans un
article ‘’ Régénération et dégénérescence : la philosophie grecque reçue
et relue par les nazis’’, montre comment Hitler a mis à contribution ses
hellénistes pour récupérer la civilisation grecque et en faire le socle de la
doctrine nazi de la race aryenne nordique supérieure (Revue Anabases,
n° 7, mars 2008, p. 141-161, 2008). Hitler lui-même déclarant : « Nous
devons conserver aussi dans toute sa beauté l’idéal grec de civilisation /. Cette
civilisation a duré des milliers d’années, elle embrasse l’hellénisme et le
germanisme ».
On voit ainsi à quelles dérives peut mener la sublimation de la pensée
grecque antique.
En France, l’helléniste tunisien Youssef Seddik adopte la même
démarche : dans le Coran, il ne voit qu’une imprégnation de la culture
grecque. Notre collègue O.S. trouve beaucoup de similitudes entre le
Coran et la culture grecque. Je trouve moi, beaucoup de similitudes, trop
même, entre ses propos et ceux de l’auteur tunisien qu’il cite (p. 15, 110,
138) et à qui il rend hommage comme pionnier (p.16). Comme si cela ne
suffisait pas, il met aussi à contribution deux orientalistes islamophobes, le
Belge Michel Cuypers et la Française Geneviève Gobillot, coauteurs de
‘’Le Coran’’ (2007) qu’il cite à profusion (p. 89, 90, 143).
N’oublions pas que O.S. a toujours été un grand admirateur de L.S.
Senghor avec qui il partageait l’idéologie helléniste. Senghor qui, même
lorsqu’il menait la vie dure aux marxistes sénégalais du PAI déclarait avoir
une grande admiration pour Marx, parce que celui-ci lisait Platon et
Aristote dans le texte en grec.
Lorsque Senghor dans ‘’Ce que l’homme noir apporte’’ (1939) dit que
« l’émotion est nègre, la raison est hellène », il soulèvera un tollé d’indignation
chez l’intelligentsia africaine. Il lui sera reproché d’inférioriser les Africains,
pour se mettre au niveau de ce grand admirateur de la culture grecque,
Arthur Gobineau, qui dans son ‘’Essai sur l’inégalité des races humaines
(1853-55) écrivait : « le nègre est la créature humaine la plus énergiquement
saisie par l’émotion artistique ». En fait, Senghor avait pastiché le misogyne
Aristote qui voyait en la femme un centre d’émotion et en l’homme un
centre de raison. Lors de l’inauguration de l’Université de Dakar en
décembre 1959, Senghor déclare : « Il n’est pas question d’abandonner
l’héritage gréco-latin, celui d’Aristote et de Descartes ». Parce que « elle n’est
pas étrange, cette rencontre du Nègre et du Grec ». Senghor a beaucoup
déteint sur O.S.
C’est un hellénisme outrancier qui pousse celui-ci à de véritables
élucubrations fantaisistes sur le texte coranique. Là où le Coran (2 : 223)
dit : « Vos épouses sont pour vous un champ de labour / », O.S. y va de son
interprétation : « Cette métaphore agricole ne peut être comprise que si on la met
en rapport avec la civilisation grecque et sa conception du mariage qui permet
d’assurer à l’homme une descendance’’ (p. 167). Là où le Coran dit que « Allah
a fait pénétrer la nuit dans le jour, et a fait pénétrer le jour dans la nuit » (34 : 29 ;
57 : 6), O.S. conclut : « C’est le Coran même qui assimile Allah au dieu grec
Helios. » (p. 48).
Si ce n’est pas du délire, ça y ressemble ! Pendant qu’on y est,
n’aurions-nous pas nous autres Africains, les Grecs comme ancêtres,
et non les Gaulois, comme on nous l’enseignait à la Coloniale ?
Ces rappels étaient nécessaires pour montrer à quelles dérives ont pu
mener le culte effréné de la civilisation grecque. Hier, comme aujourd’hui.
Rien d’étonnant donc qu’à un moment donné le Coran se trouve dans le
collimateur de ces fous de la culture grecque.
VII – Démystification de l’hellénisme
Cheikh Anta Diop dans ‘’Nations nègres et cultures’’ (1954) est le
premier à nous ouvrir les yeux sur cette mystique de la pensée grecque de
l’Antiquité. S’appuyant sur les témoignages d’historiens de l’époque,
grecs comme Diodore et Strabon, latin comme Pline l’Ancien, il nous dit
que les plus grands penseurs grecs, philosophes (Socrate, Platon,
Aristote), mathématiciens (Pythagore et Thalès) ont été formés dans
l’Egypte pharaonique nègre qui a été l’institutrice de la Grèce. Il s’y étend
plus dans ‘’’Antériorité des civilisations nègres (1967), et dans son dernier
ouvrage ‘’Civilisation ou Barbarie. Anthropologie sans complaisance’’
(1981).
C’est la même année 1954 que paraît aux Etats-Unis le livre du
Guyanais George G.M. James ‘’Stolen Legacy. Greek Philosophy is
Stolen Egyptian Philosophy’’ (Héritage volé. La philosophie grecque est la
philosophie égyptienne volée). George James est alors professeur de
grec, de latin et de mathématiques à l’Université d’Arkansas. En plus de
sa connaissance de l’Antiquité grecque et de l’ancien grec, il s’est appuyé
sur les travaux d’historiens de la philosophie (Eduard Zeller, William
Turner ?), d’historiens de la Grèce antique (John Kendrik, C.H. Vail, Eva
M. Sanford, F.M. Barber?), et d’historiens des mathématiques (W.W. Ball
et Florian Cajori).
Selon James, les premiers penseurs grecs comme Pythagore,
Parménide et Thalès sont nés en Ionie en Asie mineure (une partie de
l’actuelle Turquie), alors sous tutelle égyptienne. De là ils ont transité à
Elée en Italie avant d’aller à Athènes.
La génération suivante des Socrate, Platon, Aristote ? a effectué le
déplacement en Egypte pour s’y former auprès des prêtres de l’Ecole des
Mystères. Et à la suite de l’invasion de l’Egypte par la Grèce sous
Alexandre le Grand, la Bibliothèque Royale d’Egypte est transférée à
Athènes. Les Grecs se livrent alors à un véritable pillage littéraire des
écrits égyptiens. C’est Aristote qui a fait de Platon l’auteur de ‘’La
République’’, mais son véritable auteur est Protagoras qui a fait toutes ses
classes en Egypte.
La situation de troubles internes qui prévalait à Athènes et le conflit
avec la Perse n’offraient pas un climat apaisé pour une réflexion
intellectuelle débouchant sur une grande philosophie. Les penseurs grecs
n’ont fait que copier et compiler des écrits égyptiens disponibles dans
cette bibliothèque. Ils étaient d’ailleurs, comme Platon et Aristote,
persécutés par les autorités d’Athènes qui leur reprochaient de véhiculer
dans le pays des idées étrangères.
On nous a toujours enseigné, dit G.M. James, que Socrate a enseigné
Platon qui a enseigné Aristote : rien de cela n’est vrai ; la source
commune à tous est la science égyptienne. C’est l’Egypte du temps des
pharaons qui a civilisé la Grèce. Cette étude d’un intellectuel pourtant
formé à l’hellénisme devrait contribuer à faire tomber la culture grecque de
ce piédestal qui a voulu en faire le berceau de la civilisation de l’humanité.
Platon lui-même dans ‘’Timée’’ relate le séjour à Saïs en Egypte de
Solon, le plus sage des sept sages de la Grèce antique. Il y est question
de son entretien avec un vieux prêtre. Celui-ci lui dit ‘’qu’auprès de leur
science (à eux Egyptiens) la sienne et celle de tous ses compatriotes grecs n’était
rien’’, et d’ajouter : ‘’vous autres Grecs vous serez toujours enfants, vous ne
possédez aucune vieille tradition ni aucune science vénérable par son antiquité’’.
S’il en est ainsi, c’est parce que ‘’Athènes excellait dans la l’art de la guerre et
dans la confection des lois. Et puis le déluge a tout détruit ne laissant survivre que
des hommes sans lettres et sans instruction / de sorte que vous voilà de nouveau
dans l’enfance. Alors qu’ici en Egypte, se trouve la science ’’ (Timée, texte Internet,
p. 1-14, traduction de Victor Cousin).
Témoignage ne saurait être plus éloquent. La civilisation n’est pas née
dans la Grèce antique qui a tout importé, et qui ne pouvait avoir quelque
rapport que ce soit avec le Coran. O.S. aurait pu, ordinateur à l’appui,
découvrir que l’Egypte sous son nom arabe ‘’misr’’ est cité 5 fois dans le
Coran, et la Grèce pas une seule fois.
Le Pakistanais Abdallah Yusuf Ali a enseigné l’histoire de la Grèce
antique dans des universités britanniques, avec à son actif de
nombreuses visites de sites historiques grecs. Mais il n’a décelé aucune
trace de culture grecque dans le Coran. Sa traduction exégèse du Coran
de 1850 pages (1934, et deux rééditions) fait autorité dans l’espace
linguistique anglophone.
En conclusion
Les textes grecs (et latins) présentés par O.S. n’ont, dans le meilleur
des cas, qu’un lointain rapport avec les versets du Coran auxquels il fait
allusion. Même dans le cas de similitude parfaite entre deux textes, il n’est
pas dit qu’il y a eu emprunt ou plagiat. La même année 1954, le
Sénégalais francophone Cheikh Anta Diop et le Guyanais George G.M.
James anglophone publient chacun un ouvrage révélant les origines
égyptiennes de la philosophie grecque. Il ne viendrait à personne l’idée de
parler d’emprunt ou de plagiat entre ces deux auteurs qui ne se
connaissaient pas, vivant dans des pays différents, écrivant dans des
langues différentes.
O.S. n’a pas à s’offusquer de critiques adressées à son livre. C’est lui
qui déclenche les hostilités en considérant ceux qui n’adhèrent pas à sa
grécité du Coran comme « des esprits fermés » (p. 183), qui « théorisent sur le
Coran des inepties » (p. 16). J’accepte moi, de m’inscrire dans ce groupe.
Néanmoins, prenons-le au mot lorsqu’il proclame sa foi islamique, car,
nulle part dans son livre il ne récuse le Coran. Ecartons donc toute
suspicion de connivence extérieure. C’est son intégrisme helléniste, sans
doute avec le coup de pouce de Chaytan, qui l’a conduit à ces dérives.
O.S. devrait dompter son intégrisme helléniste. Pour cela il gagnerait à
se pénétrer de cette pensée de Serigne Cheikh Ahmadou Bamba (RAH):
Toute science n’est pas utile ; tous les érudits ne sont pas égaux.
Il y a des sciences qui endurcissent le coeur, provoquent la vanité du savant et
lui font oublier le Seigneur
/ La science utile est celle qui fait connaître à l’homme ses propres défauts de
manière claire (Massâlik-ul Jinân, vers 155, 156, 170).
O.S. devrait se rendre compte que nous avons eu dans ce pays
d’illustres penseurs, mais qui ne sont pas du bord de ses maîtres à
penser.
Pour en finir avec tous ces explorateurs de sources du Coran : Le
Coran tel que révélé n’a pas des sources, mais une Source, seule et
unique, qui est Allah. C’est par son Al Laouh –al mahfouz (la tablette bien
préservée, Coran 85 : 22) que sont descendus graduellement les
versets sur une période de 23 ans chez son premier destinataire, le
prophète Muhammad ( .(صلى الله عليه وسلم
Pr Makhtar Diouf
Adresse email : mkdiouf@refer.sn
La grécité tranchante du Pr. Oumar Sankharé
La dernière fois que nous avons rencontré et discuté avec le Pr. Sankharé c’était en 1998 à l’Université de Dakar. Il était question de philosophie grecque et de pensée islamique. L’étudiant que j’étais devait être évalué sur ses travaux. C’était en présence du Pr. Souleymane Bachir Diagne. Dans ce cadre académique, les échanges furent rudes mais courtois.
La lecture de son récent ouvrage, Le Coran et la culture grecque – ouvrage qui a suscité de nombreuses réactions au Sénégal – nous place dans le rôle inverse. Nous avons voulu en faire un compte-rendu critique et, pour cette manche, l’étudiant, qui a « grandi » entre-temps, s’est arrogé non sans humilité, la place du professeur-évaluateur.
De quoi est-il question dans cet ouvrage?
Pour l’auteur, et ce sont les présupposés de son livre, tout un « courant obscurantiste s’est ingénié à distiller l’idée d’un monde vierge d’apports culturels extérieurs » à l’islam. En effet, poursuit-il, « plus d’un millénaire d’obscurantisme a enseveli la grécité coranique dans les décombres d’une exégèse d’obédience idéologique, voire politique. » C’est pourquoi, écrit-il, « nous avons réexaminé le Coran avec un esprit neuf dégagé des pseudo-certitudes de la féodalité « maraboutique » et de la falsification de l’histoire de l’islam perpétrée par l’Occident qui s’est efforcé d’oublier son héritage arabe dans la transmission et l’enrichissement du legs hellène ». L’objectif de ce réexamen est qu’il « faut désormais émanciper le croyant en l’orientant vers une lecture personnelle du message de Dieu ».
En clair, la « guerre » est triplement déclarée : contre la Tradition (« Le temps est maintenant révolu de laisser aux prétendus religieux le soin de théoriser des inepties sur le Coran »), contre l’Occident (qui n’a pas voulu reconnaître l’héritage grec du Coran) et contre tous les prétendus exégètes du Coran.
Pour dérouler ce vaste programme, l’auteur s’aidera de l’apport de certains chercheurs dont l’helléniste et anthropologue tunisien Youssef Seddik (son prénom est tantôt écrit « Yousseph » tantôt « Youssef » par l’auteur) à qui un hommage méritant est rendu dans l’avant-propos : « Sur les traces du Tunisien Yousseph Seddik, un pionnier remarquable à qui nous rendons un hommage admiratif et respectueux, nous nous proposons de «pister» les traces de la culture grecque dans le Coran »
En fait, pour un lecteur assidu de Seddik, l’ouvrage de Sankharé apparait comme une redite. Dans Nous n’avons jamais lu le Corandu Tunisien par exemple, tout un développement est consacré à « La parole du Coran et l’hellénité » (titre du chapitre II). Tous les thèmes développés par le Tunisien sont repris dans le livre de Sankharé.
Youssef Seddik y apparait d’ailleurs comme le « Magister » dont le jugement fait autorité. L’évocation du nom du Tunisien tient lieu par moment de faire-valoir, d’argument démonstratif : « Yousseph Seddik a brillamment démontré que le Coran n’avait jamais été lu d’une lecture critique », « Cette rencontre entre la République de Platon et le Coran se trouve confirmée par Youssef Seddik qui a remarqué la similitude de la description de la fin du monde et du jugement dernier dans les deux textesYoussef Seddik a magistralement démontré le caractère grec de la langue du Coran dans ses deux ouvrages remarquables, Nous n’avons jamais lu le Coran et Le Coran autre lecture, autre traduction. Bon nombre de termes ont été répertoriés dans ces œuvres qui illustrent indiscutablement la présence de l’hellénisme dans le message d’Allah », etc.
L’impression générale que nous avons eue après avoir fermé ce livre, est qu’il a été rédigé à la hâte. Si l’auteur utilise beaucoup le conditionnel, il est catégorique par moment sur des thèmes qui sont parfois controversés dans le milieu de la recherche. Nous y avons repéré des références manquantes, des généralisations empressées, des conclusions boiteuses voire des contradictions.
L’auteur est ferme quand il écrit que le Coran «professe l’enseignement des présocratiques, de Platon et des postsocratiques » ou quand il dit que « c’est la figure de Platon qui est omniprésente dans le Coran ». Il est sans précaution quand il écrit que « Même l’Envoyé de Dieu a été taxé d’illettré par suite d’une interprétation fallacieuse du Coran qui parle plutôt d’un Prophète de la « Umma », de la communauté. ».
Il déforme les propos du chercheur Michel Cuypers. Sankharé affirme en effet que « Michel Cuypers a déjà montré l’influence de cette rhétorique grecque sur le Coran même s’il l’appelle rhétorique sémitique. ». En réalité, « rhétorique sémitique » et rhétorique grecque » sont opposées chez Michel Cuypers. Selon ce dernier, le Coran relève d’une rhétorique sémitique commune avec la Bible très différente de la rhétorique grecque. La rhétorique grecque compose un discours selon un développement logique et linéaire tandis que la rhétorique sémitique procède par un jeu complexe de correspondance par symétrie qui alterne parallélismes, compositions en miroir ou concentriques, à différents niveaux textuels qu’il s’agisse des versets, des groupes de versets ou des grands blocs sémantiques. Cuypers a d’ailleurs produit tout un ouvrage, Le Festin, consacré à la sourate Mâ’ida pour illustrer cette rhétorique sémitique différente de la rhétorique grecque.
Après nous avoir dit par ailleurs que« L’adoration du Soleil Hélios est attestée en Grèce comme dans le Coran », il cite le verset suivant consacré à la reine de Saba et qui semble bien réprouver l’adoration du soleil : « Je l’ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le Soleil au lieu d’Allah. Le diable leur a embelli leurs actions, et les a détournés du droit chemin, et ils ne sont pas bien guidés. (Coran, XXVII, 24). Sauf que, curieusement, Sankharé écrit dans la phrase qui suit que « C’est le Coran même qui assimile Allah au dieu grec Hélios ». Pour étayer son propos, il donne le verset suivant « C’est ainsi qu’Allah fait pénétrer la nuit dans le jour, et fait pénétrer le jour dans la nuit. Allah est, certes, Audient et Clairvoyant. ». À moins de rester dans un pur symbolisme, comment le Coran peut-il, d’un côté rejeter le culte rendu au soleil, et de l’autre, faire d’Allah l’équivalent d’un dieu-soleil?
Autre exemple : citant la sourate L’Aube du Coran et le verset suivant : « « L’aube » : Par l’aube et par les dix nuits. Par le pair et l’impair ! », le Pr. Sankharé affirme de manière empressée que le « dix » est issu du fameux tétractys de Pythagore, c’est-à-dire le « 10 efficace », qui est la somme des 4 premiers nombres 1+2+3+4=10. Affirmation pas très démontrée à notre avis si l’on sait par ailleurs que le « dix » apparaît dans le « Dénaire » Maya où le nombre dix ne se prononçait jamais car jugé sacré. Il est aussi évoqué dans « Les dix plaies d’Égypte ». On se souvient que Platon a parlé dans le Timée des dix dieux-rois de l’Atlantide révélés à Solon par les prêtres égyptiens. Si l’on sait que Pythagore séjourna aussi durant 22 ans en Égypte et qu’il s’y fit circoncire avant d’être initié à l’astronomie, à la géométrie et aux mystères, d’autres hypothèses devraient être retenues.
Dans ses discussions étymologiques, Le Pr. Sankharé conteste le sens généralement donné à « Moïse » (traduit généralement par « Sauvé des eaux »). Toute la recherche contemporaine s’accorde sur l’origine égyptienne du nom. Mais pour lui, c’est une « étymologie fantaisiste ». Le nom dériverait plutôt « du participe parfait du verbe latin mittere qui fait missus (envoyé) ». Ce serait donc « une contamination de l’histoire de Romulus et Rémus sauvés des eaux du Tibre ». Sur ce point, une simple discussion avec son collègue Aboubakry Moussa Lam lui aurait peut-être évité ce genre d’affirmations lapidaires. Lam a en effet consacré tout un article, disponible en ligne, sur l’origine du mot « Moïse » et qui s’accorde avec la recherche actuelle. (Aboubacry Moussa LAM, « Moïse : essai étymologique », Revue ANKH, n°10/11, octobre 2003).
L’état des recherches sur le Coran
La liste des manquements notés ci-dessus est loin d’être exhaustive. Mais avant d’en venir aux affirmations qui ont suscité des réprobations, dressons un peu l’état de la recherche sur la question des influences coraniques. Présentement, trois approches existent à propos de l’histoire du Coran : le courant traditionnel, le courant critique et le courant hypercritique. Le courant traditionnel véhicule l’histoire officielle du Coran selon laquelle le message a été révélé en « langue arabe claire » au Prophète qui le reçut en dictée, mot à mot, sur une durée de 23 ans. C’était au VIIe siècle à la Mecque et à Médine. Le Prophète Muhammad édita en partie les fragments, mais la recension complète s’étendit sur 20 ans et fut l’œuvre du 3e calife Uthmân qui le publia comme version définitive. Ce courant repose sur les indications données par le Coran, sur les hadiths (recueil de textes à la mort du Prophète) et sur la biographie (Sira) du Prophète. Le courant dit critique affirme, quant à lui, que seul l’examen scientifique de la Tradition textuelle permet de trier le bon grain de l’ivraie, c’est-à-dire, de classer les informations reçues selon leur degré de crédibilité. À ce courant appartiennent des auteurs tels que Friedrich Schwally, un des auteurs du célèbre ouvrage Histoire du Coran (Geschichte des Qorâns). On y compte d’autres chercheurs tels que Gregor Schoeler (il a étudié le fameux manuscrit trouvé à Sanaa), le Britannique John Burton, etc. En gros, ces auteurs affirment que le coran a vu le jour principalement au temps du Prophète lui-même et que la recension définitive datait du temps du 3e calife Uthmân.
Par contre, le courant hypercritique conteste en bloc toute la Tradition textuelle et souligne des divergences au niveau des auteurs arabes, la longueur de la durée de la transmission qui déborde l’époque d’Uthmân, l’absence d’un contrôle critique et indépendant de la transmission du message, etc. Un des auteurs les plus célèbres de ce courant est le Britannique John Wansbrough. Avant lui, Alphonse Mingana s’était illustré dans cette voie. Cette approche postule l’idée que le Coran n’a pu prendre sa forme définitive qu’à la fin du VIIe siècle et même bien après. Il faudrait d’ailleurs selon certains d’entre les auteurs du courant hypercritique, considérer une origine non arabe du Coran. Un auteur tel que Günter Lülling estime que certaines sourates ont des origines chrétiennes préislamiques. C’est la thèse du « Coran primitif chrétien ». Il faut signaler dans la même lancée, la parution en 2010 de l’ouvrage The Hidden Origin of IslamLes origines cachées du Coran), ouvrage collectif dirigé par les Allemands Karl-Heinz Ohlig et Gerd-Rudiger Puin. Ils y soutiennent l’idée des influences chrétiennes. Les musulmans auraient été d’abord des chrétiens selon eux. L’italien Sergio Noseda y défend une influence sassanide sur l’écriture arabe.
Un autre chercheur de ce courant hypercritique, Christophe Luxenberg (il a contribué à l’ouvrage précédent), soutient l’idée d’un héritage syro-araméen du Coran. Beaucoup de vocables utilisés dans le Coran ont selon lui une origine syro-araméenne. Les termes obscurs s’éclairent selon lui en convoquant cet héritage. Enfin, le Tunisien Youssef Seddik et d’autres comme Ali Mérad, parlent d’héritage hellène du Coran.
L’ouvrage du Pr. Sankharé est à classer dans cette approche hypercritique où rien n’est encore définitif. Certaines théories sont battues en brèche par d’autres et les débats se poursuivent encore. Sankharé revient en effet sur la longue durée de la transmission, les origines étrangères du Coran notamment grecques qui selon lui seraient occultées par les musulmans. Toutefois, le professeur ne s’arrête pas là. Il conteste la signification traditionnelle du terme « Ummî » désignant l’illettrisme du Prophète. Selon Sankharé, la signification du « lis » (iqra) coranique ordonné au Prophète est mal comprise : « il serait faux de prétendre qu’il [le Prophète] était illettré. Car alors, pourquoi Dieu omniscient lui aurait-il ordonné de lire par l’intermédiaire de l’ange alors qu’il ne savait pas lire?»
Toute la Tradition est unanime qu’il faut traduire ce terme par « illettré ». On connait, d’après le hadith célèbre, la réponse donnée par le Prophète suite à la demande (« lis ») plusieurs fois répétée de l’ange Gabriel : « Mâ ana bi qâri’in » (« je ne suis pas un lecteurJe ne sais pas lire »).
Le fameux dictionnaire arabe, Lisân, qui fait autorité pour la langue classique, retient ce sens. Le terme « « illettré » est aussi celui qui est retenu en arabe moderne. L’illettrisme est un argument crucial car il confirme l’authenticité de la prophétie de Muhammad. Un analphabète ne peut en effet être l’auteur de ce beau livre qu’est le Coran. La majorité des traducteurs du Coran conservent également ce sens. Il faut dire que ce terme peut avoir deux sens selon qu’il est utilisé au singulier ou au pluriel. Il peut signifier « illettré », dans la majorité des cas, mais il fait au pluriel (ummiyyûn/ummiyyîn) en référence à la communauté, à la nation. Ce terme utilisé au pluriel désigne « ceux qui n’avaient pas reçu de Livre », les Goyim de la tradition juive. Le terme « Gentils » est généralement utilisé pour les désigner. On note ainsi quelques différences de traduction entre l’exégèse islamique traditionnelle et l’orientalisme. Des divergences apparaissent également entre Orientalistes. Ainsi Blachère et Masson dans leur traduction du Coran traduisent « Nabi yil ummî » par « le Prophète des Gentils ». André Chouraqi retient, lui, « le Nabi des matries » en référence à « Umm » (« mère », donc tel qu’issu de la mère, fruste, dénué de savoir, etc.). L’orientaliste Jacques Berque parle également de «Prophète maternel ». Le Pr. Sankharé lui est formel : « Même l’Envoyé de Dieu a été taxé d’illettré par suite d’une interprétation fallacieuse du Coran qui parle plutôt d’un Prophète de la « Umma », de la communauté. ».
On voit bien que le Pr. Sankharé ne se limite pas à l’évocation de l’hypothèse, compréhensible du reste, d’une possible influence du grec sur le Coran. Il conteste aussi des éléments du credo musulman, discute d’étymologies de termes arabes, accuse les ulémas (hommes de savoir) de falsification, etc. Le Pr Sankharé tient à son « Prophète des Gentils » car si le Prophète ne fut pas illettré, tout le champ des influences recues, la grecque y compris, restent possible et justifiées.
Au delà de la Grèce
Dans une contribution rédigée après l’émission (L’entretien) avec le journaliste Sada Kane, nous évoquions le fait que le Pr. Sankharé « ne voyait que grec ». Pour lui, il ne fait aucun doute, « tout le message divin semble être habillé du manteau des Grecs ». Quid des autres traditions sur la Grèce elle-même? Et si le professeur tournait son regard du côté des emprunts effectués par les Grecs eux-mêmes? Ne relativiserait-il pas quelques-unes de ses affirmations lapidaires?
Le professeur semble ignorer, écrivions-nous, que ce qu’il attribue à la Grèce est en réalité un legs de l’Afrique. Platon « le prophète » omniprésent selon lui dans le Coran, a été initié par les Mantines, de plus grands « prophètes » à la peau noire et aux cheveux crépus comme nous l’enseignent les historiens grecs (Hérodote, Strabon, Diogène Laërce, etc.).
Le Pr. Sankharé qui a fréquenté l’Université de Dakar du temps de Cheikh Anta Diop ne peut donc ignorer les thèses du célèbre égyptologue. Le professeur sait-il que dans leTimée de Platon, on n’y fait mention de la « révélation » faite à Solon par un vieux prêtre égyptien? Solon dont on dit qu’il instaura la démocratie et qui fait partie des Sept Sages de la Grèce, voyagea à Saïs en Égypte. Ce qu’il y vit, dit-il lui-même, « ni lui, ni aucun autre Grec n’en avait pour ainsi dire aucune connaissance ».
Pythagore, nous le rappelions plus haut, séjourna sur recommandation de son maître Polycrate, durant 22 ans en Afrique pour étudier les mystères et les nombres. Cheikh Anta Diop s’étonnait d’ailleurs que l’on connût tout de la Grèce et très peu de l’Afrique : « Il est frappant que presque aucun nom de savant égyptien n’ait survécu. Par contre, la quasi-totalité de leurs disciples Grecs sont passés à la postérité en s’attribuant les inventions et découvertes de leurs maîtres Égyptiens anonymes. C’est ce qui ressort des passages de Jamblique qui précèdent, et des écrits d’Hérodote, faisant allusion à Pythagore qui se faisait passer pour l’inventeur des idées de ses maîtres. »
On lit d’ailleurs dans le Dictionnaire de mythologie et de symbolique égyptienne de Robert-Jacques Thibaud (Éditions Dervy, Broché – 1997), que « L’Égypte ne voulut chercher ailleurs que dans ses temples sa conscience du monde. Elle ne souhaita pas l’imposer aux autres, c’est pourquoi elle ne reçut qu’avec réticence quelques étudiants grecs à qui elle reprochait leur ignorance et leur bavardage. Ils avaient pour nom Homère, Solon, Pythagore, Démocrite, Eudoxe, Hérodote, Jamblique, Platon, plutarque et Thalès. »
Le Pr. Sankharé a raison de procéder à des comparaisons, de rappeler la transmission des savoirs. Qui peut nier qu’en 832 de l’hégire, le Calife Al-Ma’mûn fit traduire la plupart des œuvres philosophiques de la Grèce en arabe? Toutefois, ce qui est discuté, ce sont les influences grecques dans la période pré-abbasside. S’il a raison dans ses parallélismes, il a tort dans sa grécité dogmatique. Nous pensons d’ailleurs que les intentions derrière l’ouvrage de notre compatriote Papa Fary Seye,Racines égyptiennes de l’au-delà musulman, sont mieux indiquées pour l’historien des idées ou des religions. Ainsi que nous le présente son préfacier, l’égyptologue Babacar Sall :« l’auteur se démarque de toute théorisation dogmatique. Il décrit et attire l’attention sur des constats. Les parallèles sont bien choisis comme les mots d’ailleurs. Les terrains de la comparaison relèvent aussi d’un choix judicieux. L’Égypte ancienne a été la première réussite culturelle de l’humanité historiquement datée. C’est là qu’il faut chercher les plus anciennes attestations historiques des problèmes qui ont toujours hanté et qui hantent encore l’esprit de l’homme. Ils ont pour nom: foi, scepticisme, doute, etc. Quant au Coran, parce qu’il est la révélation dans sa forme ultime, il contient toutes les étapes de la révélationLa question est de savoir si la permanence du sentiment religieux et les ressemblances décelées ne traduisent pas plutôt l’unicité de la source des messages religieux. En un mot, n’est-il pas possible de penser que tous les peuples ont reçu, à un moment particulier de l’histoire, une parcelle du message divin, du même message divin ».
C’est ce que, en d’autres termes, nous rappelait la regrettée Éva de Vitray-Meyerovitch lorsqu’elle écrivait dans son ouvrage, L’islam, l’autre visage« On ne se convertit pas à l’Islam, on embrasse une religion qui englobe toutes les autres.»
Pour des passerelles entre l’Université et les daaras
Le Pr. Sankharé a mal communiqué sur son œuvre. C’est un fait. Ces propos brusquement et maladroitement exprimés à la télé et dans la presse écrite ont heurté la sensibilité de beaucoup de personnes. Il est vrai que sur le plan de la religion, la foi passionnée du charbonnier peut être interpellée comme celle de l’intellectuel le plus imperturbable. Le spectre des réactions peut aller de la passion la plus animée à l’indifférence la plus totale. De plus, la connaissance du milieu dans lequel on évolue est indispensable. Le philosopheSchopenhauer nous apprenait dans ses Parerga et Paralipomena que son collègue Fichte osé laisser en dehors de son enseignement les doctrines de la religion du pays ; il en résulta qu’il fut destitué, et insulté en outre par la populace. ». On retira également au philosophe Kino Fischer son jus legendiparce qu’il enseignait le panthéisme. Kant lui n’a pu écrire sa Critique de la raison pure que sous le couvert d’un philosophe sur le trône, Frédéric II en l’occurrence. Celui-ci décédé, il s’empressa, nous dit Schopenhauer de « modifier son chef-d’oeuvre, il le mutile, il le gâte, et, en fin de compte, il est menacé de perdre sa place. ». Ceci pour dire que les écrits sur la religion ont toujours suscité des réactions diverses.
En laissant entendre dans la presse que son ouvrage n’était destiné qu’aux universitaires, motif pris de ce que « l’universitaire n’a pas la même perception du Coran que ceux qui ont étudié dans les daaras. Ceux qui sont dans les daaras, on leur dit quelque chose et ils y croient », le Pr. Sankharé a fait preuve d’imprudence, de contradiction voire de mépris. N’a-t-il pas fait l’éloge dans son livre de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh parce que celui-ci parlait souvent de Platon? N’est-ce pas là la preuve concrète qu’un « sortant » des daaras peut valablement parler de Platon? Par ailleurs, qui ne connait pas les qualités intellectuelles d’un Khali Madiakhaté Kala, d’un Cheikh Moussa Kamara, d’un Serigne Mbaye Diakhaté pour ne citer que ceux-là? Ne sont-ils pas des produits des daaras? L’agrégé de grammaire Sankharé sait-il que dans ce pays qu’est le Sénégal, un homme des daaras nommé Ahmed Diaw Pakha, se faisait appeler le « Prince des grammairiens » (Sultân An-Nuhât) et qu’il parcourait les contrées à la recherche d’érudits qui pouvaient relever ses défis dans cette matière?
Dans une contribution récente, nous parlions, à la suite de certains auteurs, de la pluralité des systèmes d’éducation (écoles laïques, daaras, etc.) au Sénégal qui fabrique une société de conflits. L’épisode « Sankharé » est une illustration parfaite de cette situation. D’ailleurs, en pleine polémique, une personnalité issue des daaras a invité le Pr. Sankharé à revoir sa copie et à venir « s’instruire au sein des daaras qu’il méprise ». Cette « confrontation » ne pourra, selon nous, être résolue que si des passerelles sont créées entre les daaras et l’université.
Nous nous réjouissions qu’un acteur de la tradition orale, Samba Diabaré Samb, soit invité il y a quelques années à l’Université pour parler d’oralité. Des actions de ce genre devront être souvent initiées avec les personnes issues des daaras. Les passerelles ainsi créées réduiront fortement les situations d’antagonismes.
Khadim Ndiaye,
Ndongo daara
Montréal, Canada
Iba Der Thiam corrige la copie du Professeur Oumar Sankharé
Le message transmis par Dieu (SWT) au Prophète Muhammad (PSL), à travers l’Ange Gabriel, confirme, précise et complète les messages confiés à tous les Prophètes antérieurs et, en particulier, à Abraham, à Moïse et à Jésus (Qu’Allah soit satisfait d’eux).
Dans le liminaire de la première édition ( 1970) de sa traduction du Saint-Coran, le Cheikh Si Hamza Boubakeur, Directeur de l’Institut musulman de la Mosquée de Paris, Agrégé d’Arabe, membre de l’Académie Islamique de Médine, écrit : « Si les traductions du Saint Coran, qui se chiffrent à plusieurs centaines dans les seules langues européennes, sont nombreuses, elles laissent, cependant, à mon humble avis, fort à désirer, tant au point de vue du fond, qu’au point de vue de la forme.
L’extraordinaire richesse de la langue arabe, les modes de sentir, de pensée, de s’exprimer, en un mot, le psychisme du peuple qui la parle, ne rendent pas aisée la tâche du traducteur qui refuse de trahir ou de donner une interprétation personnelle à ce qui parait obscur ou ambigu.
Aucune traduction, à ma connaissance, n’offre toutes les garanties, toutes les exactitudes, toute la fidélité requise en un domaine pareil. Les traductions françaises, les moins sujettes à caution, sont faites dans une langue quasi-incompréhensible, même lorsque leurs auteurs sont des savants de souche française.
Leur louable intention de conserver au texte coranique son relief et le mouvement de son style les a conduits, parfois, à un galimatias, à des amphibologies et à des barbarismes ».
A ces difficultés de forme, s’ajoutent d’autres, d’ordre spécifiquement culturel.
Le Saint Coran impose, pour être compris, des exigences difficiles à réunir.
« Sa compréhension nécessite la connaissance de plusieurs disciplines, en plus de la grammaire et de la philologie arabe, des traditions, de la théologie, des théories d’écoles, des schismes, des sectes et de l’Histoire de l’Islam.
Pour comprendre et faire comprendre la Vulgate de l’Islam, son traducteur doit être, sous peine d’échecs lamentables, une sorte d’Encyclopédie vivante : il lui faut une information aussi vaste que précise en langue ancienne, en théologie comparée, en hérésiologie, en mythologie, en philosophie, en sociologie, en mathématique, en sciences inductives, etc.
De telles exigences, à l’ère des spécialistes, sont, le plus souvent, difficiles à satisfaire.
Revenant sur cette thématique, le Cheikh Si Hamza Boubakeur insiste, huit années plus tard :
« A tous ceux qui seraient tentés de traduire le Coran et d’en expliquer le contenu (Préface à la seconde édition : 1978), je voudrais leur recommander de lire préalablement et de méditer attentivement la Thora et l’Evangile, en leurs diverses versions, ainsi que leurs annexes (Talmud, Actes et Epitres des Apôtres) et surtout de se méfier de leur transposition en langues européennes modernes, farcis de contresens, de faux-sens, d’inepties et dénotant une ignorance renversante de la mentalité des langues et de l’histoire des Sémites.
Ils doivent, sous peine de perdre leur temps, d’étudier la Théologie judaïque et la Théologie chrétienne, sans les moindres préjugés ».
Fort de ce qui précède, le Cheikh recommande « de bien posséder les disciplines de base qui sont la langue et la littérature arabes, les hadiths, l’exégèse coranique, la théologie, le droit, l’histoire générale de la communauté, la civilisation et la doctrine générales de l’Islam, en son orthodoxie, son soufisme et ses schismes, une sérieuse connaissance de la linguistique sémitique et, parmi les langues vivantes, l’Allemand, surtout », c’est-à-dire, plus que ne confèrent de simples cours d’Arabe dans un lycée, suivis, au demeurant, à des époques inactuelles.
Ces précisions apportées, d’autres que moi ont démontré que dans la Sourate 7 « Al Araf », le verset 158 mentionne, sans la moindre équivoque, que Muhammad (PSL) était un illettré, terme utilisé dans le Texte Sacré par la plupart des traducteurs.
Né à la Mecque, Muhammad (PSL) y a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans au sein de sa famille, de sa tribu et de ses voisins avant de recevoir la Révélation.
Cette localité, à cette époque, était uns grosse bourgade dans laquelle, la plupart des habitants se connaissaient et se fréquentaient peu ou prou.
Il y a grandi avec des personnes de son âge, a joué avec elles, y a passé sa jeunesse, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte.
Pour qu’il soit lettré, il aurait fallu qu’il fréquentât une institution d’éducation, seul ou avec d’autres, qu’il eût, à tout le moins, un maître privé, connu et titré et qu’il eût une personne capable de prendre en charge les études de l’orphelin de père et de mère qu’il était.
Si tel était le cas, comment un tel événement pouvait-il être ignoré de tous, c’est-à-dire, de sa famille, de ses proches parents, de ses voisins et de toutes les autres personnes constituant son entourage mecquois ?
A supposer qu’il ait caché cet épisode de sa vie, comment aurait-il pu se faire que son ou ses maîtres n’aient été connus de personne, qu’il s’agisse d’un parent, d’un ami, d’un voisin, d’un allié ou d’un étranger ?
Après avoir reçu la Révélation, à l’âge de 40 ans, il a vécu 10 années encore à la Mecque, dans un contexte d’hostilité extraordinaire avec des parents, des voisins, des compagnons de sa génération, dont certains lui vouaient une haine féroce et n’étaient point disposés à lui accorder la moindre faveur, dans un contexte où des détracteurs impénitents, à la langue de vipère, comme Abû Sufyân, Dirât et Zib’âra et la cohorte des poétesses et autres rimailleurs Mecquois, à la plume assassine, surveillaient la moindre de ses déclarations, pour en faire des gorges chaudes.
Quelques-uns de ses plus proches parents et voisins directs le haïssaient tellement, qu’ils parsemaient ses chemins préférés d’épines, de cailloux contondants, pour lui faire mal aux pieds et le torturer ainsi physiquement.
N’ont-ils pas poussé l’hostilité contre sa personne jusqu’à organiser son assassinat ? Il ne leur a échappé qu’avec l’aide de Dieu (SWT).
Ayant toujours vécu avec lui, connaissant toutes ses fréquentations, témoins de toutes les étapes de sa vie, comment ses ennemis auraient-ils acquiescé, s’ils constataient qu’on le disait ou qu’il se disait illettré, alors qu’il ne l’était pas, eux qui savaient, parfaitement, qu’en le dénonçant avec preuves à l’appui, ils porteraient atteinte, de manière irrémédiable, à la crédibilité de sa mission, une mission qui ne pouvait prospérer qu’en se fondant sur la stricte vérité, une vérité irrécusable.
Or aucun membre de sa famille, aucun voisin, aucun allié, aucun adversaire, fût-il le plus acharné, n’a jamais contesté le fait qu’il était illettré, que ce soit au sein de toute la communauté Koraïchite, que ce soit dans toute la population de la Mecque.
Dieu, en créant cette situation, ne nous a-t-Il pas administré la preuve la plus convaincante de l’illettrisme du Prophète (PSL), au regard aussi bien du présent que de la postérité ?
Ce qu’on n’a pas dit, c’est que Khadîdja lui avait adjoint, précisément, un assistant, son propre intendant, du nom de MAYSARA, parce qu’elle savait, précisément, que ne sachant, ni lire, ni écrire, il aurait besoin d’avoir à ses côtés, une personne lettrée. Ce fut avec Maysara que Muhammad (PSL) fit son premier et son deuxième voyages en Syrie.
Or, la confiance de Khadidja en Muhammad (PSL) était telle et son affection pour lui si profonde, qu’elle n’aurait certainement pas besoin d’un intermédiaire entre lui et son nouvel employé, si ce dernier savait lire et écrire.
Il s’y ajoute que, durant toute sa vie, aucun témoignage n’existe selon lequel, Muhammad (PSL) aurait été vu lire, écrire, communiquer par la plume, que ce soit pendant les 10 années passées à la Mecque ou les 13 autres, passées à Médine.
Certains biographes du Prophète ont écrit que dans les derniers moments de sa vie, il a demandé, en vain, de l’encre et un écritoire pour transmettre, semble-t-il, peut-être, ses ultimes volontés. Mais, était-ce, pour son usage personnel qu’il avait demandé ces outils, ou pour solliciter d’un membre de son entourage de lui transcrire ses recommandations ? Nul ne peut répondre à cette question.
A l’époque de Muhammad (PSL), l’illettrisme était tellement répandu à la Mecque, qu’à la bataille de Badr, les musulmans victorieux n’ont exigé, en guise de rançon de leurs prisonniers Mecquois lettrés, pour recouvrer la liberté et sauver, en plus, leurs vies, que de se mettre au service de la communauté musulmane de Médine illettrée, dans son écrasante majorité, pour apprendre à lire et à écrire à des croyants dépourvus de ces savoirs.
La lecture et l’écriture étaient, donc, des privilèges exceptionnels, dont la maîtrise valait de l’or. Ceux qui en possédaient les mécanismes opératoires étaient connus et reconnus, enviés, respectés, adulés et honorés. Muhammad (PSL) n’avait aucune raison de se priver de tout cela, s’il était vraiment lettré.
Nous savons, par ailleurs, qu’à Al Houdaybiyyah, lorsque la délégation Mecquoise conduite par Souhayl Ibn Amr, contesta que, dans l’accord qui devait être signé, on fit mention de « Muhammad, Envoyé de Dieu » et qu’il fallut supprimer cette référence du projet, pour ne pas compromettre les chances d’un accord de paix et de concorde, le Prophète (PSL) demanda devant tous ses partisans et adversaires présents, à Ali, qui lui, savait lire et écrire, de lui indiquer dans le texte en discussion, l’endroit précis où se trouvait la mention contestée, pour qu’il la supprime, lui-même, de sa propre main, puisque son beau-fils refusait d’effacer la référence à sa mission divine, référence qu’il était incapable de retrouver tout seul.
Sa vie durant, il se fit écrire et copier tout ce qu’il voulait communiquer par écrit. Il a, toujours, prié quelqu’un d’écrire pour lui, ou a toujours eu recours au service d’un secrétaire.
Avant de terminer sur ce point, nous savons que c’est la Mère des Croyants Seyda Aïcha, qui a raconté dans un Hadith célèbre, la première rencontre de Seydina Djibril avec le Prophète (PSL) dans la grotte du Mont Hîrâ et la réponse de ce dernier, quand l’Ange lui dit : « Lis » à savoir : « Je ne sais pas lire ». Quel musulman sérieux oserait douter d’un témoignage de l’épouse de Muhammad (PSL), fille, de surcroît, de Seydina Ababacar Es-séddiq (le véridique), incarnation vivante de la fidélité et de la sincérité, premier des 4 Khalifes Rachidun, alors que la tradition musulmane lui doit, à elle seule, quelques 1 200 Hadiths, qui constituent, tous, des articles de foi.
Mais, une question demeure :
La réponse est simple. Les canaux qui mènent à la connaissance sont au nombre de trois, d’après Cheikh Ahmed Tidiane Chérif (RTA). Dans le Jawahir-Al Ma-ani, la Charte de la Voie Tidianiya, page 182), il les détaille en ces termes :
– « un, passant par les sens, par l’enseignement direct, par la transmission orale ;
– un autre, passant par la spéculation intellectuelle… ;
– un 3e canal, celui par lequel, « Dieu jette Lui-même, la connaissance dans le cœur du serviteur, sans médiation matérielle d’aucune sorte ou réflexion ». Cette connaissance est appelée : « Ladunni » (Science infuse) ».
Ce fut le cas dans le récit de Khadir et de Moïse (Paix Sur Eux), Dieu (SWT) ayant dit à leur sujet : « Nous lui inspirâmes une science venant de Nous » (La Caverne, 65).
Ce que Dieu (SWT) avait déjà eu à faire, il lui était facile de le refaire, Lui qui crée, recrée, commence, recommence, sans cesse, parce qu’Il est Omniscient et Omniprésent.
L’auteur de l’ouvrage « Le Coran et la culture grecque » soutient que la Fatiha était attestée au pays des Pharaons, 14 siècles avant le Saint Coran.
Il ajoute que cela est vérifiable en Egypte, sans indiquer aux lecteurs de son interview, l’endroit précis où se trouve l’inscription qui en fait foi, ainsi que le contenu exact et précis de cette « Fatiha antéislamique ». Celui qui affirme cette déclaration péremptoire laisse d’autant plus dubitatif, que sauf erreur de ma part, il ne maîtrise pas le déchiffrage des hiéroglyphes, ce qui n’est nullement une faute, loin s’en faut.
Il est bien dommage que les silences ci-dessus signalés ne permettent pas d’engager le débat à partir de faits précis et localisables.
Certes, des manifestations de monothéisme, alternant avec d’autres, de polythéisme, ont existé dans les religions à travers le Monde et ont, de tout temps, préoccupé les peuples, que ce soit à l’époque des premières civilisations qui se sont manifestées le long du Fleuve Jaune, environ 6 000 ans avant Jésus-Christ , celles qui leur ont succédé dans la vallée de l’Indus, entre 4 500 et 4 000 avant Jésus-Christ , celles qui se sont développées après l’unification de la Haute et de la Basse Egypte, sous Ménès, près de 3 200 avant Jésus-Christ, celles de Summer, de Harppan, des dynasties Shang, des Hyksos, des Hébreux, des Crétois, des Phéniciens, des Assyriens, des Babyloniens et des Perses.
Qu’il y ait, par conséquent, des similitudes dans des oraisons prononcées pour célébrer des divinités ou dans les hymnes articulés pour exalter la Grandeur du Créateur, ne devrait point étonner.
J’ai obtenu de mon distingué collègue, le Professeur Aboubacry Moussa LAM, égyptologue de renommée internationale, qui lit les hiéroglyphes dans le texte, des documents qui mentionnent la ressemblance existant entre l’Hymne au Soleil du Pharaon Akh-en-Aton, Pharaon de la XVIIIe dynastie (1375-1354), inscrit sur le mur ouest de la tombe d’Ay à Amarna, que l’on date du quatorzième siècle avant Jésus-Christ et le Psaume 104, tiré, soit de l’ouvrage de Marcel Laperruque, intitulé « De l’Egypte Ancienne à la Bible », soit de celui de Nicolas Grimal « Histoire de l’Egypte Ancienne » publié chez Fayard en 1981, page 272-273, ainsi que le Psaume H.104 c103, intitulé « La Gloire du Créateur », extrait de la Bible, présenté par Pierre de Beaumont, Fayard – 1981, pages 1016 à 1018.
Ces textes, que certains ont qualifiés « d’apparences du monothéisme, d’autres de manifestations de monothéisme », présentent certaines ressemblances avec des textes dits sacrés. Mais, ils n’ont rien à voir avec la Sainte Fatiha.
La Sourate Fatiha, qui sert d’ouverture au Livre Sacré des musulmans, date du début de prédication de l’An 610 ou 611, lorsque la communauté musulmane s’était suffisamment développée, pour être en mesure de célébrer en commun la prière.
Elle a été révélée, selon tous les Oulémas, à la Mecque par l’Ange Gabriel, accompagné, à l’occasion, d’une communauté de dix mille Anges environ, pour en signifier l’exceptionnelle solennité.
Son début est consacré à la louange au Seigneur et sa fin aux bienfaits de Dieu. Le Prophète aurait déclaré qu’elle contenait dans ses 7 versets, tout l’enseignement du Saint Coran. On considère, aussi, que la lecture de la Fatiha équivaut, en termes de mérites, à celle du Livre Sacré tout entier, selon Râz (1, 173,177).
La tradition recommande de terminer la récitation de la Fatiha par le souhait (âmin, amen, ainsi soit-il), commun aux 3 confessions monothéistes, terme appartenant étymologiquement aux Sémites communs.
On le trouve dans les invocations des Assyriens, des Kaldéens, des Babyloniens, etc., ce qui prouve les thèses ci-dessus énoncées.
On aurait pu en dire de même de la Basmala. J’y reviendrai.
On a prétendu que l’ascension du Prophète (PSL) au ciel n’a pas été attestée par le Saint Coran.
La preuve présentée, à l’appui de cette assertion, pour étayer cette affirmation péremptoire et téméraire, n’agrée aucun expert confirmé de la langue arabe.
La tradition, qui complète et éclaire le Texte Sacré, soutient fermement que Mohamed a voyagé la nuit, de la Mosquée de la Mecque à la Mosquée Al Aqsa de Jérusalem. A ceux qui doutaient, il a présenté une description des lieux tellement rigoureuse et précise, que tous ceux qui connaissaient le lieu de culte de Jérusalem, ont dû opiner.
Pourtant, il n’avait jamais auparavant visité ces lieux et ne les connaissait donc pas. Dieu (SWT) qui l’a fait transporter de la Mecque à Jérusalem, serait-Il incapable de le faire porter au ciel par les mêmes moyens ? La réponse ne peut être que non.
De là, il sera conduit par l’Ange Gabriel, sur le dos d’Albourakh, jusqu’aux approches immédiates « à deux portées d’arc de l’essence impénétrable de Dieu jusqu’au Lotus de la limite à l’horizon supérieur »
Mais, le respect de la transcendance et celui de la suprême immensité de Dieu l’invitent à s’abandonner en toute confiance à sa Volonté et à Sa Sagesse.
Ce fut au cours de ce voyage, qu’il découvrit les Prophètes bibliques et reçut de son Seigneur et Maître, le nombre de prières canoniques, dont sa communauté devrait s’acquitter quotidiennement.
Contester cet évènement, c’est douter de l’authenticité absolue de l’un des 5 piliers de l’Islam.
Le livre incriminé ergote sur les 114 versets de la Vulgate Coranique et parle de fautes qui figureraient dans le texte
Or, les 114 Sourates qui composent le Saint Coran n’ont pas été improvisées au hasard de n’importe quelle conjoncture. Elles ont été rassemblées et contrôlées, de manière critique et rigoureuse, pour s’assurer qu’elles étaient bien conformes à la Vulgate confiée par Allah (SWT) à Muhammad (PSL), à travers l’Ange Gabriel, qui venait, chaque année, à l’époque du Ramadan, vérifier auprès du Messager d’Allah (SWT), que le contenu qu’il avait mémorisé était rigoureusement conforme au Texte Sacré qui lui avait été transmis.
Le processus de recensement des Versets composant la Vulgate Coranique, commencé sous Aboubakr, sur les conseils de Seydina Oumar, n’a été finalisé que sous le 3e Khalifat, celui d’Uthman, pour s’assurer que toutes les précautions avaient été prises, les contrôles effectués, toutes les confrontations organisées avec des personnes vivantes qui avaient mémorisé le Saint Texte, d’autres qui l’avaient transcrit, afin qu’aucune critique de conformité ne puisse être articulée contre le travail qui avait été fait.
El Boukhari nous apprend, sur la base du témoignage de Zayd Ibn Thâbit, que l’idée de l’assemblage du Saint Coran a été suggérée au Khalife Aboû Bakr Esséddiq, le jour de la célèbre bataille d’El-Yamâma, au cours de laquelle, plusieurs preux (70, environ), ayant mémorisé parfaitement le Texte Sacré, perdirent la vie.
Craignant que la même situation ne se produise, à nouveau, au cours d’évènements similaires, au risque, avec la disparition de ceux qui le maîtrisaient, de voir le Saint Coran se perdre définitivement, Oumar suggéra de procéder à sa recension et à son assemblage parmi les sachants encore vivants, pour le « préserver de toute disparition ». Abou Bakr y procéda en un seul volume, avec le concours de ses compagnons les plus compétents et les plus vertueux.
Ayant, avant sa mort, confié ce document précieux à Oumar, celui-ci chargea sa fille Hafsa, épouse du Prophète (PSL), d’en assurer la garde.
Ce fut sur cet exemplaire que s’appuya Othman, sur les conseils de son illustre compagnon Houdhayfa Ibn-El Yemen, pour adopter la version définitive, procéder à des copies, sans aucune faute et en déposer des prototypes à la Mecque, en Syrie, au Yémen, à Bahrein, à Koufa, à Basrâ et à Médine.
C’est ce qu’on appelle la Vulgate d’Othman, modèle de rigueur, de fidélité et d’exactitude, que tous les musulmans du monde entier récitent depuis 15 siècles.
Que tel ou tel contemporain ait cherché à glisser, à des fins inavouables, à l’époque de l’assemblage de la version en préparation, des rajouts ou des suppressions inspirées par ses propres intérêts, ne doit nullement étonner.
Des phénomènes similaires ont, également, eu lieu au moment de la recension des Hadiths, parce que des personnes animées par des préoccupations personnelles en avaient inventés, au seul profit de leur cause.
Sous ce rapport, lorsqu’on compare le travail qui a été fait, aux conditions dans lesquelles, les autres Livre Sacrés, antérieurs au Coran, ont été rassemblés et officiellement consacrés, on ne peut que se féliciter de la démarche qui a été entreprise et des résultats auxquels, elle a finalement abouti.
Le Coran, pour la tradition musulmane, est une révélation qui n’a été communiquée, ni par les démons, ni empruntée aux judéo-chrétiens, mais transmise par l’Esprit fidèle (l’Ange Gabriel) à un Prophète sincère et déposée en son cœur.
Les Ecritures Saintes (Zubûr) qui l’ont précédé, l’avaient annoncé et avaient aussi annoncé son transmetteur « Mohamed, Messager de Dieu, qui n’est ni enseigné par quelqu’un, ni possédé par un djinn, ni un poète, ni un affabulateur ».
La vigilance du Créateur Suprême sur le contenu du Saint Coran est omniprésente et ne souffre d’aucune exception. N’a-t-Il pas, Lui-même, témoigné sur ces points, en ces termes ?
« Ce Coran est une parole transmise par un noble Messager.
Il n’est point l’œuvre d’un poète, minable foi que la vôtre !
Il n’est pas, non plus, la parole d’un devin, minable raisonnement que le vôtre !
C’est une révélation du Seigneur de l’Univers.
Si ce messager nous avait prêté de faux propos,
Nous l’aurions saisi par la main droite
et lui aurions tranché le cou,
sans que personne d’entre vous n’eût pu le protéger » (Sourate LXIX, Versets 40 à 47, traduction du Saint-Coran par Dr Mohamed Ould BAH, Agrégé de l’Université en Arabe, Docteur d’Etat, page 455).
On a, également, évoqué les dissensions entre les Sahabas (RTA) :
Or, dans le contexte des années qui ont suivi la mort du Prophète de l’Islam (PSL), les dissensions intervenues entre certains Sahabas (RTA) étaient inévitables. Elles n’enlèvent rien à la grandeur de tous ceux qui ont payé de leurs biens, de leur argent, de leur corps, de leur sang et, quelquefois, de leurs vies, pour que le drapeau de l’Islam Eternel triomphe sur la terre d’Arabie, essaime à travers le monde, au point de représenter, aujourd’hui, la plus importante, numériquement parlant, un milliard six cent millions (1 600 000 000) d’adeptes , de toutes les religions révélées, en recourant beaucoup plus à la persuasion qu’à la force.
Voilà pourquoi, plutôt que de gloser sur les dissensions entre les Sahabas (RTA), nous devons, au contraire, louer les vertus de ces hommes et femmes de valeur exceptionnelle, exalter leurs qualités, rendre hommage à leurs sacrifices, admirer leur détermination, d’autant que, même ceux ou celles qui étaient dans l’erreur (Dieu (SWT), Seul, sait), pensaient, au fond d’eux-mêmes, bien faire. Ils méritent, tous, notre respect et notre considération. Ils sont et demeurent des références sublimes.
On a, aussi, spéculé sur la ressemblance de certaines des descriptions d’une partie du Paradis avec des images figurant dans la mythologie grecque.
La description du Paradis, qui se retrouverait, à des nuances près, chez tel ou tel texte grec ne devrait, nullement, étonner celui qui connait l’Histoire du Monothéisme dans le Bassin de la Méditerranée, où les brassages des peuples et des cultures ont atteint un niveau rarement égalé.
Si des passages ou des images du Saint-Coran se retrouvent dans la culture grecque, pourquoi doit-on en déduire que ce sont les Arabes qui ont copié les Grecs et pas le contraire, alors que depuis Adam, le message divin, transmis par des milliers de prophètes à tous les peuples, a circulé dans le monde connu avec un contenu qui n’a jamais varié, pour l’essentiel ?
Selon le témoignage de Tabari (I. 48) sur les 124 000 Prophètes que Dieu a envoyés aux peuples du Monde, dont le premier était Adam, on en dénombre quatre qui s’exprimaient en langue syriaque : Adam, Seth fils d’Adam, Noé et Idriss ; trois qui étaient Arabes avant Muhammad (PSL), à savoir Houd, çalih, Scho’aïb (Paix et Salut sur Eux), soit, avec le Sceau des Prophètes (PSL), 4 au total.
Le miracle Grec n’a pas précédé la civilisation des peuples Sémites.
On sait, par ailleurs, que Platon (428-348), pour qui la forme supérieure du Savoir était une vision, une intuition intellectuelle des Essences qui ont pour principe premier, l’idée du Bien (Dieu), a visité l’Egypte et la Cyrénaïque.
La majorité des Arabes avaient, en effet, répondu favorablement à l’appel qu’Ismâ’îl leur avait adressé, visant à rallier la religion de son père Ibrahim, après la mort de ce dernier.
Ils croyaient, donc, en Allah, qu’ils considéraient, au départ, comme un Dieu Unique. Ils croyaient, de même, à la vie future, de même qu’au Paradis et à l’Enfer.
La reconnaissance de l’Unicité de Dieu était attestée chez un grand nombre d’entre eux, ainsi, au demeurant, que les rites préconisés par le monothéisme d’Ibrahim.
Il en fut ainsi jusqu’à l’arrivée au pouvoir d’Amr Ibn Louhay, le Chef de Khouzâaa. Mais, lorsque ce dernier, au cours d’un voyage en Syrie découvrit que les Syriens, dont la patrie comptait parmi les berceaux des Messagers et des Livres Sacrés adoraient des idoles, il s’en procura une, du nom de Houbal, qu’il ramena à la Mecque, l’installa somptuairement à la Kaaba et appela les Mecquois à pratiquer l’associonisme.
Ce fut ainsi que les populations du Hijâz, ainsi que les dirigeants de la Kaaba imitèrent son geste, de proche en proche et que le polythéisme et le monothéisme y cohabitèrent.
Telles sont les conditions dans lesquelles, des « divinités » comme Manât et Al-Lât s’imposèrent dans ce Panthéon polythéiste, si bien qu’avant la Révélation de Muhammad, le culte des idoles devint si florissant que la Kaaba en renfermait près de 360.
Les populations les invoquaient pour leurs besoins, les créditaient d’un pouvoir d’intercession auprès d’Allah, on organisant des pèlerinages au cours desquels, on se prosternait devant elles.
L’Arabie antéislamique abritait, aussi, des pratiquants du Judaïsme et des pratiquants du christianisme. Les premiers, depuis les conquêtes Babyloniennes et Assyriennes et les pressions et la captivité exercés sur eux par Boukhtnassan, en 587 avant Jésus-Chrit, les seconds, à partir de l’occupation de la Palestine par les Romains en 70 après Jésus-Christ. D’ailleurs, les persécutions de Najran par Youssouf Thou Nouwas en portent témoignage.
La Basmala qui fait partie des premiers mots révélés par l’Ange Gabriel au Prophète Mohamed (PSL) (Tabari.,I,51,52), a survécu à ces cohabitations.
Pour l’Islam, la Basmala témoignage de la présence divine en tout, quelles que soient les circonstances. Elle a été prononcée par Noé avant de pousser son arche dans le fleuve. Et Salomon la place en tête de sa missive à la Reine de Saba.
Déjà avant l’Islam, les Arabes païens disaient, en invoquant leurs divinités : « de par le nom d’Al-Lât, de par le nom de Uzza », avant d’entreprendre un voyage, de sacrifier un animal ou de prier (Zam.,I,6).
On notera, par ailleurs, que les rites de l’Islam et du Judaïsme prescrivent d’invoquer le nom de Dieu en termes presque identiques, avant tout acte sacrificatoire, sinon la chair de la bête sacrifiée est réputée illicite.
La Basmala était inscrite sur le flanc d’Adam et sur l’aile droite de l’Ange Gabriel, sous la forme d’un pentagone régulier étoilé, identique au pentagramme pythagoricien.
C’est ce qui expliquerait l’emploi de cette figure géométrique dans la décoration en général et en particulier, dans l’architecture.
Depuis les Croisades, les Turcs l’ont combinée avec le Croissant lunaire et en ont fait un symbole distinctif des drapeaux musulmans.
Au terme de cette réflexion, une question lancinante me taraude continuellement l’esprit
L’auteur du livre « Le Coran et la culture Grecque » ne manque pas de capacité de jugement. Il n’est pas doublement Agrégé pour rien. Il a révélé dans ses interviews que ses élucubrations, il les avait élaborées plusieurs années auparavant, mais n’avait pas jugé opportun de les rendre publiques.
Nous sommes à environ un mois du Ramadan, en plein mois de Radiab (Le mois de Dieu), celui justement de l’Ascension céleste de Muhammad (PSL) et du Voyage Nocturne, un mois de vivification de la foi, de confirmation de l’Unicité des messages prophétiques incarnés par le monothéisme intransigeant d’Abraham, contenus dans les trois dernières religions révélées ; un mois de générosité au cours duquel, Dieu prescrivait à ses adorateurs, les 5 prières rituelles aux lieu et place des cinquante autres, qu’il projetait de leur fixer ; un mois d’amour, de réconciliation et de paix.
En se livrant à cet exercice, qui s’inscrit dans des précédents regrettables et douloureux, qui ont fait beaucoup de mal à l’Islam et aux musulmans, en ce moment précis de l’Histoire de notre pays et des soubresauts dont la sous-région est agitée, quel objectif, vise-t-on ?
Cherche-t-on à ébranler les convictions des musulmans ? A décourager ceux sur lesquels, l’Islam exerce une irrésistible fascination, afin qu’ils n’adhérent pas à son crédo ?
Cherche-t-on à amener certains musulmans à douter de leur foi, de leur Livre Sacré, de leur Prophète (PSL) et à avoir mauvaise conscience, au risque de devenir de mauvais musulmans ?
Vise-t-on à installer le doute dans les esprits, ou à perturber les consciences, en y installant l’angoisse ?
A-t-on voulu, à présent que l’épisode de Salman Rushdie a fait chou blanc, que les caricatures ignominieuses contre le Prophète (PSL) ont révélé leurs limites étroites et grotesques, susciter un autre foyer de tensions, avec un attrait de presse et de gloire, pour en recueillir je ne sais quoi ?
J’avoue ne pas pouvoir répondre à ces questions. En raison du respect et de la considération que j’ai, toujours, eu pour l’auteur de cet ouvrage provocateur, si lourd de dangers pour la paix sociale et l’harmonie au sein de la société musulmane en général et sénégalaise, en particulier.
ANNONCE PROCHAINE PARUTION:Dissonances, mélodies sociales et politiques mauritaniennes
 À toutes et à tous de l’intérieur, comme de la diaspora
À toutes et à tous de l’intérieur, comme de la diaspora
Nous avons le plaisir de vous annoncer, Sidi N’Diaye (politise) et Abdarahmane Ngaïdé (historien), la sortie prochaine (dans deux semaines…) de notre livre intitulé :
Dissonances, mélodies sociales et politiques mauritaniennes
Discussions aléatoires et libres fragments.
(Éditions l’Harmattan-Sénégal, 2014).
Préface de Dr. Mohamadou Abdoul Diop dit Mody (historien).
En avant-goût : Extraits de l’avant-propos et de la quatrième de couverture
« Ce petit livre peut paraître ridicule, mais pas inutile. Ce sont des fragments de discussions-pensées aléatoires qui portent sur des événements fragmentés, mais toujours solidaires pour alimenter l’énergie motrice de nos communautés. Ces discussions fragmentées lient entre elles les essences internes qui commandent l’événement dans tous les sens que peut recouvrer ce terme aussi chargé que mythique. Evénement/avènement/processus ! Chaque fragment contient son mythe et décline une partie d’un visage nuancé et renfrogné sur toutes ses commissures. C’est un puzzle d’idées éparses, mais qui puisent leur sève nourricière dans les racines profondes d’une Mauritanie en évolution, en révolution (s) endormie (s) ou endormante (s).
Notre sismographe indique les positions différenciées de l’aiguille sociale et politique qui pique notre nerf sciatique et irradie tout notre corps de cette douleur indicible. Cette petite aiguille magnétique crache sur la feuille millimétrée, Mauritanie, une courbe sinusoïdale qui rend compte d’une figure animée, agitée, tiraillée de toutes parts, chevauchée par n’importe qui vers n’importe quoi. Ces fragments rendent compte de l’animation d’une petite époque. Cette époque chargée de nuages féconds en averses, en torrents et en inondation verbale, sémantique et comportementale, et qui mérite notre attention. Une bifurcation lourde et douloureuse est toujours à l’affût des errances mémorielles. Et quand un peuple ne se retrouve dans aucune de ses mémoires [plurielles par essence, devoir, vocation et obligation], il perd tous les fondamentaux de sa spiritualité et tombe dans la spirale tourbillonnaire d’un monde désarticulé et mis à sac par ses propres fils. Ce jour-là, les leçons du passé récent, les acquis du présent, et les espoirs qu’ils suscitaient ensemble, voleront en éclats comme si la vie leur était interdite pour leurs propres inconséquences. Ces fragments n’avertissent pas, ils crient et vocifèrent à haute voix en traçant des chemins modestes qui ouvrent sur des champs d’investigations poussées pour mieux comprendre la profondeur et la nécessité impérieuse de s’arrêter pour reparler, de manière sereine et intelligente, du contrat social mauritanien pour un devenir assumé, assuré et partagé dans une diversité éternellement apaisante.
Donc, dans les textes qui vont suivre, nous ne prétendons pas dire la vérité, nous écrivons plutôt pour dire, raconter à notre manière une certaine Mauritanie. Ce sont là le récit d’événements et de faits que nous avons voulu débarrasser de ces passions qui s’insinuent dans pléthore de commentaires portant sur des aspects précis de la vie politique et sociale mauritanienne.
Et si, comme l’indique le titre Discussions Aléatoires, nous écrivons librement des fragments qui peuvent laisser croire au lecteur non attentif que ceux-ci sont soudains et légers, nous le faisons toujours avec cette lucidité nécessaire à l’analyse et à l’interprétation « froide » de questions ou d’objets « chauds ». Bref, … rendez-vous au final des points de suspension. » [N’Diaye & Ngaïdé, Paris/Nantes 25/04/2014].
À bientôt autour de ces idées.
Bios Diallo-Abderrahmane Sissako L’honneur des chagrins

Son sujet : le drame que vit le Mali avec les insurrections islamistes, avec leur lot de répressions. Le réalisateur mauritanien est le seul africain parmi les dix-huit œuvres en compétition pour la Palme d‘or de cette 67e édition de Cannes. Entrer en compétition c’est un défi en soi.
Homme engagé, et de convictions, Sissako, 53 ans, y vient avec des armes irréfutables. Dire à la face du monde ce qui blesse tout humain : le chagrin. Si nul ne veut connaître cet état d’esprit, le natif de Kiffa est lui un habitué des sujets qui heurtent.
Sa filmographie en porte l’habillage : Rostov-Luanda (1996), est bâti sur les traces d’un combattant de la libération angolaise rencontré à Moscou où il fit ses études de cinéma dans le froid, La Vie sur Terre (1998), film tourné dans un village malien est porté par les textes du poète martiniquais Aimé Césaire, et Bamako, en 2006, une sa retentissante gifle aux institutions internationales sous la robe de la Banque Mondiale aux remèdes peu adaptés.
Dans le sillage, Timbuktu, Le Chagrin des Oiseaux, est la voix des sans voix. Un cri d’outre-tombe, qui fera écho. Cette nouvelle production, tombée dans l’acide huile de l’actualité, est le drame de la saison cruelle du Mali avec la prise de Tombouctou en 2012 par des djihadistes. Celle qui se faisait appeler la cité des 333 saints ou encore la perle du désert est piteusement narguée, sous le nez et la barbe de ses habitants et de la communauté internationale.
Les nouveaux maîtres détruisent les symboles du foyer de brassages ethniques, culturels, religieux et d’ouverture. Les islamistes imposent leurs lois de l’extrême. Cela méritait une colère, même par le filage d’une bobine. Abderrahmane Sissako l’a fait, avec mesure. Rien d’exagérément offert, d’impudiquement exposé. Sissako ne produit que de l’art respectueux.
Car du respect, même les oiseaux en ont besoin. Ceux qui ont marché sur Timbuktu le savent. La blessure leur restera aux visages, puisque même diminués les hommes et les femmes de Timbuktu demeurent dignes. C’est cette image de dignité qui est portée à l’écran. Puisqu’avec la foi et la détermination on peut toujours se relever d’une chute.
L’Afrique, Sissako l’a dans l’âme. Et il ne laisse rien l’égratigner. Avec un filmage de proximité, empreint de sobriété et de pudeur avec des comédiens souvent du terroir, Abderrahmane Sissako est un créateur qui ne laisse pas indifférent. Le Festival de Cannes qui lui avait déjà attribué ses appréciations à travers Un certain regard en 1993 pour Octobre et le Prix de la Critique Internationale en 2002 pour Heremakonon, pourrait lui accorder le sacre. Et ce sera justice pour le talent méticuleux, plein d’assurance et sait attendre… le bonheur !
Bios Diallo
Source: Horizons du dimanche 18 mai 2014
Source: cridem





