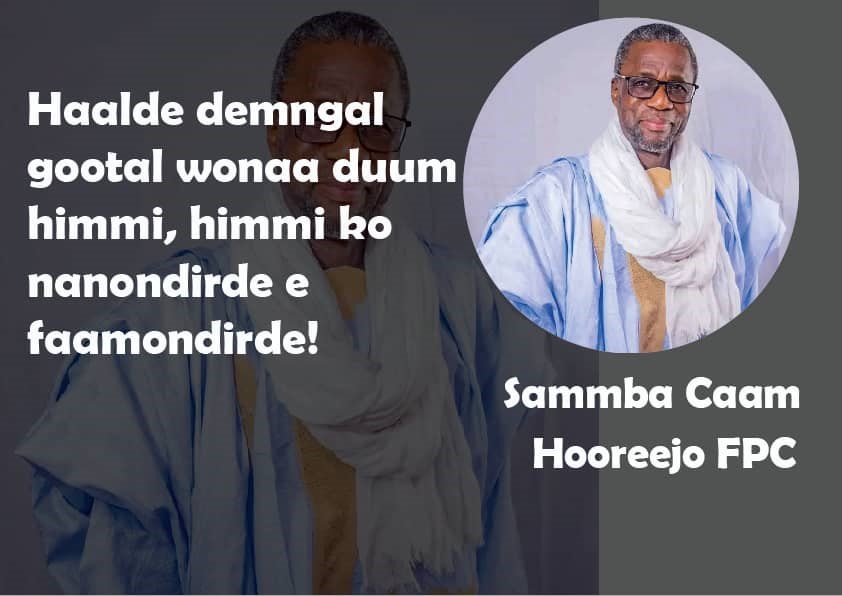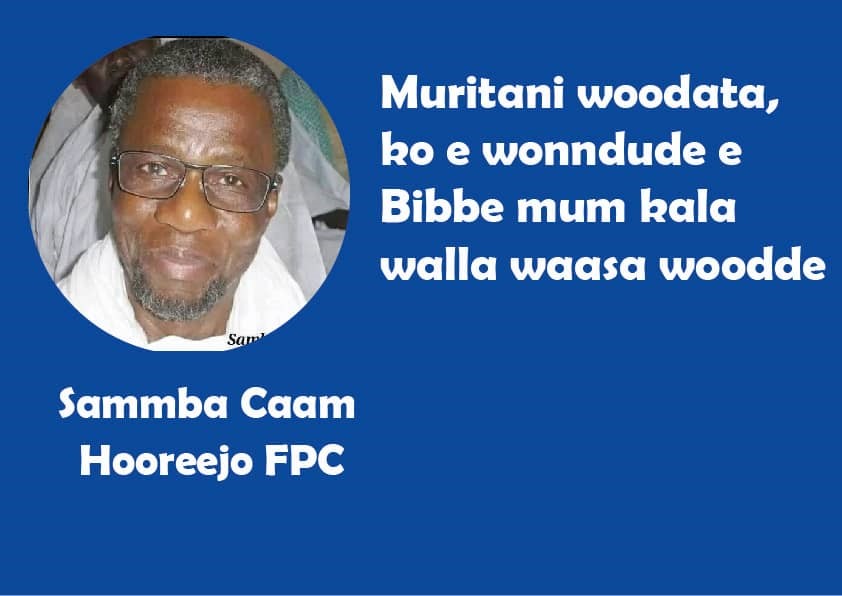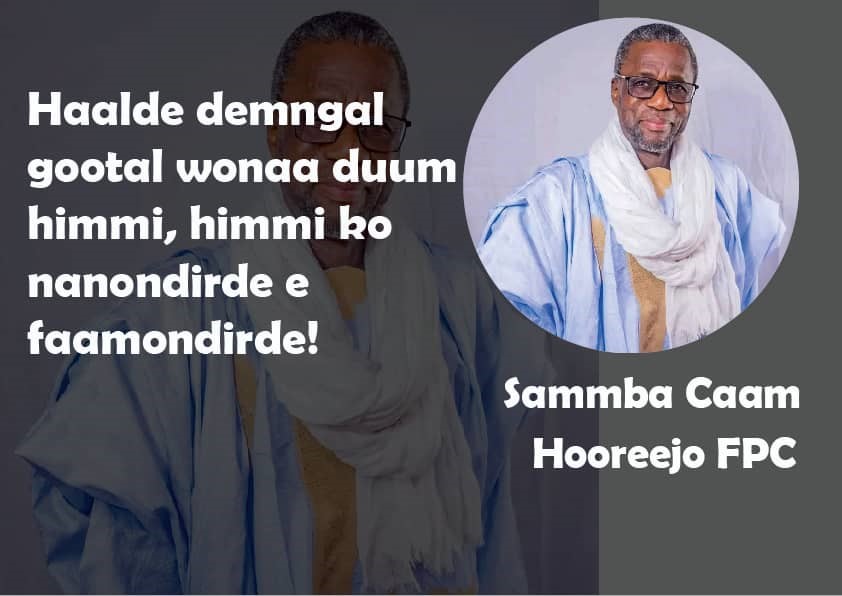Category Archives: presse
Dialogue en gestation : L’opposition à la recherche d’une nouvelle (plate)forme

Depuis quelques jours, l’opposition mauritanienne organise des réunions pour parvenir à une nouvelle plateforme politique. En effet, la présidentielle de 2019 avait fini de dissoudre la Coordination de l’opposition Politique (COD) dont les membres ont soutenu des candidats à la présidentielle. Depuis lors, l’opposition s’est embourbée dans une sorte de léthargie. Du chacun pour soi jusqu’à la création en 2020, de la coordination des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale, ceci, en faveur de la pandémie de la COVID 19. Le président de la République avait appelé à l’union contre la pandémie. Tawassoul, premier parti de l’opposition, le RFD, l’UFP, APP, SAWAB et AJD/MR avaient répondu à l’appel, ce qui avait contribué à apaiser l’arène politique du pays. Les partis de la majorité et de l’opposition ont travaillé ensemble jusqu’au retrait de Tawassoul ; APP, quant à lui, se fait tirer difficilement l’oreille. Le cadre tient jusqu’à la décision de Ghazwani d’appeler aux concertations politiques entre la majorité et l’opposition. C’est donc en faveur de ce cadre que l’opposition se retrouve pour parler d’une seule voix. Avouons-le, ce n’est pas facile. Trois réunions se sont tenues pour y parvenir. Les partis de l’opposition ont tenté de parler et d’harmoniser leurs positions. Il s’agit d’échanger sur les thématiques, le format et de mettre en place une commission de pilotage, laquelle définira le format et ceux qui devront représenter l’opposition au comité de supervision du dialogue. Il est évident que tous les partis de l’opposition ne pourraient pas siéger à ce comité et par conséquent, il faudrait désigner ceux qui y seront envoyés. Quels critères seront-ils édictés par l’opposition ? Ceux qui ne seront pas désignés rumineront-ils leur colère au sein du nouveau cadre qui sera mis en place ? Au sein de l’opposition, certains partis politiques travaillent à éviter des frictions et à unir celle-ci. C’est d’ailleurs pourquoi, les organisateurs des différentes réunions ont ratissé large ne laissant personne en marge. Ils veulent un conclave inclusif pour débattre de l’ensemble des questions nationales. La feuille de route concoctée s’est efforcée à prendre en compté l’ensemble des préoccupations majeures du pays.
Au terme de cette première étape donc, l’opposition pourrait se trouver une nouvelle plateforme et partant parler d’une seule voie aussi bien lors des concertations que lors des prochaines échéances électorales. Elle pourrait désormais peser sur les débats nationaux et imposer, pourquoi pas, au pouvoir un rapport de force en sa faveur. Sa division lors des élections présidentielle de 2019 avait fini de l’affaiblir.
Des sujets qui fâchent toujours ?
Mêmes si toute l’opposition et même la majorité s’accordent sur l’urgence de débattre de l’unité nationale et la cohésion sociale, de la gouvernance et la lutte contre la gabegie, il n’en demeure pas moins que les uns et les autres n’y mettent certainement pas le même contenu. Le passif humanitaire demeure toujours un sujet délicat. Dire la vérité sur ce qui s’est passé dans les casernes militaires, dans la vallée et dans certaines villes du pays, sur les déportations, reste difficile à réaliser car cela engage la responsabilité des forces de défense et de sécurité. Pour certains, l’armée doit être tenue hors de ces conclaves. C’est d’ailleurs pourquoi le régime de Ould Taya avait rapidement fait voter une loi d’amnistie en 1993 pour protéger ceux que les victimes, les rescapés, les veuves et les orphelins qualifient de « bourreaux ». C’est d’ailleurs pourquoi, croient savoir certains, des cercles du pouvoir et des extrémistes qui avaient été mouillées dans ces exactions travailleraient dans l’ombre à saborder les concertations que le président Ghazwani a accepté d’organiser. Or, vider cet abcès ne signifie pas régler les comptes entre les composantes du pays. Si les ayants droit des victimes, les rescapés militaires, les veuves, les déportés ramenés au pays ou les rapatriés volontaires (MOYTO KOOTA) continuent à réclamer, depuis des dizaines d’années, la vérité sur ce qui s’est passé pendant les années dites de « braise » ; ce n’est évidemment pas par esprit de vengeance. En effet, on n’a jamais vu une expédition punitive contre l’un des bourreaux que les uns et les autres suspectent avoir sévi contre leur papa, frères, mari et autre. Ils veulent que de telles exactions ne se répètent pas dans ce pays et qu’ils puissent enfin faire le deuil des leurs. Comment, dans un pays musulman, on prive les citoyens des sépultures des défunts ?
En effet, ces « évènements » de 1989/91 ont profondément ébranlé les fondements de l’unité nationale que tous les acteurs politiques, pouvoir et opposition voudraient consolider et renforcer. Cela passe par accepter un débat sans passion sur ces questions qui continuent de fâcher. On ne peut résoudre les questions nationales et apporter des solutions idoines sans faire preuve de réalisme, de dépassement et de patriotisme. Ceux qui continuent à réclamer la vérité prêchent pour une justice transitionnelle qui a fait ses preuves au Maroc, en Afrique du Sud et en Gambie ; ces pays n’en ont pas pâti, au contraire, ils ont réussi une réconciliation nationale sans accrocs.
En effet, les « évènements » ont créé, comme tout le monde le sait, une certaine méfiance entre les composantes nationales dont certains acteurs politiques, du côté du pouvoir et de l’opposition ne cessent de dénoncer leur marginalisation à tous les niveaux. Ils fustigent des écoles et des nominations monocolores, des médias publics presque exclusifs, le refus d’officialiser l’enseignement des langues nationales (Pulaar, Soninke et Wolof). Ils y ajoutent depuis quelque temps cette espèce d’hypocrisie. Les négro-africains sont supposés être des suppôts du français, langue du colon alors que tous les fils à papas sont dans les filières françaises : Lycée Théodore Monod et autres.
La récente sortie médiatique de 8 partis de l’opposition qui réclamaient justement, un dialogue politique et non des « concertations » a mis le principal parti de la majorité dans tous ces états. Ces sujets qui fâchent vont-ils favoriser un consensus entre les différents acteurs politiques ? En tout cas, tous les acteurs devant se retrouver autour de la table ont exprimé leur désir ou souhait de voir le dialogue être inclusif mais surtout de permettre de débattre de tous les sujets sans tabou.
Dalay Lam
L’Assemblée nationale approuve la loi sur la protection des symboles de l’Etat

AMI – L’Assemblée nationale a approuvé, lors d’une séance publique tenue hier mardi, présidée par M. Cheikh Ould Baya, président de l’Assemblée, un projet de loi relatif à la protection des symboles nationaux et à la criminalisation de préjudice au prestige de l’État et à l’honneur du citoyen.
Le projet de loi se compose de huit articles qui précisent son objectif – sans préjudice des dispositions stipulées dans d’autres lois – d’incriminer et de punir les actes commis intentionnellement à l’aide des médias et des technologies de communication numérique et des plateformes de médias sociaux.
Il incrimine les actes associés à la violation des principes et du caractère sacré de la religion islamique, le prestige de l’État et de ses symboles, la sécurité nationale, la paix civile, la cohésion sociale, la vie personnelle et l’honneur des citoyens.
Les articles du projet de loi expliquent en détail les différentes sanctions pour la commission des infractions qui y sont spécifiées.
Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Ould Boya a précisé dans sa présentation à la Chambre des représentants, qu’il est devenu nécessaire aujourd’hui de lutter contre tout ce qui affecterait l’unité du peuple et le prestige et la souveraineté de l’État, qui se reflètent dans ses symboles de référence. Il s’agit, a-t-il dit, de mettre fin à la mauvaise utilisation des plateformes de médias sociaux, sans préjudice des libertés garanties par la constitution et les accords internationaux ratifiés par la Mauritanie.
Il a souligné que le projet de loi vient à point nommé pour combler les lacunes qui ont été constatées dans notre système pénal afin de donner aux praticiens, juges et enquêteurs les moyens de disposer de mécanismes juridiques clairs pour imposer l’État de droit et le respect des valeurs de la République, en identifiant les actes qui constituent une atteinte aux symboles nationaux et portent atteinte au prestige de l’État, ainsi que les sanctions appropriées pour faire face au phénomène d’atteinte aux principes de la société et de propagation de la haine au sein de ses composantes.
Il a ajouté que le projet de loi permet au ministère public de diligenter automatiquement ou sur demande une action en justice contre ceux qui commettent l’un des actes stipulés dans les dispositions du projet de loi.
Le ministre a déclaré que la protection des symboles est indispensable au renforcement des institutions qui ont en charge les affaires publiques pet qui doivent jouir de la protection et du prestige qui leur permettent d’accomplir les tâches qui leur sont confiées, loin d’interférences de personnes qui consacrent toutes leurs énergies au découragement et à l’incitation à la sédition et à la dénonciation des forces armées et des forces de sécurité.
Il a insisté sur le fait que la liberté d’opinion est préservée et défendue, et que le projet de loi vise à mettre fin au chaos observé et à l’incitation à la violence et à la haine, soulignant qu’il est de la responsabilité des pouvoirs d’affronter cette situation pour éviter toute dérive préjudiciable.
Dans leurs interventions, les députés ont indiqué que le projet de loi était attendu depuis longtemps afin de mettre terme à l’anarchie qui caractérise l’espace virtuel, en violation totale des valeurs et principes sacrés, menaçant la paix et la stabilité civiles, et méprisant les symboles de l’État et l’honneur des citoyens et portant gravement atteinte à la quiétude publique.
Ils ont fait savoir que le moment est venu pour les usagers des réseaux sociaux de se rendre compte qu’il existe des limites et des règles juridiques dissuasives, et qu’il existe une grande différence entre, d’une part, la critique constructive et, d’autre part, la volonté de sape, de calomnie, d’insulte et de mépris. Ils ont indiqué que le projet de loi répond à un besoin de protection des entités publiques et des citoyens, et de respect de la vie privée.
Les députés se sont interrogés sur l’alternative à l’état actuel de chaos en termes l’utilisation des réseaux sociaux. Faudrait-il rester passif, laissant la voie grande ouverte à toutes sortes d’abus, aux rumeurs et aux incitations à la haine, ou plutôt de rejoindre d’autres pays qui ont mis en place les mécanismes de contrôle de l’espace virtuel pour éviter de sombrer dans des dérives préjudiciables à la communauté.
Le choix est vite fait ont-ils fait remarquer, et saluant les dispositions du projet de loi car il permettra de protéger les acquis démocratiques, d’assurer l’unité nationale et de préserver les valeurs de la société mauritanienne inspirées de l’Islam authentique.
Certains parlementaires ont estimé que la nature sensible du projet de loi nécessite l’implication d’experts et de la société civile dans sa préparation et de laisser aux députés suffisamment de temps pour l’étudier.
Ils ont précisé que ce ne sont pas les textes de lois qui font le plus défaut mais plutôt dans leur activation et leur application, exprimant leurs craintes que le projet de loi ne soit utilisé comme un obstacle à la critique et l’éclairage de l’opinion publique.
L’Assemblée nationale a, également, approuvé les modifications apportées par la Commission de la Justice, de l’Intérieur et de la Défense aux articles 2, 3, 5 et 7 du projet de loi, qui, dans leur ensemble, visent à clarifier le contenu de ces articles.
AMI
Percée djihadiste au Mali : Le Sénégal doit se réveiller avant qu’il ne soit trop tard (Par Hussein Bâ)
Dans le cadre d’un dossier qu’il a consacré au Mali, le journaliste sénégalais Hussein Bâ revient une fois de plus sur les dangers sécuritaires qui guettent le Sénégal, frontalier du Mali. Dans le troisième numéro de ce dossier que Seneweb publie en quatre parties, l’ancien collaborateur de « Sud Hebdo », qui a collaboré respectivement au dispositif électoral sous en ATT et IBK en 2002 et 2013 au Mali, appelle le Sénégal à être davantage regardant sur la situation du Mali, avec la volonté des djihadistes de perturber le trafic vers Bamako afin de couper le pays. Il rappelle également l’objectif final visé par ces djihadistes du GSIM est de bâtir un « Emirat islamique du Mali », avant de s’ouvrir vers l’Atlantique, donc, une menace ouverte sur le Sénégal.
« Cap vers le Sud ! », telle est la substance du message posté par Iyad Ag Ghali, patron de la nébuleuse « djihadiste » Ansar Dine devenue GSIM (Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans), affilié à al Qaïda, au lendemain de la prise de Kaboul par les Talibans. Depuis cette sentence, la situation sécuritaire s’est considérablement dégradée au Centre et à l’Ouest du Mali.
La région de Ségou est désormais aux prises avec des attaques terroristes quotidiennes. Le regain d’intérêt pour cette région et son ciblage persistant par les « djihadistes » rappelle un autre épisode, tout en clarifiant une question récurrente : en janvier 2013, le même Iyad Ag Ghali avait ordonné la descente vers le Sud en attaquant simultanément deux axes, à savoir le corridor Konna -Sévaré – Mopti et Diabali qui mène vers Ségou. Par cette opération simultanée, on se demandait si le chef des « djihadistes » voulait conquérir deux voies qui mènent à Bamako, ou simplement mettre la main sur l’aéroport Ham Bodédio de Mopti.
Au vu du déroulement actuel des opérations des « djihadistes », le doute n’est plus permis. Al Qaïda veut conquérir la capitale malienne où il dispose de nombreux sympathisants « dormants », pour y proclamer l’avènement de « l’émirat islamique du Mali ». Pour y parvenir, il mise sur deux approches redoutables : la conquête et l’administration rigoureuse des territoires du monde rural (en évitant le combat frontal dans les grandes villes) et la perturbation totale des corridors d’approvisionnement pour asphyxier le pays et la capitale.
C’est sous cet angle qu’il convient d’interpréter les attaques menées récemment dans le corridor Ouest, précisément dans les régions de Kayes et de Koulikoro, et qui concernent directement le Sénégal. Le 11 septembre 2021 (les « djihadistes sont avides de symboles), deux camionneurs marocains ont été tués à Didiéni dans la région de Koulikoro, à 300 km de Bamako, par des éléments encagoulés. Chose étrange mais logique : les assaillants n’ont pas touché à la marchandise. L’acte était plus politique que crapuleux. C’était un message sanglant.
Cette région de Koulikoro, que les « djihadistes » semblent choisir pour perturber le trafic vers Bamako, est une zone idéale pour atteindre un tel objectif. À partir de la Commune de Diéma en amont, les deux grands corridors internationaux (Dakar – Bamako et Casablanca – Nouakchott – Bamako) convergent pour aller vers la capitale malienne, en passant par cette région de Koulikoro.
En vérité, l’objectif des assaillants est de faire peur. Ils n’ont pas besoin de « check-points » armés, impossibles à tenir. Lorsque les chauffeurs, les propriétaires des camions et des marchandises auront suffisamment peur pour leur vie et pour leurs biens, la fonctionnalité des corridors sera compromise.
Pour le Sénégal, ce qui est désormais en question, c’est son ouverture vers l’Afrique. En dehors du Mali, il n’a aucun corridor viable vers le marché communautaire de la CEDEAO. Le Mali est aussi son premier marché. C’est le pays tampon avec le terrorisme au Sahel. S’il cède, le Sénégal sera en première ligne. L’approche religieuse des « djihadistes » qui y prennent un essor inquiétant est en totale contradiction avec la pratique islamique majoritaire au Sénégal qui est de tendance confrérique soufie.
Ces « djihadistes » n’aiment ni les mausolées, ni les marabouts, encore moins les Khalifes généraux. Certains rêvent de voir détruire des tombes à Kaolack, à Touba et Tivaouane, comme cela s’était passé à Tombouctou. Leur objectif final, après un « émirat islamique du Mali », c’est de s’ouvrir vers l’Atlantique.
Pour le Sénégal, la question se pose désormais en termes de sécurité nationale directe. Certes, le renforcement des dispositions sécuritaires à la frontière décidé par le président de la République est à saluer, mais cela est insuffisant. Le Sénégal doit être plus actif et pro-actif sur la scène malienne elle-même, en l’aidant de manière plus conséquente à surmonter les équations politiques et sécuritaires.
Par loyauté diplomatique, le Sénégal s’aligne derrière la CEDEAO, alors qu’il a au Mali des intérêts spécifiques qui ne sont pas ceux du Nigeria, du Ghana ou du Togo, par exemple.
Toutes les projections d’émergence vantées ici risquent d’être pulvérisées si l’immense voisin malien devait s’effondrer. Qu’à Dieu ne plaise ! Le président de la République du Sénégal doit créer un nouveau cadre dédié au Sahel directement rattaché à lui avec un agenda créatif, basé sur des compétences pointues. Ce nouveau cadre devra disposer d’un monitoring permanent des évènements, des enchaînements significatifs qui dégagent les tendances lourdes.
Tous les scénarii doivent être envisagés. Qu’est-ce qui empêcherait donc le chef de l’État du Sénégal à effectuer une visite de travail au Mali à la rencontre de la nation malienne, ne serait-ce que pour la soutenir moralement ? Ou d’inviter les acteurs maliens à Dakar comme le président Wade l’avait fait avec la Mauritanie après le coup d’État.
Certes, il y a la susceptibilité de la CEDEAO à gérer. Il faut juste faire en sorte que les partenaires de l’espace communautaire acceptent des initiatives positives complémentaires. Un nouvel agenda du Sénégal sur le Sahel et le Mali peut impulser une perspective dynamique avec des objectifs structurants :
– aider à une réévaluation du schéma politico-diplomatique de sortie de crise plus englobant que l’accord de paix et de réconciliation ;
– proposer une ingénierie politique plus adaptée afin d’aider à la stabilité institutionnelle ;
– engager une relecture audacieuse et substantielle de la doctrine de lutte anti-terroriste ;
– plaider pour un engagement plus volontariste du leadership africain dans la prise en charge des dossiers de crise ;
– promouvoir l’autonomisation de la réflexion stratégique en dotant la CEDEAO d’un véritable centre d’excellence axé sur les questions sécuritaires et menaces fondamentales.
Plus généralement, sur la question du Mali, Dakar et Abidjan doivent parler d’une même voix. Le Sénégal dispose aussi d’un point d’entrée culturel au Nigeria (grâce à Sheikh al Islam Baye Niass) qui peut aider à fluidifier cet axe indispensable. Une nouvelle posture du Sénégal plus présente peut engendrer une plus value politique et diplomatique pouvant encourager un dialogue constructif avec des acteurs non régionaux aux tendances autocratiques, qui offrent aux aventuriers de l’espace communautaire des alternatives dangereuses.
Un sursaut de dignité fondé sur le volontarisme, l’exemplarité dans la prise en charge des besoins et l’autonomisation de la réflexion stratégique, peut créer de nouveaux paramètres dans le sens du repositionnement des puissances étrangères aujourd’hui dans l’impasse.
Hussein BA
Seneweb / Le Témoin
Mauritanie : le retour par la petite porte à Nouakchott du colonel Ely Zayed Ould Mbarek

Les Nations-Unies ont finalement cédé à la pression des organisations nationales et internationales des droits de l’homme et des témoignages des rescapés de la prison mouroir de Oualata en retirant la nomination du colonel Ely Zayed Ould Mbarek à la tête de la MINUSCA à Bangui en RCA.
C’est une mauvaise nouvelle pour la Mauritanie et pour Ould Ghazouani qui avait pris la responsabilité de proposer un présumé tortionnaire de l’armée des années braise de 86 à 92 à occuper de hautes fonctions comme émissaire des Nations-Unies à la MINUSCA à Bangui en RCA. Quelques mois auront suffi aux Nations-Unies pour retirer la nomination du colonel Ely Zayed Ould Mbarek.
C’est une première bataille politique gagnée par les rescapés de Oualata et toutes les victimes négro-mauritaniennes de la vallée sous le régime du génocidaire Ould Taya et en particulier les FPC qui ont contribué à un véritable travail de mémoire et de diffusion du génocide mauritanien. C’est une victoire morale pour tous les combattants mauritaniens de la liberté qui n’ont de cesse dénoncer les exactions ou les tortures commises par les éléments de l’armée contre les dirigeants du premier mouvement de libération africaine de Mauritanie pour avoir publié le « Manifeste du négro-mauritanien ».
Pour la première fois les Nations-Unies ont cédé à la pression des victimes mauritaniennes et ouvrent ainsi la voie à l’aboutissement de plaintes internationales contre l’ancien président Ould Taya, exilé au Qatar et les nombreux tortionnaires militaires en liberté comme le boucher de Oualata le capitaine Ghaly Ould Souvy qui vient d’adresser une lettre de soutien au colonel Mbarek et d’autres hauts gradés de l’armée toujours en activité et soupçonné de génocidaire comme le chef des armées Ould Meguett.
L’émissaire des Nations-Unies rentre ainsi par la petite porte à Nouakchott et laisse derrière lui des traces indélébiles de l’horreur des camps de Oualata.
Cherif Kane
Coordinateur journaliste
Crise algéro-marocaine : le Sahara occidental «n’est pas à négocier», met en garde le roi du Maroc

Le Figaro – Le discours de Mohammed VI était très attendu dans un contexte très tendu entre le royaume marocain et l’État algérien.
Le Sahara occidental, territoire disputé entre le Maroc et les indépendantistes sahraouis soutenus par l’Algérie, «n’est pas à négocier», a affirmé ce samedi soir le roi du Maroc, Mohammed VI, dans un discours retransmis par la télévision nationale.
«Aujourd’hui comme par le passé, la ‘Marocanité’ du Sahara ne sera jamais à l’ordre du jour d’une quelconque tractation», a souligné le monarque marocain, dans un contexte de vives tensions avec l’Algérie à propos de cette ancienne colonie espagnole.
«En fait, si nous engageons des négociations, c’est essentiellement pour parvenir à un règlement pacifique de ce conflit régional artificiel», a souligné Mohammed VI dans un discours prononcé à l’occasion du 46e anniversaire de la «Marche Verte» vers le Sahara occidental.
En novembre 1975, une «Marche verte», à l’appel du roi Hassan II, mobilise 350.000 Marocains qui franchissent la frontière du Sahara occidental, alors colonie espagnole, au nom de «l’appartenance» du territoire au royaume. Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé il y a une semaine «les parties» au conflit du Sahara occidental à reprendre les négociations «sans conditions préalables et de bonne foi».
Bombardement ?
Ces négociations sont à reprendre, sous l’égide du nouvel émissaire de l’ONU, l’Italo-Suédois Staffan de Mistura, «en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable» dans la perspective d’une «auto-détermination du peuple du Sahara occidental», précise l’ONU, dans une résolution qui prolonge d’un an la mission onusienne (Minurso) dans la région. Le discours du souverain marocain, très attendu, survient au moment où les relations entre les deux frères ennemis du Maghreb sont au plus bas.
En août dernier, après des mois de frictions, Alger a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, l’accusant «d’actions hostiles». Rabat a regretté une décision «complètement injustifiée».
La tension est encore montée d’un cran ces derniers jours après que l’Algérie a fait état d’un bombardement ayant causé la mort de trois camionneurs algériens au Sahara occidental, territoire disputé entre le Maroc et les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, qu’Alger a attribué à Rabat.
Le Figaro avec AFP