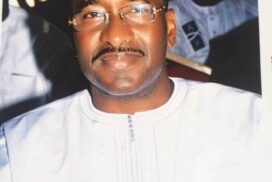Faut-il, pour autant, se venger sur les petits « hratine » ?par Mohamed Baba
 Après la condamnation pour faits d’exploitation de mineurs consécutivement à l’ « affaire d’Arafat », une petite psychose s’est emparée de la société « maure ». Les familles voient des agents de l’Initiative pour la Résurrection du Mouvement Abolitionniste en Mauritanie (IRA Mauritanie) à tous les coins de rues. Le prénom « Biram » est dans toutes les bouches. On ne s’imaginait pas exposé à aller en prison pour si peu. « Boys », « bonnes » et autres commis de ménage deviennent, du jour au lendemain, autant de raisons offertes au voisin envieux, au cousin jaloux et aux méchants en tout genre de se venger sur vous. Des familles « honorables » ont été ainsi « trainées dans le net », calomniées et accusées de tous les maux. Malgré toutes les ambigüités et le risque de dévoiement que comportent ses méthodes et les déclarations de certains de ses animateurs, je salue le combat de l’IRA et souligne son rôle majeur dans les dernières avancées des droits des gens en Mauritanie. « Paris vaut bien une messe », disait un illustre Protestant. Parmi toutes les réactions et débats suscités par le début d’application de la loi criminalisant l’esclavage et les pratiques esclavagistes, votée en début du mandat du Président Sidi Ould Cheikh Abdallahi, une seule retiendra mon attention dans ce petit texte. Il s’agit de la délectation que semblent éprouver certains « Maures » à la vue des employés hratine (exploités ou pas) mis à la porte par leurs employés. « Bien fait pour eux. Ils n’ont qu’à aller voir Biram pour les embaucher », semblent dire certains, avec une pointe de perfidie.
Après la condamnation pour faits d’exploitation de mineurs consécutivement à l’ « affaire d’Arafat », une petite psychose s’est emparée de la société « maure ». Les familles voient des agents de l’Initiative pour la Résurrection du Mouvement Abolitionniste en Mauritanie (IRA Mauritanie) à tous les coins de rues. Le prénom « Biram » est dans toutes les bouches. On ne s’imaginait pas exposé à aller en prison pour si peu. « Boys », « bonnes » et autres commis de ménage deviennent, du jour au lendemain, autant de raisons offertes au voisin envieux, au cousin jaloux et aux méchants en tout genre de se venger sur vous. Des familles « honorables » ont été ainsi « trainées dans le net », calomniées et accusées de tous les maux. Malgré toutes les ambigüités et le risque de dévoiement que comportent ses méthodes et les déclarations de certains de ses animateurs, je salue le combat de l’IRA et souligne son rôle majeur dans les dernières avancées des droits des gens en Mauritanie. « Paris vaut bien une messe », disait un illustre Protestant. Parmi toutes les réactions et débats suscités par le début d’application de la loi criminalisant l’esclavage et les pratiques esclavagistes, votée en début du mandat du Président Sidi Ould Cheikh Abdallahi, une seule retiendra mon attention dans ce petit texte. Il s’agit de la délectation que semblent éprouver certains « Maures » à la vue des employés hratine (exploités ou pas) mis à la porte par leurs employés. « Bien fait pour eux. Ils n’ont qu’à aller voir Biram pour les embaucher », semblent dire certains, avec une pointe de perfidie.
Il est peut être vrai que l’application brutale et sans accompagnement de la loi peut avoir des effets pervers. Des vies peuvent en être affectées et leur cours détourné. L’histoire de Maissara, que je m’en vais vous conter, s’en veut une illustration. Maissara est un petit hartani, de père inconnu. Sa mère, fille mère à quinze ans, aide sa grand-mère à tenir une petite échoppe quand les travaux des champs ne suffisent plus à occuper toute la famille. La grand-mère de Maissara élève, en plus de la jeune mère, trois autres enfants échelonnés dans les âges. Très vite le petit Maissara s’est trouvé livré à lui-même. Même dans les villes de l’Intérieur, la rue est une dure école, à l’issue incertaine. Les coups n’y attendent pas les années et on y dérape très vite. Un jour, il y a de cela 5 ans, la grand-mère de Maissara l’amenait chez Omar. Il y avait là, dans la famille d’Omar, des enfants de l’âge de Maissara. Omar est un directeur d’école aux méthodes réputées et craint par tous les enfants du quartier. Il n’est pas rare que des mères de famille, issues de toutes les conditions sociales, changent leur enfant d’école et le confie au Directeur Omar.
Pour la grand-mère, Omar n’est pas un directeur quelconque. Des liens plus compliqués le lie à elle et à ses deux autres sœurs. Contrairement à ses sœurs, la grand-mère de Maissara avait connu sa propre grand-mère. Elle s’appelait « El bambarya », portait des scarifications au visage et « appartenait », pour partie, à la mère d’Omar. Mais c’est là une histoire bien ancienne. La grand-mère de Maissara, ses grand-tantes et la mère de ses dernières ont toujours habité de l’autre côté de la ville d’Aleg. Elles louent, toutes, leurs services chez des Maures « blancs » mais jamais chez Omar. A la fois pour ne pas faire payer ses services à quelqu’un de la famille mais aussi pour ne pas être traitées d’anciennes esclaves. Une tacite entente s’est conclue entre ces deux familles interdisant à l’une de rémunérer les services de l’autre. Il n’y a, cependant, pas de clause qui proscrive qu’Omar aide celles qu’il considère comme étant ses protégées ni que ces dernières le lui rende sous forme de fagots de bois, bottes de paille ou portion de récolte de haricots blancs ou de graines de pastèques. Sans protocole, le Directeur accepta de garder le petit Maissara, de se charger de son éducation et, notamment, de son instruction. Aucune raison objective, expliquait-il à la grand-mère, ne pourrait l’empêcher de faire de Maissara un ingénieur. Il sera, cependant, précisa-t-il en direction de la grand-mère et du gamin, traité comme les autres enfants, même droits et mêmes devoirs. Il se lèvera tôt, comme les autres, pour aider à tirer le lait des chèvres pour préparer le petit déjeuner. Il fera les courses et autres commissions pour le compte des adultes de la famille, comme les autres enfants. Il se pliera au rituel de la tournée du lave-mains qu’on présente aux convives avant et après les repas. Il débarrassera la nappe à tour de rôle avec les autres petits garçons de la famille.
La famille d’Omar est composite et la maison abrite plusieurs générations. Etait ce parce que le prénom « Maissara » était plus facile à prononcer ou que des considérations intimes défendaient à certaines de ces dames de crier, à haute voix, certains prénoms ? Le fait est que le petit protégé d’Omar est statistiquement plus mobilisé que les autres petits de la famille. Cependant Maissara ne s’en est jamais plaint et Omar ne ratait pas d’occasion de rappeler à toute la famille les closes du contrat non écrit qui justifie la présence du petit dans la famille.
Puis vint l’affaire de « Arafat », un quartier de la Capitale, loin d’Aleg. Des militants des Droits de l’Hommes ont dénoncé la présence de fillettes mineures travaillant au service d’une famille de « Maures ». Les deux familles, « Maures » et « Hratine » ont été interpelées. D’autres cas ont été jugés et pour certains d’entre eux, la prison était au bout. Que faire du petit Maissara ? Qui est Maissara aux yeux de la loi ? Quels liens le lient-ils à la famille d’Omar ? Qui sont, pour Maissara, les petits dont il partage les jeux, les couches et les classes tous les jours ? Que fait, exactement, Maissara, dans la famille d’Omar ?
On prit des avis. Omar se déplaça pour voir le Procureur de la République et lui exposa le cas de Maissara : comment, lui dit il, préserver l’intérêt de ce petit et rester en conformité avec la loi ? En ami de la famille, le défenseur de la société, conseille à Omar de renvoyer Maissara chez sa mère ou sa grand-mère. Il faut, lui dit-il, laisser passer cet orage. Tu pourras toujours demander à sa grand-mère de le garder le soir quitte à ce que tu le gardes, toi, à la maison pour midi.
D’autres avis sont plus tranchés. « Maissara n’est pas membre de la famille. Pourquoi risquer la prison pour si peu. Rien ne peut être tiré de ce petit. Renvoyez-le dans sa famille. Qu’ils se débrouillent et, s’il le faut, qu’ils appellent Biram ».
Rendre Maissara à sa grand-mère c’est le retirer de l’école. C’est le ré-implanter dans un milieu qui ne lui est pas profitable.
Mais où est l’Etat dans cette affaire ? Où est la puissance publique ? Pourquoi le Directeur Omar ne peut-il pas garder le petit Maissara chez lui, assurer sa subsistance et veiller sur son instruction ? Quitte à faire signer à sa mère et à sa grand-mère une décharge ou une procuration de transfert d’autorité parentale. Ne devrait-il pas y avoir un moyen de régulariser cette situation au meilleur de l’intérêt de l’enfant ?
La situation de ce petit Maissara est symptomatique de la grande complexité de l’application de la loi. Comment régulariser la situation d’une bonne, d’un boy ? Existe-t-il une convention type ? Vers quelle administration se tourner ? Qui pourrait jouer le rôle des assistantes sociales, si utiles dans les autres pays ? Il est incompréhensible qu’une question si importante soit laissée au seul soin des ONGs. Si l’Etat considère que ces questions ne relèvent que du domaine des Droits de l’Homme, pourquoi ne pas y impliquer la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme ? Il est urgent que l’Etat se saisisse de cette question, éclaire les gens, les oriente et surtout fasse que les petits hratine ne soient pas victime d’une loi censé libérer leur communauté.
Mohamed Baba