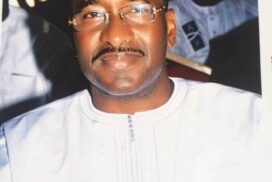Révolution manquée ou manquement à l’esprit de la Révolution ? La Mauritanie marque encore sa singularité…par Nayra Cimper
 Yves Tissier dans son Vocabulaire de l’Histoire, donne une définition sur la révolution : un « renversement soudain d’un régime politique, souvent perpétré dans la violence et qui parfois s’accompagne d’un bouleversement complet des institutions, des structures économiques et des conditions de vie d’un pays », c’est-à-dire de l’ordre social.
Yves Tissier dans son Vocabulaire de l’Histoire, donne une définition sur la révolution : un « renversement soudain d’un régime politique, souvent perpétré dans la violence et qui parfois s’accompagne d’un bouleversement complet des institutions, des structures économiques et des conditions de vie d’un pays », c’est-à-dire de l’ordre social.
Elle peut aussi se dérouler sans violence apparente mais bouleverser la société en profondeur.
Les Canadiens parlent de « la révolution silencieuse » des années soixante où la pratique religieuse a diminué, le taux de natalité s’est effondré, la délinquance a augmenté, etc… On a bien eu dans les années 68 comme on dit en France, une sorte de révolution dans les mœurs (au sens large) qui a été reprise notamment par le parti socialiste et qui n’a pas fini d’avoir de l’influence, y compris sur la vie politique.
Plus proche de nous dans le temps, l’exemple d’une révolution de sursaut, qui arrive alors qu’on ne l’attendait plus.
La Tunisie et les Tunisiens et leur révolution de Jasmin, ont réssucité l’esprit révolutionnaire fondamental, celui qui ne peut que s’insurger et s’indigner devant le spectacle de ce qu’il est convenu d’appeler l’injustice de trop. Bouazizi, par sa détresse personnelle et son acte déséspéré, a déclenché ce que Nietzche nommait malicieusement “l’esprit de vengeance”. La nature de cet “esprit de vengeance” métaphysique : c’est la vengeance à l’égard du temps qui passe, la vengeance à l’égard du passé. L’obstacle invincible contre lequel la volonté ne peut rien. Robespierre comme Lénine comme les animateurs de Mai 68 : ils ont la haine du passé. Le passé est à détruire, c’est lui qui bloque l’accès au bonheur.
Les Tunisiens ne présentent pas les symptômes de ce mal invisible, qui se nourris de l’énergie d’une colère sourde et d’un désir aveugle. L’esprit de vengeance ne porte pas ici le masque de la justice, il vient, traversant les rues, les bourgs, les villes et les villages, le retirer de sur le visage de l’autorité, de la légalité et du pouvoir. La réflexion profonde de l’homme s’exprime enfin, après des années d”observation…Après les colonisations, les guerres mondiales auto-proclamées, les indépendances octroyés, les nationalismes identitaires, les internationalismes Impériaux, l’isolation, le repli, les famines, le sous-développement, l’ouverture, la démocratie rigide excluante, la schysophrénie militaro-civil, les génocides, les guerres civiles, le terrorisme… Après tant et tant , les Tunisiens au premier rang, donne l’impulsion de cet idéal qui habitait nos pensées secrètes et nos prières intimes …
En dépit d’un contexte mondial chaotique, est née une conscience révolutionnaire aiguisée et organiser, qui se confirme avec l’éxemple de l’Egypte, où nous assistions médusé et admiratif à l’expression de la détermination et de la cohésion de tout un peuple. Autrement fier de son passé , allant jusqu’à portéger le musée du Caire, comme s’il s’agissait d’un temple renfermant les textes millénaires, qui témoignent de leur existence, de leur diversité et qui est un testament à toute l’humanité.
La révolution des Tunisiens et des Egyptiens, n’est ni marxiste ni léniniste, elle n’est pas motivée par une doctrine mais par une confrontation soudaine au réel.. L’enchainement des évènements prend une tournure innatendue quand la technologie et les réseaux sociaux se joignent au manège, émerge alors des objectifs, des stratégies, un relais de communication s’installe, des vidéos sont diffusés, des photos échangés, des communiqués écrits, des histoires racontées, une formidable mobilisation se met en place, les diasporas emboitent le pas de leurs frères au pays et sensibilisent les opinions sur leur lutte, les sympathisants du monde entier se mettent à twiter à tout va et la révolution enfonce les portes une à une…
Fidel Castro disait : ” rêver en des choses impossibles, c’est de l’utopie ; lutter pour des objectifs non seulement à notre portée mais indispensables pour la survie de l’espèce, c’est du réalisme“. On ne peut transformer positivement le réel par la critique pure et la condamnation morale du système. La vérité existe même si elle ne se manifeste pas toujours.
C’est aux hommes à lui donner droit de cité. Un révolutionnaire ne conditionne pas son engagement à la garantie d’une réussite personnelle mais au bien-fondé de ses objectifs.
Les Tunisiens et les Egyptiens ont en commun l’exercice de la non-violence comme arme de destruction massive, ce qui n’exclut pas d’avoir le droit de se défendre face à une menace cohercitive d’envergure. Bernadette Bayada, membre du Mouvement pour une Alternative Non-violente, soulignait notre besoin d’avoir un million de Ghandi , j’éspère qu’elle était devant son poste de télévision pour voir les Millions d’Egyptiens PLACE TAHRIR.
La jeunesse Mauritanienne, il faut bien le reconnaitre, ne fait plus vraiment parler d’elle, depuis les années 70.
Et encore elle ne faisait parler d’elle qu’en Mauritanie. Notre influence sur le monde qui nous entoure remonte très loin et la nostalgie à elle seule ne ranimera pas ce passé, ni n’en expliquera la signification ou la portée. Se lamenter sur ce qui n’est plus alors que ce qui est, n’est pas pris en considération, c’est un suicide ou la manifesation d’une indifférence dangereuse et meurtrière. La nécessité d’une révolution dans notre pays est urgente, elle l’était déjà hier et le sera encore demain. La fenêtre d’opportunité cependant ne restera pas ouverte longtemps. Sans inviter personne à la précipitation, la posture de la patience à bon dos, l’utiliser comme justification pour s’épargner un positionnement clair et tranché relève de la facilité.
Tomber dans des pièges aussi grossiers, tendus par des personnages dont la fourberie n’a dégale que la logique de meutes qui la sous-tend, c’est inconcevable quand on a subit comme nous trente ans de ce traîtement.
La jeunesse Mauritanienne sortit le 25 février fait écho à toutes les manifestations qualifiées d’émeutes qui ont précédés. Etouffer la voix du peuple, la contenir, n’est pas la faire disparaitre. Le mécontentement a grandit avec l’appêtit toujours plus voraces de nos gouvernants.
Il atteint aujourd’hui une étape de maturité décisive. Remettre en cause notre système n’est pas une idée saugrenue, c’est l’évidence même. De quoi ce système a t’il accouché ? De l’installation au pouvoir et dans les mentalités, d’une idéologie mal définie parce qu’hypocrite dans le fond, suivie d’une politique implacable et de l’isolation des élèments d’une même société au sein de leurs communautés respectives.
La réussite de cette idéologie qu’on base sur sa durée, tient à plusieurs facteurs que je ne vais pas approfondir ici.
Ce qu’il faut en retenir et qui peut servir de leçon dans l’avenir, c’est qu’elle aura accomplis d’instaurer un climat de défiance et d’accentuer les divergences.
Celles-ci ne manqueront pas d’être récuperées et réintroduites sous des formes diverses et pour produire différents effets. A quel moment avons-nous cesser de croire en notre destin commun ? Y avons-nous même cru un jours ?
Je crois que la providence fait bien les choses et que l’idée à l’origine de la Mauritanie moderne vit encore en nous.
Car sans cela, comment expliquer les revendications qui sont les nôtres aujourd’hui et qui ne sont ma foi ni plus ni moins que la devise de notre république. Honneur, Fraternité, Justice. L’honneur qui est attaché à la vertu et au mérite.
Quoique puisse en penser nos dirigeants, il ne s’agit pas pour nous, de leur rendre des honneurs, mais bien à eux de faire honneur à leur charge. Le mérite n’est reconnu que dans l’égalité. La fraternité assure la cohésion sociale et établit le lien indéfectible qui unit les différentes cultures entre elles. La justice, une des grandes vertus cardinales, s’impose à tous par son impartialité.
Ce que nous réclamons, c’est le départ d’un régime militaire, qui ne fait pas honneur à son corps et qui dépouille la nation de son honneur. Cet objectif ne pourra être atteint que dans un esprit de fraternité, d’union sacrée, contre un ennemi commun qui menace d’anéantir la structure même de notre société. Divisé, nous ne sommes pas plus efficace que l’opposition de posture qu’adopte certains de nos politiciens. Le courage, une autre vertu cardinale, nous a trop longtemps fait défaut, mais nous l’avons vu furtivement, quand les cavaliers du changement, ont ébranlé les fondations d’un pouvoir qu’on avait fini par croire indestructible. Ce coup de semonce ne passa pas inaperçu, une brêche venait d’être creusée et il s’agissait de la colmater coûte que coûte. Commença alors, le bal des princes charmants, tour à tour, libérateurs du peuple, redresseurs de torts, nos robins des bois nationaux, surgissait pourtant de la source incriminée, la grande muette n’était pas prête à ce qu’on la fasse taire. Changer son discours, l’adapter au goût du jours, ne représentait pas un grand sacrifice, la consensualité apportait au contraire une certaine dose de flou artistique.
Vous voulez des élections démocratiques ? La transition vous en concocte une sur mesure, en ajoutant à sa mixture une bonne dizaine de partis politiques, sortis du néant et qui y retourneront par la suite. Voilà une interprétation singulière du multipartisme dans son éphémèrité. Concédé sur la forme n’est pas concédé sur le fond. La preuve en est, qu’une fois le président civil annonçé comme démocratiquement élu, prend ses fonctions, il s’empresse pour on ne sait qu’elle raison de récompenser par les honneurs, les putshistes des putshistes des putschistes, enfin vous avez compris, en leur attribuant le grade de général. L’imbroglio démocratique n’ayant que trop durée, le général Aziz protecteur du pauvre et de l’opprimé, prends sur lui de démissionner le président en place. Après beaucoup de blah-blah, une montée de fièvre de l’opposition, des accords sont signés et nous nous retrouvons partis de plus belle pour une nouvelle élection présidentielle, remportée sans surprise par Aziz.
“Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c’est une idée dont l’heure est venue”.
Comment ne pas sentir la vérité de cette citation de Victor Hugo ? Les signes qui annonce que l’heure est venue sont si éclatants qu’on devrait se crever les yeux pour ne pas les voir. Il n’y a pas qu’une idée mais bien des idées au service de la Mauritanie de demain. Pour réaliser ces idées, nous avons les enfants de ce pays, un potentiel jusque là utilisé avec précaution, comme si nous avions plus peur de réussir que d’échouer. Il suffit de contempler le sort reservé à nos intellectuels, d’expression francophone ou arabophone, cantoné à des rôles subalternes, en retrait, dans les coulisses.
Chargés souvent de donner de la cohérence à ce qui froncièrement en est dépourvu, de trouver l’équilibre fragile qui donne l’illusion aux arguments d’être convaincants. Vivre dans le royaume de l’à peu près, quand on veut savoir où on va et comment on y va, c’est difficile.
La jeunesse qui s’est mobilisé le 25 février, n’est pas le symbole de la contestation de quelques jeunes en mal de sensations fortes ou encore de quelques fils et filles à papa. Décrédibiliser ce mouvement spontané en le réduisant à un épiphénomène, n’est pas une analyse encore moins un constat objectif. Cette affirmation gratuite est la matière avec laquelle on forge la désinformation. Si elle s’adresse à quelques individus, elle n’explique pas la présence de centaines et de milliers d’autres.
Les élèments de la coordination qui se sont laissé prendre par la lumière des projecteurs, feraient bien de réfléchir, car s’ils s’imaginent un instant égaler ou surpasser les animateurs des révolutions qui les précèdent, en éssayant de combiner des élèments qui ne peuvent pas se mélanger, ou en évitant certaines étapes pour en venir à l’éssentiel , c’est à dire à la gratification personnelle et à l’impression fantasmatique de s’être distingué, c’est qu’ils n’ont pas saisi le sérieux de la situation. Pire, ils donnent la parfaite occasion à ceux qui voudrait voir saboter cette révolution, de la discréditer et de l’infiltrer.
Les espions du pouvoir en place, les services de renseignements et les autres taupes, rendent un très mauvais service au pouvoir qu’il serve religieusement. Atténuer l’ampleur et la détermination de cette jeunesse, ne permet pas d’en discerner les contours et les ramifications. Si il est plus confortable pour eux de penser que la jeunesse Mauritanienne n’agit que par imitation, et que la fable va bientôt toucher à sa fin, je répondrais que l’imitation bien qu’étant une forme de flatterie acceptable, va rarement si loin dans la prise de risque et que pour reprendre Victor Hugo : “Ce que la fable a inventé, l’histoire le reproduis parfois”.
Nayra Cimper