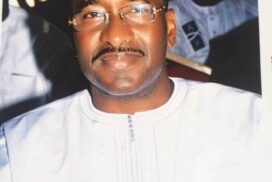Vers l’universalisme Mauritanien par Synaps Diallo
 Au lendemain du cinquantenaire de notre pays, nous sommes toujours confrontés au problème d’identité. Laquelle choisir sans frustrer une partie de la population ? Comme on le sait, les langues sont liées à l’identité des individus, nous ne pouvons en choisir une et exclure d’autres. Nous ne pouvons aussi prétendre pouvoir parler toutes les langues nationales à la fois. Il nous faut devant ce dilemme faire le choix d’une langue, pour que tous les citoyens puissent communiquer et se définir une identité commune autour de la connaissance et de la quête de sens. Naturellement, les arabisants diront tout de suite que c’est l’arabe qu’il faut choisir, ignorant les milliers de leurs concitoyens qui ne le parlent pas. Prétextant que c’est la langue de la majorité et que le français est la langue du colon. C’est un argument très simpliste et la réalité est beaucoup plus complexe que cela tant au niveau historique que contemporain. La langue française contrairement à ce que beaucoup pensent, n’est pas choisie par les afro-mauritaniens pour plaire le colon, mais plutôt comme une langue neutre non assimilationniste, commune à tous pour éviter toute velléité de domination entre concitoyens parlant des langues différentes.
Au lendemain du cinquantenaire de notre pays, nous sommes toujours confrontés au problème d’identité. Laquelle choisir sans frustrer une partie de la population ? Comme on le sait, les langues sont liées à l’identité des individus, nous ne pouvons en choisir une et exclure d’autres. Nous ne pouvons aussi prétendre pouvoir parler toutes les langues nationales à la fois. Il nous faut devant ce dilemme faire le choix d’une langue, pour que tous les citoyens puissent communiquer et se définir une identité commune autour de la connaissance et de la quête de sens. Naturellement, les arabisants diront tout de suite que c’est l’arabe qu’il faut choisir, ignorant les milliers de leurs concitoyens qui ne le parlent pas. Prétextant que c’est la langue de la majorité et que le français est la langue du colon. C’est un argument très simpliste et la réalité est beaucoup plus complexe que cela tant au niveau historique que contemporain. La langue française contrairement à ce que beaucoup pensent, n’est pas choisie par les afro-mauritaniens pour plaire le colon, mais plutôt comme une langue neutre non assimilationniste, commune à tous pour éviter toute velléité de domination entre concitoyens parlant des langues différentes.
Je rappelle que les afro-mauritaniens ont tous combattus le colon, donc ce n’est pas pour une raison aussi banale qu’ils vont adopter sa langue. Résumer le français comme langue coloniale, reviendrait à redéfinir les frontières mauritaniennes selon les mêmes termes, car elle aussi léguée par le colon. D’autre part, les afro-mauritaniens ne peuvent pas se contenter de cet argument anti-assimilationniste puisqu’ alors il ne permet pas de trouver une solution. Une idée même juste devient absurde si on s’en contente. Il nous faut une langue commune, une identité commune, pour construire un peuple. Et ne surtout pas tomber dans ces idéaux sans issus de diversité linguistiques qui au fond ne marchent pas et n’ont jamais marché. D’autant plus qu’elles amplifient le communautarisme irrationnel, mère de tous nos maux. On ne pourrait trouver dans le monde une langue qui ne s’est pas mélangée avec d’autres aux grés de l’histoire. Un exemple frappant est le fait que dans le monde arabe personne ne s’exprime de la même manière, car l’arabe classique s’est mélangé avec celles parlées par les différentes populations autochtones. Comme ce fut le cas d’ailleurs entre l’arabe et l’araménien ou le français et le grec. Mais aussi grâce à l’amour que portent les peulhs pour la religion musulmane, plus de cinquante pour cent du poular est issus de l’arabe. Le pourcentage serait naturellement plus grand si l’histoire s’était déroulée autrement en Mauritanie, notamment leur amitié et métissage légendaire avec les peuples parlant arabe. Ce scénario est valable aussi pour les communautés Wolofs, Soninkés, Mauresques bien qu’à des proportions relativement différentes.
Vivre dans le même espace et préserver l’intégrité de plusieurs langues est contre nature car cela s’oppose à l’évolution normale permettant de construire une nation paisible. Je persiste donc à penser que nos positions actuelles sur la question des langues est sans issus, elles ne pourront qu’engendrer des conflits et hélas indéfiniment, la preuve d’ailleurs est que depuis 50 ans cela dure et toujours aucune évolution, nous sommes toujours au point de départ. Le plus inquiétant est le fait que les défenseurs de tous bords d’une langue ou d’une autre ne le parlent pas vraiment. Combien de Peulhs aujourd’hui mènent une lutte acharnée pour le poular mais n’ont jamais lu un livre, ou écrit un article dans cette langue? Résumer le rôle d’une langue uniquement à son caractère maternel s’appelle du communautarisme pur et simple. Ce qui doit être défendu c’est plutôt la capacité pour une langue à fédérer le plus de monde possible autour de la littérature et le savoir de manière générale.
La langue étend le canal, il faudrait bien qu’elle mène à un contenu enrichi continuellement par un grand nombre de ses locuteurs. Cependant m’en tenir à ce discours c’est faire un raccourci simpliste ignorant le contexte historique de notre pays. Il y a bien eu divorce entre les fils de la Mauritanie, une réconciliation s’impose bien évidemment avant tout. Et la meilleurs façon d’y parvenir c’est de venir avec des propositions fédératrices, ouvrir le dialogue, tenter de convaincre de la pertinence de nos projets, expliquer, rassurer, se faire comprendre plutôt que d’imposer une langue de la manière la plus arrogante et égoïste qui soit. Comme c’est le cas aujourd’hui où certains esprits limités veulent imposer l’arabe non par pour intégrer ou rassembler, mais plutôt de jeter de l’huile sur le feu à des fins très sinistres. Les extrémistes et chauvins ont récupéré cette question pour en faire un crédo justifiant leurs thèses contres historiques et scientifiques.
Ignorant que la défense de la langue arabe à vue aussi le jour au fin fond du Fouta contre ce que les Almamis appelaient à l’époque la langue des mécréants. A un moment où à un autre tous les fils du bled ont soutenu l’arabe, cependant non pas en tant que verbe uniquement, mais plutôt comme canal menant à la culture musulmane. Rien ne justifiait l’abandon des langues maternelles, car très tôt il était apparu pour ces populations de faire la différence nette entre la religion et l’arabité, ce qui n’est pas le cas dans le monde arabe ou la frontière est beaucoup plus floue. Ce qu’il faut alors c’est un compromis, un consensus. Et oui, pour construire une nation, il faut faire un pas vers l’autre, on aura tous à y gagner au finish. Ce n’est pas accepter la domination, mais c’est au contraire faire preuve de sagesse pour en sortir encore plus grand. Donc partant d’un dénominateur commun qu’est l’islam, ce patrimoine dont on est tous si fier et qui a émaillé tous nos mœurs, nos idéaux, notre philosophie ; nous pouvons choisir collectivement le vecteur commun le plus adapté : c’est naturellement l’arabe classique.
Cependant cette fois on y introduirait du vocabulaire Peulh, Wolof, Soninké, Hassanya (ce qui se fait déjà), mais aussi des termes techniques et scientifiques venant d’autres langues internationales. Cette entreprise verra la création de l’Académie Mauritanienne qui édifiera un dictionnaire national et se chargera de définir le pourcentage de chaque langue. Je vote déjà pour l’introduction des mots maro, diwline, mbourou (rire), des mots témoins d’une langue commune qu’on a ratée et qui se serait naturellement imposé si l’histoire s’était passée autrement dans notre pays. On ne peut changer l’Histoire, mais on peut construire l’Avenir. Cet essai vient bien entendu à l’heure d’un débat lancé sur l’éducation nationale. Cela passe par la définition de valeurs communes, d’une identité commune que nous aurons choisie et construite ensemble.
Le Mauritanien du 21ème siècle je le veux à la fois universel, ingénieux, humaniste, impliqué dans toutes les grandes œuvres entreprises dans le monde. Il faudra donc introduire et mettre l’accent sur les droits de l’homme, l’histoire de la pensée humaine, la technologie, les sciences fondamentales, la philosophie. Le but sera de former des mauritaniens qui pensent par eux même et qui créent pour eux même, plutôt que toujours vouloir ressembler ou suivre les autres dans un perpétuel complexe, ou de toujours demander de l’aide même pour des problèmes résolus depuis des siècles par d’autres nations. Cependant pour une meilleure éducation, il faut un environnement propice. Cela implique même des questions sur la réforme de la famille mauritanienne. Le chantier est immense, cependant réalisable. « Les problèmes du monde ne peuvent pas être résolus par les sceptiques ou les cyniques dont l’horizon est limité par les réalités évidentes. Nous avons besoin d’hommes capables d’imaginer ce qui n’a jamais existé (…) Le changement est la loi de la vie. Et ceux qui ne regardent que dans le passé ou le présent sont certains de rater le futur (…) L’esprit humain est notre ressource fondamentale » John Fitzgerald Kennedy.
Sherbrooke, le 29 janvier 2011
Synaps Diallo
FLAM-Canada-section Amérique du Nord