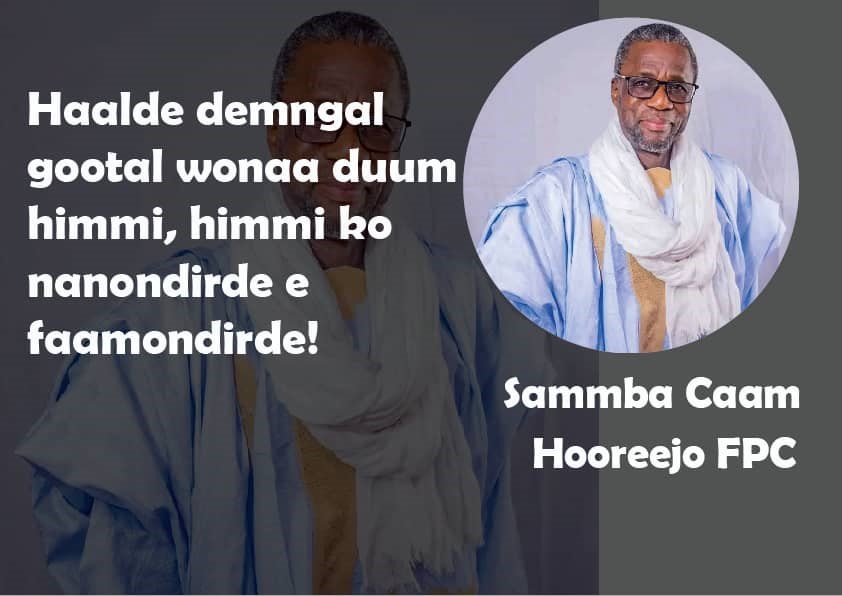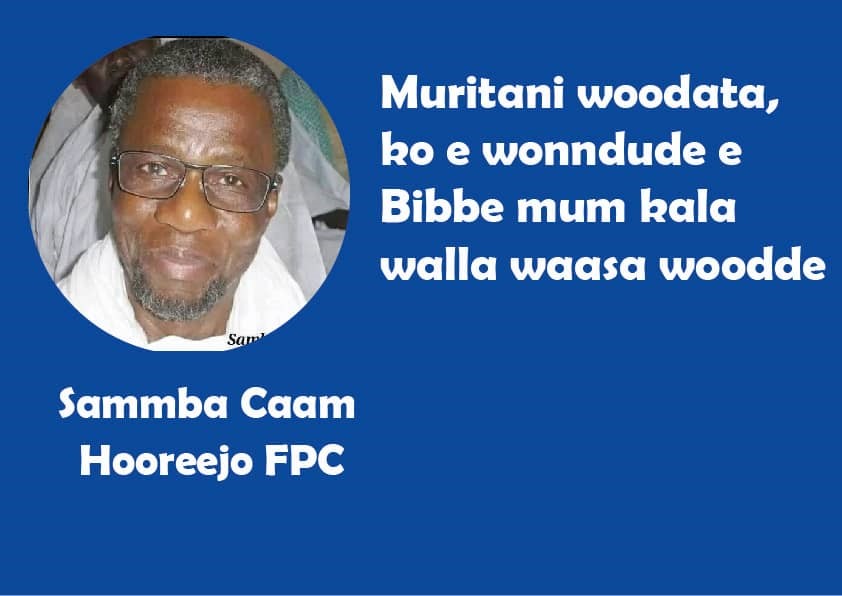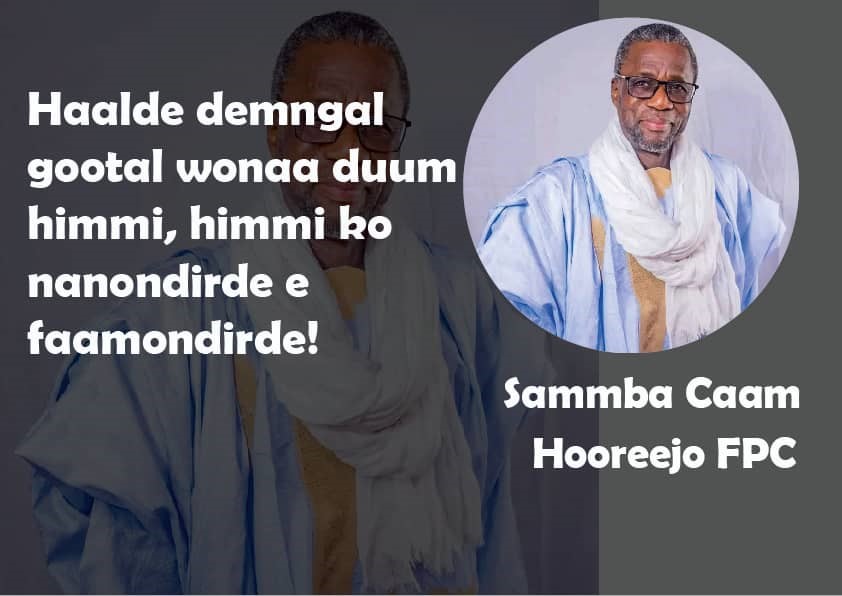Category Archives: presse
M. Dia Alassane, président de la Coalition Vivre Ensemble/Vérité Réconciliation (CVE/VR) : ‘’Il faut que le Président arrête de crier sur tous les toits que le pays n’est pas en crise’’

Le Calame : Votre coalition a décidé d’aller au dialogue en gestation. Qu’en attendez- vous ? Pensez-vous que les conditions sont suffisamment réunies pour un véritable dialogue politique ?
M. Dia Alassane : Nous avons décidé d’aller au dialogue parce que par principe nous ne fermons jamais la porte aux discussions. Les crises les plus graves, même celles qui dégénèrent en guerres, finissent toujours par être résolues autour d’une table. Et Dieu sait, malgré les dénégations du Président Ghazwani, que la crise, dans notre pays, est non seulement très profonde mais multiforme et qu’elle peut à tout moment nous faire sombrer dans le chaos. Si nous pouvons nous éviter cette menace en nous mettant tous autour d’une table, c’est tant mieux.
La Mauritanie n’a jamais été autant divisée que ces dernières années ; le repli communautaire et les velléités indépendantistes, aussi bien au nord qu’au sud du pays, n’ont jamais été aussi prononcés. Alors nous attendons que ce dialogue soit l’occasion de rediscuter du contrat national. Avons-nous véritablement la volonté de vivre ensemble ? Si oui, dans quelles conditions ? Répondre à ces questions est primordial par rapport à tout le reste puisque c’est la base pour asseoir une véritable unité nationale toujours chantée mais jamais réalisée. Bref, c’est d’un deuxième Aleg que nous avons besoin, qui aura l’avantage d’impliquer, cette fois-ci, l’ensemble des composantes nationales de notre peuple.
Je doute cependant que l’Etat soit dans les mêmes prédispositions vis-à-vis de ce dialogue puisque le président de la République persiste à dire que « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes » qu’est la Mauritanie.
Que vous a inspiré le premier tour de table organisé, il y a quelques jours par les acteurs politiques pour la mise en place d’une commission de préparation, voire de supervision ?
Je pense qu’il est effectivement très important d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans la préparation, la supervision du dialogue et plus tard le suivi de la mise en œuvre des décisions consensuelles qui en sortiront. Mon inquiétude réside plutôt dans le manque d’implication de l’Etat dans ce qui se prépare. On a entendu le Président Ghazwani dire dans une de ses dernières sorties qu’il se positionnait en arbitre entre les différents bords politiques qui croiseront le fer au dialogue. Or l’Etat est à la base et du génocide des années 1990 et de toutes les politiques de discrimination et d’exclusion qui ont suivi et qui minent l’unité nationale. Il doit donc être impliqué au premier chef dans la recherche de solutions aux problèmes qu’il a lui-même créés et ce sera à lui de les mettre en œuvre. Mais l’impression que l’on a jusque-là, c’est que l’exécutif ne veut pas du dialogue, il y va un peu à marche forcée.
Pensez-vous que la feuille de route élaborée par les partis politiques tient compte des problèmes qui préoccupent la CVE/VR ? Et quelles sont les propositions de solutions que préconise votre coalition ? Les engagements du président Ghazwani de mettre en œuvre les recommandations consensuelles des acteurs politiques vous rassurent-t-il ?
Pour la feuille de route qui avait été élaborée par les partis représentés à l’assemblée, non seulement elle ne nous engage pas, nous et nos partenaires de la Coordination des coalitions et partis politiques de l’opposition démocratique (CCPOD), mais elle est caduque. Nous considérons que la réunion qui s’est tenue en vue de mettre sur pied une commission de préparation est le véritable point de départ des assises qui s’annoncent et que l’ordre du jour sera discuté dans le cadre de cette préparation. La CVE/VR veillera à ce que ces préoccupations prioritaires y figurent en bonne place.
Quant au Président, il faut déjà qu’il arrête de crier sur tous les toits que le pays n’est pas en crise et qu’il n’a pas par conséquent besoin de dialogue. Le gouvernent devra, comme je l’avais dit plus haut, être partie prenante du dialogue et l’engagement du Chef de l’Etat à mettre en œuvre les recommandations consensuelles qui en seront issues devra prendre une forme beaucoup plus solennelle.
Depuis son arrivée au pouvoir, le président Ghazwani prône la création d’une école républicaine. Quel contenu attendez-vous de ce projet ? Les concertations engagées récemment par le ministère de l’Éducation nationale, de la Réforme et de la formation professionnelle ont-elles constitué, selon vous, un important point de départ pour ce projet ?
Une école républicaine suppose une école qui tienne compte de la diversité nationale mais surtout qui instaure l’équité pour tous les enfants du pays à travers le recours à l’ensemble de nos langues nationales comme médium d’enseignement. Le timing des journées de concertation autour de la réforme du système éducatif et les débats que cela a provoqués ne semblent pas indiquer que l’on en prenne véritablement le chemin. Il aurait été plus logique d’attendre les conclusions du dialogue annoncé en ce qui concerne le statut des langues et le type de citoyen nouveau que nous voulons pour notre pays pour réunir la famille scolaire qui ne doit se préoccuper que de l’aspect technique et de la mise en œuvre de la réforme dans le respect de l’orientation globale imprimée par les politiques.
Quelle place pourrait occuper l’officialisation puis l’enseignement des langues nationales dans ce dispositif de réforme ? Que vous inspire ce débat sur la transcription des langues nationales Pulaar, Soninké, Wolof en caractère arabe ?
L’officialisation des langues nationales pulaar, soninké et wolof relève d’une exigence de justice, d’équité et de reconnaissance vis-à-vis de l’ensemble de nos composantes nationales. Cela va créer une administration de proximité, en rupture avec celle de type colonial qui sévit dans la vallée, et aidera à une meilleure inclusion des locuteurs de ces langues de la part des pouvoirs publics, des locuteurs revigorés qui s’impliqueront davantage dans les politiques de développement. Cette officialisation permettra une plus grande visibilité à notre belle diversité en offrant un égal accès aux médias à toutes nos langues et cultures. C’est encore cette officialisation qui permettra de corriger l’inégalité structurelle de notre système éducatif en généralisant l’enseignement des et en langues nationales pour que nous en finissions avec les écoles d’élites et les concours de recrutement où ne sont généralement admis que les éléments de la composante arabe qui ne sont ni plus ni moins intelligents que les autres mais qui ont le privilège d’étudier dans leur langue. Bref, l’unité nationale, la quiétude et la cohésion sociale qui n’ont pas de prix passent nécessairement par l’officialisation de toutes nos langues nationales.
Pour ce qui est de la transcription des langues nationales, il n’y a pas plus méprisant pour une communauté linguistique que de vouloir lui imposer un alphabet. La transcription des langues négro-africaines n’est pas un sujet de discussion, surtout pas pour de petits chauvins haineux aux idéologies panarabistes importées du Moyen Orient.
La HAPA a relevé le non-respect de la diversité par les médias publics et privés voire même dans l’administration. Elle a invité ces institutions à se conformer à la Constitution. Que vous inspire cette réaction du nouveau président du gendarme des médias ?
C’est tout à l’honneur de la Hapa et surtout de son nouveau président parce que cette situation n’est pas nouvelle et le supposé gendarme de l’audiovisuel ne l’avait jamais dénoncée auparavant. Cela dit, tout reste à faire dans le sens du rééquilibrage de nos différentes langues et cultures dans nos médias publics et privés. Comment peut-on comprendre que des antennes locales de Radio Mauritanie comme celles de Kaédi, Maghama ou encore Sélibaby émettent entre 60% et 80% de leur programme en arabe ; Cela ressemble à s’y méprendre au modèle centralisateur et assimilationniste du jacobinisme par lequel la France coloniale nous avait imposé sa langue. L’officialisation de toutes nos langues nationales serait une panacée pour corriger de tels déséquilibres
Quelques années après l’assassinat de Lamine Mangane, membre de TPMN, une structure que vous présidez par ailleurs, où en est l’enquête ?
L’enquête en est toujours au point zéro. Bala Mangane, le père du jeune garçon, avait déposé plainte, dès le lendemain de l’affaire, par l’intermédiaire de son avocate Me Fatimata Mbaye. Mais selon celle-ci, il n’y a jamais le moindre début de l’exécution d’une quelconque instruction. Interpellée sur l’affaire à l’Examen Périodique Universel (EPU) de Novembre 2015, la Mauritanie avait répondu qu’une enquête avait été diligentée et qu’elle avait conclu à un non-lieu, ce qui est évidemment faux. La famille et TPMN courent toujours pour que justice soit rendue à ce jeune martyr de la citoyenneté pour tous.
TPMN a été un fer de lance dans la dénonciation du recensement biométrique des populations. Quelle appréciation vous en faites quelques dizaines d’années après ?
Le temps nous a donné raison. L’Etat, à travers les commissions mises en place dans les régions dans les départements et communes de la vallée du fleuve, reconnait implicitement le tort fait à ces populations, Mais dix ans après, il faut avouer que l’exclusion de l’état-civil continue de plus belle pour bon nombre de Noirs de Mauritanie. De fait, le combat de TPMN reste plus que jamais d’actualité jusqu’à ce que chaque Mauritanienne et chaque Mauritanien puissent obtenir ses papiers d’état-civil sans entraves dues à son appartenance ethnique et/ou statut social.
Quelle évaluation faites-vous des deux ans du président Ghazwani ?
Ce sont deux années perdues durant lesquelles le Président a bénéficié non seulement d’un état de grâce de la part de l’opposition mais également d’un immense espoir de changement de la part des populations. Mais il ne les a pas malheureusement mises à profit pour travailler mais à nous distraire avec l’affaire Aziz. Pour ne rien arranger la pandémie du covid 19 est arrivée avec la gestion opaque, calamiteuse et clientélistes des immenses fonds dédiés à la lutte contre la maladie. Puis il y a les concours, les nominations et les mouvements au sein des administrations des forces armées et de sécurité qui renforcent chaque jour que Dieu fait l’exclusion sur la base de l’appartenance ethnique et raciale. L’inflation continue de frapper de plein fouet le pouvoir d’achat de nos compatriotes qui sont de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir assurer leur pitance quotidienne. On me rétorquera que le climat politique est apaisé avec l’opposition mais cela n’a malheureusement aucune incidence sur le panier de la ménagère.
Quels rapports entretiennent aujourd’hui les deux CVE ? Sont-elles parvenues à concocter une contribution commune pour le dialogue politique en vue ?
Nous entretenons des rapports de cordiale fraternité et nous essayons autant faire se peut d’accorder nos violons pour l’essentiel. Nous travaillons ensemble mais également avec nos autres partenaires de la CCPOD à l’élaboration d’une plateforme commune de l’opposition.
Propos recueillis par Dalay Lam
Préparatifs des concertations politiques : Premier tour de table

Les acteurs politiques de la majorité et de l’opposition ont tenu, le mercredi 27 Octobre, une réunion préparatoire au lancement des concertations politiques. Maîtresse d’œuvre, la présidence de l’UPR a, semble-t-il, ratissé large. Plus de trente partis, mouvements politiques et personnalités indépendantes étaient conviés à ce premier tour de table. Rencontre d’échanges, selon diverses sources, sur les périphéries des prochaines concertations. On s’est juste contenté d’écouter les différents points de vue, évaluer le rapport majorité-opposition et fixer le cadre du dialogue, en explorant son format et son chronogramme, la composition du comité de pilotage et sa présidence, etc. Le retour à Nouakchott, il y a quelques jours, de l’ex-candidat à la présidentielle de 2019, Sidi Mohamed Boubacar, entrerait-il dans les manœuvres de positionnement autour de celle-ci ?
Aux termes de longs discours parfois « hors sujets », cette première rencontre a donc permis de jauger le point de vue des acteurs politiques mauritaniens. Et marque, même si le débat est resté très général, le début « des choses sérieuses ». Avant de se séparer, les participants se sont donné une à deux semaines pour approfondir leur contribution et permettre ainsi d’actualiser la feuille de route concoctée par les partis politiques.
On notait l’absence du président de l’APP, Messaoud ould Boulkheïr qui a préféré envoyer un représentant. Du côté du RFD, c’est l’avocat Yakoub Diallo qui a représenté le parti : il pilote depuis quelque temps ce dossier « technique ». Comme on l’a déjà constaté, le président Ahmed ould Daddah s’est mis quelque peu en retrait. Du côté de l’UFP, c’est Mohamed ould Khlil qui a représenté son parti, le président Maouloud étant actuellement à l’étranger.
Éclosion, enfin, d’un long processus enclenché depuis Février 2020 avec la mise en place du cadre de concertation des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale ? La lutte contre le COVID en était l’argument, le président Ghazwani ayant appelé à un consensus autour de la pandémie. Lesdits partis avaient saisi la perche pour parler d’autres enjeux nationaux qui ne pouvaient, en fait, être débattus qu’à travers un dialogue national inclusif. Un cadre que quitteront d’ailleurs quelque temps Tawassoul, principal parti de l’opposition démocratique, et l’AJD/MR du président Ibrahima Sarr. Tous deux dénonçaient les visées, « pas du tout claires » de ce processus et le peu de « lisibilité » de ses actions.
Ces partis restent, comme l’APP, « très réticents et prudents ». Iront-ils jusqu’à boycotter les concertations ? La question reste posée. Plusieurs observateurs redoutent une division de l’opposition, comme ce fut l’ordinaire des dialogues précédents. Parallèlement à la mise en place dudit cadre, le principal parti de la majorité présidentielle avait enclenché un processus de concertations internes sur les questions nationales, comme l’unité et la cohésion sociale. Des actions qui ne pouvaient qu’aboutir à un dialogue politique inclusif pour se donner du poids auprès du président de la République.
Vers un nouveau pacte républicain ?
Ce dialogue politique inclusif était également réclamé par plusieurs partis de l’opposition. En effet, la dernière présidentielle avait fait apparaître une fracture au niveau national, à travers la candidature de la Coalition Vivre Ensemble (CVE),portée par le docteur Kane Hamidou Baba, et celle de Biram Dah Abeïd, dénonçant tous deux la « marginalisation » de la composante noire du pays et accusés, en conséquence, de « communautarisme ». Le malaise apparu au lendemain de la proclamation des résultats de l’élection, le lourd dossier du passif humanitaire, la place des langues nationales dans le système éducatif et l’administration et la question récurrente de l’esclavage et de ses séquelles n’ont cessé de constituer comme un goulot d’étranglement pour le pouvoir. La tenue, en début d’année scolaire, de concertations sur le système éducatif et ses recommandations interrogent par ailleurs bon nombre d’observateurs.
Toutes ces préoccupations ne peuvent, selon lesdits acteurs politiques, trouver un consensus qu’au sein d’un dialogue politique sérieux et inclusif. Mais le président Ghazwani s’y était opposé, pensant que l’ouverture des portes de son palais aux acteurs de l’opposition suffirait à normaliser les relations entre son pouvoir et celle-ci. Or nombre de ses acteurs espèrent beaucoup plus que des entretiens privés. Ils veulent un véritable changement d’avec le régime et les pratiques de gouvernance de son prédécesseur.
La persistance de celles-ci, déplorables, le recyclage d’anciennes figures aziziennes, les lenteurs et hésitations dans la gestion du dossier d’Ould Abdel Aziz tendirent l’atmosphère entre les deux camps. Le président de la République se dit alors prêt à accepter des « concertations politiques » avec l’opposition. Mieux, de déclarer que son gouvernement en accompagnerait le processus et mettrait en œuvre les recommandations de ses participants. De leur côté, les leaders de huit partis dont Messaoud ould Boulkheïr affirmaient, lors d’une conférence de presse commune, que ce serait le « dialogue » ou rien. Les uns et les autres conviendront ensuite que les deux formules veulent dire la même chose et en engageaient enfin les préparatifs.
Ce troisième dialogue politique va-t-il permettre de refonder la Mauritanie, mettre en place un nouveau pacte républicain ? Cela suppose que les acteurs politiques mauritaniens de tout bord acceptent de débattre sans passion des questions qui minent le socle de l’unité nationale. Ils doivent comprendre que la Mauritanie ne doit laisser aucun de ses fils au bord de la route. L’école républicaine dont parle le président Ghazwani ne peut servir de fuite en avant ni de prétexte à un nouveau tour de vis.
Perceptibles depuis quelques années, diverses pratiques donnent l’impression à certains mauritaniens d’être étrangers en leur propre pays. Le dialogue doit permettre au pouvoir de repartir sur un bon pied, corriger les insuffisances accumulées et, partant, relancer l’espoir suscité chez les Mauritaniens par l’élection d’Ould Ghazwani, après une décennie de régime trop centralisé, gabegie et exclusion. Les acteurs politiques lui déblayeront le terrain à travers ces concertations. Pourvu qu’il en soit ainsi !
Dalay Lam
le calame
MISE AU POINT / Par Samba Thiam

Samba Thiam – Il semble, aux dires des gens, qu’il se produit en ce moment un débat vif dans les forums arabes, portant sur un article que j’avais produit il y a dejà quelques mois.
L’article en question s’intitule “Nous voulons nos langues”. .. “Pour l’officialisation de toutes nos langues nationales”. La polémique, qui enfle, tournerait, semble-t-il, autour de l’accusation sur un propos que j’aurais tenu ou écrit, qui tient à un segment de phrase : “l’arabe langue étrangère”.
Ce fait divers confirme ce que nous disait Gemal : “lorsque les arabo-berbères ( francophones ou bilingues) ont quelque chose à cacher ils l’écrivent en arabe”…
D’abord je voudrais rappeler que cet article est vieux et disponible presque partout , et que ceux qui le voudraient pourraient aisement le consulter, il n’y a rien à cacher …Il a été publié dans Cridem, dans le site des FPC, à Kassataya, presque partout je crois …
Cela dit, je ne puis quand meme ne pas constater tristement que certains jeunes intellectuels qui se targuent d’être des progressistes puissent descendre aussi bas,; déformer, volontairement, les propos de l’adversaire, rien que pour le jeter en pâture.
Monter une cabale contre moi, ourdie de nouveau par le Système, au regard de l’actualité où les esprits sont chauffés à blanc ne me surprend guère et ne m’intimide pas non plus !
Pour revenir à l’article en question, voilà, en toute honnêteté, ce que j’ai écrit : “les écoliers négro- africains font face dans leur scolarité à deux langues étrangères, au sens pédagogique du terme : L’arabe et le français …”. Ce qui signifie que ni l’arabe ni le français ne constitue leur langue maternelle … Les mots ont leur sens !
Ce propos je le maintiens, parce que c’est la pure vérité, et qu’il n’y a aucun mal à dire la vérité …Dieu n’aime pas les menteurs et les hypocrites… Je suis habitué aux cabales. On ne me fera pas taire. Avec le temps les masques-tous les masques- finiront par tomber un à un pour révéler qui est qui ? Je regrette simplement que mon ami Jemil me poignarde, à nouveau, dans le dos, même si nous ne sommes plus du même camp…
Qui n’a pas fait d’enquête n’a pas droit à la parole, disait Mao, c’est-à-dire se doit de se méfier d’affirmer des choses sans avoir vérifié…
Samba Thiam
Président des FPC.
AJD/MR : nous sommes attachés à la préservation du français dans l’enseignement et l’administration

Alakhbar – Le parti de l’Alliance pour la Justice et la Démocratie/Mouvement du Renouveau (AJD/MR) a mis en exergue son attachement à la préservation de la langue française dans l’enseignement et l’administration, qualifiant l’inverse de discrimination à l’encontre des concitoyens formés dans cette langue, notamment ceux dont la langue maternelle n’est pas l’arabe : Négro-Africains.
Les concertations sur la réforme du système éducatif étaient mal préparées, a estimé le parti, indiquant qu’elle visait l’approbation d’une orientation idéologique, précisant que son but était tout sauf ce que nous pensons être utile pour mettre en place un bon enseignement national respectueux de notre diversité et de notre unité.
Rien ne peut redonner à notre éducation nationale toute sa splendeur si elle n’est pas placée dans une vision générale et futuriste pour notre nation et pour la citoyenneté de demain que nous voulons voir émerger, précise le communiqué de l’AJD/MR.
Il semble dans ces circonstances qu’imaginer des journées de concertation sur l’éducation nationale, mettant à l’écart le problème fondamental de la construction nationale, est une démarche le fond reste ambigu, ajoute le parti.
Nous ne comprenons pas la raison de cette précipitation pour discuter de manière isolée les questions de l’enseignement et des langues nationales des autres problèmes, souligne l’AJD/MR, selon laquelle, ces problèmes n’ont-ils pas leur place dans un dialogue national paisible entre toutes les forces vives du pays, en plus d’autres questions nationales ?
Concernant la participation du parti à ces discussions, le communiqué précise : nous pensons que ces questions sont suffisamment structurelles pour notre cause nationale pour qu’elles ne soient discutées que dans le cadre d’un dialogue national, précise le parti, si si nous voyons qu’il est utile d’avoir un vrai dialogue entre toutes les forces vives de notre pays, nous mettrons au premier plan la question principale qui épuise notre nation, menace sa stabilité et son unité, à savoir la question de la coexistence qui est affectée à travers la discrimination à laquelle sont exposées les communautés noires du pays.
L’Alliance et ses partenaires ne participeront à aucun dialogue qui n’aborde pas ces questions fondamentales, ajoute le communiqué.
Traduit de l’Arabe par Cridem
Mauritanie : changements au sein de l’armée

Le chef d’état-major des forces armées, le général Mohamed Ould Meguet, a procédé à des changements des dirigeants dans les institutions militaires.
Les changements touchent des dizaines de colonels ainsi que des attachés militaires dans plusieurs ambassades mauritaniennes. Il s’agit du changement le plus important dans le corps militaire depuis l’arrivée au pouvoir du président Mohamed Ould Ghazouani.
Voici la liste des changements:
Général Mohamed Ould Rafa – Directeur de l’Hôpital Militaire
Colonel Abdoullah Haddou Ould Abdel Wadoud – Directeur de la communication et des relations publiques
Colonel Mohamed Taqiyoullah Ould Nama Sidi Ousmane – Conseiller du Ministre de la Défense
Colonel Mohamed Sidi Moukhtar Jiddou – Commandant de l’Ecole Nationale des Officiers
Colonel Abdallah Ould Mohamed Sidi Lemine – Commandant de la première région Militaire – Nouadhibou
Colonel Ahmed Mohamed Sidiya Ould Mohamed Mouloud – Commandant de la Sixième Région Militaire – Nouakchott
Colonel Mohamed Cheikh Ould Muhammad Heiba - Commandant du septième district militaire – Aleg
Colonel Mohamed Ould Arabi Jaafar – Commandant du quatrième district militaire – Selibaby
Colonel Abdarahmane Abdamel – Directeur de l’Institut supérieur d’anglais
Colonel Mohamed Mahmoud ould Mohamed Talib Jiddou – Directeur des Forces Armées et Forces de Sécurité
Colonel Mohamed Ould Hamid Wadou – Commandant du Premier Bureau, Etat-Major des Armées
Colonel Mohamed Mustafa ould Yeb – Officier adjoint dans l’état-major de l’Air
Colonel Tekwir Val ould Chanan – Commandant du Centre National d’Entraînement Commando
Colonel Sidi Mohamed Ould Aboubakar – Chef du projet d’école d’application
Colonel Hassan Ali ould Abdi – Conseiller du Ministre de la Défense
Colonel Mohamed Othman ould Sidi Mohamed Said – Adjoint au Commandant de la Deuxième Région Militaire – Zouerate-
Colonel Mohamed Salem ould Yark Said – Chef de Groupe au Collège Militaire du Groupe des Cinq Pays du Sahel
Colonel Mohamed Abdallah ould Mohamed Moloud – Assistant du commandant du deuxième bureau du commandement de l’état-major de l’armée
Colonel Mohamed Ahmad ould Haj Mohamed – Commandant du bataillon de parachutistes des forces spéciales
Colonel Mahfouz Ould Boubali – Sous-directeur de la Direction des transmissions
Colonel Bakar Ibrahim Youssouf – Commandant du Centre de Formation Technique de l’Armée
Colonel Mohamed Lemine ould Mohamed Bilal – Commandant de la deuxième région militaire
Colonel Ahmed Salem ould Mohamed Val Zein – Commandant du Secteur Ouest de la Force Conjointe des Cinq Pays du Sahel
Colonel Ahmed Muslim ould Muslim – Commandant du cinquième district militaire – Nema
Colonel Ael Ould Asri – Directeur du Centre National d’Entraînement de l’Armée
Colonel Mohamed Mukhtar ould Mohamed Lemine- Directeur des relations publiques extérieures
Colonel Abdallahi Mukhtar ould Mohamed – Commandant du Centre de commandement de la planification et des opérations
Colonel Ael Hammoud ould Mahmoud – Conseiller du chef d’état-major des armées
Colonel Nafeh Mohamed Abdallah Bah – Directeur de l’intégration dans l’état-major
Colonel Samori Bakai – Inspecteur chargé de l’armée à l’Inspection générale des armées et des forces de sécurité
Colonel Dicko Mali Bakali – Conseiller du Chef d’Etat Major Général des Armées
Colonel Ely ould Mohamed Haiba – Inspecteur en charge du moral et des conditions de vie des individus
Colonel Cheikh Mohamed ould Ahmed Dalloul – Commandant Adjoint du Premier District Militaire – Nouadhibou
Colonel Ibrahim Ahmed ould Miloud Mukhtar – Directeur des Sports
Colonel Abdallah Mohamed ould Mahmoud Ibrahim – Conseiller du chef d’état-major des armées
Colonel Samti Gandega – Conseiller du Ministre de la Défense
Nomination des attachés militaires aux ambassades
Colonel Mohamed Lemine ould Arif Bara – Khartoum (Soudan)
Colonel Mohamed Lemine ould Mohamed Abdallah Abno – représentant de l’Islamic Counter-Terrorism Gathering à Riyad (Arabie Saoudite)
Colonel Mohamed Ayadeh ould Mohamed Mokhtar – Alger (Algérie)
Colonel Mohamed Lemine ould Mohamed Moktar Zamal – Pékin (Chine)
Colonel Mohamed Mukhtar Ahmed ould Kehl – Addis-Abeba (Éthiopie)
Colonel Kabir Ould Issa – Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis)
Colonel Ishaq Abdallah ould Mahmoud Ibrahim – Londres (Grande-Bretagne)
Colonel Hammad Hammadi ould Mohamed Lemine – représentant de l’Islamic Counter-Terrorism Gathering à Riyad (Arabie Saoudite)
Colonel Mohamed Abdallah ould Jenk – Dakar (Sénégal)
Colonel Zein Ould Sweidat – Paris (France)
Colonel Mohamed Ould Cheikh Akrif – représentant de l’Islamic Counter-Terrorism Gathering à Riyad (Arabie Saoudite)
Colonel Makhtoor Amhadi – Attaché Adjoint à Rabat (Maroc)
Colonel Yakoub Aadullah ould Salem – Attaché militaire adjoint au Caire (Egypte)
Colonel Ibrahima Jibril Kay – Attaché militaire adjoint à New York (Nations Unies)
Lieutenant-Colonel Yacoub Suleymane ould Cheikh Sidya – Attaché militaire adjoint à Madrid (Espagne)
Lieutenant-colonel Sidi Mohamed Ahna ould Mokhtar Ely – Attaché militaire adjoint à Ankara (Turquie)