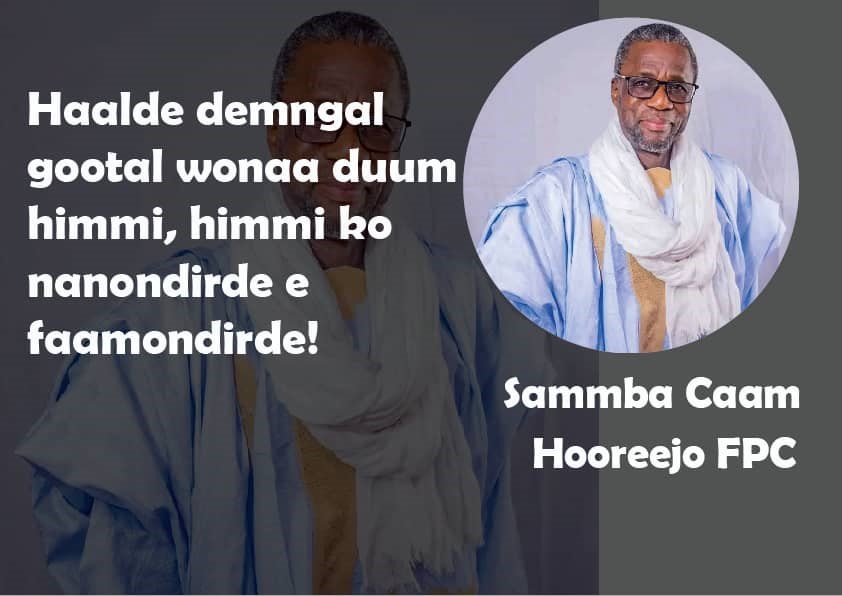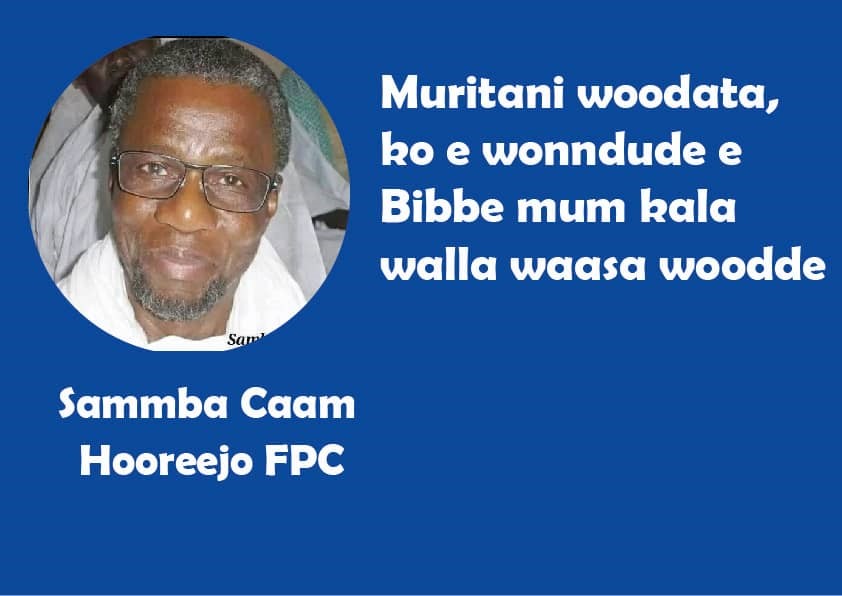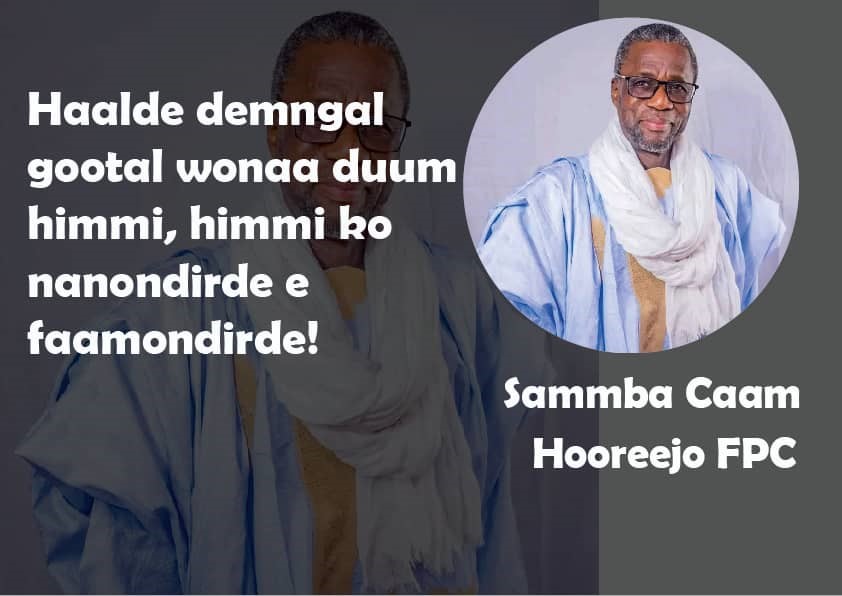Category Archives: presse
Réponse à Merzoug, à Gourmo, à Biram et à tous les détracteurs d’un débat légitime sur l’immigration

Avant de répondre à ces contradicteurs de valeur, je tiens à exprimer mon indignation face à l’exclusion injustifiée de l’Union des Anciens Candidats à la Présidence de la République (UACPR) des débats publics et des cérémonies officielles. Depuis 1992, une vingtaine de candidats encore en vie, ont brigué la magistrature suprême.
Parmi eux, 15 sont membres de l’UACPR, une association officiellement reconnue en 2022 et présidée par le Ministre Bodiel Houmeid, avec le Ministre Ba Alassane Mamadou comme 1ᵉʳ Vice-Président et moi-même en tant que 2ᵉ Vice-Président. Alors, pourquoi restreindre les invitations aux seuls candidats de la dernière élection ? Si une référence électorale s’impose, c’est bien celle de 2007, unanimement saluée comme un modèle. Revenons à notre débat :
La question migratoire mérite d’être abordée avec rigueur, loin des caricatures et des postures idéologiques. Derrière les accusations de “xénophobie” et d'”extrémisme”, certains cherchent à disqualifier tout débat légitime sur un enjeu fondamental pour la souveraineté de notre pays. Il est essentiel d’aborder la question migratoire sans passion et avec rigueur.
Parler de “submersion migratoire” ou d’”invasion étrangère” traduit une inquiétude réelle au sein de la communauté nationale, mais ces termes peuvent paraître excessifs ou chargés politiquement. Comme vous le savez, le langage façonne les perceptions et appartient au patrimoine universel.
Cela dit, nier les défis posés par des flux migratoires incontrôlés serait antipatriotique et malhonnête. En réalité, la migration en Mauritanie est avant tout une immigration. Il s’agit d’un flux unidirectionnel et irrésistible vers un pays à la fois convoité pour ses richesses, envié pour sa position stratégique, mais aussi – et paradoxalement – décrié parce qu’il incarne un modèle de cohabitation séculaire entre musulmans de cultures et de couleurs diverses, une réalité qui fascine autant qu’elle dérange. J’entends par ce concept d’immigration, tout déplacement de populations vers la Mauritanie, qu’il s’agisse de migration régulière, d’accueil de réfugiés ou de migration irrégulière.
L’immigration en Mauritanie : une réalité incontestable
Il est faux de prétendre que l’immigration en Mauritanie est un simple phénomène de transit. En réalité, elle est unidirectionnelle : des centaines de milliers de migrants s’installent durablement, modifiant notre équilibre socio-économique et démographique. Minimiser cet enjeu, c’est nier l’évidence. C’est jouer contre son camp.
La Mauritanie a besoin de défenseurs sincères, pas de profiteurs. Cette réalité nous est dictée par une Europe néocoloniale, quelquefois avec la complicité de certains États voisins et, plus tragiquement encore, de quelques Mauritaniens eux-mêmes ! Il ne s’agit pas d’un “complot”, mais d’une politique bien réelle où la Mauritanie est utilisée comme barrière migratoire, sans contrepartie significative.
Or, un pays qui peine déjà à offrir des services de base à ses propres citoyens ne peut supporter une immigration incontrôlée, ni accueillir toute la misère du monde, d’autant plus que ce flot humain ne se limite pas aux Africains subsahariens, mais inclut aussi des Asiatiques.
L’Effet d’Appel Endogène (EAE) : Un facteur d’instabilité économique et sociale
Nous faisons face à un chômage endémique, particulièrement chez les jeunes diplômés.
L’économie peine à répondre aux besoins nationaux et l’augmentation des prix met à mal les ménages mauritaniens. Dans ce contexte, l’immigration de masse stimulée par une singularité mauritanienne que j’appelle l’Effet d’Appel Endogène (EAE), exerce une pression supplémentaire sur nos ressources limitées.
Ce phénomène EAE trouve ses racines dans des facteurs profondément ancrés dans notre société, tels que notre légendaire hospitalité, l’ouverture de nos foyers, le recours systématique à une main-d’œuvre domestique étrangère et l’engouement suscité par la découverte et l’exploitation de nouvelles richesses.
La Mauritanie est présentée comme un nouvel Eldorado, une image amplifiée et largement relayée par une certaine presse européenne aux intentions peu innocentes. Elle apparaît ainsi comme l’une des rares portes d’entrée vers l’Europe, à l’heure où d’autres pays verrouillent hermétiquement leurs frontières.
Le patronat mauritanien a joué un rôle clé dans l’aggravation de cette situation. En persuadant le gouvernement de ratifier des accords frontaliers défavorables, il a plaidé pour une ouverture des frontières sous prétexte de stimuler les exportations industrielles.
Cependant, en l’absence d’une véritable industrie nationale, cette politique a encouragé l’afflux massif d’immigrés. Pire, ce même patronat privilégie l’emploi d’expatriés, perçus comme moins coûteux et offrant un service de meilleure qualité que les nationaux.
Un autre aspect préoccupant est le soutien opportuniste dont profitent certains immigrés. Certaines ambassades européennes à Nouakchott, ainsi qu’une partie de la classe politique et certaines ONG prétendument dédiées aux “droits de l’homme”, exploitent la question migratoire à des fins idéologiques.
En prétendant défendre les “droits humains”, ces acteurs soutiennent souvent les immigrés subsahariens contre l’intérêt national, souvent en raison d’une proximité ethnique ou raciale, plutôt que d’un véritable souci de justice universelle. Ils défendent une immigration massive qui ne sert ni la Mauritanie, ni ses citoyens.
Il ne s’agit pas d’un humanisme désintéressé, mais d’un agenda politique. Nous touchons là, à un problème plus large : la montée d’un racisme politique, où des projets de société se construisent non sur des valeurs communes, mais sur la couleur de peau ou la haine du Maure.
Cette dérive est dangereuse, prospérant là où l’État est faible. Une Mauritanie forte et souveraine ne peut tolérer ces clivages artificiels, qui ne servent que des agendas extérieurs et compromettent notre unité nationale. Le racisme n’est pas une opinion, c’est un crime qui mérite d’être jugé sans circonstances atténuantes et condamné sévèrement. Les sociétés plurielles et cosmopolites ne tolèrent pas la complaisance de l’État.
Identité et souveraineté : des enjeux vitaux
L’immigration incontrôlée ne menace pas seulement notre économie, mais aussi notre identité. Trois piliers structurent la Mauritanie :
1. L’Islam : ciment et socle de notre nation, il fait face à une épreuve sans précédent. Des influences étrangères s’emploient à éroder son rôle central, tandis qu’un afflux massif d’immigrants bouleverse l’équilibre religieux du pays.
Aux 500 000 migrants déjà accueillis – comme l’a annoncé le Premier ministre des Canaries – s’ajoutent des centaines de milliers de réfugiés maliens à M’berra et un flot incontrôlé de clandestins, dont nombre ne partagent pas la foi musulmane. Une réalité inédite pour un pays historiquement à 100 % musulman.
2. La langue arabe et les langues nationales : garantes de notre unité, elles sont trop souvent marginalisées au profit d’une francophonie héritée de la colonisation et instrumentalisée pour diviser.
3. Le peuple mauritanien : sa cohésion est mise en péril par un afflux incontrôlé de populations qui ne partagent pas toujours nos valeurs et nos traditions.
Une politique migratoire ferme et juste
La gestion de l’immigration doit être basée sur des principes clairs :
• La souveraineté nationale : la Mauritanie doit décider qui entre et qui s’installe sur son territoire, en fonction de ses intérêts propres.
• Une régulation stricte : une politique migratoire laxiste met en péril notre stabilité et favorise la criminalité. Les récents incidents de Gougui et Tevragh Zeina en sont des exemples concrets.
• Le refus des ingérences étrangères : ni l’Europe, ni les ONG, ni certaines élites ne doivent dicter à la Mauritanie sa politique migratoire.
Conclusion : une Mauritanie maîtresse de son destin
Il est impératif de fermer les frontières et de renégocier sans concession les accords défavorables avec les pays voisins. L’immigration régulière doit être gelée, car le seuil de tolérance est dépassé, tandis que l’immigration clandestine doit être combattue sans relâche. Le refoulement des sans-papiers n’est plus une option, mais une nécessité dictée par la survie nationale.
Certes, il est profondément immoral de refuser l’accueil à un être humain en détresse, d’autant plus lorsqu’il est frère et voisin. Mais c’est une dette lourde que la Mauritanie doit aujourd’hui régler pour éviter les périls qui la guettent.
Il est temps que la Mauritanie cesse d’être un pion dans les stratégies migratoires internationales et reprenne pleinement le contrôle de son destin.
Qu’ALLAH protège notre Mauritanie commune.
Par Dr Mohamed Ahmed BABA AHMED SALIHI
Coup d’État en Mauritanie : les tribus ont pris le pouvoir. Par Pr ELY Mustapha

“Il n’est pas des nôtres celui qui appelle au tribalisme. Il n’est pas des nôtres celui qui combat pour le tribalisme. Il n’est pas des nôtres celui qui meurt pour le tribalisme.”
Hadith du Prophète Mohamed que la paix soit sur lui
(Sunan Abu Dawud 5121, Livre 41, Hadith 133)
“Ô peuple ! Votre Seigneur est Un et votre père [Adam] est un. Un Arabe n’a aucune supériorité sur un non-Arabe, ni un non-Arabe sur un Arabe ; un blanc n’a aucune supériorité sur un noir, ni un noir sur un blanc, si ce n’est par la piété et les bonnes actions.”
Sermon d’Adieu (Khutbatul Wada) du Prophète Muhammad (PSL)
(Musnad de l’Imam Ahmad ibn Hanbal (hadith n° 23489)
Sahih al-Bukhari (partie du long hadith du Sermon d’Adieu)

La mort institutionnelle de l’Etat
La Mauritanie contemporaine offre un cas d’école de la déliquescence institutionnelle : l’État, en tant qu’entité régulatrice, n’existe plus. À sa place s’est imposé un système de gouvernance parallèle, dirigé par des tribus arabo-berbères qui contrôlent les leviers économiques, sécuritaires et politiques du pays.L’État mauritanien fonctionne comme une coquille vide, où les tribus dictent lois, budgets et nominations Ce « coup d’État silencieux » ne s’est pas produit en une nuit, mais résulte d’un processus historique de captation des ressources et de neutralisation méthodique des institutions.
Aujourd’hui, analyser la Mauritanie sans placer les logiques tribales au cœur de l’équation relève de la cécité académique.
I- Les racines historiques de l’hégémonie tribale
La colonisation française : architecte précurseur du tribalisme mauritanien moderne
L’administration coloniale française a codifié les hiérarchies tribales en s’appuyant sur des chefs tribaux comme relais locaux, marginalisant les Haratines (descendants d’esclaves) et les AfroMauritaniens. Ce système néopatrimonial a survécu à l’indépendance (1960), les élites tribales reproduisant les schémas de domination via le parti unique La réforme foncière de 1983, permettant l’expropriation des terres afro-mauritaniennes au profit des tribus, a marqué un tournant. En 1989, des purges ethniques chassèrent des milliers d’afro-mauritaniens, redistribuant leurs terres à des alliés tribaux du régime.
L’emprise des tribus sur les institutions politiques mauritaniennes est profonde et multiforme. Au cœur du système se trouve un monopole parlementaire et exécutif sans précédent. Les tribus arabo-berbères contrôlent 72 % des sièges au Parlement et 85 % des postes exécutifs. Cette domination n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une stratégie délibérée de captation du pouvoir. Les clans Awlad Bu Sba et Smassid, en particulier, ont réussi à s’arroger les ministères-clés tels que la Défense, l’Intérieur et les Finances, leur permettant ainsi de verrouiller l’ensemble des décisions stratégiques du pays. Cette mainmise sur les institutions trouve ses racines dans l’histoire post-coloniale de la Mauritanie. Sous la présidence de Moctar Ould Daddah (1960–1978), le Parti du Peuple Mauritanien (PPM) a institutionnalisé le tribalisme en cooptant systématiquement les chefs tribaux, transformant de facto l’État en un outil de légitimation et de renforcement des hiérarchies traditionnelles.
Le tribalisme comme doctrine d’État
Aujourd’hui, les tribus contrôlent 72% des sièges parlementaires et 85% des postes exécutifs. Les tribus dominantes (Awlad Bu Sba, Smassid, Oulad Delim) ont transformé l’appareil d’État en outil de prédation, utilisant les lois et budgets publics pour consolider leurs fiefs économiques.
Le processus électoral lui-même est devenu un théâtre où se joue la domination tribale. Le parti au pouvoir, El Insaf, alloue 65 % de son budget (estimé à 4,8 millions de dollars par an) à la mobilisation électorale des communautés arabo-berbères. Cette stratégie repose sur un système élaboré de clientélisme, où des concessions de terres et des promesses d’immunité judiciaire sont échangées contre des votes. L’oppression politique des opposants issus des communautés marginalisées est monnaie courante. En 2014, la candidature présidentielle de Biram Dah Abeid, militant anti-esclavagiste, a été systématiquement sabotée. Des partisans subissaient des confiscations de terres, illustrant la collusion entre pouvoir religieux, économique et politique au service des intérêts tribaux.
II- L’économie capturée : Tribus contre Trésor public
Les secteurs-clés sous contrôle tribal
La captation des ressources économiques par les tribus dominantes illustre de manière flagrante leur influence sur le gouvernement. Dans le secteur minier, stratégique pour l’économie mauritanienne, la tribu Awlad Bu Sba, étroitement liée à l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, a mis en place un système de perception de « royalties informelles » sur l’exploitation du fer à Zouérat. Ce mécanisme opaque permet de détourner entre 8 et 12 millions de dollars par an des revenus de la SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière), privant ainsi l’État de ressources cruciales pour son développement. Le secteur des pêcheries n’échappe pas à cette logique prédatrice.
Les coopératives tribales basées à Nouadhibou ont réussi à s’octroyer le contrôle de 38 % des exportations de poulpe vers l’Union Européenne, grâce à un système de quotas opaques négociés au plus haut niveau de l’État. Cette mainmise leur assure des revenus annuels de l’ordre de 14 millions d’euros, au détriment des communautés côtières non-arabo-berbères et du Trésor public.Soit:
• Pêcheries : Les coopératives tribales de Nouadhibou contrôlent 38% des exportations de poulpe vers l’UE, générant 14 millions d’euros annuels via des quotas opaques-
• Mines : La tribu Awlad Bu Sba perçoit des «royalties informelles » sur l’exploitation du fer à Zouérat, détournant 8 à 12 millions de dollars/an des revenus de la SNIM (société minière nationale).
Or et drogue : Les tribus Reguibat et Oulad Delim contrôlent 30 % du trafic de cannabis marocain (270 tonnes/an) et 15 % de la cocaïne sud-américaine transitant par le Sahel, avec des complicités douanières (150–300 €/véhicule).
Les systèmes de prédation sont variés et multiples. Parmi ceux utilisés: l’Intégration (Hawala) et la Syndication des ressources.
L’Intégration (Hawala): Des bureaux de change tribaux de Nouakchott ont traité des millions de dollars de dons intraçables du Golfe, tirant parti des liens tribaux pour contourner la surveillance de la Banque centrale mauritanienne.
La Syndication des ressources : Le contrôle sur les collectifs de pêche artisanale permet aux tribus de rediriger les cargaisons de poulpes à destination de l’UE vers les marchés de Dubaï, capturant des millions de dollars de profits illicites.
La prédation systémique
La structure étatique de Solidarité, destinée à lutter contre la pauvreté, canalise 40% de son budget (6 millions de dollars) vers des «projets» tribaux servant à acheter des loyautés tribales. Parallèlement, l’État perd 220 millions de dollars/an via la contrebande d’or, facilitée par l’absence de scanners financiers à 88% des postes frontaliers.
III. L’effacement de l’État de droit
Justice sélective et impunité tribale
Le Conseil Supérieur de la Magistrature, dominé à 60% par des tribus, bloque les enquêtes visant les élites tribales. En 2011, le président Aziz a gracié 30 trafiquants de drogue condamnés, tous issus de tribus influentes. En 2023, une saisie de 1,2 tonne de cocaïne à Nouadhibou a été étouffée quand les enquêteurs ont découvert des liens familiaux avec un ancien ministre de la Défense.
L’instrumentalisation du système judiciaire
L’instrumentalisation du système judiciaire au profit des intérêts tribaux est un autre exemple frappant de cette influence.
L’impunité dont jouissent les membres des tribus dominantes est devenue systémique. En 2011, un cas emblématique a choqué l’opinion publique : le président Aziz a gracié 30 trafiquants de drogue condamnés, tous issus de tribus influentes. Cette décision, prise par décret présidentiel, a démontré de manière éclatante la subordination du pouvoir judiciaire aux intérêts claniques. Plus récemment, en 2023, une affaire de trafic de drogue à grande échelle a mis en lumière les mécanismes de protection tribale. Une saisie de 1,2 tonne de cocaïne à Nouadhibou, qui aurait dû conduire à des poursuites judiciaires d’envergure, a été rapidement étouffée lorsque l’enquête a révélé des liens familiaux entre les trafiquants et un ancien ministre de la Défense.
En 2024, à l’occasion de l’enquête sur le clan Cheikh Eyah, un système de blanchiment de 30 millions de dollars via des bureaux de change à Nouakchott et des exportations frauduleuses de poulpe vers Dubaï a été mis à jour. Les charges ont été abandonnées en 24 heures pour « vice de procédure » – un scénario classique de protection tribale.Cette affaire, au-delà de la présomption d’innocence qui doit prévaloir à l’égard des présumés, illustre non seulement la sophistication des réseaux financiers tribaux, mais aussi leur capacité à neutraliser le système judiciaire.
Ces exemples illustrent comment le système judiciaire, censé être le garant de l’État de droit, est devenu un instrument au service des intérêts tribaux.
Armée et sécurité : des milices tribales déguisées
L’armée et les forces de sécurité n’échappent pas à l’emprise tribale, compromettant sérieusement la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’État mauritanien. 90 % des postes d’officiers supérieurs sont occupés par des tribus. Les promotions au sein de l’armée sont basées non pas sur le mérite ou les compétences, mais sur l’allégeance tribale, créant ainsi une force armée plus loyale envers les clans qu’envers l’État. Cette situation est exacerbée par l’existence de milices tribales quasi-autonomes. Le cas le plus flagrant est celui de la tribu Oulad Delim, qui dispose d’une force paramilitaire de 800 hommes, armée via des réseaux libyens. Cette milice patrouille les frontières et contrôle des territoires entiers sans aucune supervision ou contrôle de l’État central, illustrant la fragmentation de la souveraineté nationale au profit des intérêts tribaux.
Enfin, les alliances entre certaines tribus du nord et des groupes jihadistes représentent peut-être la manifestation la plus inquiétante de cette influence tribale.. Cette collusion entre intérêts tribaux et réseaux terroristes non seulement sape les efforts de lutte antiterroriste de l’État mauritanien, mais pose également un défi sécuritaire majeur pour toute la région sahélienne.
IV. Conséquences : un pays en déliquescence
La Mauritanie n’est plus un État au sens wébérien du terme (soit une communauté humaine, qui à l’intérieur d’un territoire déterminé (…) revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime), mais une constellation de fiefs tribaux régis par des lois parallèles.
Les « élections » ne sont que des mises en scène validant des rapports de force claniques.
Ainsi , pour faire face à ces mécanismes de prédation, toute réforme devra nécessairement passer par :
• La restitution de 30% des actifs miniers et halieutiques aux coopératives non tribales
• Le renforcement des tribunaux anticorruption sous supervision internationale
• Le déploiement de douanes intelligentes (IA, blockchain) à Nouakchott et Nouadhibou
Sans rupture radicale, la Mauritanie restera un État fantôme, où la citoyenneté s’efface devant l’appartenance tribale.
Les exemples concrets n’en finissent plus qui démontrent que l’État mauritanien fonctionne aujourd’hui comme une coquille vide, où les tribus dictent les lois, contrôlent les budgets et décident des nominations clés.
Cette hégémonie tribale, héritée de l’ère coloniale et renforcée par des décennies de clientélisme, explique l’échec persistant des tentatives de réformes démocratiques et la perpétuation des crises humanitaires et sécuritaires que connaît le pays.
Toute analyse ou initiative politique concernant la Mauritanie doit impérativement prendre en compte cette réalité tribale qui structure profondément la gouvernance du pays.
La Mauritanie se trouve, donc, à un carrefour critique. Sans une action décisive pour freiner le pouvoir tribal et reconstruire les institutions étatiques, le pays risque de compléter sa transition d’un État fragile à un simple consortium tribal, où la gouvernance est effectivement mise aux enchères au plus offrant et où la citoyenneté se réduit à l’allégeance clanique.
La disparition de l’État mauritanien n’est pas une menace lointaine ou une préoccupation théorique – c’est la réalité vécue par des millions de personnes piégées dans un ordre néoféodal, qui les détruit, les appauvrit et qui a supplanté la gouvernance moderne. Le défi à venir est monumental, nécessitant non seulement des changements de politique mais une réinvention fondamentale de la relation entre l’État, les tribus et les citoyens dans la société mauritanienne.
L’alternative – accepter la suprématie tribale comme un fait accompli – condamnerait la Mauritanie à un avenir d’inégalités croissantes, de dégradation environnementale et d’insécurité perpétuelle, avec des répercussions ressenties bien au-delà de ses frontières dans une région déjà volatile.
Il y a environ 1431 ans, le 9è jour de Dhul-Hijjah, alors qu’il se tenait dans la vallée d’Uranah au Mont Arafat, le Prophète Muhammad (SAW) a délivré son sermon d’Adieu (Khutbatul Wada) :
« Ô Peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais si après cette année, je serai de nouveau parmi vous. Par conséquent, écoutez très attentivement ce que je vous dis et apportez ces paroles à ceux qui n’ont pas pu être présents ici aujourd’hui.
Ô Peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette ville comme sacrés, considérez la vie et les biens de chaque musulman comme une responsabilité sacrée. Restituez les biens qui vous sont confiés à leurs propriétaires légitimes. Ne blessez personne pour que personne ne vous blesse. Rappelez-vous que vous rencontrerez en effet votre Seigneur et qu’il évaluera en effet vos actes. (….)
Mais qui aujourd’hui, l’entend encore ?
« Si vos cœurs n’étaient pas absorbés par les paroles et que vous n’en raffoliez, vous entendriez ce que j’entends. » (Hadith du Prophète Mohamed que la paix soit sur lui)
Certainement pas par des gouvernants d’un Etat pris en otage par des tribus, avec laquelle l’Alliance avait été formellement interdite par le prophète Mohamed (PSL) de son vivant.
Paix aux innocents.
Pr ELY Mustapha
Dialogue politique : Moussa Fall choisi par le président Ghazouani pour la coordination

Sahara Médias – Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a confié la coordination du prochain dialogue national à l’homme politique Moussa Fall.
Cette décision a été prise lors d’un iftar (rupture du jeûne) organisé par le président en l’honneur de la Fondation de l’opposition démocratique, des chefs de partis politiques et des candidats aux dernières élections présidentielles, dimanche soir au palais présidentiel.
Au cours de cette rencontre, Ould Ghazouani a évoqué le prochain dialogue national qui, selon lui, sera lancé dans quelques semaines.
Ould Ghazouani a annoncé que Moussa Fall, homme politique mauritanien et figure nationale, serait chargé de la coordination du dialogue.
Moussa Fall est une figure du consensus national qui, jusqu’à récemment, était actif dans l’opposition. Il a une longue histoire dans la politique mauritanienne.
Ould Ghazouani a demandé à tous les partis politiques de lui faire parvenir leurs propositions pour le prochain dialogue national.
Ould Ghazouani a annoncé son intention d’organiser un dialogue national global lors de son discours d’investiture au début du mois d’août.
Il a décrit le dialogue national à venir comme étant inclusif, n’excluant personne et n’éludant aucun sujet.
Depuis lors, le gouvernement, représenté par le Premier ministre, a tenu une série de réunions avec les partis politiques pour préparer le dialogue.
cridem
Bureau du député Biram Ould DahAbeid : Déclaration

Le Calame – Un communiqué de l’Agence mauritanienne d’information (Ami), rapporte, le 19 février 2025, l’échange d’allocution entre le Premier ministre et l’Ambassadeur de l’Union européenne, au titre du dialogue politique, qu’implique l’Accord d’association Acp-Ue.
Le volet de la concertation stratégique couvre des domaines complémentaires qui vont de l’économie, au développement, en passant par la sécurité, la migration et la protection des droits humains. Chacun des deux orateurs a relevé le niveau très élevé de la coopération, non sans souligner que la Mauritanie en bénéficie désormais davantage que tout autre pays d’Afrique.
La partie mauritanienne a exprimé le besoin de « mobiliser les fonds et les ressources nécessaires » en vue de consolider sa stabilité, dans un environnement certes en proie à une multiplication des crises multidimensionnelles.
Compte tenu de l’importance de l’évènement et de ses retombées sur le front intérieur, il convient de formuler, ici, quelques observations, à l’endroit de l’Ue, notre partenaire de toujours, dont nous apprécions la résolution, déjà ancienne, à propager les valeurs de l’universalisme et de la non-violence :
1. Aujourd’hui, la gouvernance de la Mauritanie n’offre les garanties minimales de transparence et de gestion vertueuse. Les niveaux vertigineux de corruption et d’impunité,que tolère le pouvoir du moment, jettent un discrédit empirique, sur ses intentions et son discours. Tout, là, n’est qu’affichage, manipulation et petites ruses de cleptomanie, comme le rappelle le gâchis du Port de Ndiago, parmi d’autres fiascos du genre. Les dernières révélations au sujet du détournement d’un concours financier de l’Agence française de développement (Afd), témoignent de l’acuité du trompe-l’œil, de la façade à l’arrière-cour :
2.Le soutien de l’Ue, tant qu’il s’exerce sans une conditionnalité assumée en public, selon des mécanismes de suivi et de reddition des comptes, équivaut, de facto, à une complicité avec les affameurs de la population. D’une telle imprudence résulterait, par réaction de dépit, l’essor de la démagogie, du populisme insurrectionnel et de la désinformation, au profit de puissances et de fauteurs de guerre nullement intéressées à promouvoir la démocratie et la centralité de l’individu.
3.Le seul dialogue susceptible de porter la semence de l’équité et de la paix est, d’abord, domestique. Quand les Mauritaniens auront discuté de l’avenir commun et décidé, ensemble, la reconnaissance des partis et des associations encore maintenus en deçà de la légalité, alors, oui, l’Ue pourra se prévaloir de parler à un peuple uni, dans la diversité de ses composantes.
Au lieu de continuer à soutenir le conglomérat des factions tribales et d’encourager son appétence à la prédation, les partenaires multilatéraux du pays seraient bien inspirés de comprendre combien l’invasion migratoire du sud au nord découle, en premier, de l’échec des élites du Continent. Peu importent les millions d’euros dépensés, les programmes d’endiguement aux frontières ne sauraient mettre un terme au sauve-qui-peut généralisé.
Le problème s’avère d’une gravité et d’un potentiel de désordre insoupçonnés. Peut-être le temps est-il venu, pour l’Europe et le Monde libre, de se livrer à l’autocritique salutaire, sous peine de poursuivre leur déclin, au bénéfice de la tyrannie.
Dakar, le 21 février 2025
Diplomatie Mauritanienne : Forces et faiblesses dans un monde en mutation. Par Pr ELY Mustapha

Pr. ELY Mustapha — « L’anarchie internationale est ce que les États en font » (Wendt A. Social Theory of International Politics)
La Mauritanie, pays sahélien situé à la croisée des enjeux géopétropolitiques du Maghreb et du Sahel, a déployé une diplomatie marquée par une stratégie d’équilibre, des alliances économiques ciblées et une gestion prudente des tensions régionales durant ces dix dernières annés.
Comme le souligne Hans Morgenthau dans Politics Among Nations (1948), « les États agissent rationnellement pour maximiser leur pouvoir et leur sécurité dans un système international anarchique ».
Cette logique réaliste a guidé notre pays dans son approche d’équilibre entre le Maroc et l’Algérie, lui permettant de maintenir une stabilité relative dans un contexte volatile. Cependant, cette diplomatie rencontre également des défis structurels, illustrant les limites des théories classiques face à des enjeux hybrides.
Forces de la diplomatie mauritanienne
1. Médiation régionale et neutralité stratégique
La Mauritanie a consolidé son rôle de médiateur neutre dans les conflits régionaux, en particulier autour du Sahara Occidental. En maintenant des relations équilibrées avec l’Algérie et le Maroc, elle applique une stratégie d’équilibre des puissances (balance of power), théorisée par Kenneth Waltz (Theory of International Politics, 1979).
Comme l’écrit Waltz, « dans un système multipolaire, les petits États peuvent tirer profit des rivalités entre grandes puissances pour préserver leur autonomie ». Cette posture a permis à la Mauritanie d’éviter de s’aliéner l’un ou l’autre camp, tout en servant de pont discret entre les parties prenantes.
Cependant, John Mearsheimer (The Tragedy of Great Power Politics, 2001) rappelle que « l’équilibre des puissances est toujours précaire dans les régions polarisées » – une réalité illustrée par les pressions croissantes du Maroc et de l’Algérie sur Nouakchott.
2. Diversification des partenariats économiques
La diplomatie économique mauritanienne incarne les principes de l’interdépendance complexe de Robert Keohane et Joseph Nye (Power and Interdependence, 1977), selon lesquels « les interactions économiques multilatérales réduisent les risques de conflit et augmentent la résilience ». En attirant des investissements chinois (37 % des exportations), marocains et européens, la Mauritanie a limité sa dépendance.
Cependant, Samir Amin (L’accumulation à l’échelle mondiale, 1970) met en garde : « Les économies périphériques restent captives des puissances centrales si elles n’industrialisent pas leurs ressources ». Ce piège se reflète dans le déficit commercial chronique (7 % du PIB en 2023), lié aux importations chinoises à bas coût.
3. Intégration aux initiatives internationales
L’alignement sur les Objectifs de développement durable (ODD) et la ZLECAF relève du constructivisme d’Alexander Wendt (Social Theory of International Politics, 1999), pour qui « les normes internationales façonnent les identités et les intérêts des États ».
En adhérant à ces cadres, la Mauritanie a renforcé sa crédibilité auprès du FMI, obtenant 86,9 millions de dollars pour des réformes. Toutefois, Stephen Krasner (International Regimes, 1983) souligne que « l’efficacité des régimes internationaux dépend de la capacité des États à internaliser les normes » – un défi face aux retards dans la transition numérique mauritanienne.
4. Gestion sécuritaire proactive
La réussite sécuritaire du pays s’appuie sur la théorie de la sécurité humaine développée par Mahbub ul Haq (Reflections on Human Development, 1995), selon laquelle « la sécurité ne se limite pas à l’absence de guerre, mais inclut la lutte contre la pauvreté et l’exclusion ».
En combinant modernisation militaire et programmes communautaires, la Mauritanie a évité les attaques terroristes depuis 2011. Cependant, Amartya Sen (Development as Freedom, 1999) rappelle que « la liberté politique et sociale est un pilier de la sécurité durable » – un enjeu face à la marginalisation persistante des Harratines.
Faiblesses et limites structurelles
1. Dépendance économique et vulnérabilité externe
La Mauritanie illustre les thèses de la théorie de la dépendance d’André Gunder Frank (The Development of Underdevelopment, 1966) : « Les pays exportateurs de matières premières sont structurellement vulnérables aux chocs externes ».
Les retards dans le projet gazier GTA et la domination chinoise dans les exportations minérales en sont des manifestations. Pour Samir Amin, une « déconnexion contrôlée » via l’industrialisation serait nécessaire pour briser ce cycle.
2. Pressions géopolitiques contradictoires
La neutralité mauritanienne est érodée par les rivalités de pouvoir décrites par Mearsheimer : « Les grandes puissances cherchent toujours à dominer leur région, menaçant l’autonomie des petits États ». Le corridor atlantique marocain et les pressions algériennes via le Polisario placent Nouakchott dans un dilemme stratégique typique des zones d’influence concurrentes.
3. Défis de gouvernance interne
Comme le souligne Douglass North (Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990), « les institutions inefficaces entravent le développement, même en présence de ressources abondantes ». La corruption et la faible collecte fiscale en Mauritanie limitent l’impact des réformes, malgré les financements internationaux (sur ces aspects voir mes précédents articles sur les finances publiques mauritaniennes).
4. Limites de la diversification diplomatique
Les projets d’énergies renouvelables stagnants rappellent les critiques de Walt Rostow (The Stages of Economic Growth, 1960) : « La modernisation ne peut être importée ; elle requiert des institutions locales solides ». Sans capacités techniques endogènes, la diversification reste superficielle.
Pour sortir des écueils théoriques et pratiques, la Mauritanie doit hybrider les approches :
– Équilibre des puissances et sécurité humaine : Comme le suggère Ul Haq, « investir dans le développement local pour consolider la stabilité ».
– Interdépendance et déconnexion contrôlée : Appliquer les clauses de contenu local préconisées par Amin pour transformer les ressources en industries.
– Constructivisme et néo-institutionnalisme : Renforcer les institutions, car « les normes sans capacités internes sont illusoires » (Krasner).
En conclusion, la diplomatie mauritanienne a, de notre point de vue et sur 10 ans (de 2015 à 2025), illustré à la fois les forces et les limites des théories des relations internationales. Si le réalisme explique sa neutralité tactique et l’interdépendance ses alliances économiques, les théories critiques (dépendance, sécurité humaine) révèlent ses vulnérabilités structurelles.
Comme l’écrit Wendt, « l’anarchie internationale est ce que les États en font » – pour la Mauritanie, l’enjeu est de transformer sa position géostratégique en un projet de développement inclusif, ancré dans des réformes institutionnelles audacieuses.
Pr ELY Mustapha