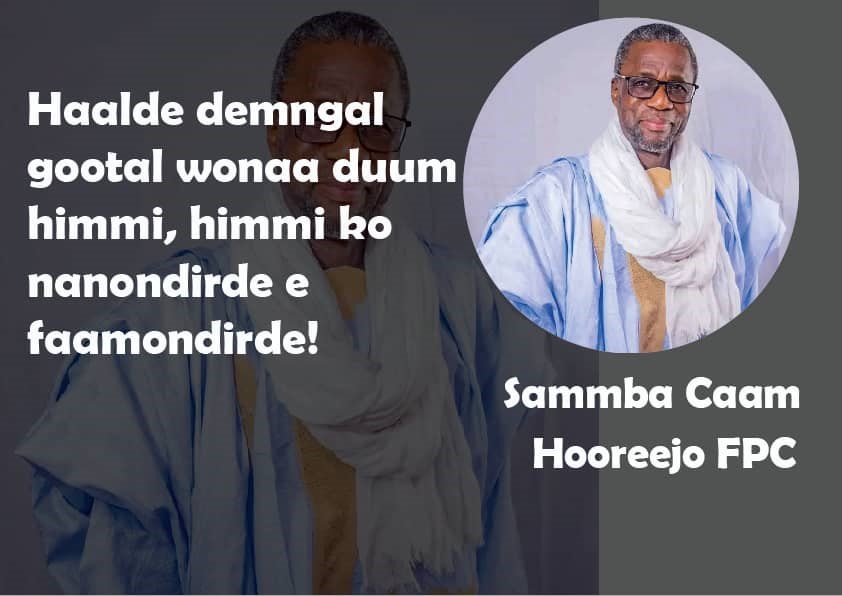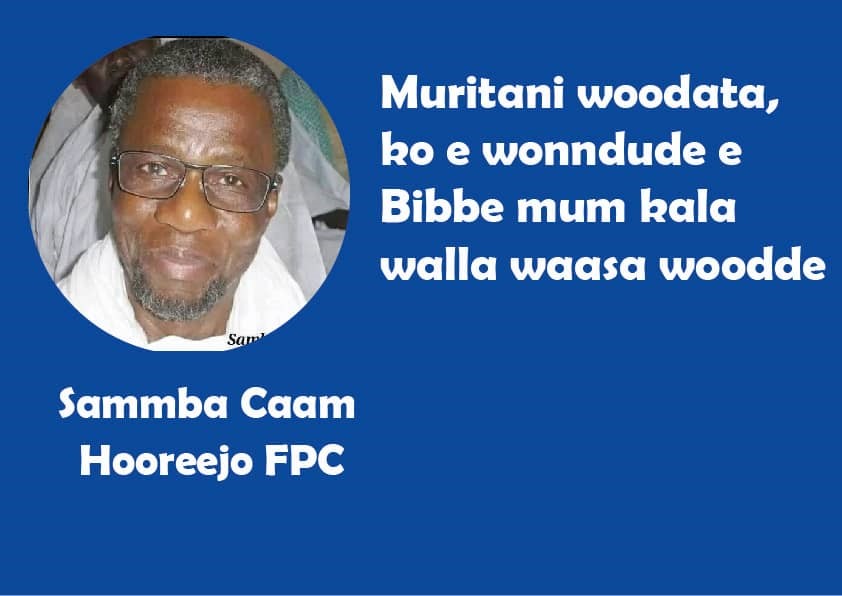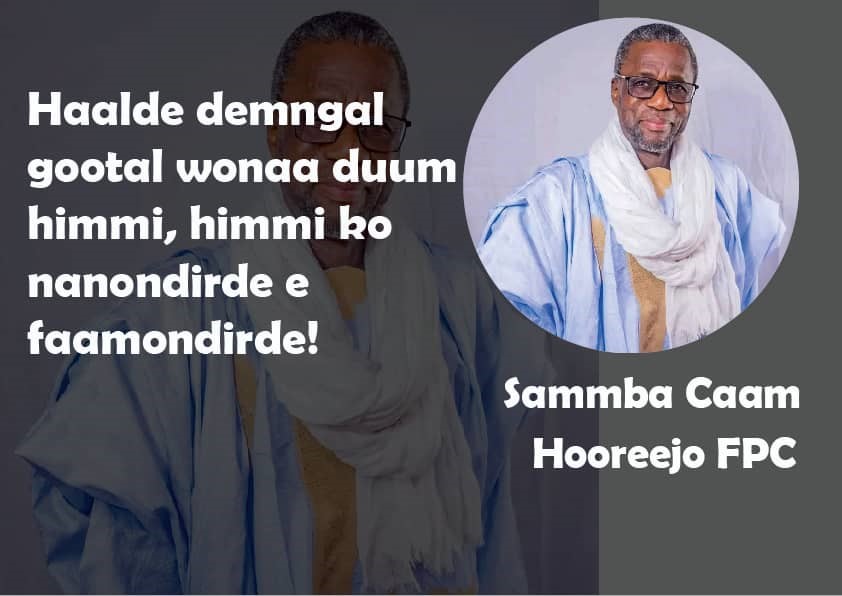Category Archives: dossiers anniversaires
Ibrahima Diawado N’jim, le mauritanien qui murmure à l’oreille de Manuel Valls
Musulman, professeur d’arabe, né dans le Sahel mauritanien : un profil atypique dans la garde rapprochée du ministre français de l’Intérieur. Pourtant, ce militant associatif l’accompagne depuis douze ans.

Mamadou Barry Flam-usa, repond a Dicko
FLAMNET-RÉTRO: Les FLAM et moi : cauchemar d’enfant et rêve d’adulte par Mohamed El Hacen Ould Lebatt.
 La première fois que j’entendis parler des FLAM, c’était dans la bouche d’un cousin à moi, ami d’Ely Ould Mohamed Vall (oué oué, ami d’Ely, en Mauritanie, c’est un qualificatif en soit, on peut par exemple entendre ce type d’échange : « Abdallahi, tu vois qui c’est ? », « non ! », « mais si, l’ami d’Ely », « ah, oui, je le connais », nous le voyons donc, c’est un qualificatif, ça peut même devenir un boulot à plein temps, j’ai des exemples, mais là on s’éloigne du sujet) ce cousin donc est entré un jour à la maison, avec sous le bras une grosse liasse de papier, il est parti directement s’enfermer dans le salon, ma mère me demanda de lui ramener un verre de thé et du zhrig, quand je suis rentré il a précipitamment rangé les feuilles, mais voyant qu’il ne s’agissait que d’un gamin de dix ans, il s’est détendu.
La première fois que j’entendis parler des FLAM, c’était dans la bouche d’un cousin à moi, ami d’Ely Ould Mohamed Vall (oué oué, ami d’Ely, en Mauritanie, c’est un qualificatif en soit, on peut par exemple entendre ce type d’échange : « Abdallahi, tu vois qui c’est ? », « non ! », « mais si, l’ami d’Ely », « ah, oui, je le connais », nous le voyons donc, c’est un qualificatif, ça peut même devenir un boulot à plein temps, j’ai des exemples, mais là on s’éloigne du sujet) ce cousin donc est entré un jour à la maison, avec sous le bras une grosse liasse de papier, il est parti directement s’enfermer dans le salon, ma mère me demanda de lui ramener un verre de thé et du zhrig, quand je suis rentré il a précipitamment rangé les feuilles, mais voyant qu’il ne s’agissait que d’un gamin de dix ans, il s’est détendu.
Le mystère qui entourait ces papiers a éveillé ma curiosité, je lui ai demandé de quoi il s’agissait, il me répondit : « c’est le programme des FLAM ! ». Il me dit que les FLAM c’est les nègro-africains, qu’on ne leur connaît pas de visage, que Demba le menuisier, ou les Diallo, nos voisins de toujours, peuvent en faire partie, qu’il ne faut pas traîner avec eux, car ils comptent nous égorger tous, mais que la police en a arrêté quelques uns, hier, et ils ont trouvé sur eux leur programme. Je l’ai quitté avec un grand sentiment de peur mais aussi un inexplicable malaise, pourquoi Demba, ce gentil garçon, voudrait-il m’égorger ?
Bien sûr avec mon jeune âge d’alors, je ne pouvais pas comprendre que, si le document était réellement des FLAM, pourquoi sa lecture doit s’entourer de telle mesure clandestine, n’est ce pas ce document qui prouve l’infamie des FLAM, et donc la nécessité de les mettre hors d’état de nuire ? Il est donc de l’intérêt de la police d’encourager plutôt sa lecture.
Ce n’est que lorsque j’ai eu le véritable Manifeste du Nègro-mauritanien Opprimé que j’ai compris l’étendue de la manipulation machiavélique dont je fut victime, et je suis loin d’être le seul.
Je ne m’étendrai pas ici sur la réécriture du manifeste, de telle sorte que les FLAM deviennent, dans l’imaginaire collectif Beidhane, ainsi que celui de la quasi totalité des populations Haratines, synonymes de Négro-africain voulant égorger le pauvre musulman, afin de permettre que notre pays soit annexé par l’étranger (à l’époque l’étranger c’était le Sénégal), et je caricature à peine, mais ce qui m’importe ici est de faire la lumière sur la campagne d’information que les FLAM ont mis en place pour dévoiler leur vrai visage, campagne dont le fer de lance est le site FLAMNET.
Il a fallu du temps aux FLAM, pour se réorganiser, se remettre en contact, ce qui n’est pas chose aisée, quand les militants en Mauritanie doivent se cacher, et ceux de l’étranger sont dispersés de par le vaste monde (Sénégal et Mali, mais aussi les USA, l’Espagne, l’Allemagne, la France, la Belgique et les pays scandinaves)
Tout commence en juin 2000, époque où les étudiants préparaient les examens, l’unique source dont on disposait pour s’informer sur le pays était mauritanie-net, et c’est là qu’on a appris la naissance de Flamnet. La suite est connue de tous, d’abord les Flam deviennent fréquentables par une bonne majorité de Maure, ensuite on se rend compte qu’en fait, ils ne voulaient pas nous égorger, ni même égorger Ould Taya, mais qu’en définitive la réciproque est vraie, c’est nous qui les avons égorgés.
Je vous épargnerais le rébarbatif discours sur « La Communauté de Destin et bla bla bla… » mais je veux juste rappeler que la Mauritanie n’est pas plus arabe qu’africaine, et vice-versa, nous avons une double appartenance, donc une double vocation (triple, d’après le PRDS car, apparemment, la Mauritanie a aussi une vocation hébraïque ! )
En définitive, la question que nous devons nous poser n’est plus : mais pourquoi ils nous détestent ? Mais : Qu’avons nous fait pour qu’ils nous détestent ?
Supposant que le froid nordique a réussi à apaiser la hargne de Kaaw Touré, je me permets une timide remarque :
Pourquoi ne pas envisager une version arabe de Flamnet?
Je remarque que d’ores et déjà on peut publier en arabe sur le site FLAMNET, j’espère donc que le nouveau FLAMNET tranchera avec la vieille habitude de nos intellectuels d’écrire uniquement à destination du pré-carré francophone.
Bon Anniversaire donc aux FLAM !
Mohamed El Hacen Ould Lebatt.
www.flamnet.info
FLAMNET-RÉTRO: Quand Biram Dah Abeïd courtisait les FLAM
 Toute la Mauritanie, l’Afrique et le monde entier doivent rendre hommage à l’organisation Flam de Mauritanie qui ont payé un prix de sang de leur engagement pour une Mauritanie égalitaire battue sur le respect de toutes races, langues, et cultures qui la composent. Vous êtes les pionniers de ces luttes que nous autres militants abolitionnistes et pour l’avènement d’un Etat de droit nous menons non sans grandes difficultés ; toutes ces causes sont collatérales, votre engagement nous l’apprend.
Toute la Mauritanie, l’Afrique et le monde entier doivent rendre hommage à l’organisation Flam de Mauritanie qui ont payé un prix de sang de leur engagement pour une Mauritanie égalitaire battue sur le respect de toutes races, langues, et cultures qui la composent. Vous êtes les pionniers de ces luttes que nous autres militants abolitionnistes et pour l’avènement d’un Etat de droit nous menons non sans grandes difficultés ; toutes ces causes sont collatérales, votre engagement nous l’apprend.
Plus que jamais, le commun des mauritanien ou le simple observateur saura de nos jours, que vos slogans originels, vos mots d’ordre sont d’une très grande actualité et requièrent l’adhésion de tous les justes.
En avant, la lutte continue !
Biram Ould Dah Ould Abeid
Nouakchott le 14 Mars 2010
Vent de fronde en Turquie
 « Il est assez tentant d’y voir [dans les manifestations en Turquie] un islamisme de gouvernement contesté par une mouvance laïco-républicaine, à l’inverse de la place Tahir au Caire, où un pouvoir laïco-républicain était aux prises avec la révolte d’une nébuleuse islamiste… »
« Il est assez tentant d’y voir [dans les manifestations en Turquie] un islamisme de gouvernement contesté par une mouvance laïco-républicaine, à l’inverse de la place Tahir au Caire, où un pouvoir laïco-républicain était aux prises avec la révolte d’une nébuleuse islamiste… »
Ainsi questionné par Mediapart le 4 juin 2013, Levent Yilmaz, professeur d’histoire à l’université Bilgi d’Istanbul, répondait :
« La nuit de samedi (1er juin) a donné lieu à des ralliements qui défient ce genre de typologie. On a même vu des supporters de clubs de football ennemis s’entraider, tant l’appel à la fois puissant et unanime des réseaux sociaux avait fait son œuvre : un brassage impressionnant, sans les caractéristiques, les particularismes et les exclusives attachés aux mouvements partisans.
L’opposition institutionnelle renonce, du reste, à tenter de récupérer ce mouvement et son million de Turcs contestataires, qui relève donc de l’événement populaire spontané, sans idéologie préconçue, aux mains d’individus responsables allant jusqu’à nettoyer la place et son square après les charges policières. »
Passons sur la question du journaliste… et la définition de la lutte en Egypte comme opposant une nébuleuse islamiste à un pouvoir laïco-républicain (on croit rêver), mais la réponse de Yilmaz s’inscrit en faux contre les simplifications qui ont cours sur la Turquie, mais aussi sur le monde arabe (Tunisie, Egypte) et qui réduisent la vie politique à un affrontement entre deux blocs.
Pour une bonne revue de ce qui s’écrit sur la Turquie, on peut consulter le site d’Alain Bertho, « Anthropologie du présent », qui suit les événements au jour le jour.
Et aussi le blog d’Etienne Copeaux, « Un pas de côté dans les études turques ».
Oui, le Parti de la justice et du développement (AKP) est issu d’un mouvement islamiste proche des Frères musulmans. Mais il est important de faire un bilan objectif de ce qu’il a réalisé depuis son accession aux affaires en 2002 et qui s’est traduit par deux nouvelles victoires aux élections législatives en 2007 et en 2011 (cette année-là avec près de 50 % des suffrages).
La plus importante avancée réalisée par ce parti a été la mise à l’écart de l’armée, qui est rentrée dans ses casernes (sur cet affrontement, lire « Qui gouverne la Turquie ? »). Jusque-là, cette institution faisait la pluie et le beau temps, et pesait d’un poids politique démesuré, régulièrement dénoncé par l’Union européenne. Car il est clair qu’il ne peut y avoir de progrès démocratique quand l’état-major décide des affaires essentielles. Un des problèmes de l’opposition dite de gauche (le Parti républicain du peuple, CHP) est qu’il est incapable de choisir entre son allégeance à l’armée et la démocratie. Ce parti est traversé par des courants nombreux et a été incapable de représenter une solution de rechange à l’AKP (il a obtenu environ 26 % des suffrages en 2011).
Sur un site passionnant consacré au football et à sa place au Proche-Orient, « The Turbulent World of Middle East Soccer » (avec une place importante accordée aux ultras, les supporteurs des clubs dont on connaît le rôle surtout en Egypte), James Dorsey note, le 2 juin :
« Contrairement aux manifestations de masse qui ont renversé les dirigeants dans les pays d’Afrique du Nord, les protestations en Turquie visent un dirigeant démocratiquement élu qui a remporté trois élections avec une majorité respectable, a présidé une période de croissance économique importante et repositionné son pays comme une puissance régionale avec des ambitions mondiale. Elles ont également eu lieu dans un pays qui, contrairement aux pays arabes, et malgré tous ses défauts, est démocratique et a une société civile remuante et fortement développée. »
Il faudrait ajouter que c’est aussi ce gouvernement qui a eu le courage d’ouvrir des négociations avec les « terroristes » du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).
Alors, que s’est-il passé ? Pourquoi une manifestation écologique au cœur d’Istanbul s’est-elle transformée en fronde ?
Deux facteurs ont joué, au moins de manière indirecte, et provoqué un certain mécontentement : le ralentissement économique (notons que, malgré leur diminution sensible dans les années 2000 (PDF), les inégalités restent importantes en Turquie) ; une hostilité grandissante à l’activisme d’Ankara en Syrie.
Mais la responsabilité principale de la révolte incombe à celui-là même qui fit le succès de l’AKP, Recep Tayyip Erdogan, le premier ministre. Grisé par ses réalisations, il cherche à tout prix à consolider son pouvoir, à faire rédiger une constitution présidentielle qui lui permettrait de briguer la charge de chef de l’Etat, méprise ses adversaires, multiplie les initiatives brouillonnes.
Le plus grave est sans doute la dérive autoritaire qui a vu emprisonner des dizaines de journalistes, des centaines d’opposants, notamment kurdes. La brutalité de la répression contre les manifestants de Taksim a uni contre lui un large front, très hétéroclite et qui ne se limite sûrement pas aux « laïcs ». Ainsi que le rappelle James Dorsay, pour la première fois depuis 30 ans, les supporteurs des trois grands clubs de football d’Istanbul, pourtant rivaux, se sont joint aux manifestants, dont la diversité politique et sociologique est très notable, comme le remarquent Didem Collinsworth et Hugh Pope, « The Politics of an Unexpected Movement » (4 juin) :
« Encore plus étonnante est la présence de groupes rivaux agissant côte à côte, y compris ceux qui représentent la communauté alévie (environ 10 % de la population de la Turquie), ultranationalistes, conservateurs de droite, quelques islamistes et les Kurdes de Turquie — certains brandissant le drapeau du PKK. Quelques groupes plus marginaux se sont également joints aux protestations, y compris des gauchistes et des marxistes ainsi que des anarchistes brandissant des drapeaux noirs. »
La grille de lecture qui voudrait voir dans ces actions un mouvement contre la réislamisation de la société ne correspond pas à la réalité. Levent Yilmaz note : « Nous avons bien entendu affaire à un gouvernement conservateur musulman, qui n’a pourtant pas exercé d’oppression confessionnelle. Erdogan présente un profil autoritaire. Il semble en voie de “poutinisation”. Il se mêle de tout et suscite la peur. Cette atmosphère de crainte, étouffante, a gagné des secteurs qui semblaient intellectuellement armés pour y résister : les médias, l’université…
Mais les grilles de lecture, en France ou ailleurs, poussent parfois à surinterpréter certains signes d’autoritarisme en en faisant des signaux religieux. L’exemple des récentes dispositions limitant le marché de l’alcool est symptomatique. L’affaire m’apparaît moins répressive que bien des ordonnances d’outre-Atlantique, par exemple, où la vente est souvent interdite aux moins de 21 ans. En Turquie, se fondant sur une législation déjà existante, le pouvoir veut entraver un tel commerce après 22 heures ou à proximité des écoles. J’y vois davantage la marque du conservatisme que de l’islamisme. »
Notons aussi que la mainmise du pouvoir sur les grands moyens de télévision audiovisuels a joué aussi un rôle dans la fureur des manifestants (lire « Dans la rue, la colère monte contre “CNN-Pingouins” et les médias turcs acquis au pouvoir », LeMonde.fr, 4 juin).
Que va-t-il se passer maintenant, alors que le premier ministre a quitté la Turquie pour l’Afrique du Nord, que le syndicat de la fonction publique a appelé à une grève de 48 heures (peu suivie) et que la Confédération syndicale des ouvriers révolutionnaires (DISK), qui revendique 420 000 membres, appelle à une grève mercredi 5 juin ?
En l’absence d’Erdogan, le vice-premier ministre Bülent Arinç a, selon l’AFP, reconnu les « légitimes » revendications des écologistes à l’origine de la fronde. Il a aussi présenté ses « excuses » aux très nombreux blessés civils, et a regretté l’usage abusif des gaz lacrymogènes par la police, « qui a fait déraper les choses ».
Existe-t-il des divisions dans l’AKP ? Sans aucun doute, et les propos du président Gul ont été aussi apaisants que ceux du vice-premier ministre. Mais il serait hâtif de tirer un trait sur Erdogan, qui dispose encore de vastes appuis, y compris dans une partie notable de la population.
Sur le mouvement de Fethullah Gülen, lire Wendy Kristianasen, « Ces visages multiples de l’islamisme », Le Monde diplomatique, juillet 1997.
Un autre facteur pèsera, que relève Dorsey : « Le rival islamiste de M. Erdogan, Fethullah Gülen, un religieux puissant auto-exilé, basé en Pennsylvanie, qui exerce une influence dans la police, peut très bien avoir vu les protestations comme une occasion d’affaiblir le premier ministre. Le collègue de parti de M. Erdogan, le président Abdullah Gul, est considéré comme proche de M. Gülen. Dans une allusion voilée à M. Erdogan, M. Gülen a récemment prêché contre l’orgueil. Par ailleurs, des rapports circulant à Istanbul disent que l’armée, qui partage les suspicions des laïcs à l’égard du gouvernement, a refusé les demandes d’aide de la police, et qu’un hôpital militaire a même distribué des masques à gaz aux manifestants. »
Alain Gresh
Le monde diplomatique