Category Archives: culture
De l’origine de l’humanité à nos jours
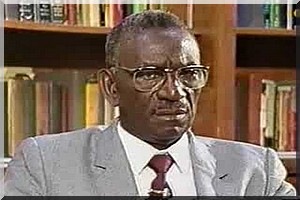 Aujourd’hui, grâce à la science on sait de façon sûre que l’humanité a pris naissance en Afrique sous la latitude du Kenya, dans cette région à cheval entre l’Ethiopie, le Kenya et la Tanzanie et qui se prolonge sur un axe Nord-Sud jusqu’en Afrique du Sud et l’Afrique est incontestablement le berceau de l’humanité.
Aujourd’hui, grâce à la science on sait de façon sûre que l’humanité a pris naissance en Afrique sous la latitude du Kenya, dans cette région à cheval entre l’Ethiopie, le Kenya et la Tanzanie et qui se prolonge sur un axe Nord-Sud jusqu’en Afrique du Sud et l’Afrique est incontestablement le berceau de l’humanité.
« Une humanité qui est née dans cette latitude n’aurait pas pu survivre, si elle n’était pas pigmentée noire dés son apparition » soutient feu le professeur Cheikh Anta Diop, de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire –IFAN- dans une vidéo conférence dont CRIDEM a une copie.
Selon cet égyptologue émérite, « la nature ne crée rien au hasard ». C’est ainsi que dame nature a protégé cette humanité née sous l’équateur par un écran de mélanine.
Ce qui fait que les premiers hommes étaient nécessairement noirs tant qu’ils n’étaient pas sortit de l’Afrique. Ce n’est qu’après l’avoir fait qu’il va changer d’aspect suivant les régions géographiques et que les autres races vont apparaitre, c’est premiers hommes comprenaient six spécimens dont celui que nous sommes.
Jusque dans l’état actuel des recherches, il est prouvé que les trois premiers n’ont pas atteint un niveau d’expansion leur permettant de sortir du continent africain contrairement aux trois autres qui sont sortis de l’Afrique. Selon toujours Cheikh Anta Diop, le quatrième et le cinquième « ont disparus ».
Le crane du cinquième que montre la vidéo se distingue par des yeux sur orbite avec une absence presque de front, il n’avait pas de lobe antérieur à la différence de l’homo sapience, « il n’a jamais pu sublimer la nature pour créer une œuvre d’art » souligne le savant sénégalais, décédé le 7 février 1986 à l’âge de 63 ans non pas sans avoir prouvé à la face du monde que l’Afrique est le berceau de l’humanité à travers une œuvre littéraire et scientifique d’une haute facture.
C’est le crane de ce cinquième homme de notre humanité, découvert pourtant après la disparition de l’auteur de « Nations Nègres et Culture » dans le désert Tchadien appelé « Dumaï » qui est venu encore étayer les thèses du professeur Diop après la découverte de Lucie à Oldoway en Afrique du Sud.
C’est donc l’homme de Grimaldi qui entre en Europe il y a plus 50 mille ans, il va survivre par adaptation dans un climat de l’extrême froid de la dernière glaciation qui a duré 100 mille ans. C’est lui qui donnera naissance à l’homme de Cro-Magnon, un leucoderme. « Même s’ils ne le reconnaissent pas avec autant d’honnêteté, les scientifiques acceptent la thèse que le blanc est sorti du noir par adaptation ».
L’humanité en sortant de l’Afrique et en s’adaptant aux différents climats de la terre a donné naissance aux différentes races. Si l’homme n’était sorti du continent berceau de son humanité, il n’y aurait pas de différenciation, l’humanité serait homogène et noire car le reste du monde ne serait habité.
C’est un négroïde qui a donné naissance aux races les tests ADN (Acide Désoxyribo Nucléique) qui constitue la molécule support de l’information génétique l’ont prouvé. Ne pas confondre ce sigle avec les noms et prénom de votre serviteur.
La race est une notion géographique. Pourquoi n’était-il pas possible que l’homme naisse ailleurs qu’en Afrique ? Les théories des paléontologues s’affrontent sur le cas, ceux qui sont partisans du mono-génétisme, que l’homme serait d’une même espèce, celle du polycentrisme qui voudrait que par plusieurs évolutions l’homme ait vécu à tous les coins du globe.
Cheikh Anta Diop ne s’est pas contenté de prouver que l’homme est parti d’Afrique mais que c’est cette même Afrique qui a civilisé le monde des millénaires avant la Grèce et Rome à travers l’Egypte. Une Egypte nègre à l’image des fresques représentants les races sur tombeau de Ramsès II.
Ainsi, la pensée religieuse serait partie de l’Afrique, c’est un pharaon qui a dit que Dieu est un et qu’on ne doit pas le représenter par une image, à une époque bien avant Moise et la bible de Jésus. Ce pharaon Iknadon avait six filles avec la reine Néfertari.
Jusque sous la 18eme dynastie, la civilisation égyptienne va jouer en Afrique, le même rôle joué des siècles après par la Grèce en occident. Cheikh Anta, estimait que pour recréer un corps de science humaine et mieux connaitre la place centrale de l’Afrique à l’échelle du monde, il faut nous faut repartir de l’Egypte pour réconcilier les civilisations africaines avec l’histoire.
Il nous faut certes apprendre l’histoire des autres, mais connaissons-nous d’abord, parce quand un peuple perd sa mémoire historique il devient fragile. La conscience historique permet à un peuple de devenir fort et nous devons la vivifier souligne le professeur qui dit que, « la plénitude culturelle doit faciliter la fraternité des races ».
ADN
Cridem
Musique, maestro : Malouma, une diva citoyenne
VIDÉO. La chanteuse mauritanienne ne se contente pas de chants avec de belles mélodies. Elle leur ajoute une dimension sociale engagée.
En 2011, Malouma Mint Meïddah avait été élevée au rang de chevalier à l’ambassade de France à Nouakchott, en Mauritanie. Cette fois, en mai dernier, c’est après avoir fait vibrer le festival Arabesques qu’elle a été distinguée à Montpellier. Désormais, elle est citoyenne d’honneur du département français de l’Hérault. De bon augure sur son chemin du “partage” avec le public qu’elle ne voit pas seulement comme une source de revenus dans son art.
Chanter est un besoin
À 54 ans, née d’une famille griotte, iggiw, Malouma n’a jamais voulu être la griotte de… Si elle chante, c’est parce qu’elle en ressent le besoin. L’envie de nommer des choses. Ses cordes vocales, elle les sollicite dans les chants depuis qu’elle a 6 ans. Théâtre de ses premières poussées vocales : Charatt, près de Mederdra, dans le Trarza. Sous les conseils de son père Moktar Ould Meïddah, une des mémoires de la musique maure traditionnelle, elle façonne des strophes et mélodies à son image. Les armes faites, la voilà qui se lance pour tracer son sillon avec un timbre de voix qui lui est bien propre.
Chanter, une manière de faire bouger la société
Et elle sait se faire entendre, Malouma, même s’il faut en payer un prix parfois bien élevé. Par le biais d’une audace peu commune, elle fait entendre aux politiques les maux du peuple, à la société conservatrice, elle jette des défis. Censure et mise à l’écart ne manquent pas d’essayer de la bousculer, mais cette diva du désert n’en a cure et ne laisse rien entamer sa détermination. Ainsi du jour où elle a entonné dans les années 1990 la chanson “Habibi Habaytou”. Ce chant, fredonné comme une berceuse sous les tentes, est un hymne à l’amour sans gant : “Mon ami, je l’aime. Oui, je l’ai aimé. Il m’a marquée”, dit-elle dans cette chanson. Les critiques fusent. La chanteuse est traitée de folle. On veut la marginaliser. Loin d’abdiquer, elle récidive avec un chant condamnant le divorce. Explication : il s’agit là d’une pratique un peu trop répandue dans la société maure, et au seul profit de l’homme qui en abuse par des remariages.
Derrière la chanteuse, une citoyenne engagée
Aujourd’hui encore, dans Knou, son dernier album, elle parle encore des charmes et tares de ce qui l’entoure. Toujours pour les justes et nobles causes : l’égalité et l’État de droit pour tous, la place de la femme et l’éducation des jeunes qui risquent de tomber dans des mains destructrices de leur avenir… À ces plaidoiries, elle ajoute la défense de l’environnement. Autant de thématiques qui perlent l’album, plus que jamais à son image. Knou, dit Malouma, est la danse qui a marqué et accompagné son adolescence, l’a bercée. Elle a eu alors envie de rendre hommage à la beauté de la danse en même temps qu’aux femmes qui la pratiquent qu’elles trouvent sublimes. Un clin d’oeil aussi aux diversités de la Mauritanie, qu’elle défend, puisque knou est une esthétique de l’est du pays, alors qu’elle est de l’Ouest.
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’au-delà du social elle y flirte avec la politique. De quoi comprendre son incursion comme sénatrice du Rassemblement des forces démocratiques (opposition). “J’utilise ma présence et mon temps de parole dans cette chambre pour prolonger mes textes, mes chants. À chaque passage de ministres, ou d’une personnalité importante, je dis l’attente du peuple”, confie-t-elle.
Knou, l’art sublimé côtoie la vie
Pour cet album, la chanteuse a travaillé avec le peintre Sidi Yahia. Celui-ci a installé son atelier dans la fondation de sa complice pour être auprès du souffle de la voix de cette diva, pinceau à la main. Chacune des 11 chansons a eu droit à une sublime illustration que surmonte l’ardin, instrument singulièrement mauritanien, qui dompte complaintes et murmures des nuits de douceur. Après “Goueyred”, conçue sur un couplé avec son père et inspirée du poète Mohamed Ould Youra, Malouma nous tient par l’oreille pour “Mektoub”, où elle fustige le chômage et le désespoir de la jeunesse. Un cri d’indignation, entre le luxe insolent des uns et la quête de survie des autres. Deux pistes après, on suit la pente glissante avec “Dahar”, sur le Printemps arabe, les mouvements migratoires en Afrique et ailleurs, avec leurs lots d’incertitudes et de drames. Des paroles entre conseils et désespoirs. “L’islam est une belle religion”, souligne l’auteur de “Zemendour”. Malheureusement, aujourd’hui, celui-ci est instrumentalisé. Ce qui dénature son contenu d’amour et de paix et porte préjudice à ceux qui le pratiquent”, explique-t-elle. Il y a aussi cette mise à l’index de l’insouciance et de la cruauté de l’homme.
Un souffle de modernité
Dans “Menn Mina”, Malouma Mint Meïddah défend l’environnement. Suffisamment bien pour qu’une maison d’édition canadienne lui fasse part de sa volonté de la publier autant dans un livre et un guide scolaire que sous un format numérisé sur iPad. Il convient de rappeler qu’une autre chanson, “Nour”, fait depuis quelques années le bonheur des écoliers marseillais. L’album se clôture par un bonus, rencontres de voix et d’instruments entre la diva et le pianiste hollandais Mike del Ferro, qui a joué avec la Libanaise Fairouz. Puis, puis Achikna et ses entraînantes chaloupées amoureuses dédiées à Mohamed Ould Taleb, qu’on surnomme l’émir des poètes. Modernité et tradition se côtoient de plus en plus dans le répertoire de Malouma, une diva qui se voit comme une citoyenne avant tout.
Par NOTRE CORRESPONDANT À NOUAKCHOTT, BIOS DIALLO
REGARDEZ Malouma en diva “rockeuse”
https://www.youtube.com/watch?v=1oVbXLp-7fY
Source: le calame
Contribution : La Mauritanité ! Qu’en dit l’histoire ?
 L’opération actuelle d’enrôlement, il semble qu’il s’agisse de cela, plutôt que d’un recensement, la précision est apportée par Mohamed Ould Abdel AZIZ lui même qui doit s’y connaître, ne tient compte ni de notre histoire, ni de notre géographie, ni même de notre géopolitique encore moins de la fragile alchimie (de peuplement ou population) léguée par nos ainés. C’est pourquoi, il nous a semblé utile de rafraichir notre mémoire collective sur la construction toute récente de notre pays afin d’aider à mieux comprendre pourquoi nos populations portent naturellement les mêmes noms de familles du Sahara, du Sénégal, du Mali, du Maroc, de l’Algérie et bien d’autres pays dont des citoyens ont fait le choix d’être des nôtres. Il nous semble, donc, risqué de parler de noms de familles courants.
L’opération actuelle d’enrôlement, il semble qu’il s’agisse de cela, plutôt que d’un recensement, la précision est apportée par Mohamed Ould Abdel AZIZ lui même qui doit s’y connaître, ne tient compte ni de notre histoire, ni de notre géographie, ni même de notre géopolitique encore moins de la fragile alchimie (de peuplement ou population) léguée par nos ainés. C’est pourquoi, il nous a semblé utile de rafraichir notre mémoire collective sur la construction toute récente de notre pays afin d’aider à mieux comprendre pourquoi nos populations portent naturellement les mêmes noms de familles du Sahara, du Sénégal, du Mali, du Maroc, de l’Algérie et bien d’autres pays dont des citoyens ont fait le choix d’être des nôtres. Il nous semble, donc, risqué de parler de noms de familles courants.
La Mauritanie n’est pas une île. Elle n’est pas non plus un No Man’s Land. Elle est le reflet de ses voisins, avec une personnalité propre, qui s’enrichit continuellement.
Par sa position géographique, à mi chemin entre l’Afrique noire et le Maghreb, la Mauritanie est un carrefour d’échanges et de cultures, un melting pot. Sa création par la France coloniale répondait à un triple objectif : Relier ses protectorats du Nord (Maghreb) à ses colonies du Sud (AOF et AEF), limiter l’influence Espagnole au seul Sahara et contrecarrer l’idée du «Grand Maroc».
La création de la Mauritanie
Le nom de la Mauritanie n’apparait officiellement que le 27 décembre 1899 par décision ministérielle qui délimitait un territoire qui englobe les régions s’étendant de la rive droite du fleuve Sénégal et de la ligne entre Kayes et Tombouctou, jusqu’aux confins du Maroc et de l’Algérie. Cette décision ministérielle et le choix du nom ont été inspirés par Xavier COPPOLANI.
En 1900, la première limite du Territoire fut fixée à travers un tracé théorique délimitant les zones d’influences franco – espagnoles au Nord. Le 10 avril 1904, par arrêté, tous les territoires situés sur la rive droite du fleuve Sénégal sont rattachés aux protectorats des pays Maures. Paradoxalement, la fracture entre Maures et Noirs de la vallée du Fleuve sera « officialisée » par les arrêtés n°469 et 470 du 20 août 1936 qui organisaient séparément les commandements et administrations : une administration indirecte chez les « indigènes maures », avec des émirs dépendant désormais de l’administration coloniale ; et une administration directe chez les populations sédentaires noires, avec la création de cantons dont les chefs étaient auxiliaires de police judiciaire et percepteurs des impôts.
Ce mode de gestion séparée est renforcé par la mise en place d’un système éducatif différencié. En effet l’administration coloniale, pour asseoir son autorité, affirme son intérêt pour l’institution scolaire en vue d’une plus grande emprise sur les populations autochtones. Dans sa circulaire du 22 juin 1897, le Gouverneur Général E. CHAUDIE écrit : « l’école est le moyen le plus sûr qu’une nation civilisatrice ait d’acquérir à ses idées les populations encore primitives». « C’est elle (l’école) qui sert le mieux les intérêts de la cause française » ajoutera le Gouverneur Général William PONTY dans une circulaire du 30 août 1910, comme pour confirmer les propos de son prédécesseur.
Simplement, l’implantation de cette école en Mauritanie se fera, et pendant longtemps, dans le Sud : Kaédi en 1898, Boghé en 1912…., alors que les Médersas le seront seulement à partir de 1916 à Boutilimit, puis à Atar en 1936…., en raison notamment de l’hostilité affichée en pays Maures. C’est ce qui explique qu’à l’accession de notre pays à sa souveraineté le 28 novembre 1960, l’essentiel des cadres et des lettrés en langue française sont du Sud.
Enfin, le décret du 5 juillet 1944 rattache la région du Hodh, jusqu’alors sous dépendance du Soudan (actuel Mali), à la Mauritanie. Ce rattachement revêt un cachet sécuritaire, l’administration cherchant à neutraliser le mouvement Hamalliste (Cheikh Hamahoullah) dans cette région.
En lieu et place des Émirats (Adrar, Trarza, Brakna, Tagant) et des États du Sud (Guidimakha, Waalo, Fouta Tooro) se substitue et se superpose le futur État de Mauritanie. Jusqu’au 2 juin 1946, le nom de la Mauritanie continuera d’être associé, jumelé avec celui du Sénégal sous l’appellation de « Circonscription Mauritanie – Sénégal » et Saint Louis du Sénégal restera capitale de la Mauritanie jusqu’à la veille de l’indépendance. On comprend dès lors que bon nombre de Mauritaniens soient nés au Sénégal.
Tel est le contexte historique et politique dans lequel a été enfantée la Mauritanie actuelle, regroupant Sooninko, Wolofs, Maures, Bambaras, Haratines et Haal Pulaar en qui vont devoir désormais vivre sur un même territoire unifié et placés sous une même autorité. Il va s’en dire que pour présider aux destinées de notre pays, il vaut mieux connaître ce contexte et tenir compte de toutes les pièces du puzzle. Le prix à payer pour les fils de notre pays, maures comme noirs, sera énorme.
Les clefs de ce nouvel ensemble, fraichement créé, encore fragile, ont été confiées à Mokhtar Ould DADDAH. Si celui-ci appelait à construire ensemble la nation mauritanienne, sa conduite des affaires sera très tôt considérée comme partisane. Il va notamment opter pour une politique d’arabisation du système éducatif qui sera perçue par les uns comme un acte de souveraineté et de « repersonnalisation », et par les autres comme une mesure d’exclusion et d’assimilation. Car l’objectif à peine voilé de cette décision politique était de procéder à un rattrapage de l’avance prise par les noirs, surreprésentés dans l’appareil d’Etat, aux yeux des courants pan arabistes.
Le calcul politique qui sous-tendait cette mesure, les conditions de son application, la mauvaise gestion des conséquences de cette application en termes de contestation cristalliseront toutes les frustrations et « pollueront » pour ainsi dire le climat politique de notre pays. La brèche ouverte depuis est devenue un fossé, si grand aujourd’hui qu’il fait courir à notre pays le risque de conflits à répétitions.
Est-il possible d’éviter à notre pays un futur incertain ?
Les mauritaniens peuvent-ils s’arrêter un instant pour s’accorder sur l’essentiel en vue de construire un destin commun ? Quel modèle pour la Mauritanie : Etat unitaire, Etat fédéral ? Ancrage dans le monde Arabe ou dans l’Afrique noire ? Trait d’union ?
Nous verrons dans notre prochaine livraison que, dès 1946 lors des premières élections législatives dans le cadre de l’Union Française, la question était déjà posée. En 1945, en prévision de ces élections, deux tendances s’étaient dessinées : Chez les Maures « le représentant de la Mauritanie ne saurait être un noir » tandis que les notables noirs, inquiets, font appel à une candidature européenne (source : Sous – série : 2G45 : 134, Archives Nationales du Sénégal).
Quoi qu’il en soit, nul ne peut gouverner paisiblement notre pays en méconnaissance totale de son histoire ou au mépris de celle-ci, faite de recompositions, de brassages, de mélanges de sociétés si différentes que tout éloignait au début, mais qu’il faut désormais administrer harmonieusement selon un principe si simple de justice et d’égalité, non pas de principe, mais d’égalité effective.
Ciré BA etBoubacar DIAGANA – Paris, août 2011.
L’immigration est un désastre pour l’ Afrique et sa jeunesse, selon l’artiste ivoirien Ismaël Isaac
 L’artiste musicien ivoirien, Ismaël Isaac, a exhorté, mardi, la jeunesse africaine à éradiquer l’immigration pour le développement du continent, estimant c’est ‘’ un désastre pour l’Afrique et sa jeunesse’’.
L’artiste musicien ivoirien, Ismaël Isaac, a exhorté, mardi, la jeunesse africaine à éradiquer l’immigration pour le développement du continent, estimant c’est ‘’ un désastre pour l’Afrique et sa jeunesse’’.
Dans son nouvel album de 14 titres intitulé « Je reste », à travers le titre ‘’Lampedusa” en référence au naufrage de centaines africains sur cette île italienne, le reggae-man ivoirien crie sa douleur face à ce qu’il considère comme un « gâchis » pour l’Afrique.
« L’immigration est un désastre pour l’Afrique et sa jeunesse. J’ai personnellement été touché par ce phénomène parce que j’ai un proche dont on n’a toujours pas de nouvelles depuis sa tentative d’immigrer en Europe alors qu’il était pétri de diplômes. Prendre la pirogue pour aller mourir dans la mer, je dis non », a-t-il dénoncé.
Produit par le groupe Canta production, cet album a été réalisé entre Abidjan, Paris et Londres aux standards internationaux et enregistré entièrement en live. « Je reste » a mobilisé plus de 35 musiciens, techniciens et arrangeurs de sons.
De son vrai nom, Issiaka Diakité, c’est en 1990 que Ismaël Isaac enregistre son premier album intitulé ‘’Rahman” puis ‘’Treich feeling” en 1997, ‘’Black système” en 2000 avant de sortir cette année ‘’Je reste”, album avec lequel, l’artiste souhaite donner une dimension internationale à sa carrière.
Source: seneweb
Du Mali à la Syrie, des oppositions religieuses montées en épingle Pour une analyse profane des conflits
Peut-on comprendre la guerre au Mali si l’on fait l’impasse sur la difficile survie des tribus qui peuplent le vaste désert du Sahara ? Que le drapeau des rebelles soit celui de l’islamisme radical ne change rien aux données profanes, économiques, sociales et politiques qui, là comme au Liban, en Irak, en Iran ou en Palestine, constituent le terreau des affrontements et des crises.
par Georges Corm, février 2013
Nous avons changé d’époque. A la période où l’on condamnait, à l’Ouest, la subversion communiste encouragée par Moscou et où l’on célébrait, à l’Est, la lutte des classes et l’anti-impérialisme a succédé celle qui convoque les luttes de communautés religieuses ou ethniques, voire tribales. Cette nouvelle grille de lecture a acquis un crédit exceptionnel depuis que le politologue américain Samuel Huntington a popularisé, il y a plus de vingt ans, la notion de « choc des civilisations », expliquant que les différences de valeurs culturelles, religieuses et morales étaient à la source de nombreuses crises. Huntington ne faisait que redonner vie à la vieille dichotomie raciste, popularisée par Ernest Renan au XIXe siècle, entre le monde aryen, supposé civilisé et raffiné, et le monde sémite, considéré comme anarchique et violent.
Cette invocation de « valeurs » encourage un retour à des identités primaires que les grandes vagues successives de modernisation avaient fait reculer et qui, paradoxalement, reviennent en grâce avec la mondialisation, l’homogénéisation des modes de vie et de consommation, ou encore les bouleversements sociaux provoqués par le néolibéralisme, dont sont victimes de larges couches de population dans le monde. Elle permet une mobilisation des opinions publiques à l’échelle internationale en faveur de l’une ou l’autre des parties d’un conflit, mobilisation fortement aidée par la permanence de certaines traditions universitaires imprégnées d’un essentialisme culturel hérité des visions coloniales.
Alors que le libéralisme laïque à la mode européenne et l’idéologie socialiste, qui s’étaient répandus hors d’Europe, semblent s’être tous deux évanouis, les conflits sont réduits à leur dimension anthropologique et culturelle. Peu de journalistes ou d’universitaires se préoccupent de maintenir un cadre d’analyse de politologie classique, qui prenne en compte les facteurs démographiques, économiques, géographiques, sociaux, politiques, historiques et géo-politiques, mais aussi l’ambition des dirigeants, les structures néo-impériales du monde et les volontés de reconnaissance de l’influence de puissances régionales.
En règle générale, la présentation d’un conflit fait abstraction de la multiplicité des facteurs qui ont entraîné son déclenchement. Elle se contente de distinguer des « bons » et des « méchants » et de caricaturer les enjeux. Les protagonistes se verront désignés par leurs affiliations ethniques, religieuses et communautaires, ce qui suppose une homogénéité d’opinions et de comportement à l’intérieur des groupes ainsi désignés.
Les signes avant-coureurs de ce type d’analyse sont apparus durant la dernière période de la guerre froide. C’est ainsi que dans le long conflit libanais, entre 1975 et 1990, les divers acteurs ont été classés en « chrétiens » et « musulmans ». Les premiers étaient tous censés adhérer à un regroupement dénommé Front libanais, ou au parti phalangiste, formation droitière de la communauté chrétienne ; les seconds étaient réunis dans une coalition dénommée « palestino-progressiste », puis « islamo-progressiste ». Cette présentation caricaturale ne s’embarrassait pas du fait que de nombreux chrétiens appartenaient à la coalition anti-impérialiste et anti-israélienne, et soutenaient le droit des Palestiniens à mener des opérations contre Israël à partir du Liban, alors que bien des musulmans y étaient hostiles. En outre, le problème posé au Liban par la présence de groupes armés palestiniens, et par les représailles israéliennes violentes et massives que subissait la population, était de nature profane, sans relation aucune avec les origines communautaires des Libanais.
Généralités creuses et stéréotypes
Au cours de la même période, il se produisit d’autres manipulations des identités religieuses qui ne furent nullement dénoncées par les analystes spécialisés et les grands médias. Ainsi, la guerre d’Afghanistan, provoquée par l’invasion soviétique de décembre 1979, devait donner lieu à une mobilisation de « l’islam » contre des envahisseurs qualifiés d’athées, et occulter la dimension nationale de la résistance. Des milliers de jeunes musulmans de toutes nationalités, mais principalement arabes, furent entraînés et radicalisés sous la houlette américaine, saoudienne et pakistanaise, créant ainsi le contexte favorable au développement d’une Internationale islamiste djihadiste qui perdure.
De plus, la révolution iranienne de janvier-février 1979 fut à l’origine d’un malentendu géopolitique majeur, les puissances occidentales pensant que le mieux, pour succéder au chah et éviter un gouvernement à coloration bourgeoise nationaliste (sur le modèle de l’expérience menée par Mohammad Mossadegh au début des années 1950), ou socialisant et anti-impérialiste, serait l’arrivée au pouvoir de dirigeants religieux. L’exemple de deux Etats très religieux, l’Arabie saoudite et le Pakistan, étroitement alliés aux Etats-Unis, leur fit présumer que l’Iran serait lui aussi un partenaire fidèle, et tout aussi résolument antisoviétique.
Par la suite, la grille d’analyse changea. La politique anti-impérialiste et propalestinienne de Téhéran fut dénoncée comme « chiite », antioccidentale et subversive, en opposition à une politique sunnite qualifiée de modérée. Susciter une rivalité entre sunnites et chiites, et accessoirement entre Arabes et Perses — piège dans lequel Saddam Hussein fonça tête baissée en attaquant l’Iran en septembre 1980 —, devint une préoccupation majeure des Etats-Unis, davantage encore après l’échec de leur invasion de l’Irak en 2003, qui débouchera finalement sur un accroissement de l’influence iranienne (1).
Toute une littérature politique et médiatique invoque désormais le danger représenté par un croissant dit « chiite », constitué par l’Iran, l’Irak, la Syrie et le Hezbollah libanais, qui tenterait de déstabiliser l’islam sunnite, pratiquerait le terrorisme et serait animé par la volonté d’éliminer l’Etat d’Israël. Personne ne pense à rappeler que la conversion d’une partie des Iraniens à l’islam chiite ne remonte qu’au xvie siècle, et qu’elle fut encouragée par la dynastie des Safavides pour mieux s’opposer à l’expansionnisme ottoman (2). On feint également d’ignorer que l’Iran a toujours été une puissance régionale majeure, et que le régime ne fait que poursuivre, sous de nouveaux oripeaux, la politique de grandeur du chah, qui se voulait le gendarme du Golfe — et qui avait, lui aussi, de fortes ambitions nucléaires, encouragées alors par la France. Malgré ces données historiques profanes, tout, au Proche-Orient, est désormais analysé en termes de « sunnites et chiites ».
Depuis le déclenchement des révoltes dans le monde arabe, début 2011, le jeu de la simplification continue. A Bahreïn, les manifestants sont décrits comme des « chiites » manipulés par l’Iran contre les gouvernants sunnites. C’est oublier les citoyens de confession chiite partisans du pouvoir en place, comme ceux de confession sunnite qui sympathisent avec la cause des opposants. Au Yémen, la révolte houthiste (3) des partisans de la dynastie royale qui a longtemps gouverné ce pays n’est vue que comme un phénomène « chiite », dû exclusivement à l’influence de l’Iran.
Au Liban, en dépit des oppositions qu’il peut susciter au sein de la communauté chiite, et, à l’inverse, de la popularité qu’il a acquise auprès de nombreux chrétiens et musulmans de diverses confessions, y compris des sunnites, le Hezbollah est considéré comme un simple instrument aux mains des ambitions iraniennes. On passe sous silence le fait que ce parti est né de l’occupation par Israël, entre 1978 et 2000, d’une large partie du sud du pays, peuplée majoritairement de chiites ; occupation qui aurait sûrement perduré sans sa résistance acharnée.
Par ailleurs, que le Hamas à Gaza soit un pur produit « sunnite », issu de la mouvance des Frères musulmans palestiniens, ne dérange guère les analystes qui soutiennent le sunnisme « modéré » : ce mouvement doit être dénoncé, puisque les armes fournies sont d’origine iranienne et destinées à lever le blocus du territoire par Israël.
En bref, la nuance est partout absente. Les situations d’oppression ou de marginalité socio-économiques sont passées sous silence. Les ambitions hégémoniques des parties en conflit n’existent pas : il y a des puissances bienfaisantes et d’autres malfaisantes. Des communautés aux opinions et aux comportements diversifiés sont caractérisées au moyen de généralités anthropologiques creuses et d’essentialismes culturels stéréotypés, alors même qu’elles ont vécu durant des siècles dans une forte interpénétration socio-économique et culturelle.
De nouveaux concepts ont envahi les discours : en Occident, les « valeurs judéo-chrétiennes » ont succédé à l’invocation de nature laïque de racines « gréco-romaines ». De même, la promotion de « valeurs, spécificités et coutumes musulmanes », ou « arabo-musulmanes », a succédé aux revendications anti-impérialistes, socialisantes et « industrialisantes » du nationalisme arabe d’inspiration laïque, qui avait longtemps dominé la scène politique régionale.
Désormais, les valeurs individualistes et démocratiques que prétend incarner l’Occident sont opposées aux valeurs supposées exclusivement holistes, « patriarcales et tribales » de l’Orient. Déjà, naguère, de grands sociologues européens avaient estimé que les sociétés bouddhistes n’accéderaient jamais au capitalisme industriel, basé sur les valeurs censément très spécifiques du protestantisme…
Dans la même veine, la question palestinienne n’est plus perçue comme une guerre de libération nationale, qui pourrait être résolue par la création d’un seul pays où vivraient sur un pied d’égalité juifs, chrétiens et musulmans, comme l’a longtemps réclamé l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) (4). Elle est considérée comme un refus arabo-musulman opposé à la présence juive en Palestine, et donc, pour beaucoup de bons esprits, comme le signe d’une permanence de l’antisémitisme contre laquelle il faudrait sévir. Un peu de bon sens suffit pourtant pour comprendre que si la Palestine avait été envahie par des bouddhistes, ou si la Turquie postottomane avait voulu la reconquérir, la résistance aurait été tout aussi constante et violente.
Au Tibet, au Xinjiang, aux Philippines, dans le Caucase sous domination russe, en Birmanie, où l’on vient de découvrir l’existence d’une population musulmane en conflit avec ses voisins bouddhistes et désormais au Mali, mais aussi dans l’ex-Yougoslavie démembrée sur des lignes communautaires (Croates catholiques, Serbes orthodoxes, Bosniaques musulmans), en Irlande (divisée entre catholiques et protestants) : dans toutes ces régions, les conflits peuvent-ils vraiment être perçus comme l’affrontement de valeurs religieuses ? Ou sont-ils, au contraire, profanes, c’est-à-dire ancrés dans une réalité sociale dont nul ne se soucie plus guère d’analyser la dynamique, tandis que de nombreux dirigeants communautaires autoproclamés y trouvent l’occasion de réaliser leurs ambitions ?
L’instrumentalisation des identités dans le jeu des grandes et des petites puissances est vieille comme le monde. On avait pu croire que la modernité politique et les principes républicains qui se sont diffusés sur la planète depuis la Révolution française avaient durablement installé la laïcité dans la vie internationale et dans les rapports entre les Etats ; or il n’en est rien. On assiste à la montée des prétentions de certains Etats à se faire les porte-parole de religions transnationales, en particulier pour ce qui est des trois grandes religions monothéistes (judaïsme, christianisme et islam).
Des sanctions à géométrie variable
Les Etats qui se saisissent du religieux le mettent au service de leur politique de puissance, d’influence et d’expansion. Ils justifient ainsi la non-application des grands principes des droits humains définis par les Nations unies, l’Occident entérinant l’occupation continue des territoires palestiniens depuis 1967, et certaines puissances musulmanes acceptant les flagellations, lapidations, mains coupées aux voleurs. Les sanctions appliquées aux contrevenants au droit international varient elles aussi : châtiments sévères imposés par la « communauté internationale » dans certains cas (Irak, Iran, Libye, Serbie, etc.), absence totale de simple réprimande dans d’autres (occupation israélienne, régime de détention américain à Guantánamo).
Faire cesser cette instrumentalisation et les analyses simplistes qui visent à dissimuler la réalité profane des conflits constitue un impératif urgent, notamment au Proche-Orient, si l’on veut parvenir à apaiser cette région tourmentée.
Georges Corm
Ancien ministre libanais, auteur de Pour une lecture profane des conflits, La Découverte, Paris, 2012.





