Category Archives: presse
DÉBAT SUR LA TRANSCRIPTION DE NOS LANGUES NATIONALESLet’s be real, Mister Sakho !

DÉBAT SUR LA TRANSCRIPTION DE NOS LANGUES NATIONALESLet’s be real, Mister Sakho !Par Dr Mouhamadou Sy dit Pullo Gaynaako Ainsi donc rouvre le débat sur la transcription des langues non arabes de Mauritanie. Un débat conclu et clos depuis bientôt soixante ans, mais qu’une classe d’idéologues, en Mauritanie, continue de soulever pour la simple raison que la conclusion, pourtant basée sur une expertise bien solide, ne satisfait pas son idéologie conquérante. Il y a moins de deux ans, Pr Ely Moustapha soulevait la même question et prônait, avec beaucoup de méprises sur l’histoire récente de ces langues et leur lutte, et surtout du mépris, volontaire ou par mégarde, à l’égard des communautés concernées et les acteurs de cette lutte, la transcription des dites langues en caractères arabes plutôt que les caractères latins adoptés à la conférence de Bamako. Il y a quelques jours l’on a appris qu’une commission gouvernementale a été mise en place pour veiller à l’application de l’article 6 de la constitution. Le contenu de cet article définit les langues Arabe, Pulaar, Soninké et Wolof comme nationales et promeut l’Arabe à un statut officiel exclusif. À la tête de cette commission se trouve Monsieur Abou Sow, ancien ministre et fervent défenseur de la transcription des langues nationales en caractères arabes. Ce qui frappe dans cette commission c’est déjà l’absence des acteurs reconnus, pour leur compétence et leur dévouement, de la promotion des langues nationales, à commencer par ceux liés de près ou de loin au défunt institut des langues nationales. Comment pourrait cela s’expliquer si ce n’est par un souci de faire passer sans résistance aucune un projet d’empoisonnement de la lutte des langues non arabes du pays ? Il y a plusieurs choses à dire sur cette commission et sur l’article 6 lui-même et son injustice primordiale de laquelle découlent toutes les autres, mais nous y reviendrons une autre fois.La question de la transcription a ainsi inévitablement refait surface à la suite de l’annonce de cette commission et de son programme. Et cette fois, c’est Monsieur Moctar Sakho, dont je viens d’entendre le nom – et je ne le précise que par souci d’exactitude – qui dit nous appeler au « pragmatisme », à la « franchise » et au « réalisme », notamment par la formule « Let’s be real » martelée en point final de son texte. S’il n’y voit pas d’inconvénient, je me permets de la réutiliser. Car en effet, il faut bien être tout cela et regarder la question en face. Sur ce point, Monsieur Sakho, nous sommes vraiment d’accord. Et, il faut surtout analyser les données du problème de façon objective et méticuleuse et non se limiter aux impressions impulsives.Le texte de Monsieur Sakho recycle principalement le fameux argument coranique, dans une saveur qui se veut nouvelle.Tout d’abord, il prétend que l’apprentissage du coran est le point de départ de l’expérience scolaire des enfants mauritaniens, et donc cela peut servir de justification à la décision de changer de transcription en faveur des caractères arabes. En réalité, Monsieur Sakho, il n’en est rien ! les enfants mauritaniens ne commencent pas leur aventure scolaire par l’apprentissage du coran. Que faites-vous de la matrice culturelle et linguistique qui a accueilli ces enfants, à leur naissance, qui les a vu grandir, et qui a forgé les bases d’un certain nombre de leurs fonctions cognitives fondamentales ? Vous allez à l’encontre d’un nombre considérable de résultats scientifiques sur le développement cognitif de l’enfant et son apprentissage en tenant de tels propos. L’école, dans son sens qui sied à ce contexte, commence donc bien avant le coran ; c’est d’ailleurs ainsi que l’apprentissage même du coran utilise les acquis de cette école primordiale dans sa méthode mnémotechnique bien connue chez nous. Par conséquent, ce sont des enfants qui ont déjà expérimenté les vestiges d’une école traditionnelle et ayant subi l’encadrement de diverses institutions sociales, incluant des notions dans divers métiers, qui arrivent chez le maître coranique. En omettant cette réalité qui est loin d’être anodine, vous répliquez les erreurs du système qui a produit les échecs scolaires qui semblent vous préoccuper. Ensuite, vous affirmez, toujours dans le but de défendre une transcription arabe, que ‘notre culture quotidienne est largement arabo-musulmane’. Il faut avouer qu’il y a une certaine ambigüité dans cette affirmation. Mais comme l’on parle des langues non arabes de la Mauritanie, il est logique de considérer qu’elle se rapporte aux communautés non arabes du pays. Elle devient alors tout à fait erronée.Ce qui fait le socle de leur culture quotidienne n’est en aucun cas d’essence arabo-musulmane, ni linguistiquement, ni sociologiquement. Et dire ceci n’est pas nier les influences bien réelles que la culture islamique a sur ces communautés, mais c’est uniquement le faire avec mesure. Affirmer avec aisance une telle contre-vérité scientifique dont le contraire est vérifiable, autant à l’observation de la société en question qu’à la consultation de la vaste littérature de recherche qui lui est consacrée, est tout juste indigne de quelqu’un qui prétend faire une proposition d’une certaine clairvoyance scientifique. Vous nous avez appelés à la raison, en utilisant la malencontreuse formule de Senghor. Ce que, personnellement, je trouve très irrespectueux et mal placé. Tout de même, j’apprécie beaucoup l’invitation en tant que telle. Nous sommes ici précisément sur un terrain strictement rationnel. Vous ne serez certainement pas contre que nous adoptions une attitude logique vis-à-vis de la question, vu que vous l’avez vous-même demandé. Donc je suppose que vous êtes à l’aise.Vous dites avoir basé votre réflexion sur votre propre expérience. Expliquez nous alors comment votre expérience de praticien des langues vous a mené à la conclusion qu’en Mauritanie, toutes les langues devraient utiliser les caractères arabes. Avez-vous déjà été confronté à ces problématiques ? Mieux, avez-vous mené des études dont les résultats l’ont suggérée ? Si de l’expertise il y est, il ne suffirait tout de même pas de réclamer une profession pour la faire s’exprimer ; il faudrait, à la place, fournir des arguments solides qui relient vos observations à la théorie que vous en faites. Tout ceci en gardant à l’esprit que, sans une étude à grande échelle, ces observations personnelles n’auront que la valeur épistémique très limitée qu’un témoignage peut avoir. En tout cas, ce serait ainsi ; si jamais l’on décidait de faire les choses avec raison, comme vous le réclamez. Maintenant que nous avons discuté de la faiblesse des arguments principaux du texte de Monsieur Sakho, il convient d’exposer ceux qui sous-tendent la position opposée. Contrairement à ce que laisse penser un passage du texte de Sakho, l’argument des partisans de la continuation des caractères latins n’est pas basé sur le seul fait que l’UNESCO les reconnaît. Il y a des raisons de nature scientifique qui font qu’ils sont préférables aux caractères arabes, en plus des raisons culturelles, géographiques et programmatiques bien solides. Il y a deux ans, dans le contexte du même débat, il a été exposé le fait vérifiable, basé sur une analyse comparative des sons fondamentaux du Pulaar et ceux du Français et de l’Arabe, que le Pulaar partageait avec le Français 70,97% de ses sons fondamentaux contre 51,61% de sons partagés avec l’Arabe. Un an plus tard, dans une étude statistique sur l’utilisation relative des lettres Pulaar dans sa production écrite, j’ai pu calculer les fréquences d’utilisation de chaque lettre. Je tiens à préciser que l’étude n’était en aucune manière motivée par ce débat. D’ailleurs, qui l’a déjà lu peut, tout au plus, témoigner des motivations cryptanalytiques. C’est bien plus tard que j’ai fait la remarque évidente que ces données peuvent, en fait, raffiner l’observation basique faite ci-haut sur le rapport des sons. On trouve en fait que les sons du Pulaar extra-latins ne sont utilisés qu’à hauteur de 4,34%, ce qui veut dire que les 70,97% des sons que le Pulaar partage avec le Français expriment déjà 95,66% de la production écrite du Pulaar. La même observation montre que 72,65% de cette production est exprimée par les sons arabes. La différence est donc de 23,01% en faveur du Français, et des caractères latins donc ! Vous vouliez de la raison ? Elle est là exprimée par les chiffres et par la méthode dépourvue des sentiments. Reste à savoir ce que vous voudrez rationnellement qu’on en fasse !Rien qu’à ce niveau, on voit donc l’avantage phénoménal que les caractères latins ont sur ceux arabes dans le contexte de la transcription du Pulaar. La même conclusion devrait s’appliquer aux autres langues concernées vu leur parenté avec le Pulaar.Les autres arguments qu’il ne faudrait pas négliger non plus comprennent la standardisation : on ne peut pas sérieusement soutenir que des langues transfrontalières comme celles dont on parle adoptent une transcription différente selon la géographie. Cela constituerait un frein sérieux à leur développement qu’aucune solution nationale ne pourra résorber. Là aussi, let’s be real et pensons convenablement la question. La nature transfrontalière de ces langues et les peuples qui les parlent est un fait qui se passe de toute discussion et vouloir la tronquer pour satisfaire les caprices d’une idéologie est un manque de sérieux inouï qui, dans de conditions normales, ne mériterait qu’un petit sourire. Je crois que les penseurs africains auront toujours tort de vouloir confiner les réalités de leurs peuples dans les aléas géographiques des frontières insoucieuses de toute réalité culturelle ou économique des populations. Surtout, pas au moment où une nécessité pressante fait que même des frontières construites de façon progressive et reflétant une certaine logique historique sont en train de se fléchir au profit du contact des peuples plutôt que de poursuivre les rigidités nationalistes. La véritable Afrique est celle des peuples et non celle des états dessinés à la va-vite. Notre salut passera par le fait que les états finissent par le comprendre, et qu’ils arrêtent de céder au jeu dangereux qui est celui d’assister sans réagir à la mort des peuples (de leurs langues et cultures) quand ils ne l’accélèrent pas par diverses manipulations et mises en opposition génocidaires de leurs communautés constitutives. Ils ont tout intérêt à mettre l’accent sur ces ponts qui les relient de façon si profonde, et de mener des politiques de développement adaptées.La vocation de la Mauritanie, comme celle de tout état africain typique, n’est pas de se matérialiser en un terrain où une culture promue au sommet de l’état assimile -voire assassine – les autres. Il n’est pas question de requérir les mêmes traits culturels, linguistiques ou ‘transcriptifs’ pour garantir la paix dans un pays, surtout pas de le faire en sommant les défavorisés de l’état à rejoindre l’élu. Il est plutôt question d’admettre sa diversité et d’en faire une identité, une force ; d’accueillir l’éventail culturel, linguistique et historique ; d’incuber ces imaginaires dans le plus profond des programmes éducatifs et culturels pour espérer cueillir des créativités diverses. Cela nécessite une dimension dans nos réflexions qui va au-delà des frontières et qui permet de renouer avec notre trajectoire historique authentique.
DEVOIR DE MÉMOIRE ET REFUS DE L’OUBLI.
TÉMOIGNAGE
Exécutions, déportations et répressions au Guidimakha (sud de la Mauritanie) de 1989 /1990 : Peut-on les oublier nos victimes ?
Au cours de nos recherches de mémoire de maitrise (1997 ) intitulé (Les Peulh du Guidimakha,réparation et organisation sociale),nous avons enquêté sur les noms des personnes victimes (mortes,rescapées et déportées) lors des événements de 19 89 /90 dans la wilaya du Guidimakha.
Nous mettons à la disposition des lecteurs et tous ceuxquise sentent intéressés par cette question, qui un jour sera utile pour mettre de la lumière sur des cas qu’a connu cette région .Voire même pour contrebuter à la résolution du dossier du passif humanitaire, qui pour nous est loin être réglé.
Dans un premier temps, nous avons établi la liste des personnes civiles mortes suite aux tortures soit de l’armée soit de certains éléments de la garde nationale, de la police, et même d’une milice organisée par le gouverneur du Guidimakha à l’époque. Nous devons certaines informations aux rescapés qui sont encore en vie malgré les humiliations subies pendant cette période lourde de séquelles et de conséquences.
Dans un second temps, nous avons établi la liste de ces derniers et en fin celle des familles, personnes expatriées de la ville de Sélibaby et en fin la liste des villages déguerpis au cours de même période de tragédie dans notre histoire. Cependant nous tenons à préciser que d’autres cas existent dans cette wilaya.
A. /les exécutions
Dans la commune de Gouraye, plus précisément dans la localité de Boroudji, pendant la tabaski de 1989 sont arrêtés et tués par des militaires basés à Diaguilly les nommés :
1/ Killé Samba Ba
2/ Samba Diouldé touré
3/ Samba Yero Barry
Ces trois personnes sont enterrées dans une fosse commune entre Diaguilly et Moullisimo dans la même commune. Nous avons recueilli ces informations auprès d’Alassane kalidou Saoqui réside à Boroudji (rescapé de cette arrestation) et N’Dama Demba Sao qui était berger à Diaguilly, grâce à qui a d’ailleurs la fosse a été retrouvée. Toutes les 4 (les 3 tués et le rescapé) étaient allés vendre leurs bœufs pour les préparatifs de la tabaski.
A Moudji,dans la même commune ,le dimanche12 Ramadan1990 sont arrêtés et tués par un groupe d’hommes composé d’ éléments de la garde nationale, de la gendarmerie ,de la police et même des civils qui avaient comme prétexte la vérification des pièces d’identité.Il s’agit de
1/ Abdoulaye Galo Ba
2/ silly loumé
3/ Baillo M’bourel Ba
4/ Deya Sankoulé
5/ Boubou Mamadou Diallo
6/ Demba Sall de wendou Goubé
7/ Saidou Moussa Sow de Moudji
8/ Samba Barry
Nous devons cette information à Diallo Mamoudou Sinthiou (rescapé). Dans cette même commune toujours, le vendredi 1ér jour de la fête de Korité ( 1990) sont arrêtés pour ne plus être revus à feytas les nommés :
1/ Souleymane N’donguel Sow
2/ Souleymane Gory Sow (élève coranique)
3/ Boulo Sow
Nous devons cette information à Abou Hamady Sow (rescapé).
Jeudi, 24 Ramadan19 90 dans la commune de Sélibaby,dans la localité de woyndouyol (campement situé à 3 km de sélibaby>) sont tués:
1/ Harouna Ousmane Diallo
2/ Adama Oumar Diallo
3/ Galo Dieye Ba
4/ Yéro Hawa Dia
5/ Séyel M’Baye Ba
6/ Koudel Diallo
7/ Adama Bocar Ba
Ces 7 personnes sont enterrées dans une fosse commune près de Tomiyatt dans la commune de Souvi.
Sont rescapés:
– Harouna Omar diallo
– Yéro Samba yéro sow
– yéro M’Beri sy
– Doulo Dialo
– Moussa Douré
Ces informations nous ont été données par les rescapés.
Le 27 du mois de ramadan 19 90, ce fut le tour de Amadou Dadiouguel Diallo et de Moussa Ciré, Demba Mody Ba de disparaître
Le 28 du même mois Samba Kolo Ba(un mineur) est tué par prés de >Hamdallahi de la commune de >Hassi Cheggar.
Le 1ér jour de la fête de korité de la même année, Bala Sow est tué lui aussi à Bafou à quelques kilomètres de la ville de Sélibaby, ses vaches sont retrouvées 3jours après dans une clôture à soufi, chef lieu de la commune.
Dans la commune de wompou, meurent suite aux tortures des militaires : Mamadou Demba M’Baye et Samba Habi Ba de Diarrebé. La responsabilité de ces exactions est attribuée à ceux qui commandaient l’unité de l’armée basée à Tagou Talla avaient réclamé 20 beoufs pour les libérer. Le commandement de l’unité basée à Lougueré Poli Bodhedji est cité parmi les auteurs des ces crimes. Ces informations sont de Demba M’Baye, père des deux victimes, qui d’ailleurs a été emprisonné à >Nouakchott en même temps que Demba Rédou Deh et Samba Guessel Deh,Yaya Bocar sall (militaire) et Mamadou Gambi.
C’est par écrit n;535 PAG/CSJ du 7/6/90 et celui du 492/PAG:CSJ/ du 01/8/91 de l’avocat Général auprès de la cour spéciale de justice au ministère du Développement Rural que Demba M’Baye a été libéré. Pendant cette période, plusieurs personnes arrêtées au commissariat de police de Sélibaby la brigade de la gendarmerie, au camp de la 10ème région ont été déclarées mortes. Parmi elles, on peut citer : Yaya Tall, Dia Abdoul Modi Demba Diogoré Sow Abdoulaye Demba Rédou, Ifra Mamadou Samba Deh Samba Tibillé, Issa Mamadou Ifra Ba, Samba Modiel Ba et N’Gadiary leelé.
Dans la commune de khabou également étaient tués : Moussa Boubou de Touroula, Sadio, M’Baré tué entre Coumba Ndao et Touroula, YeroAlioun Sow tué et attaché derrière une voiture à khabou et Mamadou Coumba Sow, bucheron parti à ma recherche de bois.
A cette liste s’ajoute Hamadi Kibbo Diallo, tué à Goudiawol par un certain Brahim Salaye de la tribu d’oulad Béri accompagné de Zouber pendant que Saidou Abdoulaye Dia a été tué à windé Gniby dans la commune d’Arr.
Samba Racine Ba, un malade mental disparu a été retrouvé mort au cours de cette période aussi.
Hamady Sambel sow , Hamady Saidou sow, Ifra Bailo kanté qui étaient allés présenter leurs condoléances à Doumolly suite à la tuerie de Sambayel Niaka sow par Toumony et Med ould khay ont été déclarés morts. Les assassins de Sambayel Niaka ont été arrêtés grâce à Bamba ould Ely Maouloud, chef de tribu Tajounit.
En octobre 89, Ba Hadiya, directeur de l’école de Kalinioro de la commune de Boully a été tué à bout portant par un garde alors qu’il était venu s’enquérir des nouvelles de son neveu qui était à la recherche de ses vaches et arrêté par l’unité du garde assassin.
Dans le même village Djiby Samba, berger de profession a été assassiné à coups de bâtons par des hommes de la tribu de Hel mbarek alors qu’il rentrait de voyage du Mali.
Dans la localité de Mouta alla, 27 personnes ont été ramassées dans leur village et embarquées par une patouille militaire pour une destination inconnue. Selon Galo Penda Diam So ya de Seye Sidi (moughataa de Mbout) une femme et sa fille faisant partie de ce groupe de disparus ont été vues par lui même à Oualata et qu’il était prêt à témoigner à quelque niveau que cela soit. La commission interministérielle qui était chargée du dossier des refugiés, lors de sa visite à Sélibaby a été saisie pour cas. Mais en vain.
A Nébiya (commune de ould yengé),Adama N’Diaye et sa famille dont une femme qui venait d’accoucher ont été embarqués pour ne plus être revu et ses animaux emportés ,une seule vache a pu s’échapper pour venir se réfugier dans la localité de Boujoubayé. A cette liste s’ajoute Samba Modiel Ba de Dioubayé.
B/Rescapés des Tueries et Tortures
1/ Alassane kalidou sao de Borouji
2/ Demba Rédou Deh de sounatou
3/ Samba Guessel Deh de sonatou
3/ Yaya Bocar Sall de Sélibaby
Demba M’baye de Diarébé
4/ Samba galo Ba de sélibaby
5/ Sadio Alel Diallo de sélibaby
5/ Abou Hamady sow de sélibaby
6/ Mamoudou Sinthiou D iallo de kitan
7/ Yero Samba yero de woydouyol
8/ yéro M bery sy de woydouyol
9/ Moussa Douré de woydouyol
10/ DouréDIalo de woydouyol
11/ IssaSamba Ba de woydouyol
12/ Alassane Samba yero Deh
13/ Samba Galayel BA
14/ Samba Dopperé Ba
15/ Niaka Birass Dia
16/ Kane Amadou Demba
17/ Kibo Diallo
18/ Alasane Adel sow
19/ Moudou yero Nialé sow
20/ Demba Doudou Dialla
21/ Demba Hamady Deh
22/ Abou Galoyel Ba
Les 11, derniers ont été arrêtés dans le mois de septembre 89 dans un petit campement situé à l’est de Daffort lors que des vaches enlevées aux peulh dans le département de sélibaby et confiées à des maures de Doubaly par Tourad, juge d’instruction à sélibaby ont été razziées.
Après 4 jours de Tortures à Awoitawal, ils ont été envoyés à la brigade de gendarmerie de ould yengé pour 11 jours avant d’être envoyer à Sélibaby où ils sont restés pendant 9 mois et 13 jours en prison. Notons au passage que pendant leur séjour en prison, ils ont été obligés de signer le remboursement de ces vaches à hauteur de 6 vaches par individu soit au total 66 vaches pour être libérer.
C//les familles déportées de sélibaby et villages déguerpis:
– Famille de Sy Hamodine instituteur
– Famille de Hada Diallo, employé à la direction régionale de l’enseignement fondamental du Guidimakha
– Famille de Dia Adama Karou,instituteur
– Famille de Ba Mamadou Boye
– Famille de sow AMADOU,prof
– Famille de Boubou Guenguel
– Famille de Séga soumaré
– Famille d’ifra soumaré
– Famille de Belle soumaré
– Famille de Diallo Harouna tero
– Famille de Bambado camara
– Famille de Demba samba woury
– Famille de Y aya tall
– Famille de Bocar Hamady sall
– Famille de Sow Demba Malal
– Famille de yero Datt
– Famille de Mamadou TALL
– Famille de Malik Diagne Ba
– Famille de Sadio woury
– Famille d’Ismaila Sall
Et quelques personnes dont :
– Ba El Housseinou Bocar
– Hamady Maro sarré
– Belal AW, prof
– Diallo Kalidou yero Salam
– Ndim Mamadou.
Quant aux villages et /ou campements qui déguerpis on note:
Dans le département d’ould yengé:
– Gourel seydi Tabara – Mouta alla – Takadé Thierno Samba – Ould jiddou guanguébé et ould Jiddou foulabé – Goupou mbondi louboyré(revenu en 93)
Dans de Sélibaby on note aussi:
– loobiya
– kajel pobbi
– bafou
– talabé
– Gourel adama
– Sounatou
Pour finir, nous avons fait ce travail pour que l’opinion nationale et internationale sache que règlement du passif humanitaire est autre chose qu’une simple prière ou indemnisation de certains victimes. Les douloureux événements de 1989 et 91 qui ont secoué notre pays et menacé notre cohésion sociale peuvent pas être oubliés que quand il y a reconnaissance des torts et autres concernés que ceux indemnisés par l’auto proclamé président des pauvres alors qu’il les ignore. Nous espérons toute fois que justice sera rendue un jour à l’ayant droit et que l’impunité cessera dans ce pays pour consolider notre unité nationale.
Nous nous engageons à mettre à la disposition de tous ceux intéressés par ces cas la liste des tortionnaires et/ou de personnes ayant contribué à cela.
Signé Amadou Bocar Ba
M. Messaoud Boulkheir, président de l’Alliance Populaire Progressiste (APP) et du Conseil Economique, Social et Environnemental : ‘’Le pays a besoin d’un Guide qui comprend plus et mieux que quiconque que l’heure n’est plus celle des atermoiements…’’
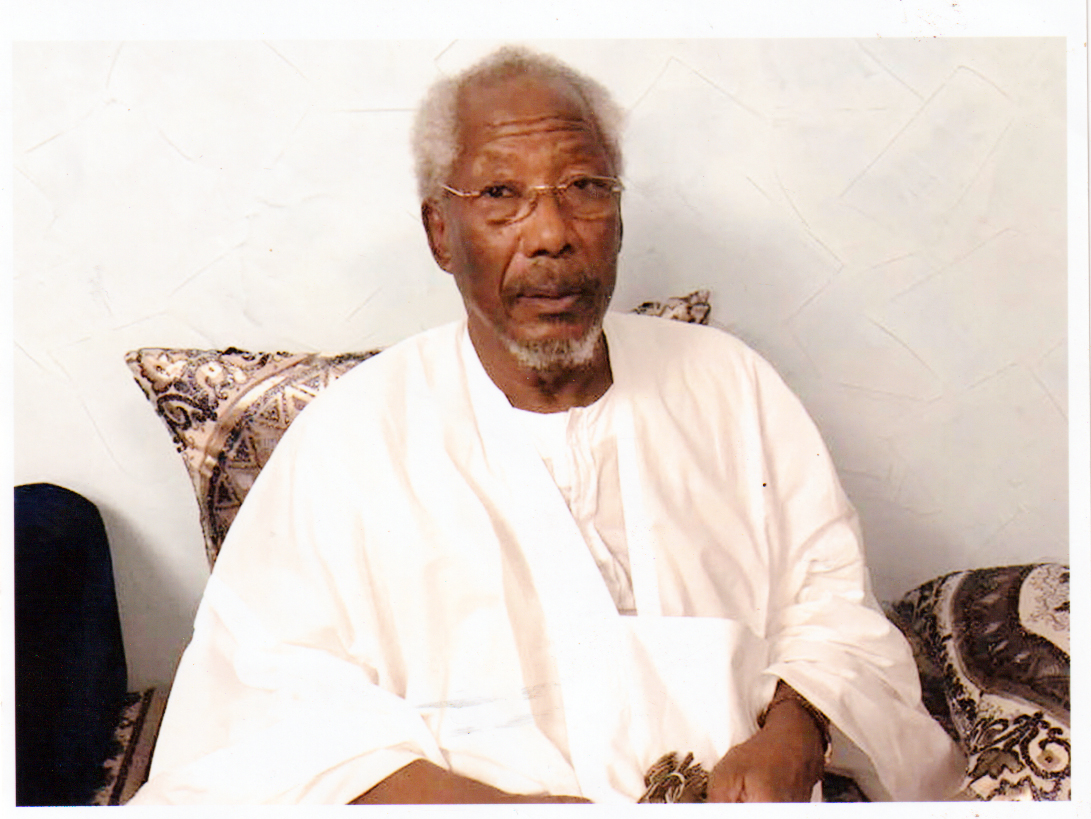
Le Calame : Depuis quelques jours, la conférence de presse de certains partis politiques de l’opposition et coalitions et fait couler beaucoup d’encre et de salive. Certains vous accusent d’avoir été très critique vis-à-vis du régime d’Ould Ghazwani à qui vous avez demandé de démissionner dans la mesure où il n’est pas disposé à « affronter les problèmes du pays ». Que lui reprochez-vous après deux ans de règne ?
Messaoud Boulkheir : Je n’ai pas été très critique mais seulement critique « en disant ouvertement ce que chacun pense intimement »
Un Président est surtout élu pour affronter et résoudre, autant que faire se peut, les problèmes, tous les problèmes de son pays et non pas pour les éviter par crainte de ne pas être en mesure de les résoudre ; or ne pas arriver à les résoudre sera toujours moins grave que de ne rien tenter pour y parvenir. Demander à un Président de démissionner est le slogan le plus usité à travers le Monde et de surcroît le plus civilisé. Il n’a aucun sens péjoratif. Quand un Président investi de presque tous les pouvoirs (même assez souvent de ceux dévolus aux autres Institutions) doute de ses capacités d’assumer ses lourdes charges, il doit au moins oser démissionner.
Quant aux raisons qui m’ont appelé à donner ce conseil, c’est que si le Pouvoir Exécutif, celui-là même duquel tout un chacun attend le plus et le mieux, préfère ne voir en les tourments que vit son pays et que subissent les citoyens qu’une affaire qui concerne au premier chef les Députés et les Juges, c’est qu’il veut s’en laver les mains à l’exemple de Ponce Pilate plus de deux millénaires avant lui.
C’est ce qui explique qu’après une décennie d’un pouvoir personnalisé à l’extrême et deux ans après que lui-même l’eût remplacé, rien ou très peu semble avoir été fait pour s’en démarquer au moins.
Pas en tout cas du point de vue de la méthodologie comme par exemple : Dresser un état des Lieux ou AUDIT au moins en ce qui concerne certains secteurs clés : les Institutions de la République (Présidence, Assemblée Nationale, Justice, Armée), l’Unité nationale et comment Vivre Ensemble, les Droits Humains, les Rapports sociaux et sociétaux, l’Enseignement, la Santé, l’Emploi, la Démocratie, les Problèmes Economiques (le Domaine Public, les Approvisionnements, la Banque Centrale, la Monnaie, la Pêche, les Mines, l’Energie, le Pétrole, l’Agriculture, les Infrastructures, etc…)
Je n’ai jamais prétendu que les choses étaient ou seraient faciles, bien au contraire, et c’est la raison pour laquelle le pays a besoin d’un Guide qui prend le taureau par les cornes car il est censé comprendre plus et mieux que quiconque que l’heure n’est plus celle des atermoiements…
-Au lendemain de la conférence de presse des partis politiques, le président de la République a convié les partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale à une réunion sur les concertations qu’il pourrait lancer sous peu. Et selon nos sources, vous avez été sollicité, comme le président de Tawassoul par le président de l’UPR, mais vous avez décliné l’offre. Pouvez-vous nous dire les raisons ?
-Ce n’est en tout cas pas par mépris, ou manque d’intérêt, mais tout simplement par logique et par habitude. J’ai l’habitude d’assumer mes choix et m’étant montré hier seulement dans une position, je ne pouvais accepter de me montrer le lendemain dans une autre… sans aucun préalable.
-Lors de votre prise de parole, vous avez déclaré que Ghazwani n’a pas fait mieux que son prédécesseur, Ould Abdel Aziz. Qu’attendiez-vous de celui à qui vous aviez apporté votre soutien pendant la présidentielle de 2019 ? Avec cette déclaration, le président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) que vous êtes ne craint-il pas, comme beaucoup de perdre son poste ? Pour marquer votre mécontentement, certains pensent que vous devriez démissionner de votre poste de président du CESE. Qu’en pensez-vous ?
–J’attendais un minimum qui aille dans le sens de tout ou partie de ce que j’ai évoqué en réponse à la première question.
Pourquoi devrais-je démissionner d’une fonction qui accrédite, plus que les mots, ma bonne foi et ma sincérité, au cas où certains, sûrement très nombreux, seraient opportunément portés à en douter ? Par contre si le Pouvoir considère qu’il faut me la retirer, je comprendrais tout à fait.
-Le dialogue politique auquel vous appelez devrait permettre de trouver des solutions aux problèmes d’exclusion des Haratines et des négro-africains de tous les secteurs économiques, de l’armée et des corps de sécurité, de l’esclavage ou de ses séquelles, du passif humanitaire, des langues nationales Pulaar, Soniké et Ouolof et de l’état-civil, en somme, la question du vivre ensemble. Pourquoi, à votre avis, le président Ghazwani ne s’est pas attaqué à ces questions cruciales alors qu’il s’était engagé, lors de sa déclaration de candidature le 1er mars 2019 à rétablir toutes les victimes d’injustice dans leur droit ? A quoi servirait un dialogue qui ne débattrait pas de ses questions ?
-En ce qui concerne tous les signataires du Communiqué ou de la Déclaration lu(e) en début de la Conférence de Presse, le Dialogue est la seule véritable porte de sortie des crises multidimensionnelles qui inquiètent les populations. La plus grave d’entre toutes est celle relative à l’Unité nationale dont dépendra l’avenir du pays. Il faut une relecture de notre Constitution pour définir ensemble et une fois pour toutes comment assurer notre VIVRE ENSEMBLE.
Une fois cette étape franchie, tout le reste deviendra facile.
-Après votre conférence de presse, on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir si votre front prendra part aux « concertations » dont parle le président ? Au cours de la conférence de presse, vous avez laissé entendre que « c’est le dialogue ou rien »? Qu’est-ce qui pourrait vous amener à réviser votre position ? La réactualisation de l’ancienne feuille de route conçue entre opposition et majorité représentés à l’Assemblée Nationale ou un autre geste ?
-Par Dialogue, nous entendons des discussions claires entre concitoyens et patriotes conscients de leur diversité, de leurs différences, de leurs particularités mais soucieux de leur complémentarité et véritablement désireux de vivre ensemble sur des bases de Liberté, d’Egalité, de Justice, de Démocratie, de Solidarité et de Partage. Il va sans dire que cet Idéal, pour être atteint, implique que les débats ne doivent éluder aucune question, que tous les débatteurs soient les bienvenus, que les résultats des discussions soient consensuels et qu’ils aient obligatoirement force de Loi (Constitutionnelle ou Organique.)
Je pense que ceci, décliné sous quelque forme ou vocable que ce soit nous engagera certainement.
-Votre conférence de presse intervient au moment où l’opinion se demandait où était passée l’opposition depuis l’élection du président Ghazwani. Peut-on considérer désormais qu’elle est sortie de sa torpeur, qu’elle va se réorganiser et mettre fin à la longue période de grâce du président Ghazwani ? Allez-vous reprendre langue avec le RFD, l’UFP et SAWAB par exemple ?
-Les développements futurs apporteront certainement des réponses à ces questions que vous posez.
-Que vous inspire le retrait du parti RAG de la coalition, aussitôt après la conférence de presse ?
-Cela ne m’a inspiré ni plus ni moins que ce que m’avait inspiré sa position d’avant.
-Lors de sa campagne présidentielle, le candidat Ghazwani avait promis de lutter contre la gabegie. On a vu la création de la commission d’enquête parlementaire (CEP) sur la décennie d’Ould Abdel Aziz inculpé et placé en détention préventive depuis quelques mois déjà. Durant les deux ans, la gabegie a-t-elle reculé ? Pensez-vous qu’Ould Abdel Aziz pourrait bénéficier d’un jugement équitable ?
-N’ayant à son arrivée enregistré aucun paramètre permettant au profane que je suis de bénéficier d’une base d’évaluation crédible par rapport à laquelle comparer, je me contenterai de dire que s’il y a eu des améliorations, elles sont très peu visibles et encore moins sensibles mises à part les déclamations habituelles, mais là on est plus dans la ressemblance que dans la divergence.
Je souhaite à tout justiciable de bénéficier d’un jugement équitable et si Ould Abdel Aziz devait être le premier à en bénéficier, il doit se considérer comme le plus heureux des Mauritaniens et tous les Mauritaniens y verraient le seul véritable Changement intervenu après lui.
-Les partis politiques, majorité et opposition réunies reconnaissent tous qu’il ya des problèmes de l’unité nationale et de la cohésion sociale. Qu’est-ce qui, à votre avis les empêchent de trouver la solution ? Jusqu’à quand les communautés noires continueront-elles à se plaindre de leur « exclusion » ? La dernière présidentielle a laissé apparaître des candidatures dites « communautaires ». Avez-vous le sentiment que la composante arabe est suffisamment « sensible » à ces plaintes répétées ?
-Très sincèrement je pense qu’en abordant le problème du Vivre ensemble des communautés nationales, il ne faut pas impliquer ces dernières au point de les confondre tant avec ceux qui se croient investis de poser les problèmes en leur noms qu’avec les décideurs politiques qui pensent agir en notre nom à tous.
Les seuls responsables sont ceux qui détiennent le Pouvoir et leur perception de l’usage qu’il faut en faire : Est-ce qu’ils doivent l’exercer dans l’intérêt du grand ensemble ou simplement dans l’intérêt personnel ou à la rigueur du petit ensemble. C’est en cela que se distinguent les Hommes d’Etat des autres… et ce sont ces Hommes d’Etat que le Pays peine à « géniter » depuis plus de soixante ans…et que certains réclament de plus en plus fortement… y compris par les candidatures communautaires.
-Vous avez toujours été partisan du dialogue politique en Mauritanie pour dites-vous défendre l’intérêt de la Mauritanie. Vous vous êtes investis pour l’organisation de deux dialogues sous Ould Abdel Aziz dont certains ont pondu d’importantes recommandations mais restées hélas sans suite. Est-ce à dire que lesdits dialogues n’ont pas été à la hauteur de vos attentes ? En quoi celui auquel vous appelez de vos vœux aujourd’hui pourrait-il être plus constructif que les précédents ?
-Quoiqu’on puisse en dire, les Dialogues organisés sous le régime précédent ont permis certaines avancées majeures qui ne sont pas que théoriques sur le plan des Institutions, de la démocratie, des élections, de la proportionnelle, du Genre, du nomadisme politique, des candidatures indépendantes, de l’esclavage, du Droit à la différence, des coups d’Etat et même du 3ème mandat.
Que certains de ces acquis aient été contournés ou qu’ils aient déçu les attentes, ne diminue en rien leur importance. La vie est ainsi faite qu’il faut oser, échouer, recommencer, jusqu’à la perfection…
-Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d’avoir toujours soutenu Ould Abdel Aziz alors que son régime était gabegique et qu’il excluait les noirs de ce pays?
-Ne me faites pas perdre mon temps par des réponses à des questions qui ne méritent pas qu’on s’y arrête. Ces accusations ne concernent que ceux qui les avancent.
-Le président du parti pour la défense de l’environnement, M. Dellahi a dénoncé l’usage de la langue arabe pour « bloquer » les négro-africains lors des examens, concours et recrutements nationaux. Partagez-vous son avis ?
-C’est certainement un des aspects qui renforce ce sentiment de frustration, d’exclusion et de discrimination chez cette Communauté.
-L’Agence TAAZOUR a pour mission d’œuvrer pour la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion. Pensez-vous qu’elle accomplit cette mission ? Avez-vous le sentiment que « les personnes cibles » profitent des milliards qu’elle investit depuis quelques années ?
-Pas plus que ne l’a accomplie TADAMOUNE avant elle et à laquelle on n’a demandé aucun compte ni dressé aucun bilan. Ce ne sont que des officines au service de ceux qui les créent et de ceux qui les dirigent pour en faire tout ce qu’ils veulent, sauf ce pourquoi et pour qui elles ont vu le jour.
Propos recueillis par Dalay Lam
le calame
Dialogue/Unité nationale : Va-t-on dépassionner le débat ?

Que pourraient apporter à la Mauritanie les concertations actuellement en gestation entre les acteurs politiques ? C’est la question qui taraude ceux-ci, les observateurs et, dans une certaine mesure, les partenaires techniques et financiers, soucieux de stabilité pour leurs investissements. Ce n’est un secret pour personne qu’un certain « malaise », pour ne pas dire méfiance, sévit entre les différentes communautés du pays« Les Mauritaniens ne vivent plus ensemble », a-t-on même entendu dire, « mais côte-à-côte ». La situation est donc sérieuse et il faut en prendre toute la mesure. Cela fait des années que la question de l’unité nationale et de la cohésion sociale est rabâchée par les partis politiques et les acteurs de la Société civile. Des termes très « bateaux » dont on se demande si ces acteurs et l’État – qui en est le premier responsable…– se mettront d’accord sur le contenu et les solutions, tant sensiblement divergent les intérêts des uns et des autres. Déjà deux manifestes pour plus de droits politiques, économiques et sociaux ont été publiés : l’un en 1986, par les cadres négro-africains, et l’autre en 2014, par leurs homologues haratines ; tous dénonçant un racisme d’État qui les exclut, dans les faits, de tous les leviers politiques, économiques, sociaux, militaires, sécuritaires et autres…
Des frustrations qu’ils accumulent depuis des années. La dernière présidentielle de 2019 est venue accentuer le fossé entre les communautés. La question du « Vivre ensemble » fut l’un des thèmes centraux de la campagne électorale. Un long chemin dont les partis politiques à leadership négro-africain se sont chargés de rappeler quelques dates douloureuses. Notamment les évènements de 1986 à 1990, avec la déportation de milliers des leurs vers le Sénégal et le Mali et les exécutions extrajudiciaires dans les casernes des forces de défense et de sécurité. Les mouvements négro-africains parleront d’une « épuration ethnique » perpétrée par Ould Taya et dénonceront la loi d’amnistie de 1993 visant à protéger les présumés auteurs ou commanditaires de ces crimes. Sous ould Abdel Aziz, la marginalisation s’est renforcée, donnant l’impression à nombre de citoyens noirs d’« être étrangers en leur propre pays », comme s’en plaindront certains, constatant des « nominations à caractères mono-ethniques, des écoles réservées à certaines catégories de citoyens, le tribalisme et le clientélisme ». Au plan politique, on ressent comme une Mauritanie coupée en deux : riches, les uns seraient tous blancs, les autres tous noirs et pauvres. La topographie de certains quartiers de la capitale illustre cette dichotomie, excessivement manichéenne sans doute mais cependant expressive d’une indéniable généralité.
Toutes ces questions sont aujourd’hui d’actualité. Les victimes et rescapés des événements de 86-90 continuent à dénoncer le refus de l’État de leur apporter des solutions idoines. La loi d’amnistie de 93 qui fut adoptée avec un pressing manifeste de hauts cadres de l’État reste en vigueur et, rangé depuis sous le vocable « Passif humanitaire », tout ce dossier se voit ignoré sinon étouffé par nombre de maures. Avec la « Prière de Kaédi », Ould Abdel Aziz déclarant l’avoir réglé et clos, complicité de quelques rescapés militaires et veuves aidant.
Les journées de concertations pendant la transition 2005-2007 et les divers dialogues politiques sous Ould Abdel Aziz n’ont pas réussi à soigner les nombreuses plaies sur le chemin de l’unité nationale où la question de l’esclavage et/ou de ses séquelles dont sont particulièrement victimes les Haratines double la question raciale d’une dimension statutaire touchant toutes les communautés. Ici, malgré l’adoption d’une loi criminalisant cette pratique et ses conséquences, les organisations de défense des droits de l’Homme ne cessent d’épingler et de dénoncer des cas flagrants dont le dernier aura été celui de Ouadane, en Adrar. Les institutions mises sur pied pour sortir de leur dépendance économique et de leur pauvreté les anciens esclaves ainsi que leurs homologues« libérés » ou tout simplement désireux de sortir de la servilité, ne sont trop souvent que des structures« cosmétiques »à seule fin de plaire aux bailleurs et organismes internationaux. Les milliards mobilisés à cet égard sont en grande partie dépensés au profit de gros bonnets et de leurs fonctionnaires complices.
École et langues nationales
Voilà l’essentiel de ce qu’on appelle la « question nationale » ou « dossier de l’unité nationale ».Mais son soubassement tient à celui de l’école. Les Négro-mauritaniens dénoncent l’utilisation de la langue arabe – « langue nationale et officielle » – pour les empêcher d’émerger. Et de réclamer en conséquence l’officialisation et l’introduction des langues pulaar, soninké et wolof dans le système éducatif pour, d’une part, renforcer l’unité nationale et la cohésion sociale, et donner, d’autre part, les mêmes chances à tous les enfants du pays. Une expérience concluante fut menée dans les années 80, avant de se voir prestement étouffée quand il s’est agi de passer à sa généralisation. Des extrémistes qui avaient fini de phagocyter le pouvoir renversèrent le gouvernement militaire d’Ould Haïdalla et réduisirent l’Institut des Langues Nationales (ILN) à une coquille vide. L’école républicaine annoncée par le président Ghazwani lui redonnera-t-il vie ? Rattaché au Département des langues de l’Université de Nouakchott, il attend son heure…
Haro sur l’exclusion !
La « question nationale » a pris aujourd’hui une telle ampleur que même certains partis politiques jusque-là taxés d’extrémistes pour avoir refusé de dénoncer les injustices dont sont victimes les Noirs de Mauritanie s’en sont emparés. Il aura fallu que le défunt président de la République Sidi ould Cheikh Abdallahi décide d’amorcer le rapatriement des déportés au Sénégal et rencontre des mouvements négro-africains qualifiés, eux aussi, d’ultras, pour que leurs antagonistes s’engagent à déstabiliser son régime. 8 Août 2008. Face à une opposition déterminée à lui barrer le chemin, le général Ould Abdel Aziz s’attache les services de plusieurs de ses frères d’armes et autres opportunistes politiques pour rallier le vote des gens. Il organise la « prière de Kaédi » le 25 Mars 2009 et décrète une « Journée nationale de réconciliation » qui va, de fait, s’attacher surtout à diviser les organisations des victimes et rescapés militaires, au lieu de panser véritablement les plaies. Tout au long de la décennie qui suit, les partis politiques à leadership négro-africain donnent de la voix et élèvent, dans l’Hémicycle, la dénonciation de la marginalisation de leurs communautés, avec les députés Ibrahima Sarr, Thiam Ousmane et Sawdatou Wane. Ils sont soutenus par divers autres, à l’instar de l’UFP, avec Kadiata Malick Diallo et Moustapha Bedredine, ou du RFD, avec Kane Hamidou Baba… De retour au pays, les FLAM – qui deviendront FPC, parti toujours non reconnu à ce jour – pourfendent « l’exclusion des Négro-mauritaniens et des Haratines »,à l’instar de l’IRA de Biram Dah Abeïd et d’autres organisations comme SOS Esclaves, AFCF ou le FONADH… Un front commun contre le « beïdanisme » semble ainsi se former.
Face à ces critiques et à la réaction de la Communauté internationale, l’UPR, le parti au pouvoir, et ses soutiens de la majorité présidentielle apportent la réplique. Dans les dialogues organisés avec divers partis de l’opposition, colloques et séminaires, les questions de l’unité nationale et du passif humanitaire ne sont plus sujets tabous. Tout le monde prétend s’en préoccuper… mais sans jamais y apporter de véritables solutions. Aujourd’hui et malgré la présence en son sein de plusieurs « nationalistes », l’UPR semble aborder ces problèmes avec moins de passion. Lors d’un atelier consacré au renforcement de l’unité nationale et à l’éradication des « séquelles » de l’esclavage, l’un de ses vice-présidents a défendu la recherche d’un consensus autour d’une plate-forme de convergence entre tous les acteurs politiques sur la question nationale, parce qu’« on ne peut plus », fait-il remarquer, « continuer à tirer, chacun de son côté, la couverture à soi » : le risque de la déchirer a trop grandi. Cette plate-forme doit permettre de répertorier tous les problèmes du pays en vue d’en débattre sans passion et sans parti pris.
Mais certains malins esprits s’entêtent à juger extrémiste, voire ennemi de la Nation, tout celui qui dénonce les injustices et les exclusions. On se rappelle des réprobations qu’avait suscitées le discours de Balas lors de l’ouverture du dernier dialogue politique au Palais des congrès. Le président du parti Arc-en-Ciel y évoquait le calvaire subi par les Négro-africains pendant les années de braises 89-91 ; se sentant morveux, certains boutefeux tentèrent de couvrir son discours par un vacarme hostile et Ould Abdel Aziz dut intervenir en leur demandant fermement de le laisser continuer. On se souvient également de l’ire suscitée par les propos du président Biram Dah Abeïd affirmant la réalité de l’apartheid en Mauritanie. Le fait est que les extrémistes de tous bords paraissent incapables de parler de l’unité nationale sans passionner le débat. Les uns nient jusqu’à même les évènements de 89-91 et l’exclusion dont sont victimes les Noirs du pays ; les autres mettent tous les Maures dans le même panier, oubliant l’audace de ceux qui dénoncèrent publiquement les exactions racistes commises par le régime d’Ould Taya. Le cas des jeunes du MDI dont beaucoup étaient pourtant des « fils-à-papa »fut salué par tous les patriotes. La vérité est qu’il y a beaucoup de compromis, en Mauritanie, entre blancs et noirs –c’est son histoire même – et c’est tous ensemble qu’il faut avoir le courage de dénoncer les injustices et rétablir les victimes dans leur droit. On ne doit pas régler le problème des uns pour en satisfaire d’autres. Tout comme il n’y a pas de problème sans solution, sitôt qu’on accepte d’en parler sans passion.
On en est encore loin. La réaction de certains partis et acteurs politiques aux déclarations du président Messaoud ould Boukheïr, le président d’APP, de Moctar Sidi Maouloud de Moustaqbel et d’Ould Dellahi du PMDE, lors de la conférence de presse des partis de l’opposition, laisse sceptique sur ce qui pourrait advenir des concertations annoncées. Tous dénonçaient l’exclusion dont sont victimes les Noirs du pays. Samba Thiam, le président des FPC, souhaitait dans la foulée que le dialogue en gestation ouvre à une refondation de la Mauritanie sur des bases saines et justes. Nul n’a compris pourquoi le président Ghazwani a balayé du revers de la main tout « dialogue » politique arguant de ce que « la Mauritanie ne connaît pas de crise ». Mais, en off, bon nombre de cadres, et d’élus de la majorité présidentielle vous avouent que la situation du pays ne peut pas continuer ainsi.
Avec l’engagement de l’UPR et des partis de l’opposition, peut-on espérer que les concertations dont on parle partout amènent les uns et les autres à une réelle convergence de vue sur le vivre ensemble en Mauritanie ? Et le président Ghazwani à faire avancer d’un grand pas cette question, clouant ainsi le bec à tous ceux qui l’accusent de faire quasiment la même chose que son prédécesseur ?
Feuille de route à actualiser
Les thèmes de la feuille de route sont pertinents : processus démocratique en vue de réformes constitutionnelles et législatives, renforcement de l’État de Droit, révision du système électoral, normalisation de la vie politique ; traitement des dossiers des droits nationaux en suspens en vue de l’unité nationale, éradication réelle de l’esclavage et de ses séquelles, mise en évidence des voies et mécanismes à même de consolider la cohésion sociale ; bonne gouvernance à travers la lutte contre la corruption, réforme de la justice, de l’administration et du Domaine, consolidation des réformes de l’enseignement, de la santé et de la décentralisation, formulation des processus garantissant au citoyen l’accès aux services publics, assainissement des marchés publics et renforcement, enfin, de la juste application de la loi sur la Fonction publique. Ce chapitre devra permettre aux femmes, aux jeunes et à la diaspora de participer à la vie politique et au développement du pays ; accompagner et renforcer la réforme des médias publics et la liberté de la presse ; développer la préservation de l’environnement, le traitement des impacts des changements climatiques et la protection des intérêts supérieurs du pays. Mais il reste à revoir certains points : si la question de l’esclavage et/ou de ses séquelles est bien explicitée dans la thématique de l’unité nationale, le passif humanitaire est absent du paragraphe. L’expression « dossiers des droits nationaux en suspens » demeure floue.
Dalay Lam
le calame
Le nouveau paradigme politico-sécuritaire en Afrique Par Seyid Ould Bah

Malgré les déclarations rassurantes des deux chefs des juntes qui ont accaparé le pouvoir au Mali et au Tchad, la candidature des chefs d’État militaires qui gèrent la conjoncture transitoire dans les deux pays sahéliens est plus que probable.
Bien que l’Union africaine a adopté depuis sa charte constitutive de 2000 un arsenal juridique dissuasif visant à prévenir et sanctionner les changements anticonstitutionnels des régimes politiques dans les États membres, sa position initiale, intransigeante, a fini par s’infléchir dans un sens réaliste et souple, quitte à entériner et accompagner les prises de pouvoir par la force dans des contextes spécifiques.
Les deux cas malien et tchadien en sont des exemples édifiants. Le coup d’État survenu à Bamako le 18 août 2020 s’est imposé comme l’unique possibilité pour délivrer le pays d’une crise politique aiguë. Il fut salué par l’ensemble de la classe politique et la société civile mobilisées depuis quelques mois dans une large révolte continue contre un régime corrompu et impotent, quoique issu d’élections pluralistes.
L’Union africaine, qui a condamné le putsch malien et suspendu le Mali de ses instances, a manifesté une ligne de conduite souple et complaisante vis-à-vis des nouvelles autorités militaires, même après l’évincement du président et du chef de gouvernement civils (mai 2021). La France et l’Union européenne ont emboîté le pas aux organismes africains en accordant la priorité aux impératifs sécuritaires sur les engagements démocratiques.
Cette même logique a prévalu au Tchad lors du décès du président Idriss DébyInto. L’Union africaine et la France ont supervisé le transfert du pouvoir au conseil militaire transitoire présidé par le général Mahamat Idriss Déby, qui était le dauphin déclaré de son père.
Schéma de légalisation incontournable
Si les deux juntes se sont engagées auprès de la communauté africaine et internationale à organiser des élections pluralistes libres et transparentes dans un délai limité convenu avec la classe politique impliquée dans l’ensemble du processus de la transition et qu’elles se sont engagées aussi à respecter le principe de non-éligibilité des autorités militaires dans les prochaines compétitions électorales, force est de constater que le schéma de légalisation des pouvoirs en place par les urnes devient de plus en plus incontournable.
Le colonel AssimiGoïta, chef de la junte malienne, n’a pas exclu l’éventualité d’une candidature à la prochaine élection présidentielle revendiquée par une large frange du champ politique malien. Les cercles militaires et sécuritaires influents dans les orientations diplomatiques internationales sont devenus de plus en plus convaincus que la guerre contre les mouvements terroristes et la défense de l’intégrité territoriale du Mali pourrait imposer le choix d’un chef d’État issu des rangs de l’institution armée.
Le même phénomène est perceptible à N’Djaména, où le général MahamatDéby prépare sereinement sa candidature à la magistrature suprême en enfreignant les dispositions réglementaires de l’Union africaine mais avec la complicité effective des partenaires internationaux du Tchad
La diplomatie de l’ingérence diplomatique en Afrique, symbolisée par le fameux discours du président français François Mitterrand au sommet afro-français de La Baule, le 20 juin 1990, a fait son temps.
Si le standard international de gouvernance qui s’applique aujourd’hui en Afrique implique nécessairement le formalisme pluraliste et le moment électoral, son impact réel sur la nature du régime politique est marginal dans les contextes où l’armée est l’acteur politique primordial. Il s’agit dans ces contextes de régimes militaires qui s’accommodent avec les critères de légalisation constitutionnelle et normative du pouvoir politique, sans grande incidence sur leur mode de fonctionnement.
Un grand diplomate africain rompu à la politique internationale a remarqué récemment que le paradigme sécuritaire a remplacé l’injonction démocratique en plaçant la lutte contre le radicalisme violent et les mouvements séparatistes au cœur même des agendas internationaux.
Les impératifs de stabilité et d’apaisement social prennent donc les dessus sur les demandes de libéralisation et d’ouverture démocratique. C’est ainsi que nous sommes ramenés au dilemme hégélien, à savoir le passage obligé par le «tyran fondateur» pour bâtir une nation libre. La liberté lui paraissait l’issue d’une dialectique sociale qui est amorcée par une totalité rigide et autoritaire qui s’identifie graduellement à la conscience civique de ses membres et finit ainsi par s’ouvrir et traduire la communauté universelle des citoyens de l’État.
SeyidOuld Bah est professeur de philosophie et sciences sociales à l’université de Nouakchott, Mauritanie, et chroniqueur dans plusieurs médias. Il est l’auteur de plusieurs livres de philosophie et pensée politique et stratégique.
Twitter: @seyidbah
NDLR: L’opinion exprimée dans cette page est propre à l’auteur et ne reflète pas nécessairement celle d’Arab News en français
le calame





